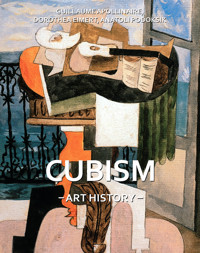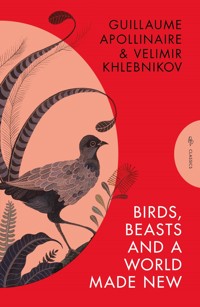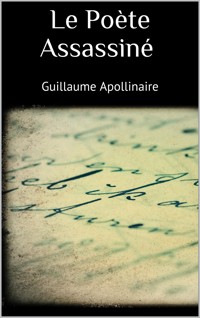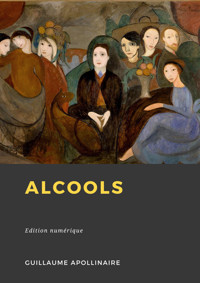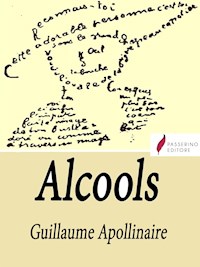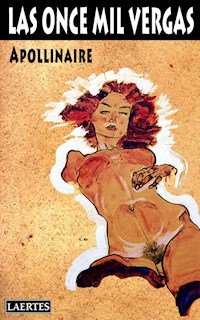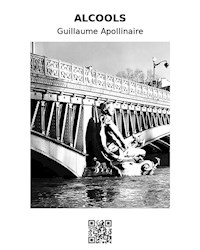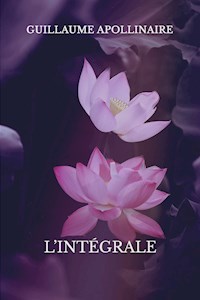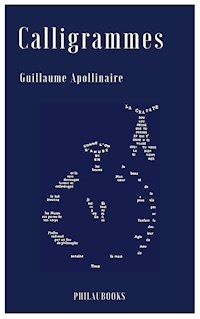Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GrandsClassiques.com
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Les vacances à la campagne changent un adolescent en homme.
POUR UN PUBLIC AVERTI. Roger est un jeune garçon en vacances dans la maison de campagne familiale. Il décrit ses fantasmes, ses premiers émois et la complaisance de la gent féminine à son égard. L'innocence de l'adolescent se dissipe rapidement et débute alors son apprentissage amoureux : il séduit les femmes et assouvit ses désirs. Commande d'un éditeur clandestin,
Les Exploits d'un jeune Don Juan est publié pour la première fois en 1911 sous une couverture muette. Initialement signé uniquement "G. A.", l'ouvrage est ensuite réimprimé plusieurs fois sous le nom de Guillaume Apollinaire.
Un récit érotique drôle et stimulant, plus léger que les autres romans du genre signés par Apollinaire.
EXTRAIT
Les jours d’été étaient revenus, ma mère s’était rendue à la campagne dans une propriété qui nous appartenait depuis peu.
Mon père était resté à la ville pour s’occuper de ses affaires. Il regrettait d’avoir acheté cette propriété sur les instances de ma mère :
— C’est toi qui as voulu cette maison de campagne, disait-il, vas-y si tu veux, mais ne me force pas à y aller. D’ailleurs, tu peux être certaine, ma chère Anna, que je vais la revendre dès que l’occasion s’en présentera.
— Mais mon ami, disait ma mère, tu ne peux pas te figurer comme l’air de la campagne fera du bien aux enfants…
— Ta, ta, ta, répliquait mon père, en consultant un agenda et en prenant son chapeau, je t’ai passé cette fantaisie, mais j’ai en tort.
Ma mère était donc partie à sa campagne, comme elle disait, dans l’intention de jouir le plus rapidement et le plus complètement possible de ce plaisir momentané.
Elle était accompagnée d’une sœur plus jeune qu’elle et encore à marier, d’une femme de chambre, de moi, son fils unique, et enfin d’une de mes sœurs plus âgée que moi d’un an. Nous arrivâmes tous joyeux à la maison de campagne que les gens du pays avaient surnommée le Château.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Guillaume Apollinaire (1880-1918) est un écrivain et grand poète du XXe siècle. Il participe aux révolutions littéraires et esthétiques de son époque, qui mèneront à la naissance de courants tels que le cubisme et le surréalisme, dont il fut le précurseur. Il est aussi connu pour sa pratique du calligramme, ces poèmes écrits en forme de dessins et non en strophes. Son héritage érotique comprend des recueils de poèmes (
Poésies Libres,
Poèmes à Lou) et quelques romans (
Les Onze Mille Verges,
Les Exploits d'un jeune Don Juan,
La Fin de Babylone).
À PROPOS DE LA COLLECTION
Retrouvez les plus grands noms de la littérature érotique dans notre collection
Grands classiques érotiques.
Autrefois poussés à la clandestinité et relégués dans « l'Enfer des bibliothèques », les auteurs de ces œuvres incontournables du genre sont aujourd'hui reconnus mondialement.
Du Marquis de Sade à Alphonse Momas et ses multiples pseudonymes, en passant par le lyrique Alfred de Musset ou la féministe Renée Dunan, les
Grands classiques érotiques proposent un catalogue complet et varié qui contentera tant les novices que les connaisseurs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 99
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
« Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées,La valeur n’attend pas le nombre des années. »(Corneille.)
1
Les jours d’été étaient revenus, ma mère s’était rendue à la campagne dans une propriété qui nous appartenait depuis peu.
Mon père était resté à la ville pour s’occuper de ses affaires. Il regrettait d’avoir acheté cette propriété sur les instances de ma mère :
— C’est toi qui as voulu cette maison de campagne, disait-il, vas-y si tu veux, mais ne me force pas à y aller. D’ailleurs, tu peux être certaine, ma chère Anna, que je vais la revendre dès que l’occasion s’en présentera.
— Mais mon ami, disait ma mère, tu ne peux pas te figurer comme l’air de la campagne fera du bien aux enfants…
— Ta, ta, ta, répliquait mon père, en consultant un agenda et en prenant son chapeau, je t’ai passé cette fantaisie, mais j’ai en tort.
Ma mère était donc partie à sa campagne, comme elle disait, dans l’intention de jouir le plus rapidement et le plus complètement possible de ce plaisir momentané.
Elle était accompagnée d’une sœur plus jeune qu’elle et encore à marier, d’une femme de chambre, de moi, son fils unique, et enfin d’une de mes sœurs plus âgée que moi d’un an.
Nous arrivâmes tous joyeux à la maison de campagne que les gens du pays avaient surnommée le Château.
Le Château était une vieille demeure de fermiers riches. Il datait, sans doute, du XVIIe siècle. À l’intérieur il y avait beaucoup de place, mais la disposition des pièces était si extraordinaire qu’en somme cette maison était plutôt incommode à habiter à cause des allées et venues qu’occasionnait ce désordre architectural. Les chambres n’étaient pas placées comme dans les maisons ordinaires, mais étaient séparées par une masse de couloirs obscurs, de corridors tortueux, d’escaliers en spirale. En un mot, c’était un véritable labyrinthe et il fallut plusieurs jours pour se reconnaître dans cette maison afin d’arriver à une notion exacte de la disposition des appartements.
Les communs où étaient la ferme avec les étables et les écuries étaient séparés du Château par une cour. Ces bâtiments étaient reliés par une chapelle dans laquelle on pouvait aussi bien entrer par la cour, que par le Château ou les communs.
Cette chapelle était en bon état. Elle était autrefois desservie par un religieux qui habitait le Château et s’occupait aussi du soin des âmes des habitants du petit hameau qui était éparpillé autour de notre demeure.
Mais depuis la mort du dernier chapelain on n’avait pas remplacé ce religieux et seulement chaque dimanche et chaque jour de fête, parfois aussi pendant la semaine pour entendre les confessions, un capucin du couvent voisin venait dire dans la chapelle les offices indispensables au salut des bons paysans.
Lorsque ce moine venait, il restait toujours pour dîner et on lui avait préparé une chambre près de la chapelle, pour le cas où il dût coucher là.
Ma mère, ma tante et la femme de chambre Kate étaient occupées à préparer l’habitation, elles étaient aidées dans cette tâche par le régisseur, un valet de ferme et une servante.
Comme la récolte était déjà rentrée presque toute entière, nous avions le droit, ma sœur et moi, de nous promener partout.
Nous parcourions le Château dans tous les coins et recoins, depuis les caves jusqu’aux combles. Nous jouions à cache-cache autour des colonnes, ou encore l’un de nous, abrité sous un escalier, attendait le passage de l’autre pour sortir brusquement en criant de manière à l’effrayer.
L’escalier de bois qui menait au grenier était très raide. Un jour j’étais descendu devant Berthe et je m’étais caché entre deux tuyaux de cheminées où il faisait très sombre, tandis que l’escalier était éclairé par une lucarne donnant sur le toit. Lorsqu’elle parut, descendant avec circonspection, je m’élançai en imitant avec force l’aboiement du chien. Berthe qui ne me savait pas là perdit pied de la grande frayeur qu’elle eut et, manquant la marche suivante, elle tomba de telle sorte que sa tête était au pied de l’escalier tandis que ses jambes se trouvaient encore sur les marches.
Naturellement sa robe était retournée et lui couvrait le visage, laissant ses jambes à découvert.
Lorsque je m’approchai en souriant, je vis que sa chemise avait suivi sa robe jusqu’au-dessus du nombril.
Berthe n’avait pas mis de pantalon parce que – comme elle me l’avoua plus tard –, le sien était sale et que l’on n’avait pas encore eu le temps de désempaqueter le linge. C’est ainsi qu’il arriva que je visse pour la première fois ma sœur dans une nudité impudique.
À la vérité je l’avais déjà vue toute nue parce que l’on nous avait souvent baignés ensemble les années précédentes. Mais je n’avais vu son corps que par derrière ou tout au plus de côté, parce que ma mère aussi bien que ma tante nous avaient installés de telle façon, que nos petits culs d’enfants fussent placés l’un en face de l’autre pendant qu’on nous lavait. Les deux dames prenaient bien garde que je ne jetasse aucun coup d’œil défendu et, lorsqu’on nous passait nos petites chemises, on nous recommandait de mettre soigneusement nos deux mains devant nous.
Ainsi Kate avait été une fois très grondée, parce qu’elle avait oublié de recommander à Berthe de mettre sa main devant elle un jour qu’elle avait dû la baigner au lieu de ma tante ; moi-même je ne devais en aucune façon être touchée par Kate.
C’étaient toujours ma mère ou ma tante qui me baignaient. Lorsque j’étais dans la grande baignoire on me disait :
« Maintenant Roger, tu peux retirer tes mains. »
Et comme on pense bien, c’était toujours l’une d’elles qui me savonnait et me lavait.
Ma mère qui avait comme principe que les enfants doivent être traités en enfants le plus longtemps possible avait fait continuer ce système.
À cette époque, j’avais treize ans, et ma sœur Berthe quatorze. Je ne savais rien de l’amour, ni même de la différence des sexes.
Mais lorsque je me sentais tout nu devant des femmes, lorsque je sentais les douces mains féminines se promener de-ci de-là sur mon corps, cela me causait un drôle d’effet.
Je me souviens fort bien que dès que ma tante Marguerite avait lavé et essuyé mes parties sexuelles, j’éprouvais une sensation indéterminée, bizarre, mais extrêmement agréable. Je remarquais que ma quéquette devenait brusquement dure comme du fer et qu’au lieu de pendre comme auparavant, elle relevait la tête. Instinctivement, je me rapprochais de ma tante et j’avançais le ventre autant que je pouvais.
Un jour qu’il en avait été ainsi, ma tante Marguerite rougit brusquement et cette rougeur rendit plus aimable son gracieux visage. Elle aperçut mon petit membre dressé et, faisant semblant de n’avoir rien vu, elle fit signe à ma mère qui prenait un bain de pieds avec nous. Kate était alors occupée avec Berthe, mais elle devint aussitôt attentive. J’avais d’ailleurs déjà remarqué qu’elle préférait de beaucoup s’occuper de moi que de ma sœur, et qu’elle ne manquait pas une occasion d’aider dans cet office ma tante ou ma mère. Maintenant elle voulait voir aussi quelque chose.
Elle tourna la tête et me regarda sans aucune gêne, tandis que ma tante et ma mère échangeaient des regards significatifs.
Ma mère était en jupon et l’avait retroussé jusqu’au-dessus du genou pour se couper plus commodément les ongles. Elle m’avait laissé voir ses jolis pieds en chair, ses mollets nerveux et ses genoux blancs et ronds. Ce coup d’œil jeté sur les jambes de ma mère avait fait autant d’effet sur ma virilité que les attouchements de ma tante. Ma mère comprit probablement cela aussitôt, car elle rougit et laissa retomber son jupon. Les dames sourirent et Kate se mit à rire jusqu’à ce qu’elle fût arrêtée par un regard sévère de ma mère et de ma tante. Mais elle dit alors pour s’excuser :
« Berthe aussi rit toujours lorsque j’arrive à cet endroit avec l’éponge chaude. »
Mais ma mère lui ordonna sévèrement de se taire.
Au même instant la porte de la salle de bain s’ouvrit et ma sœur aînée Élisabeth entra. Elle avait quinze ans et fréquentait l’école supérieure.
Bien que ma tante eût rapidement jeté une chemise sur ma nudité, Élisabeth avait cependant eu le temps de me voir et cela me causa une grande gêne. Car si je n’avais aucune honte devant Berthe, je ne voulais cependant pas être vu tout nu par Élisabeth qui, depuis quatre ans déjà, ne prenait plus de bains avec nous, mais se baignait soit avec les dames, soit avec Kate.
J’éprouvais une espèce de colère de ce que toutes les personnes féminines de la maison avaient le droit d’entrer dans la salle de bain même quand j’y étais, tandis que je n’avais pas ce droit. Et je trouvais absolument abusif qu’on m’en interdit l’entrée même lorsqu’on baignait seulement ma sœur Élisabeth, car je ne voyais pas pourquoi, malgré qu’elle affectât des airs de demoiselle, on la traitât différemment de nous.
Berthe elle-même était outrée des prétentions injustes d’Élisabeth qui s’était un jour refusée à se mettre nue devant sa jeune sœur et n’avait pas hésité à le faire lorsque ma tante et ma mère s’étaient enfermées avec elle dans la salle de bains.
Nous ne pouvions pas comprendre ces façons d’agir qui tenaient à ce que la puberté avait fait son apparition chez Élisabeth. Ses hanches s’étaient arrondies, ses tétons commençaient à se gonfler et les premiers poils avaient fait leur apparition sur sa motte, comme je l’appris plus tard.
Ce jour-là, Berthe avait seulement entendu ma mère dire à ma tante en quittant la salle de bains :
— Chez Élisabeth, c’est venu de très bonne heure.
— Oui, chez moi une année plus tard.
— Chez moi deux ans plus tard. Il faudra maintenant lui donner une chambre à coucher pour elle seule.
— Elle pourra partager la mienne », avait répondu ma tante. Berthe m’avait raconté tout cela et naturellement le comprenait aussi peu que moi-même.
Cette fois-là, donc, dès que ma sœur Élisabeth en entrant, m’eut vu tout nu avec mon petit vit tout dressé comme un petit coq en colère, je m’aperçus que son regard s’était porté sur cet endroit extraordinaire pour elle et qu’elle ne put cacher un mouvement de profond étonnement, mais elle ne détourna pas son regard. Au contraire.
Lorsque ma mère lui demanda brusquement si elle voulait aussi se baigner, une grande rougeur envahit son visage et elle répondit en balbutiant :
— Oui, maman !
— Roger et Berthe ont maintenant fini, répliqua ma mère, tu peux te déshabiller.
Élisabeth obéit sans hésiter et se déshabilla jusqu’à la chemise. Je vis seulement qu’elle était plus développée que Berthe, mais ce fut tout, car on me fit quitter la salle de bains.
Depuis ce jour-là, je ne fus plus baigné avec Berthe. Ma tante Marguerite ou bien ma mère étaient encore présentes, parce que ma mère avait été trop inquiète de me laisser baigner seul depuis qu’elle avait lu qu’un enfant s’était noyé dans une baignoire. Mais les dames ne touchaient plus à ma quéquette ni à mes petites couilles, bien qu’elles me lavassent encore le reste. Malgré cela, il m’arrivait encore de bander devant ma mère ou ma tante Marguerite. Les dames s’en apercevaient bien, malgré que ma mère détournât la tête en m’enlevant et en me remettant ma chemise et que ma tante Marguerite baissât les yeux vers le sol.
Ma tante Marguerite avait dix ans de moins que ma mère et comptait par conséquent vingt-six ans ; mais comme elle avait vécu dans une tranquillité de cœur très profonde, elle était très bien conservée et semblait une jeune fille. Ma nudité semblait lui faire beaucoup d’impression, car chaque fois qu’elle me baignait, elle ne me parlait que d’une voix flûtée.
Une fois qu’elle m’avait fortement savonné et rincé, sa main frôla mon petit vit. Elle le retira brusquement, comme si elle avait touché un serpent. Je m’en aperçus et lui dis avec un peu de dépit :
— Gentille petite tante chérie, pourquoi ne laves-tu plus tout entier ton petit Roger ?