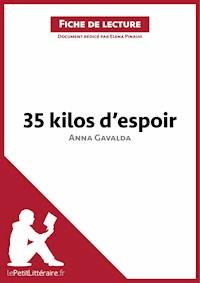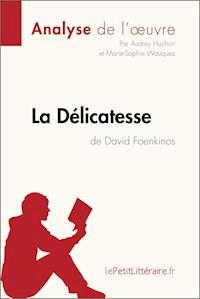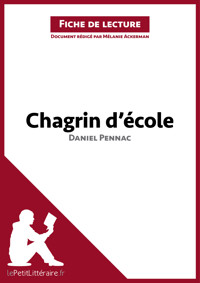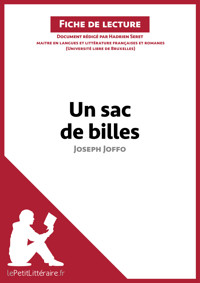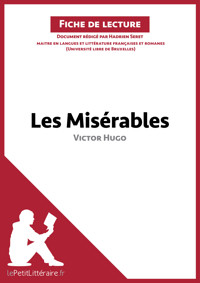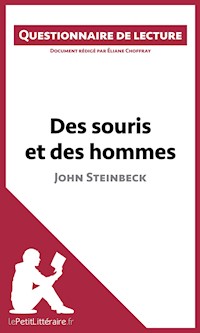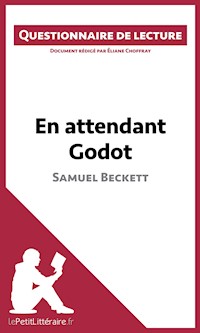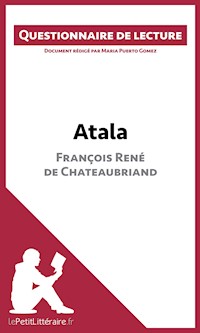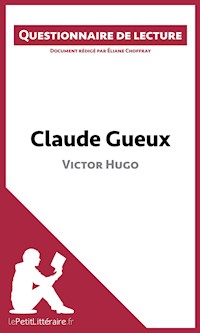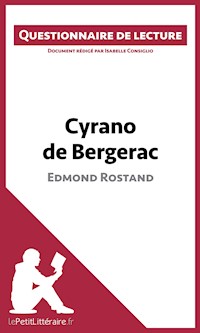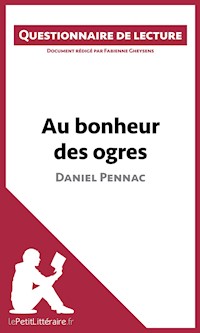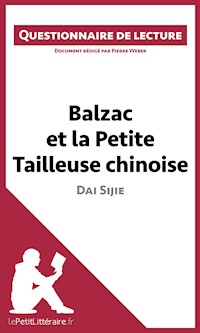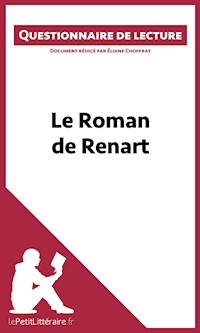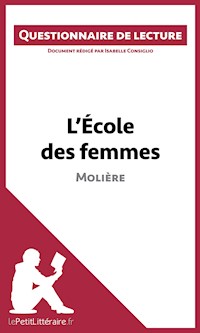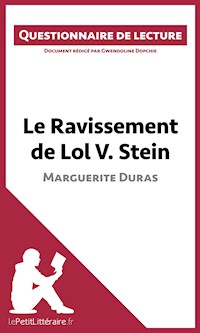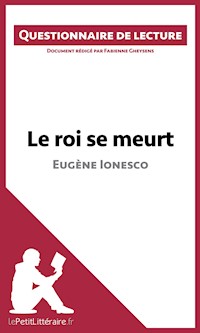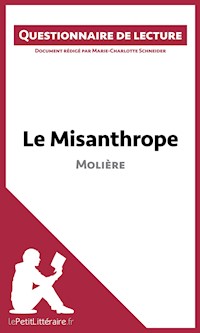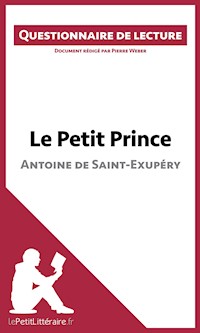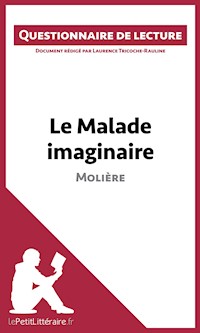9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: lePetitLitteraire.fr
- Kategorie: Bildung
- Serie: Commentaire et Analyse de texte
- Sprache: Französisch
Plongez-vous dans l’analyse du chapitre 3 de la deuxième partie des Faux-Monnayeurs d’André Gide pour approfondir votre compréhension de l’œuvre !
Que retenir du chapitre 3 de la deuxième partie des
Faux-Monnayeurs, une des oeuvres les plus importantes du XXe siècle ? Retrouvez toutes les subtilités de ce chapitre dans un commentaire original et complet pour approfondir votre réflexion sur le récit.
Vous trouverez dans cette fiche :
• Une introduction sur l’œuvre et son auteur
• L’extrait sélectionné : Deuxième partie (« Saas-Fée »), chapitre 3
• Une mise en contexte
• Un commentaire de texte complet et détaillé
L’outil indispensable pour percevoir rapidement ce qui fait du chapitre 3 de la deuxième partie des
Faux-Monnayeurs un métadiscours sur le genre romanesque !
À propos de la collection LePetitLitteraire.fr :
Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en matière d’analyse d’œuvres classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles au format papier et numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers toute la littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires.
LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de l’Éducation. Plus d’informations sur http://www.lepetitlitteraire.fr
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 24
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
André Gide
Écrivain français
Né en 1869 à Paris
Décédé en 1951 dans la même ville
Quelques-unes de ses œuvres :
Les Nourritures terrestres (1897), récit
Les Caves du Vatican (1914), sotie
Les Faux-Monnayeurs (1925), roman
André Gide (1869-1951) est un auteur français issu d’une famille bourgeoise protestante. Considéré comme un écrivain majeur du XXe siècle, il est lauréat du prix Nobel en 1947. Son œuvre aborde notamment la question d’une homosexualité qu’il assume : il clame sa volonté de se libérer des carcans sociaux et religieux.
Gide publie sa première œuvre, Les Cahiers d’André Walter, en 1890, et ses ouvrages majeurs paraissent dans les années vingt. Son succès est grandissant et ses publications engagées : il dénonce le colonialisme et le totalitarisme soviétique, et lutte contre le fascisme. L’écrivain s’inscrit également comme un précurseur du nouveau roman par la complexité de sa forme narrative, présente entre autres dans Les Faux-Monnayeurs (1925). La richesse de son travail nait de l’alliance entre la rigueur de sa morale due à son éducation et sa quête de liberté.
Les Faux-Monnayeurs
Un roman « miroir »
Genre : roman
Édition de référence : Les Faux-Monnayeurs, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1925, 384 p.
1re édition : 1925
Thématiques : argent, amitié, amour, famille, mépris, suicide
Publié en 1925, Les Faux-Monnayeurs est le seul roman que Gide ait qualifié de « roman », les autres n’étant, selon sa formule, que des « soties » (pièces de nature satirique jouées au Moyen Âge) ou des « récits ».
Le texte étudié ici nous montre d’une part un écrivain en train d’élaborer une nouvelle poétique, de l’autre une série de personnages, d’écrivains ou de critiques qui interagissent avec lui. Le roman que l’écrivain envisage d’écrire et qu’il intitule Les Faux-Monnayeurs est le sujet premier de ce texte qui se propose de mettre en cause le genre romanesque. Et pourtant ce livre n’est pas dépourvu d’aventures incroyables, notamment celle des faussaires évoqués par le titre.
TEXTE ÉTUDIÉ
DEUXIÈME PARTIE (« SAAS-FÉE »), CHAPITRE 3
« Est-ce parce que, de tous les genres littéraires, discourait Édouard, le roman reste le plus libre, le plus lawless1…, est-ce peut-être pour cela, par peur de cette liberté même (car les artistes qui soupirent le plus après la liberté, sont les plus affolés souvent, dès qu’ils l’obtiennent) que le roman, toujours, s’est si craintivement cramponné à la réalité ? Et je ne parle pas seulement du roman français. Tout aussi bien que le roman anglais, le roman russe, si échappé qu’il soit de la contrainte, s’asservit à la ressemblance. Le seul progrès qu’il envisage, c’est de se rapprocher encore plus du naturel. Il n’a jamais connu, le roman, cette “formidable érosion des contours”, dont parle Nietzsche2