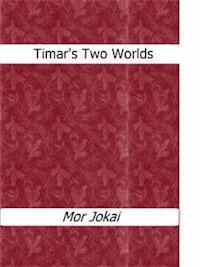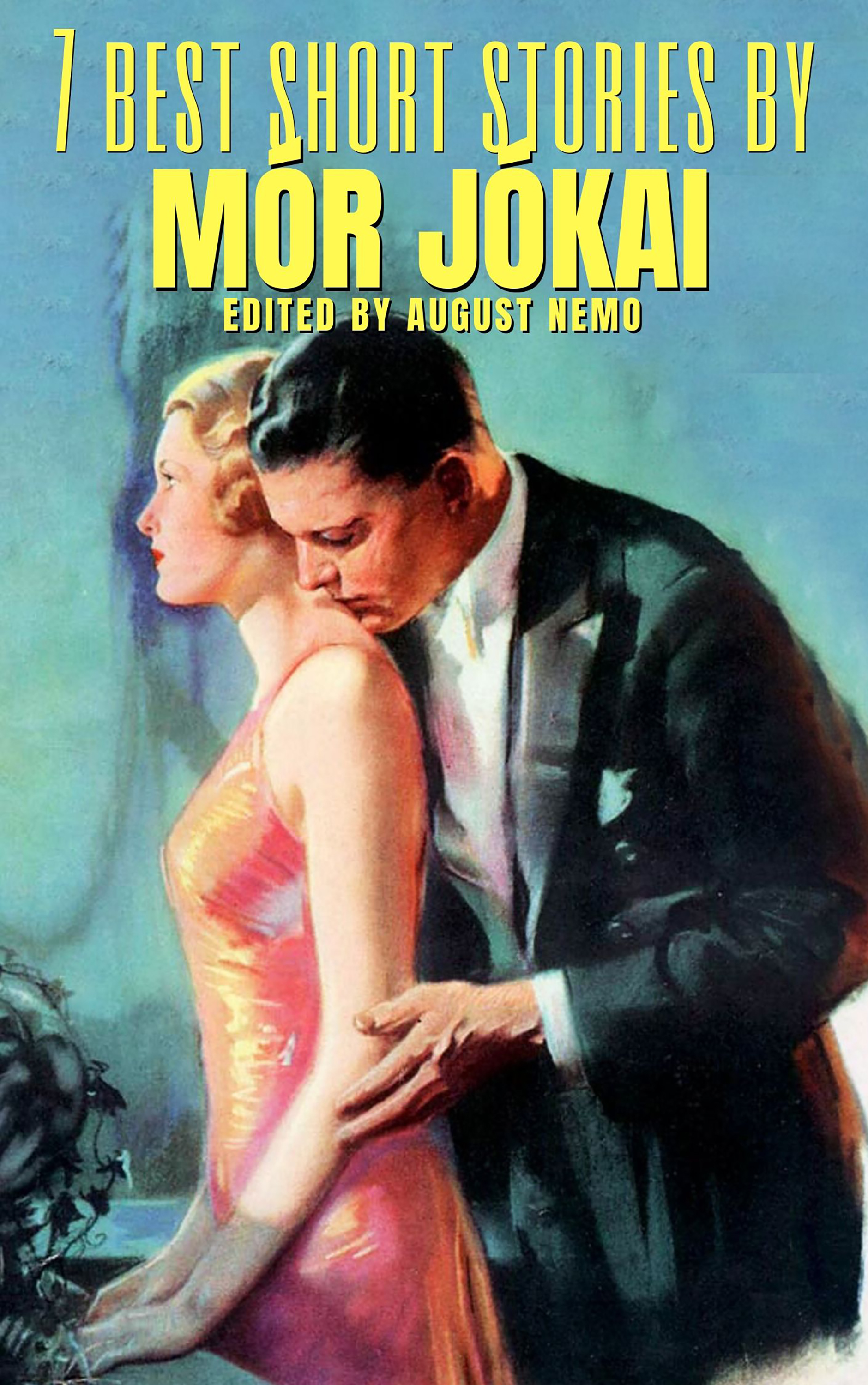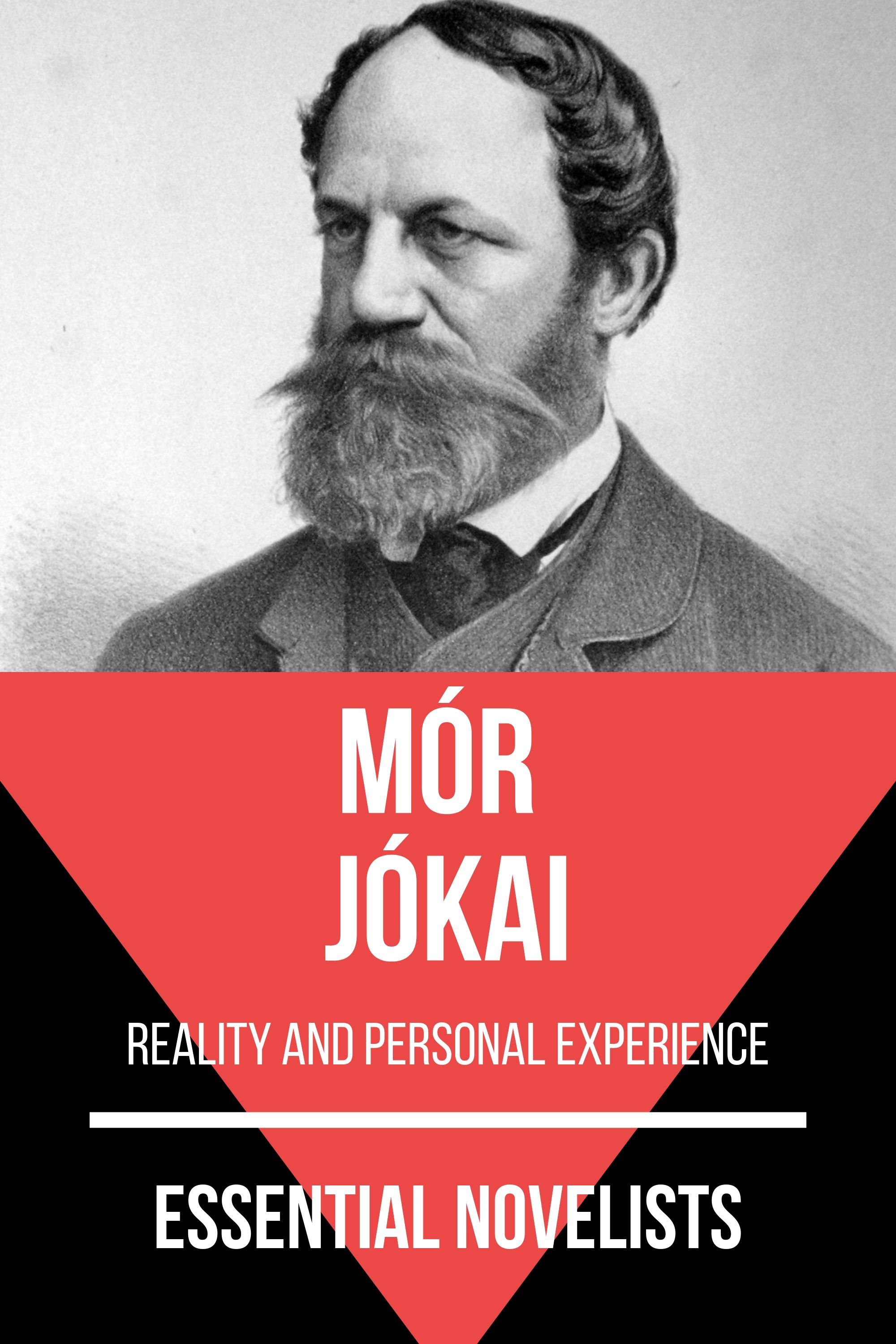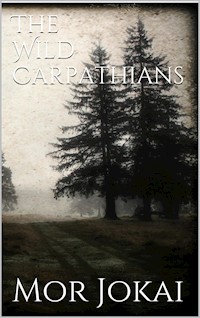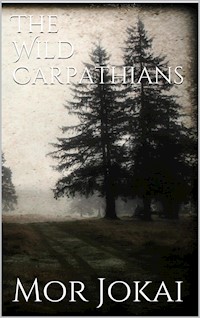1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Französisch
Dans 'Les fils de l'homme au cœur de pierre', Mór Jókai dépeint avec une plume lyrique et évocatrice des aventures passionnantes au cœur de la Hongrie du XIXe siècle, entrelaçant romantisme et réalisme social. Le récit suit la vie de protagonistes confrontés à des dilemmes moraux et à la cruauté du destin. À travers des descriptions vivantes, Jókai explore les tensions entre l'individu, l'amour et la société, tout en dépeignant des paysages pittoresques et une riche culture hongroise. Son style, empreint de digressions philosophiques, offre au lecteur une réflexion sur la condition humaine, tout en le plongeant dans un contexte historique tumultueux, marqué par les luttes nationales. Mór Jókai, figure emblématique de la littérature hongroise, a été un fervent nationalist et un acteur de la vie politique de son temps, ce qui a profondément influencé son œuvre. Les thèmes de l'identité nationale et de l'amour, souvent mêlés à des références à la mythologie hongroise, témoignent de son engagement. Son vécu et son activisme social lui ont permis d'explorer les failles de la société, et 'Les fils de l'homme au cœur de pierre' se veut une critique de la dureté des cœurs humains dans un monde impitoyable. Je recommande vivement ce roman à tout lecteur avide de récits riches en émotions et en réflexions. La profondeur des personnages et la beauté de l'écriture font de cette œuvre un incontournable pour ceux qui s'intéressent à la littérature hongroise et aux explorations psychologiques des âmes humaines, défiant ainsi le lecteur à interroger ses propres valeurs. Dans cette édition enrichie, nous avons soigneusement créé une valeur ajoutée pour votre expérience de lecture : - Une Introduction succincte situe l'attrait intemporel de l'œuvre et en expose les thèmes. - Le Synopsis présente l'intrigue centrale, en soulignant les développements clés sans révéler les rebondissements critiques. - Un Contexte historique détaillé vous plonge dans les événements et les influences de l'époque qui ont façonné l'écriture. - Une Analyse approfondie examine symboles, motifs et arcs des personnages afin de révéler les significations sous-jacentes. - Des questions de réflexion vous invitent à vous engager personnellement dans les messages de l'œuvre, en les reliant à la vie moderne. - Des Citations mémorables soigneusement sélectionnées soulignent des moments de pure virtuosité littéraire. - Des notes de bas de page interactives clarifient les références inhabituelles, les allusions historiques et les expressions archaïques pour une lecture plus aisée et mieux informée.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Les fils de l'homme au coeur de pierre
Table des matières
Introduction
Au cœur d’une nation secouée par la tourmente, là où l’obéissance promet la sécurité tandis que la liberté exige le courage, l’énigme demeure de savoir si le cœur humain peut rester de pierre quand l’Histoire martèle à la porte, lorsque les serments s’opposent aux affections, que l’honneur se mesure au prix du sacrifice, et que chaque foyer devient l’écho d’un combat plus vaste, si bien que la fidélité, la mémoire et le désir d’avenir se heurtent dans le même battement, obligeant chacun à choisir entre la prudence qui dessèche et la flamme qui consume sans garantir la victoire.
Les fils de l’homme au cœur de pierre, roman historique de Mór Jókai publié en 1869, s’inscrit au sein des grands récits du XIXe siècle qui transforment l’histoire récente en fresque romanesque. L’action se déploie en Hongrie, à l’époque des bouleversements de 1848–1849 au sein de la monarchie des Habsbourg, et suit les secousses collectives autant que leurs répercussions domestiques. Classique de la littérature hongroise, l’ouvrage associe l’ampleur d’un tableau national aux tensions intimes d’une famille confrontée à l’urgence des choix. Sa publication, proche des événements évoqués, confère à la narration une énergie testimoniale, sans renoncer aux ressorts du roman d’aventure et du sentiment.
Le roman s’ouvre sur une maison où l’autorité paternelle, admirée et redoutée, a imposé un modèle de dureté dont l’ombre persiste, tandis qu’une mère lucide s’emploie à orienter autrement l’avenir. Trois fils, différents par le tempérament et par les ambitions, deviennent les vecteurs d’itinéraires qui croisent l’espace public et la sphère privée. La prémisse, simple et puissante, place la cellule familiale au centre d’une époque qui exige des positions nettes. La lecture ménage un équilibre entre scènes d’intimité, mouvements collectifs et épisodes d’action, de sorte que l’arc narratif épouse tour à tour le souffle de l’histoire et la palpitation des cœurs.
Le récit adopte une voix ample et omnisciente, capable d’embrasser de vastes panoramas puis de se resserrer sur un geste ou un regard, avec une ironie mesurée qui n’ôte rien à la gravité des enjeux. Jókai use d’images vives, de retournements efficaces et d’une cadence feuilletonesque qui entretient l’attente sans sacrifier la cohérence. Les dialogues, nerveux et expressifs, révèlent des positions morales autant qu’ils dessinent des caractères. La tonalité conjugue ferveur, mélancolie et un humour discret, si bien que l’expérience de lecture alterne l’élan et la réflexion, offrant une immersion à la fois romanesque et civique.
Au cœur du livre, la lutte entre conscience et obéissance prend des visages concrets: fidélité familiale, loyauté politique, amour et ambition, chacun sollicitant une hiérarchie de valeurs jamais évidente. La métaphore de la pierre, menace de dureté et promesse d’endurance, interroge ce que signifient la force et la constance quand les circonstances se dérobent. S’y ajoutent la question de l’héritage et de la transmission, le poids des serments, l’éveil des sentiments et l’apprentissage de la limite. La narration montre comment les convictions se façonnent au contact des autres, et comment la maturité coûte parfois autant que la victoire.
Pour les lecteurs d’aujourd’hui, l’actualité du livre tient à la clarté avec laquelle il met en scène des décisions difficiles dans des contextes polarisés. Il rappelle que la vie civique se nourrit de courage mais aussi d’écoute, que la loyauté n’est pas soumission et que l’idéal ne dispense pas de prudence. À l’heure où l’opinion se forme souvent dans l’urgence, ce roman valorise la lenteur réfléchie, la responsabilité individuelle et la complexité des appartenances. Il propose un espace de reconnaissance pour celles et ceux qui, pris entre intérêts privés et devoirs publics, cherchent des repères mieux ancrés que l’instant.
Œuvre majeure du roman historique hongrois, Les fils de l’homme au cœur de pierre offre à la fois un miroir d’époque et une méditation durable sur la responsabilité. Sa puissance vient de l’entrelacement patient des destins, sans manichéisme, et d’une écriture qui sait unir l’ampleur épique à la précision des gestes. On y entre pour l’aventure et l’émotion, on y reste pour la profondeur morale et la finesse d’observation. Lire ce livre, c’est éprouver la manière dont l’histoire collective traverse et transforme les vies, et mesurer ce que signifie tenir, sans se fossiliser, dans des temps incertains.
Synopsis
Publié en 1869, Les fils de l’homme au coeur de pierre de Mór Jókai situe une saga familiale au cœur de la révolution hongroise de 1848–1849. Un grand seigneur, réputé inflexible, meurt en laissant un testament qui assigne à chacun de ses trois fils une destinée conforme à sa fidélité envers l’Empire. Sa veuve, révoltée, prononce en secret un contre-programme moral, les engageant à servir la cause nationale. À partir de ce double mandat, le roman installe une tension durable entre la volonté paternelle et la décision maternelle, ferment d’un récit où choix privés et secousses de l’histoire se nouent.
Les trois fils, dissemblables par leur tempérament et leurs aspirations, incarnent autant de voies possibles pour une génération soumise à la tourmente. L’aîné s’oriente vers la vie publique et les débats institutionnels, le second se forge dans l’épreuve militaire, le cadet explore les séductions du monde et de l’esprit. Leur mère, figure d’autorité discrète, tente d’aligner ces trajectoires sur une fidélité nouvelle, non plus à la personne du père, mais à une idée de la patrie. Le roman détaille comment convictions, ambitions et sentiments transforment des injonctions héréditaires en engagements personnels.
Au fil de la mobilisation révolutionnaire, Jókai déploie un panorama de salons, d’assemblées et de casernes, où s’opposent prudence légaliste et ardeur réformatrice. Les fils affrontent l’appareil administratif, la surveillance policière et les séductions d’une carrière conforme au testament paternel. Des alliances opportunes et des inimitiés tenaces se forment, tandis que la rumeur des provinces et le fracas des frontières pèsent sur les décisions. La famille devient un laboratoire moral où s’éprouvent loyauté filiale, obéissance civile et conscience nationale, chaque choix laissant entrevoir les coûts humains d’un conflit qui dépasse les protagonistes.
Avec l’éclatement des hostilités, la distance entre parole et action se réduit. Le roman suit l’apprentissage du courage, mais aussi les déconvenues d’une guerre qui bouscule rangs, fortunes et réputations. L’un des fils découvre la charge d’une responsabilité publique, un autre l’éthique de l’épée, le dernier la fragilité des attachements mondains. La veuve, pivot de la maison, négocie soutiens et protections, tout en préservant la cohésion des siens. Scènes d’héroïsme, retraits stratégiques, intrigues sentimentales et calculs administratifs s’enchaînent, révélant la difficulté de concilier l’exigence de l’honneur avec la prudence nécessaire à la survie.
Un tournant décisif survient quand l’équilibre militaire se rompt sous l’effet d’une intervention étrangère et d’une reprise en main impériale. L’espionnage, les dénonciations et les procédures d’exception resserrent l’étau autour des acteurs civils et militaires. Le foyer Baradlay, qui avait été un lieu d’élan et de refuge, devient une cible à protéger autant qu’un symbole à défendre. Les fils affrontent, chacun selon ses moyens, l’épreuve de la défaite partielle, de l’isolement ou de la compromission, tandis que la mère soutient, rassemble et différencie les devoirs, cherchant à préserver, sans éclat vain, l’essentiel de leur dignité.
Dans l’après-coup, le récit explore la logique de la répression et les voies, officielles ou clandestines, de la persévérance. Tribunaux, exils, réinventions et silences imposés définissent un nouveau théâtre où l’habileté vaut parfois autant que la bravoure. Les personnages arbitrent entre justice et vengeance, fidélité et survie, engagement public et loyauté intime. La figure du père défunt, dont le testament hante chaque geste, est relue à la lumière des sacrifices consentis et des illusions dissipées. Jókai maintient la tension narrative par un entremêlement de suspense, de portraits sensibles et de tableaux historiques sans s’abandonner au pur documentaire.
Au-delà de ses péripéties, le roman interroge la transmission, l’autorité et la responsabilité en temps de crise. L’opposition entre volonté paternelle et mandat maternel éclaire la manière dont une nation se refonde dans et par la sphère domestique. Par sa synthèse de chronique politique, de récit d’aventures et de drame familial, l’œuvre s’impose comme l’un des grands romans historiques de Jókai. Elle continue de résonner par sa réflexion sur la mémoire de 1848, la fragilité des victoires et la force des fidélités, tout en laissant au lecteur la découverte des destinées ultimes que scellent les dernières pages.
Contexte historique
Au début du XIXe siècle, le royaume de Hongrie fait partie de la monarchie des Habsbourg, avec des institutions propres: Diète siégeant à Pozsony (Pressburg), réseau d’assemblées de comitat et une noblesse jouissant d’exemptions fiscales. Le pays demeure largement agraire, structuré par des obligations seigneuriales envers les paysans, tandis que Buda et Pest, villes distinctes, s’urbanisent rapidement. L’ère des réformes (1825–1848), animée par Széchenyi et Kossuth, réclame modernisation, représentation responsable et usage officiel du hongrois (loi de 1844). Ce cadre oppose magnats conservateurs et élites nouvelles. Le roman exploite cette tension sociale et institutionnelle pour situer ses personnages face aux mutations irréversibles.
En 1848, la « printemps des peuples » embrase l’Europe. À Pest le 15 mars, la jeunesse radicale proclame les « Douze points » exigeant liberté de la presse, responsabilité ministérielle et égalité civile; la censure est aussitôt abolie. Le roi Ferdinand V sanctionne les Lois d’avril, fondant un gouvernement hongrois responsable présidé par Lajos Batthyány. Ces mesures abolissent les corvées, élargissent le suffrage et réforment l’administration. La mobilisation civique, les gardes nationales et une presse foisonnante transforment le quotidien. Le roman reflète cette effervescence politique, montrant comment l’enthousiasme réformateur et la confiance dans la légalité constitutionnelle façonnent les choix initiaux des protagonistes.
Très vite, les tensions s’aiguisent entre le gouvernement de Pest-Buda et la cour de Vienne, appuyée par des forces loyalistes dans les pays de la Couronne. Le ban de Croatie Josip Jelačić franchit la frontière en 1848, et l’affrontement tourne à la guerre d’indépendance hongroise. En décembre 1848, François-Joseph succède à Ferdinand V et conteste la validité des Lois d’avril, durcissant le conflit. La formation de l’armée honvéd et la politisation des élites divisent familles et clientèles. Le roman met en scène ce patriotisme naissant et les lignes de fracture qu’il révèle, sans occulter la loyauté de certains envers l’ordre impérial.
L’abolition des redevances féodales en 1848 bouleverse la société rurale et redéfinit les rapports entre nobles propriétaires et anciens serfs. Dans les villes, une bourgeoisie d’affaires émerge autour des banques de Pest, du commerce danubien et des premiers chemins de fer (ligne Pest–Vác ouverte en 1846). Le pont des Chaînes, inauguré en 1849, symbolise l’unification économique de Buda et Pest. Les clubs patriotiques, salons et journaux façonnent des réseaux d’influence. Le roman inscrit ses trajectoires dans cette modernisation rapide, en mettant en relief l’ascension des élites urbaines et les résistances d’un ordre foncier attaché à ses prérogatives.
Le royaume de Hongrie est multiethnique: Hongrois, Slovaques, Roumains de Transylvanie, Serbes du sud, Croates et autres communautés y vivent avec des revendications linguistiques et politiques distinctes. En 1848, plusieurs mouvements nationaux formulent des programmes d’autonomie ou de reconnaissance culturelle; des affrontements éclatent dans certaines régions. Les autorités hongroises défendent l’intégrité du pays, tandis que Vienne instrumentalise parfois ces tensions. Les débats sur la langue administrative, la représentation et la conscription traversent tous les milieux. Le roman replace ses intrigues dans cet espace composite, en suggérant comment les fidélités locales, impériales ou nationales peuvent coexister, s’opposer, ou se reconfigurer au gré des circonstances.
En 1849, à la demande de Vienne, la Russie impériale intervient massivement; l’armée hongroise capitule à Világos en août. La répression qui s’ensuit, menée notamment par le général Haynau, se traduit par des exécutions et des emprisonnements; le 6 octobre 1849, treize officiers sont exécutés à Arad, et Lajos Batthyány est fusillé à Pest. Une partie des acteurs s’exile; d’autres entrent dans la clandestinité. Les commémorations des martyrs nourrissent une culture politique de deuil et de persévérance. Le roman transpose ce contexte traumatique en explorant la loyauté, la perte et l’endurance, tout en évitant l’apologie directe d’acteurs précis.
Les années 1850 voient le « néoabsolutisme » de Bach: centralisation administrative, justice réorganisée, usage accru de l’allemand, police politique et censure. Malgré cela, l’économie se modernise (chemins de fer, industrie légère) et une « résistance passive », associée à Ferenc Deák, refuse la collaboration tout en évitant l’insurrection. À partir de 1860, les ouvertures constitutionnelles relancent la négociation. La mémoire des combattants et des victimes structure la sociabilité, entre deuil et espoir. Le roman, publié après l’assouplissement, critique les méthodes autoritaires et valorise la probité civique, montrant comment les choix individuels prennent sens dans un climat de surveillance et de résignation.
Le Compromis austro-hongrois de 1867 crée la Double Monarchie et rétablit un large autogouvernement hongrois. Pest-Buda connaît une expansion soutenue qui culmine plus tard dans l’unification urbaine de 1873. Dans ce contexte de consolidation étatique et de modernisation, Mór Jókai, figure majeure du romantisme hongrois, publie à la fin des années 1860 ce roman historique destiné à un vaste public. S’appuyant sur des souvenirs collectifs proches, l’œuvre contribue à fixer une mémoire nationale héroïque tout en marquant des réserves envers l’immobilisme aristocratique et les calculs opportunistes. Elle reflète l’idéal civique de l’époque, sans renoncer à une lecture critique des choix politiques récents.
Les fils de l'homme au coeur de pierre
AVANT-PROPOSDU TRADUCTEUR
Il y a, dans l’histoire des peuples, de ces moments suprêmes où toutes les facultés de la nation sont réveillées et mises en jeu de ces moments où le génie national s’affirme avec éclat, en revendiquant pour le peuple son droit à la vie. Telle est, pour les Magyars, l’année1848.
La Hongrie avait montré son héroïsme à l’Europe lorsque, de concert avec la Pologne, elle avait sauvé, il y a plusieurs siècles, le monde civilisé de l’invasion des Tartares et des Turcs. Mais ensuite le pays, affaibli par cette lutte gigantesque, tomba en1526dans les filets de l’Autriche, et son développement fut comme arrêté.
Il y eut des soulèvements partiels sous les Bocskay, les Rakoczy, les Bethlen, d’immortelle mémoire, mais ils n’eurent aucun résultat: les empereurs d’Autriche, pressés par le danger, accordaient quelques réformes qu’ils s’empressaient de retirer dès que la paix était rétablie.–Le dernier soulèvement eut lieu en .1825: les. Hongrois réclamèrent, de tous les côtés à la fois, leurs lois et leurs libertés que, depuis1526, tous les empereurs avaient juré de respecter et qu’ils avaient tous violés. Enfin, vers1847, lorsque l’Europe commença à s’agiter, la nation tout entière voulut obtenir des réformes. Les propriétaires, entraînés par la parole ardente de Louis Kossuth, cet éloquent Washington de la Hongrie, et gagnés par un généreux enthousiasme révolutionnaire, comme la noblesse française dans la nuit du4août, abolirent d’eux-mêmes les corvées, et, non contents de libérer les paysans, leur distribuèrent gratuitement la terre.
L’Autriche continua cependant à résister aux vœux du pays, et la population de Pesth, poussée à bout, se souleva le15mars1848, deux jours après la révolution de Vienne. L’empereur, pressé de toutes parts, accorda enfin une constitution à la Hongrie, et l’on nomma un ministère national. Mais, aussitôt, la Cour souleva secrètement, à force d’or et d’intrigues, neuf nationalités différentes établies en Hongrie: les Raciens, les Croates, les Serbes, les Valaques, les Esclavons, les Saxons, etc. Alors la nation, menacée de périr, se leva tout entière. Le 14avril1849, l’indépendance de la Hongrie fut solennellement proclamée. L’Autriche, aux abois, appela la Russie à son aide. La Hongrie résista encore héroïquement, et, pour tomber, il fallut qu’elle eut un traître dans son sein. Elle fut vaincue, mais elle avait gagné la foi en elle-même.
Pendant la courte durée de son indépendance, le pays, malgré ces luttes surhumaines, s’était transformé: des fabriques avaient été élevées de tous côtés, des écoles s’étaient ouvertes. Des poëtes immortels avaient surgi tout à coup: les Petofi, les Arany, les Vörosmarty, les Tompa, et tant d’autres. Toute une littérature nouvelle et patriotique avait pris naissance.
Maurice Jokaï, conteur plein de verve, appartient à cette génération des écrivains de la révolution. C’est lui qui consola le peuple Hongrois pendant les longues années de deuil, de1850à1867! Ses nombreux romans et son théâtre rappelaient à la nation, et rappelaient avec l’autorité du talent, ses anciennes gloires, ses héroïsmes, sa grandeur. La popularité de l’écrivain fut immense. Nous avons choisi, parmi ses romans, celui où Maurice Jokaï retrace avec âme quelques épisodes de cette mémorable révolution à laquelle il a pris part.
L’action s’ouvre peu de temps avant1848. Le château et le village imaginaires où commence ce récit sont situés au milieu d’une plaine que terminent, à l’est, les montagnes de la Transylvanie, et, à l’ouest, celles de Bude.
Cette plaine riche et fertile est arrosée par le Danube et la Tisza. C’est cette Puszta magyare où le vent fait onduler, dans des champs à perte de vue, les épis dorés du blé et du maïs. Là aussi paissent, dans des prairies sans fin, de grands troupeaux de bœufs aux cornes gigantesques. C’est le pays des mirages!.
Nous nous sommes efforcé de laisser à ce remarquable ouvrage toute son originalité et sa couleur locale.
Palfalva (Hongrie), ce15septembre1879.
A MADAME COLOMAN DE TISZA
NÉE COMTESSE DEGENFELD,
A la personnification vivante de la véritable hongroise, au type idéal qui a inspiré l’auteur de ce roman,
A la patriote, qui est aussi la poésie et la providence du foyer,
CETTE TRADUCTION EST DÉDIÉE EN TÉMOIGNAGE
D’AFFECTUEUSE ADMIRATION.
A. DE G.-T.
LES FILSDEL’HOMME AU CŒUR DE PIERRE
ISOIXANTE MINUTES[8]!
Le noble convive portait un toast[1q]. Il en était au milieu de son discours et élevait sa coupe remplie de champagne[1]; l’enthousiasme se peignait sur son visage un peu trop échauffé. Les autres invités, qui formaient la plus brillante réunion qu’on puisse imaginer, attendaient le moment de saisir leur verre pour le vider en l’honneur de leur hôte. Les laquais empressés versaient le «vin généreux[3].» Un peu en arrière, les czigany[2] (tziganes) fixaient leurs yeux ardents sur l’orateur, afin d’attaquer la note au moment où il cesserait de parler et de couvrir par leurs accords bruyants le joyeux cliquetis des verres. Tout à coup, le médecin de la famille, qui était entré sans bruit dans la salle, s’approcha de la maîtresse de la maison, et lui dit quelques mots à l’oreille. Elle se leva aussitôt et quitta précipitamment la salle, sans même songer à s’excuser auprès de ses voisins de cette brusque sortie.
Cependant le toast commencé s’achevait:
«A la gloire de ce grand patriote, de notre maître à tous!–notre lumière, notre orgueil,–qui, quoique absent, est présent dans tous les cœurs!–Que Dieu lui accorde de nombreuses années!»
La fanfare éclata, les verres se heurtaient avec enthousiasme[3q].
–. Vivat[4]! Vivat! criait-on de toutes parts. Puisse-t-il vivre cent ans!
A qui souhaitait-on une si longue vie?–A l’illustrissime seigneur Kazimir, baron de Baradlay[5], chevalier de l’ordre de la Clef et de l’Eperon d’or, possesseur d’immenses domaines, de villages, de villes, directeur général de l’opinion publique de toute la contrée, en un mot, au véritable Grand-Lama[6].
C’est lui qui, depuis quelques jours, avait rassemblé dans son château tous ces hommes plus ou moins influents, pour débattre en commun le programme à suivre, l’attitude à prendre dans les affaires publiques, et ce festin était le couronnement d’une œuvre menée à bonne fin.
Malheureusement, le roi de la fête était absent, et sa femme, la baronne de Baradlay, présidait seule au joyeux banquet.
Le toast achevé, on s’aperçut que celle à qui il était adressé avait disparu. Les laquais, interrogés, répondirent que le médecin était venu parler à leur maîtresse et que celle-ci avait immédiatement quitté la table.
–Que peut donc avoir notre ami Baradlay? hasardèrent quelques-uns.
–Notre illustre seigneur et maître, s’empressa de dire Bencze de Rideghvary, qui remplissait l’office d’administrateur, est en proie à ses douleurs accoutumées.
Les plus intimes se tournèrent alors vers ceux qui n’étaient pas au courant, et leur confièrent tout bas que le baron de Baradlay était atteint, depuis longtemps, d’une ossification du cœur[7], qui parfois lui occasionnait d’atroces souffrances, mais que, néanmoins, il pourrait bien vivre encore une dizaine d’années.
Sur ce, la gaîté reprit de plus belle.
Or, voici les quelques mots que le docteur avait dits à l’oreille de la châtelaine:
«Il n’a plus que soixante minutes à vivre[2q]!»
La baronne était devenue plus pâle que de coutume, mais personne ne s’en était aperçu.
Dès qu’elle eut quitté la salle, elle saisit les mains du docteur:
–Est-ce vrai? lui dit-elle.
Le docteur fit un signe affirmatif, et, arrivé dansa troisième salle, où le bruit du festin ne parvenait pas, il répéta:
–Il n’a plus que soixante minutes à vivre, et il désire vous parler. Il a fait éloigner tout le monde. Veuillez entrer chez lui. Mes soins lui sont désormais inutiles.
Puis il s’éloigna lentement et laissa la pauvre femme continuer seule son chemin.
Elle entra vivement dans la quatrième salle: on y voyait, accrochés au mur et superbement encadrés, les portraits de grandeur naturelle du maître et de la maîtresse de la maison, dans leurs riches habits de mariés. En passant devant ces portraits, la pauvre femme aux joues pâles cacha sa tête dans ses mains. Les sanglots la suffoquaient,–et il lui était défendu de pleurer! Il lui fallut une demi-minute pour se vaincre, c’était une demi-minute volée aux soixante dernières minutes du mourant: elle aurait à en répondre!
Elle s’arma donc de courage, passa par la bibliothèque et entra dans la chambre où le malade comptait, les derniers instants de sa dernière heure.
Là se trouvait cet homme, dont le cœur s’était changé en pierre, au moral comme au physique. Il était sur son séant, soutenu par une innombrable quantité de coussins, les traits calmes et dignes comme s’il avait voulu poser résolûment en face de ce grand artiste: la Mort.
Sa femme s’avança vers lui rapidement.
–Je vous ai attendue! dit-il d’un ton de reproche.
–Je suis venue aussitôt, répondit la pauvre femme en s’excusant.
–Vous vous êtes arrêtée pour pleurer, et vous savez pourtant que mon temps est compté!
La malheureuse femme se mordit les lèvres.
–Allons, Marie, point de faiblesse! continua le malade de plus en plus froidement. C’est l’arrêt de la nature. Dans soixante minutes je serai une masse inerte. Le docteur l’a annoncé.–Nos convives se divertissent-ils bien?
Elle répondit en inclinant la tête.
–Qu’ils continuent! Ne permettez pas qu’ils se dispersent. Ils sont venus à la Conférence: qu’ils restent pour mes funérailles. Il y a longtemps que j’en ai réglé toute la pompe. Des deux cercueils, vous choisirez pour moi celui qui est en marbre noir. On y posera mon sabre à ornements de platine. Ce sont les élèves de l’école de Debreczin[10] qui chanteront les chants funèbres, point de musique d’opéra, nos vieux cantiques seulement. Le doyen prononcera son discours ici, dans la maison mortuaire, et l’évêque fera le sien à l’église. Le pasteur du village se contentera d’une simple prière devant mon tombeau. M’avez-vous compris?
Elle regardait fixement devant elle.
–Je vous en prie, Marie, continua-t-il. Jamais je ne pourrai répéter ce que je vous dis en ce moment. Veuillez vous asseoir à cette petite table, près de mon lit; écrivez ce que je viens de dire et ce que je vais dire encore.
Elle obéit silencieusement. Il continua:
–Vous avez toujours été une épouse soumise et fidèle. Vous avez toujours accompli toutes mes volontés. Pendant une heure encore je suis votre maître. Mais ce que je vais vous dire pendant cette heure, toute votre vie il faudra vous le rappeler!–Je veux rester votre maître, même après ma mort. Un maître inexorable. Ah! j’étouffe; donnez-moi quelques gouttes de ce cordial.
La pauvre femme lui versa les gouttes dans une petite cuiller d’or.
Il put parler plus facilement.
–Ecrivez mes dernières volontés. et que nul autre que vous ne les connaisse. J’ai accompli une grande œuvre qui ne doit pas périr avec moi. Quand même tout changerait autour de nous, je veux que ce coin de terre, qui est à nous, reste immuable. Quelques-uns sont capables de me comprendre, mais bien peu savent agir, et presque personne ne l’ose. Écrivez bien chacune de mes paroles.
Elle écrivait eu silence[4q].
–J’ai trois fils, qui doivent continuer mon œuvre[5q]. Mais ils sont encore trop jeunes; il leur faut d’abord recevoir les leçons de la vie. Jusque-là il vous sera défendu de les voir. Ne soupirez pas. Ils sont assez grands pour savoir marcher seuls. Mon fils aîné, Odon[15], doit rester à la cour de Saint-Pétersbourg[11]. Il n’est encore que secrétaire d’ambassade, mais il est appelé à une haute destinée. La Russie est une bonne école pour lui. La nature l’a gratifié de trop d’enthousiasme. Cela ne vaut rien, il en guérira là-bas. Il apprendra à connaître la valeur réelle des hommes, son cœur s’endurcira, et, lorsqu’il reviendra, il pourra saisir d’une main ferme le gouvernail que je suis forcé d’abandonner. Ayez soin de lui envoyer assez d’argent pour qu’il puisse toujours rivaliser de luxe avec les jeunes gens les plus à la mode. Laissez-le boire jusqu’à la lie la coupe des voluptés: rien ne rend sceptique et indifférent comme l’abus des plaisirs.
Le malade regarda l’heure, il devait se hâter, il avait tant à dire encore!
–Cette jeune fille, continua-t-il plus bas, cette jeune fille pour laquelle j’ai dû l’expatrier, tâchez de la marier; ne reculez devant aucun sacrifice. Il ne manque pas d’hommes qui soient dignes d’elle: quant à la fortune, vous y pourvoirez. Si la jeune fille refuse et s’obstine, il faut faire en sorte que son père soit déplacé et nommé en Transylvanie[13]. Nos amis vous y aideront. Jusque-là Odon ne doit pas revenir, à moins qu’il ne se marie. Il n’y a rien à craindre pour lui en Russie. Une seule fois, un Czar[12] a épousé la fille d’un pope; mais c’était un Czar.
Mon second fils, Richard[16], restera encore un mois dans la garde impériale; mais ce n’est pas une carrière, ce n’est qu’un début. Il faudra qu’il entre dans la cavalerie, il y servira un an et tâchera de se faire recevoir dans l’état-major. L’habileté, la fidélité et le courage sont les trois degrés par lesquels on arrive à toutes les dignités. Que mon fils se fraye son chemin lui-même, et qu’il jette de l’éclat sur toute la famille. Il ne doit jamais se marier. Une femme ne serait qu’un empêchement dans sa carrière. Sa tâche est de pousser ses frères. Quelle admirable recommandation qu’un frère «mort au champ de bataille!.»–Marie, vous n’écrivez plus? Vous pleurez? Ne soyez pas faible en ce moment, je vous en conjure. Je n’ai plus que quarante minutes, et j’ai tant à dire.
Marie se remit à écrire.
–Mon troisième fils, le plus jeune, Jeno[17], qui est mon préféré,–quoiqu’il n’en sache rien et que je l’aie traité aussi rudement que les autres,–doit rester à Vienne[14] et continuer à servir dans son administration. Qu’il s’élève peu à peu, par ses propres efforts. Cette lutte avec la fortune le rendra souple, intelligent et adroit. Qu’il apprenne à se faire aimer de ceux qu’il doit employer un jour à sa propre élévation. Il ne faut lui venir en aide en rien, il doit apprendre à se servir d’autrui; c’est ainsi qu’il finira par connaître la valeur individuelle des autres. Il faut attiser en lui l’ambition, il faut le pousser à se lier avec des hommes puissants ou de naissance illustre, et à renoncer à toute rêverie poétique.
L’altération excessive des traits du moribond montrait combien il devait souffrir pendant qu’il parlait. Il se tut un instant, puis, domptant la douleur, il poursuivit:
–Trois colonnes de cette force suffiront pour soutenir l’édifice que j’ai commencé: un diplomate, un soldat, un haut fonctionnaire. Ah! que n’ai-je pu la continuer, cette œuvre, jusqu’à ce qu’ils aient été assez forts pour venir prendre leurs places!. Marie, ma femme, Madame de Baradlay! je vous prie, je vous ordonne, je vous adjure, de remplir fidèlement la tâche que je vous laisse! Chaque atome de mon être lutte contre la mort; mais, à ce moment suprême, il m’importe peu que ce qui, en moi, n’est que poussière, redevienne poussière. Ce n’est pas la peur de la mort qui fait perler cette sueur froide sur mon front, c’est la crainte d’avoir travaillé en vain. L’ouvrage d’un quart de siècle serait anéanti! Des rêveurs enthousiastes jettent le diamant dans le feu, sans réfléchir qu’il s’y décomposera en ses vils éléments et perdra toute sa valeur. Ce diamant, c’est notre noblesse hongroise de huit cents ans, qui seule vivifie toute la nation, étant le talisman secret de notre existence nationale! Voilà ce qu’on veut anéantir, emporté par des rêves insensés. Ah! Marie, si vous saviez ce que souffre mon cœur, mon cœur de pierre. Non, ne me donnez pas de remède, c’est inutile. Mais placez-là, devant moi, les portraits de mes fils; leur vue me soulagera.
Mme de Baradlay mit les trois miniatures, encadrées ensemble, devant son mari, qui les regarda longuement l’une après l’autre, et semblait, en les regardant, oublier ses souffrances. Il posa sa main décharnée sur le portrait de l’aîné de ses fils et murmura:
–Je crois que c’est celui-ci qui me ressemble le plus.
Puis, repoussant les miniatures, il ajouta froidement:
–Point d’attendrissement: le temps est court. Dans quelques instants, j’aurai abandonné à mes fils ce que j’ai reçu de mes aïeux. Que Nemesdomb[9] reste toujours le foyer de mes principes. Vous ne quitterez pas ce château après ma mort.
Marie cessa d’écrire et regarda le malade avec étonnement.
–Vous paraissez interdite, continua celui-ci. Vous vous demandez en quoi une faible femme, une veuve, peut aider à une œuvre sous laquelle l’homme le plus fort succomberait? Je vais vous le dire. Six semaines après ma mort, vous vous remarierez.
La pauvre femme laissa échapper sa plume.
–Je le veux! continua-t il sévèrement. J’ai même choisi d’avance celui que vous épouserez. C’est Bencze de Rideghvary.
A ces mots, la malheureuse, impuissante à se contenir davantage, quitta la table, et, se jetant à genoux près du lit de son mari, lui saisit la main qu’elle arrosa de ses larmes.
L’homme au cœur de pierre ferma les yeux et demanda conseil aux ténèbres; puis, raffermi de nouveau, il reprit:
–Cessez, Marie, le temps manque pour les pleurs. J’arrive à la fin. Ce que j’ai dit doit être! Vous êtes jeune encore, vous n’avez que quarante ans; vous êtes belle, et vous le serez toujours. Il y a vingt-cinq ans, lorsque je vous ai épousée, vous ne me paraissiez pas plus belle qu’en ce moment. Vous êtes belle comme vous êtes douce et bonne; je vous ai beaucoup aimée, vous le savez bien. Dans la première année de notre union, mon fils Odon est venu au monde; dans la seconde année nous avons eu mon second lils, Richard, et enfin, dans la troisième, le dernier de mes fils, Jeno, nous est né. Alors Dieu m’envoya cette cruelle maladie, et les médecins me déclarèrent que j’étais fiancé à la mort. Un seul baiser de vous m’aurait tué. Et je meurs lentement à vos côtés depuis vingt ans.
Depuis vingt ans vous avez été la garde-malade d’un mourant. Et j’ai eu le courage de traîner cette existence déplorable, car une idée me soutenait, qui me donnait une force surnaturelle. J’ai vécu, sachant me priver de tout bonheur, de toute jouissance. J’ai renoncé à tout ce qui fait battre le cœur de l’homme. J’ai dit adieu aux rêves, à la poésie, à tout ce qu’aime la jeunesse; je suis devenu froid, calculateur, impénétrable. Je n’ai vécu que pour l’avenir,–pour un avenir qui doit être l’éternité du passé. C’est dans cet esprit que j’ai élevé mes trois fils. C’est par là que j’immortalise mon nom. Ce nom est maudit dans le présent, mais il sera béni un jour! C’est pour ce nom que vous avez tant souffert.–Vous devez être heureuse encore.
La pauvre femme, sanglotant, voulut protester.
–Je le veux! dit aussitôt le malade en retirant sa main. Retournez à votre table et écrivez encore ma volonté suprême.–Ma femme épousera, six semaines après ma mort, Bencze de Rideghvary, qui est le plus digne de me succéder. Ainsi, je meurs tranquille. Avez-vous tout écrit, Marie?
Celle-ci gardait un morne silence.
–L’heure touche à sa fin, dit le malade, d’une voix saccadée, mais je ne mourrai pas tout entier! Posez votre main sur la mienne, et restez ainsi jusqu’à ce que vous sentiez le froid do la mort. Point d’attendrissement,–point de larmes,–encore un peu de fermeté. Nous ne nous dirons pas adieu, car mon âme restera près de vous et ne vous quittera jamais[6q]. Tous les soirs elle viendra vous demander compte de la manière dont vous aurez rempli mes dernières volontés.
Mme de Baradlay était toute tremblante, tandis que son mari, prenant tranquillement sa main et la posant sur la sienne, ajouta d’une voix entrecoupée:
–Tout est fini. le docteur avait raison, je ne souffre plus. Tout devient obscur, je ne vois plus que les portraits de mes fils. Tu t’approches déjà, ombre noire. Arrête! Encore quelques instants!. J’ai un dernier mot à dire!.
Mais la mort n’attend point:–elle ne permit pas à «l’homme au cœur de pierre» d’achever, et, l’étreignant avec force, elle lui fit sentir sa toute-puissance. Alors le baron de Baradlay ferma les yeux, et, n’essayant plus de lutter, il expira sans proférer une plainte.
Sa femme, voyant que tout était fini, se jeta à genoux près de la table, et, saisissant le papier sur lequel elle venait d’écrire, elle s’écria avec ferveur:
–Ecoute-moi, grand Dieu! Reçois cette âme égarée avec autant de miséricorde et de bonté que je mettrai d’énergie et de volonté à ne pas accomplir un seul de ces ordres impies! Je jure ici, devant toi, de faire en toute chose le contraire de ce qui vient de m’être imposé! Viens à mon aide, Dieu puissant!
Un cri effroyable, un cri surhumain, fit tressaillir Mme de Baradlay. Elle jeta les yeux avec épouvante vers e lit, et elle vit les lèvres du mort entr’ouvertes, sa main droite étendue, ses yeux fixes.
Peut-être, avant de quitter ce séjour, cette âme de fer avait-elle entendu le terrible serment de révolte de la pauvre femme, et ce cri était-il une protestation suprême?
IILA PRIÈRE DES FUNÉRAILLES.
Les funérailles n’eurent lieu que huit jours après[7q]. Pendant ce temps, l’homme au cœur de pierre fut embaumé et exposé aux regards des curieux. Il fallait bien accorder quelques jours à tous les amis qui devaient arriver des environs, puis aux ecclésiastiques qui avaient à préparer leurs pompeux discours.
Je ne décrirai pas le service funèbre. Toutes ces cérémonies se ressemblent plus ou moins. Je dirai seulement que les discours furent fort longs et que la baronne de Baradlay pleura tout le temps, comme une pauvre veuve qui vient de perdre son soutien.
–Elle peut au moins laisser couler ses larmes en liberté, dit un des invités à l’oreille de son voisin. Pendant qu’il vivait, cela ne lui était pas permis.
–Il est vrai, le défunt n’a pas été tendre, répliqua l’autre. Il ne souffrait pas une larme, même d’une femme.
–Elle a dû être bien malheureuse!
–Je suis payé pour le savoir.
–Vous avez été l’ami intime de la famille?
–Le plus intime, répondit celui-ci, haut fonctionnaire très influent.
–Mais voyez donc, Mme de Baradlay est encore fort belle.
–Elle a été conservée dans de la glace.
–Je ne crois pas qu’elle reste veuve plus d’une année.
Le haut fonctionnaire se contenta de friser sa moustache et dit:
–Écoutons le discours il est fort beau.
En effet, l’évêque excellait dans les oraisons funèbres.
Quelque beau que fût ce discours, il eut pourtant une fin. On entonna alors les cantiques. L’église du village possédait un orgue, présent du défunt. On y exécuta, avec accompagnement de voix, un chant funèbre tiré de l’opéra de Nabuchodonosor[22]; les paroles avaient été appropriées à la circonstance.
–Ah! si mon ami entendait ce morceau d’opéra, dans quelle fureur il serait, dit tout bas le haut fonctionnaire Rideghvary, à son voisin.
–Il n’aimait peut-être pas la musique de théâtre?
–Il ne l’aimait pas dans les églises. Et même, dans son testament, il a expressément défendu qu’on en chantât à ses funérailles.
–Vous connaissez le testament du défunt?
Le haut fonctionnaire cligna des yeux, voulant faire entendre que c’était son secret, mais qu’il permettait qu’on le devinât.
Le chant terminé, la cérémonie ne l’était pas encore. Trois ecclésiastiques étaient assis dans le premier banc et ils n’étaient pas là pour rien.
Ce fut un second évêque qui monta en chaire.
–Mon Dieu, est-ce que le troisième prêtre parlera aussi? dit un des invités en s’agitant.
–Oh! non, ce n’est que le pasteur du village, il ne fera qu’une courte prière devant le caveau.
–Est-ce que cette jeune fille serait?. demanda le premier interlocuteur; mais la fin de la phrase fut chuchotée si bas que personne ne put l’entendre.
–Non, mais je cherche des yeux depuis longtemps celle que vous voulez dire.
Le haut fontionnaire finit par la découvrir, car il ajouta:
–Elle est là bas, dans le coin, appuyée contre le mur. Elle porte son mouchoir à sa bouche. Vous ne voyez pas? Attendez un peu, quand le heiduque qui tient la torche se posera de nouveau sur sa jambe gauche, vous l’apercevrez juste derrière lui.
–Ah! je la vois, oui., là-bas, avec une robe qui n’est ni brune ni grise?
–Oui, c’est cela.
–Quelle charmante enfant! Ce n’est pas étonnant, si.
Le reste fut inintelligible.
Et pourtant c’était dommage de ne pas écouter ce deuxième discours, car si le premier avait été un chef-d’œuvre de dialectique et d’éloquence, celui-ci brillait par la poésie, les images saisissantes et les comparaisons. A chaque instant arrivait une citation des auteurs profanes.
Après cette superbe introduction, l’évêque prit congé, au nom du défunt, de tous les parents, amis et connaissances. C’est à cette cérémonie, accomplie à la clarté des torches, qu’il fit preuve d’une rare perspicacité. Il sut nommer les «Excellences,» les «Grâces,» les «Grandeurs,» chacun à sa place et selon son rang, sans oublier personne, sans commettre la moindre erreur.
Lorsque l’évêque en vint à celui qui: «loin de sa patrie, errant parmi les champs de glace du Nord, ignorait encore son malheur,» et lorsqu’il lui adressa le dernier adieu au nom d’un père «aimant,» la jeune fille, remarquée quelques instants auparavant, cacha sa tête dans ses mains et fondit en larmes.
Ce qui fit dire aux deux interlocuteurs:
–Pauvre petite! Elle peut être bien sûre de ne jamais le revoir!
Enfin, la cérémonie s’acheva. Douze heiduques[24], vêtus de leurs plus beaux costumes de gala, enlevèrent le cercueil et le placèrent sur leurs épaules; les amis les plus intimes de la maison saisirent les glands du drap mortuaire; le haut fonctionnaire offrit la main à la veuve, et tout le cortège quitta l’église pour se rendre au tombeau de famille.
Alors le pasteur du village se découvrit et vint se placer en face du cercueil, à la porte du tombeau.
Beaucoup étaient curieux d’entendre le bouillant Barthélemi Langhy, qui, malgré son âge avancé, était vif comme la poudre; on l’avait surnommé le vieux Kurucz[23].
Des boucles de cheveux, blancs comme la neige, encadraient son large front. Ses sourcils épais, ses yeux pleins de feu, donnaient à son visage une expression frappante de hardiesse.
Il joignit les mains et commença ainsi:
«Dieu puissant, juge équitable de tout ce qui vit ici-«bas!
«Écoute notre prière! Voici un de tes serviteurs: son corps est là, couvert d’or et de richesses étincelantes, attendant qu’on le descende dans son palais de marbre, pendant que son âme, tremblante et nue à la clarté des étoiles, demande une place au ciel.
«Que sommes-nous pour quitter cette vie avec une telle pompe, tandis que les vers de terre sont nos frères, et que la poussière est notre mère!
«Le souvenir d’une seule bonne action laisse plus de clarté après nous que la flamme de mille torches, et la bénédiction muette des concitoyens pare mieux un «cercueil que les dorures, les croix et les décorations.
«Seigneur! sois miséricordieux envers celui qui n’a jamais connu la miséricorde.
«Ne demande pas avec trop de sévérité à cette âme tremblante: Qu’as-tu fait? Est-ce la bénédiction ou la malédiction qui monte au ciel derrière toi?
«Car qui pourrait la défendre, sinon ta bonté inépuisable, lorsque, dépouillée de toute pompe périssable, elle sera forcée de répondre à tes sévères questions:
«Es-tu venu en aide à ceux qui souffraient?» « Non!»
«As-tu été le protecteur des opprimés?» «Non!»
«As-tu écouté les plaintes des désespérés?» «Non!»
«As-tu essuyé les larmes des malheureux?» «Non!»
«As-tu fait grâce aux vaincus?» «Non!»
«As-tu aimé ceux qui t’aimaient?»
«Non! non, et toujours non!»
«Et, si tu lui demandes ce qu’il a fait du pouvoir que tu lui as confié?–Quel bien il a procuré à ceux qui dépendaient de lui?–S’il a servi sa patrie, ou bien s’il l’a vendue?–Qui appellera-t-il à son secours! Avec laquelle de ses décorations se couvrira-t-il! Quel «roi ou quel empereur viendra le protéger là-haut1»
Les joues du prêtre s’enflammèrent, sa taille se redressa; l’assistance était haletante.
«Grand Dieu! continua-t-il, exerce la miséricorde au lieu de la justice, ne regarde pas à ce qu’a fait le défunt, mais songe qu’il était aveugle et qu’il ne connaissait pas la vérité!
«Pardonne-lui dans le ciel, et efface la trace de ses œuvres ici-bas! Qu’il ne reste de lui aucun souvenir! Permets que ses fils ne lui ressemblent point et que tout ce qui a été crime dans le père devienne vertu «et gloire dans les fils!.
«Ecoute, grand Dieu, la prière de ton serviteur[10q]! «Amen!.»
La porte de fer roula sur ses gonds: tout était terminé. Le public,–qu’il eût compris ou non les paroles du ministre,–se montra satisfait, et se dirigea vers le château où des tables étaient dressées pour les maîtres et les serviteurs, dans des salles différentes. Maintenant qu’on était en règle avec le défunt, chacun se hâtait de satisfaire aux exigences de la nature.
Le vieux prêtre resta le dernier, et, lorsque tous se furent éloignés, il saisit la main de la jeune fille à la robe brune et disparut dans une autre direction.
On l’attendit en vain au château.
IIIZÉBULON TALLÉROSSY.
Les banquets funèbres ressemblent à tous les autres repas, seulement on n’y porte point de toasts.
La maîtresse de la maison, la veuve, s’enferma dans les appartements les plus retirés, et les invités prirent place à la triple rangée de tables, dans la salle d’honneur. Ils pouvaient être cent cinquante. Le cuisinier avait travaillé dé son mieux. Comme d’habitude, le sommelier faisait servir toutes sortes de vins, les uns après les autres; et les invités firent honneur au festin comme à un repas de noces.
Vers la fin, lorsqu’on commençait à offrir les glaces dans de petites soucoupes de porcelaine de Sèvres, un convive attardé entra tout à coup avec un grand fracas.
En l’apercevant, toute la compagnie fit entendre un «ah!» joyeux, et les valets de service eux-mêmes se mirent à sourire. Pourtant la physionomie du nouvel arrivé ne portait aucune trace de gaité; au contraire, il avait l’air désolé.
–C’est Zébulon! dit-on de tous côtés, notre brave Allemand magyarisé!
Oui, Zébulon, mais plein de colère et de désespoir, le front couvert de sueur, la moustache et la barbe pleines de givre; il fronce démesurément les sourcils, mais en vain: personne n’a peur de lui.
–Je n’ai pas trouve de relais, à la ternière poste! s’écrie-t-il pour excuser son retard.
Les jeunes gens se lèvent aussitôt devant lui avec empressement; les hommes plus âgés lui font des signes d’amitié; les laquais s’empressent autour de lui, lui prenant son bonnet fourré, ses gants d’hiver; ils auraient bien voulu lui ôter aussi son habit garni de fourrure, mais c’était chose impossible, attendu qu’il n’en avait point d’autre en dessous. Quand il déboutonnait son habit, il était en tenue de salon; quand il le boutonnait, au contraire, il lui servait de vêtement pour sortir; et le même habit, bien brossé, devenait encore son costume de parade.
–Venez ici! A côté de moi! A ma place! lui cria-t-on de toutes parts.
Mais Zébulon n’y fit aucune attention. Il avait aperçu une chaise vide auprès du haut fonctionnaire qui l’appelait, et, tenant à lui faire les honneurs de son givre tout frais, il se précipita vers lui pour l’embrasser le premier.
Alors, se souvenant de la solennité du moment, il poussa un profond soupir, et, saisissant les deux mains du haut fonctionnaire, il dit en gémissant:
–Est-ce ainsi que nous tefions nous rengondrer? Qui l’eût gru!
Trois heures plus tôt, cette expression de tristesse eût parfaitement convenu; mais les vins de Chênes et de Bude avaient un peu dissipé la mélancolie. Le haut fonctionnaire lui répondit donc avec calme:
–Assieds-toi, Zébulon, voici une chaise vide.
Zébulon aurait bien voulu distribuer encore quelques embrassades au givre autour de lui, mais on le fit asseoir de force.
–Mais ch’oggube la blace de guelgu’un?
–Ne t’inquiète de rien, reste tranquille, c’est la place du ministre.
–Du ministre! s’écria Zébulon, appuyant ses deux mains sur la table pour se relever (car ses pieds engourdis refusaient le service). Ah! che ne m’azieds pas tans une chaisse à ministre.
–Ne bouge pas! lui dit le fonctionnaire, et il lui parla tout bas.
Son autre voisin lui donna aussi quelques explications.
–Ah! ah! alors c’est pien, dit Zébulon avec satisfaction. Et il s’enfonça dans sa chaise, pendant que les laquais s’empressaient d’apporter tout ce qui restait du festin: un superbe fogas, du faisan, de la salade, des mets sucrés, etc.
Zébulon goûtait de tout, à tort et à travers, mélangeant ce qu’il avait devant lui, la crème fouettée avec le faisan, les beignets avec le poisson. Qu’importe? tout ne devait-il pas se réunir dans le même estomac! Tout en mangeant, il raconta à l’assemblée les péripéties de son voyage.
–Che suis en route depuis trois chournées. Ch’étais heureusement arrivé jusqu’à la ternière poste. Che temante tes relais. Rien! Tous geval partis depuis la veille pour l’enderrement. Che crie, che tis gui che suis, che menace; en fain! Alors ch’avisse un brafe homme et lui offre une pelle somme d’archent pour me tirer d’emparras, n’importe gomment, et le coquin attèle à ma pelle galèche quatre affreux puffles, et ainsi ch’ai été draîné!
Zébulon avait une expression si tragique, en racontant comment les quatre buffles l’avaient amené, que les assistants purent à peine s’empêcher de rire, d’autant plus qu’il était en train de manger des choux-fleurs avec une compote de fraises, ce qui était de l’effet le plus grotesque.
–Encore s’ils m’avaient draîné honnêtement, reprit Zébulon; mais, en passant devant un étang, les malheureux troufèrent qu’il faisait chaud quoiqu’il chelât, et les foilà tetans, et la galèche après, et nous restons au beau milieu, teux heures, chusqu’à ce que la fantaisie des puffles fut bassée. Et alors che suis arrivé en retard: che n’ai eu ni oraison funèbre, ni brédication, ni atieu, pas même une betite brière!
–Oh! pour cela, vous n’avez pas perdu beaucoup, interrompit le haut fonctionnaire.
Ceci fit réfléchir Zébulon. La chaise était vide, la prière avait déplu, il devait y avoir quelque chose là-dessous.
Cependant il tâchait de rattraper ses amis, en mettant les morceaux doubles, et il arriva enfin au café. Alors il demanda au fonctionnaire l’explication de l’énigme.
Tous ses cheveux se dressèrent sur sa tête quand il apprit ce qui était arrivé.
–Mais c’est inouï!
Personne ne défendit le ministre. Zébulon continua donc, tout en buvant son café par petites gorgées:
–Che le ferais jasser tu derritoire, moi! Che le ferais citer defant le consistoire! Che lui tonnerais des goups de ganne!
Puis, à chaque phrase, il jetait en souriant un coup d’œil sur l’assemblée pour obtenir une approbation.
–Pourvu qu’il ne lui arrive pas de plus grand malheur! dit Rideghvary, pendant que Zébulon ramassait le sucre au fond de sa tasse. Il pourrait être appelé ad audiendum verbum[29].
–C’est ce qu’il lui faut! c’est ce qu’il lui faut! cria Zébulon. C’est ce que che foulais tire. Il lui faut un beu de brison, dix ans de Kufstein[28], réfolutionnaire, perturpateur!
Le haut fonctionnaire, voyant que la séance se prolongeait un peu trop et que le jour baissait, interrompit le discours de Zébulon, et, donnant le signal, il se leva de table.
Il fallait songer au départ. Il n’est pas d’usage que les invités passent la nuit dans la maison mortuaire. Il s’agissait donc d’élire la députation de dix membres qui devait prendre congé de la maîtresse de la maison et lui présenter encore une fois les condoléances de toute l’assemblée.
Pendant ce temps, le majordome donnait des ordres pour que chaque invité trouvât son équipage tout prêt, et Zébulon ses quatres buffles.
Il va sans dire que Zébulon ne manqua pas de se déléguer lui-même et de se joindre à la députation. Il passa deux ou trois fois la main sur les manches de son habit, puis, se croyant suffisamment brossé, il monta avec ses compagnons à l’étage supérieur où les attendait Mme de Baradlav.
Elle était prête à les recevoir, très pâle, et se tenait immobile, comme une statue de marbre, près de son bureau. La chambre, toute tendue de soie gros bleu, était obscurcie par d’épais rideaux de la même étoffe.
Ce fut l’évêque de l’oraison funèbre qui parla le premier à la veuve. Il versa sur sa douleur le baume de quelques phrases bibliques.
Le second évêque lui fit ensuite quelques citations, toujours empruntées à différents auteurs profanes.
Enfin le haut fonctionnaire s’approcha d’elle, lui prit familièrement la main, et l’assura que sijamais sa douleur augmentait de façon à devenir insupportable, elle eût à se souvenir de lui, son ami le plus fidèle et qui partageait toutes ses angoisses.
Sur ce, la députation aurait dû prendre congé. Mais la maison se serait écroulée sur lui, que Zébulon aurait encore trouvé le moyen de dire ce qui lui tenait au cœur, et ce que les autres avaient, selon lui, oublié de dire.
–Je suis au tésespoir, commença-t-il, de n’afoir bas eu le plaisir d’assister à l’enterrement.
–Ce n’est pas un plaisir, Zébulon, lui dit son voisin à l’oreille.
–J’ai été embêché, continua-t-il sans se troubler, et che regrette de ne bas afoir bayé le tribut de mes larmes à ce crand homme. Ah! si ch’avais été ici guand cet infâme ministre a tit cette brière plasphémadoire, il n’aurait bu agever!.
Le voisin tira violemment l’habit de Zébulon, qui, croyant avoir fait une faute de grammaire, s’empressa de reprendre:
–Agever. elle! Mais, n’ayez bas beur, il sera puni, renvoyé. Ce n’est pas assez, il sera abbelé, «ad audiendum verbum,» il coûtera de la brison. Là il aura le temps d’abbrendre à tire les brières. Nous le bunirons nous teux, M. de Rideghvary et moi, gonsolez-vous
La belle femme pâle tourna alors ses yeux expressifs non sur Zébulon, mais sur le fonctionnaire, et elle le regarda si longuement et si fixement qu’il ne put soutenir ce regard.
Heureusement le voisin officieux tira si fort l’habit de Zébulon que celui-ci en fut étranglé un instant, ce qui l’empêcha de pérorer plus longtemps. Alors la veuve salua avec dignité et se retira. Zébulon promena des regards triomphants sur l’assemblée: c’était lui qui avait parlé le plus longtemps.
Une demi-heure plus tard, des nuées de poussière accompagnaient les différents équipages qui quittaient le château de Nemesdomb, et, quand la nuit vint, tout était redevenu calme dans la maison du baron de Baradlay.
IVDEUX BONS AMIS.
Nous sommes dans une immense salle de malachite[8q]. De gracieuses colonnes élancées, taillées d’une seule pièce, soutiennent le plafond. A l’entour des colonnes on aperçoit des plantes rares, groupées avec art, entre autres, de superbes agaves portant fièrement leurs bouquets de fleurs attendus pendant cent ans, et le palmier d’Amérique, dont les feuilles immenses couvrent une partie de la salle.
Des milliers de prismes gigantesques descendent du plafond, entourant des lampes brillantes qui renvoient toutes les couleurs de l’arc-en-ciel.