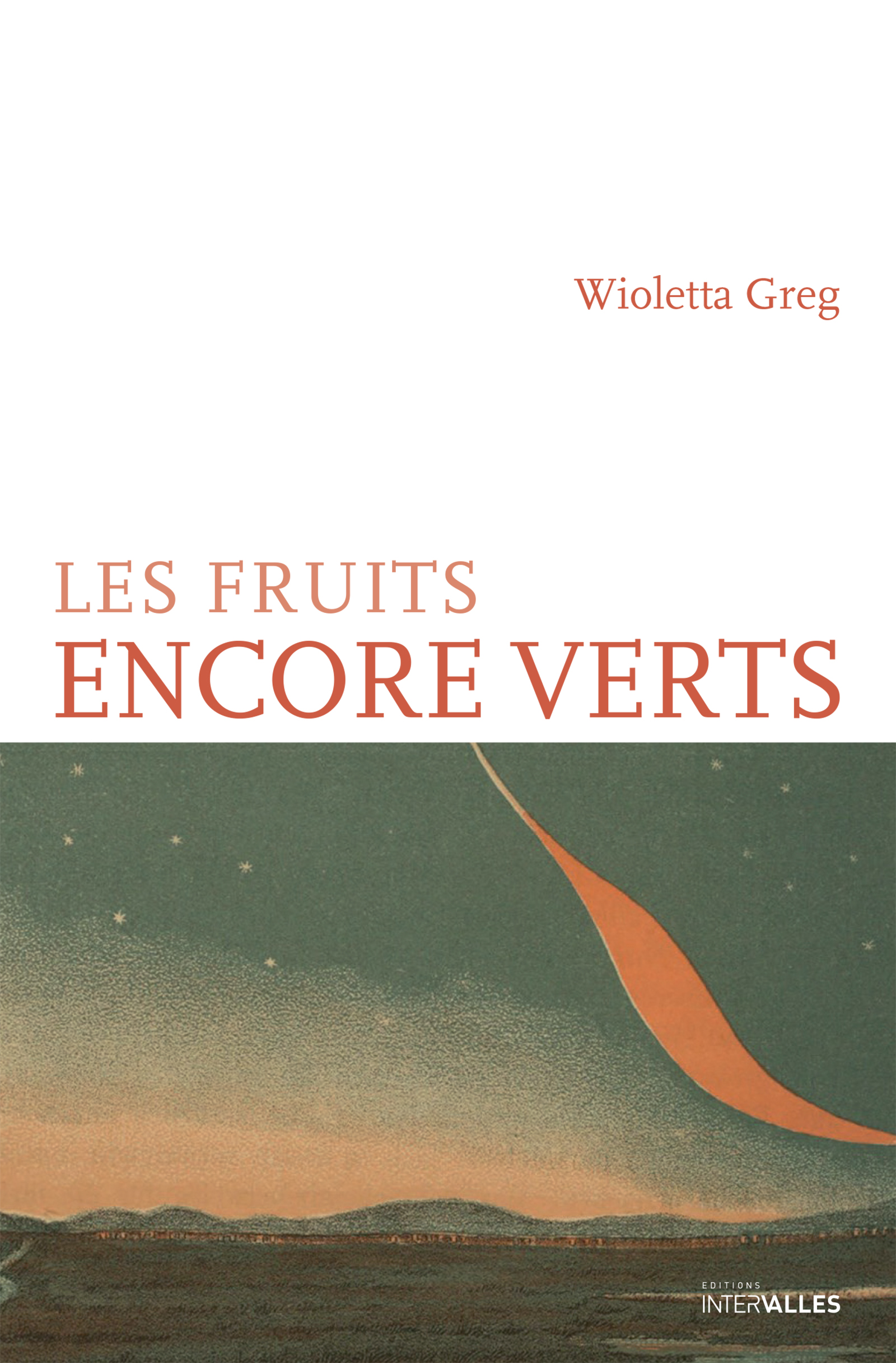
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Intervalles
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Les Fruits encore verts est un portrait riche, subtil et texturé de la vie rurale dans la Pologne communiste des années 1970 et 1980. Par le regard d’une enfant au seuil de l’adolescence, on pénètre un monde où les superstitions n’ont pas disparu des sovkhozes et où la religion, voire certains rites païens, coexistent avec les directives du parti.
Dans cet univers où les hommes et les femmes semblent mener des vies parallèles, la solidarité des femmes entre elles s’exerce autour de traditions parfois folkloriques dont Wioletta Greg, tout en nuances et en clair-obscur, peint avec subtilité l’humanité. Malgré ses apparences de bourgade assoupie, ce village cache bien des secrets, même les personnages auxquels on donnerait le bon Dieu – ou la médaille de Lénine – sans confession. Discrètement, les ombres allemande et soviétique planent derrière toute l’histoire du village et de la famille de la narratrice. Car les personnages, même les plus secondaires, sont à la fois archétypaux et enracinés dans un moment particulier de l’histoire polonaise récente.
L’écriture de Wioletta Greg, d’une sensualité rare, restitue avec peu d’effets mais sur un rythme extrêmement mélodieux une époque et un monde à la fois si proches et si lointains pour donner naissance à un roman d’éducation en forme de brillant exorcisme.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
« Chaleureux et drôlement subversif. »
Times Literary Supplement
« Un premier roman plein de maîtrise et de charme. »
Kirkus Reviews
« Un joyau. »
The Guardian
« Un petit bijou de livre. » Barbara Lambert,
RCJ
À PROPOS DE L'AUTEURE
Wioletta Greg est née en 1974 dans le Jura polonais. En 2006, elle quitte la Pologne pour s’installer au Royaume-Uni. Elle a publié plusieurs recueils de poésie, ainsi que deux romans, dont
Les Fruits encore verts, inspiré de son enfance dans la Pologne des années 1970 et 1980. Ses œuvres sont traduites notamment en anglais, en italien, en allemand en catalan et en espagnol.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
La petite brebis égarée
Ma cape de baptême, avec son petit bouquet de pervenches et d’asparagus fanés, était restée accrochée près de deux ans à la fenêtre de notre maison en pierre. Elle me faisait envie, cette cape clap-clap, avec sa petite rose brodée au milieu. J’en aurais bien fait une couverture pour mes poupées, mais maman me défendait d’en approcher.
— N’y touche pas, Loletka, c’est un souvenir, on la décrochera quand papa reviendra, disait-elle.
Elle avait raconté à une voisine passée la voir deux minutes, autrement dit deux heures, comment, un mois après l’arrestation de papa pour désertion et deux semaines avant d’accoucher, elle avait été affectée à un chantier de la Suw-Bud. Dans le cadre du nouveau plan quinquennal, sa brigade, qui comptait douze travailleuses, devait produire des dalles et des pavés pour que la commune puisse aménager à temps les parvis des bâtiments administratifs, des écoles et des centres de santé. Elle travailla jusqu’au jour où elle ne supporta plus le froid, alla se réfugier derrière la bétonnière et là, perdit les eaux dans le seau à chaux. On la transporta alors à la maternité. Elle rentra à la maison avec moi en février. Comme elle perdait toujours du sang après l’accouchement, elle s’allongea sur le lit, me démaillota de mes langes qui dégageaient une odeur d’urine et de matières visqueuses pour vérifier que j’étais bien entière, badigeonna de gentiane le moignon de mon ombilic, noua un ruban rouge à mon poignet pour éloigner le mauvais sort et s’endormit plusieurs heures. De ce genre de sommeil où l’on décide de dire adieu à la vie ou de s’y accrocher.
Papa ne rentrait toujours pas. Ses lettres, couvertes de dessins d’animaux et de plantes, s’accumulaient dans la boîte à chaussures tandis que l’éphéméride s’effeuillait et qu’il ne restait plus qu’une fine liasse de jours avant la fin de l’année. Les mois passèrent. Des canetons venaient d’éclore dans le vestibule, maman les transporta dans la porcherie avec leur mère pour les rapprocher du demi-pneu rempli d’eau qui se trouvait dans la cour. Grand-père commença à fabriquer de nouveaux volets pour le grenier ainsi que la bascule de mon cheval. Grand-mère confectionnait de petits coqs multicolores avec des copeaux de tremble. Les mouches se remirent à bourdonner entre les doubles fenêtres. La cape avait perdu ses couleurs et le rebord de la fenêtre était semé de feuilles de pervenche lorsqu’un monsieur maigre à moustache et aux cheveux frisés arriva à la maison. En me voyant, il fondit en larmes et pleura toute la journée. Il ne se calma qu’avec le Mondial de foot, quand les Polonais commencèrent à jouer.
En juin, nous nous rendîmes à la kermesse de la paroisse Saint-Antoine. La procession s’ébranla. Le prêtre sortit de l’église suivi d’un cortège de bannières couvertes de broderies, de dames déguisées en princesses avec des couronnes et des agneaux en paille. Les communiantes jetaient des fleurs de lupin sur leur passage. J’étais fascinée et, quand maman se mit à chercher dans son sac de la monnaie pour la quête, j’en profitai pour lui lâcher la main et m’élancer à la suite du cortège royal. Je courus longtemps avant de m’arrêter près d’un stand où flottait une baleine gonflable argentée. Elle ne risquait pas de s’envoler dans les nuages, le soleil l’avait piégée dans des cercles rouges et violets. Il m’aveuglait et me brûlait les joues. La foule dorée disparaissait au milieu des carrioles et des voitures, laissant derrière elle de longues ombres sur le mur de la basilique.
Sous un arbre se trouvait un lama en mue. De la bave dégoulinait de son museau. Les gens s’approchaient, jetaient de l’argent dans une boîte enchaînée au grillage, puis installaient leurs enfants sur le dos de l’animal protégé par une couverture bariolée. Ensuite, un monsieur coiffé d’un chapeau de paille les prenait en photo avec un appareil astucieux qui recrachait les images aussitôt. Le lama, sous ses longs cils, avait un regard triste. De petites ampoules grillées tournoyaient dans ses yeux. Je m’apprêtais à caresser sa frange ébouriffée quand soudain retentit un coup de feu venant du stand de tir. Effrayé, le lama sursauta, et je me réfugiai précipitamment sous l’étal le plus proche protégé par une toile cirée. Au-dessus de moi, j’entendais le bruissement des ballons en aluminium, le son des trompettes, des sifflets, des harmonicas et des crécelles. Je me bouchai les oreilles et restai sous l’étal. Du jus de framboise coulait de la toile cirée sur ma robe neuve.
Des guêpes, tels des piranhas rayés, commencèrent à virevolter autour de mes nattes. Elles aspiraient le jus des jolies petites roses sur ma robe et n’en finissaient pas de grossir. La plus énorme, posée sur ma tête, bourdonna tout près de mon oreille. Je me couchai à même le sol et fondis en larmes :
— Maman, maman ! Les guêpes veulent me manger toute crue !
Mais maman était loin. La toile cirée se souleva et monsieur Moustache apparut.
— Ah ! te voilà, petite coquine ! Il me tira de mon refuge et me serra dans ses bras. Qu’est-ce qu’elle fabriquait, ma petite brebis égarée ? Je l’ai cherchée partout.
— Lâche-moi, papa ! Lâche-moi ! m’écriai-je joyeusement, essuyant furtivement ma morve sur le revers de sa veste.
Monsieur Moustache, tout heureux de m’entendre l’appeler papa pour la première fois, me fit tournoyer dans les airs. Les yeux fermés, je riais aux éclats. Le soleil piqua les guêpes les unes après les autres qui reprirent une taille normale puis s’envolèrent à travers les cercles rouges et violets. La lumière me chatouillait comme l’eau de mon bain dans le baquet de la cour. Je commençais à avoir faim et mordillais la ceinture de ma robe. Une tête émergea de l’arrêt d’autocar plongé dans l’obscurité : maman, avec un collier d’obwarzanki1 autour du cou.
1 Petits pains en forme d’anneaux, souvent recouverts de graines de pavot et enfilés sur une cordelette. (N.d. T.)
Le gros lot
Malgré l’interdiction de maman, je me mis à dormir avec Asphalte. Il sentait le foin et le lait, il avait sur le cou une carte d’Afrique blanche comme neige. Il venait me voir en pleine nuit, s’allongeait sur l’édredon et ronronnait en remuant ses pattes comme s’il voulait pétrir du pain. Depuis le jour où je l’avais trouvé dans le grenier, je vivais avec lui dans une drôle de symbiose : je le portais dans mon pull comme un nouveau-né, chipais pour lui de la crème dans le buffet et, le dimanche, lui donnais mon aile de poulet.
Tout l’été, nous vagabondions ensemble dans les champs, Asphalte me faisait découvrir une autre géométrie du monde, un monde dont les limites n’étaient pas tracées par des chemins envahis de chardons et d’arroche, par des passages empierrés, des haies ou encore des sentiers fauchés ou foulés par l’homme, mais par la lumière, les sons et les forces naturelles. J’appris à suivre Asphalte entre les parpaings, les meules de foin, à grimper aux pommiers et aux cerisiers, à éviter les puits de calcaire enfouis sous les ronces, les nids de frelons, les terrains marécageux et les pièges à gibier dans les champs de blé.
Après les fêtes de Noël, Asphalte commença à me fuir. Il ne faisait que quelques courtes apparitions dans la maison, déposait sur le seuil une souris à demi morte, comme pour excuser son absence par cette offrande. Le premier jour des vacances d’hiver, il disparut pour de bon. Je le cherchai sous les bâches et dans les cages à ragondins de mon oncle où il passait ses journées à somnoler, mais il restait introuvable.
Mon suspect numéro un dans l’affaire de la disparition d’Asphalte était oncle Lolek qui, quelques mois plus tôt, avait réussi à se procurer un grand sac de sucre et l’avait caché dans sa remise à charbon, Asphalte en avait fait son bac à litière. Je courus donc chez mon oncle, armée du fusil de papa, pointai l’arme sur lui et lui intimai de me rendre Asphalte sur-le-champ en criant que je ne le laisserais pas transformer mon chat en peau de lapin et en saucisson comme il le faisait avec ses ragondins puants. D’abord complètement interloqué, mon oncle fut pris d’un tel rire qu’il faillit en tomber dans le tonneau de chou mariné. Il m’offrit des bonbons pour me remercier de l’avoir mis de bonne humeur dès le matin.
Le lendemain à l’aube, j’interrogeai le laitier, qui avait arrêté son cheval devant chez nous pour hisser les bidons sur sa charrette avec son crochet.
— Vous n’avez pas vu Asphalte ?
— Qui ça ?
— Un chat noir.
— Pfff, Dieu m’en garde, manqu’rait plus qu’ça, qu’un chôt noir pôsse sur ma route ! Ah ! Attends un peu, y en avait un tout plein de taches qui traînait près du pont.
— Non, le mien n’a pas de taches. Si jamais vous en voyez un noir, prévenez-moi.
— Eh, Wiolitka, attends ! J’ai què’qu’chose pour toi.
Il me donna un petit fromage blanc à la vanille de la coopérative, puis fouetta son cheval.
J’errai encore deux heures dans Hektary, inspectai chaque gouttière et chaque buisson d’osier. Frigorifiée, je finis par rentrer à la maison. Mon père était revenu du travail. Assis sur le canapé, il taillait un flotteur dans de la mousse de polyester en se réchauffant les pieds dans une bassine d’eau salée. J’en profitai pour grimper en douce au grenier par l’échelle, où je fouillai le foin à la recherche d’un indice laissé par Asphalte : une touffe de poils, une plume, une coquille d’œuf…
— Qu’est-ce que tu fabriques là-haut par un froid pareil ? me cria mon père.
— J’attends Asphalte, papa. Ça fait déjà trois jours qu’il a disparu.
— Descends, tu vas geler. On va faire cuire des pommes de terre dans la cendre.
— Je descendrai pas tant qu’Asphalte sera pas revenu.
— Allez, descends ! Je sais ce qui lui est arrivé.
Je dévalai l’échelle à tire-d’aile. Coup de chance : un sac d’avoine était appuyé contre les barreaux du bas, sans lui, mes dernières dents de lait auraient sauté. Je m’assis dans le coin près du sapin de Noël et, impatiente d’entendre des nouvelles d’Asphalte, je triturais les aiguilles tombées sur le sol, mais mon père restait muet. Il finissait de peindre une bande jaune vif sur son flotteur. Il le posa enfin sur le journal près du poêle et s’installa en face de moi.
— Eh bien… Comment te dire ça… commença-t-il. Il y a trois jours, au bord de l’étang, Asphalte a voulu attraper un poisson coincé dans un des pièges à rats musqués et il s’est noyé, me récita-t-il d’une traite, avant de me lancer un regard inquiet.
Je m’allongeai sur le canapé, le dos tourné à la pièce. Pendant la semaine qui suivit, je n’adressai la parole à personne, sinon à moi-même, tout bas. Mon silence ne paraissait même pas étrange puisque tout le monde à la maison chantonnait ou murmurait dans sa barbe. Par exemple, penchée sur sa planche à pâtisserie, ma grand-mère récitait des litanies de Lorette en découpant des pâtes pour la soupe ; « Mère Ceci, Mère Cela » chuchotaient à leur tour les murs et la poule en verre ; « Mère Ceci, Mère Cela » répétaient les miroirs, les tapisseries, les vieux ressorts du canapé monté sur ses quatre roulettes en bois de bouleau. Mon père fredonnait des chansons de Presley et des ballades de prisonniers comme Pain noir, café noir en sifflant, une feuille de tilleul entre les lèvres, ou en grattant son banjo ; maman chantait Une abeille s’est posée sur le pommier, mais seulement quand elle était énervée ; le matin, mon grand-père descendait dans le puits de calcaire en chantant « le 1er septembre, Hitler l’insolent s’est juré de partir en guerre contre la terre entière ». Mais dès que je parlais ou chantonnais toute seule, tous me lançaient des regards étonnés et maman augmentait la dose de Milocardin dans ma petite cuillère.
Je passais la deuxième semaine des vacances à la fenêtre à arroser les géraniums avec mon infusion de menthe froide. Je souffrais de maux de ventre, car j’avais avalé en cachette des morceaux de chaux et des franges du couvre-lit parce que Asphalte me manquait.
La tiédeur de mon souffle chaud avait créé une lézarde entre les fougères de givre sur la vitre. Je pouvais ainsi observer ce qui se passait dans la cour. Une heure plus tard, le portail grinça. J’entendis la voix de Justyna et du Grand Witek, mes camarades demandaient à maman en train de répandre les cendres du poêle sur le chemin si j’irais à la basilique Saint-Antoine pour la journée de prière.
— Wiolka n’ira sûrement pas, leur répondit ma mère de sa voix enrouée. Elle a mal au ventre.
— Mais, M’dame, après, y aura la loterie, la coupa le Grand Witek.
— Quelle loterie ?
— Et ben, le tirage au sort de la statue bénite, expliqua Justyna.
— Allez peut-être lui en parler vous-mêmes.
— Pas la peine ! – J’étais déjà dehors, emmitouflée jusqu’aux oreilles dans mon châle de laine. – Je vais avec eux.
Maman parut étonnée de ma guérison soudaine, mais elle ne dit rien. Du bout de sa botte en caoutchouc, elle dessina un arc de cercle dans les cendres chaudes sous lesquelles apparut de l’herbe brune, ramassa un clou noirci, le lança vers le tas de sable et rentra dans la maison.
L’après-midi, la centrale électrique de Łagisza annonça à la radio une réduction de production niveau dix. Le courant avait été coupé dans toute la paroisse et il faisait un froid de canard dans l’église. Une bonne centaine d’enfants envoyait des nuages de vapeur sous la voûte, où les saints grassouillets nageaient comme dans le lac Balaton. Seuls quelques cierges sur les autels éclairaient les trois nefs. Le soleil couchant transperçait de sa fourche le Jésus en argile dressé sur son socle, drapé de bleu et le cœur couronné d’épines. Dans une nef latérale, j’observai une souris errant dans les labyrinthes des stucs dorés.
Après la prière, on jeta des petits papiers avec le tampon de la paroisse dans une urne en bois. Une fillette de dix ans à peine, déguisée en ange, tira un billet et le remit au vicaire. Le silence se fit. Le courant fut rétabli. La lumière nous aveuglait. Le souffle des radiateurs se répandit dans l’église comme le déluge. Le curé prononça mon nom. Les ex-voto renvoyèrent l’écho de sa voix. Sous le coup de l’émotion, j’avalai le chewing-gum que le Grand Witek m’avait donné. L’organiste entonna le cantique de La barque : « Seigneur, c’est moi que tu regardes. Ton sourire m’appelle par mon nom. » Les enfants s’écartèrent pour me laisser passer. Justyna me poussa au milieu de l’église. Je m’avançai dans la clarté dorée jusqu’à l’autel. Le vicaire me tendit son étole à baiser, puis la statue de Jésus. Quelqu’un m’attrapa par le cordon de mes gants et m’entraîna sur le côté. Je quittai l’église, escortée par les enfants de Hektary, en oubliant de me tremper les doigts dans le bénitier.
J’enveloppai la statue dans mon châle. Justyna, le Grand Witek et moi la portâmes à tour de rôle, tel le Saint-Sacrement, sur les quatre kilomètres qui nous séparaient de Hektary. La nuit tombait, la neige glacée pénétrait dans nos bottes, nos mains étaient gelées, mais nous n’y prêtions pas attention. Nous étions tellement excités par le lot que j’avais gagné que nous nous signâmes devant toutes les chapelles au bord du chemin et devant la source sacrée. Le Grand Witek répéta le geste devant la maison de la directrice de l’école, au cas où son doberman aurait surgi à travers un trou de la clôture.
Devant le puits, je dis au revoir à mes amis et courus jusqu’à la maison. Je m’arrêtai un instant dans l’entrée pour déballer ma statue. Je fis irruption dans la pièce éclairée, comme le curé faisant sa tournée de Noël, et posai le Jésus sur la table. La veillée de plumage avait justement lieu chez nous et à ma vue, toutes les femmes qui aidaient ma grand-mère à trier les plumes restèrent bouche bée. Elles abandonnèrent leurs cribles remplis de duvet sur les chaises, s’agenouillèrent sur le sol tapissé de blanc et se mirent à prier. À peine eurent-elles récité deux dizaines de chapelets que leurs maris, inquiets, vinrent frapper à nos fenêtres.
Tard dans la nuit, tandis que toutes les femmes étaient reparties chez elles, que la respiration paisible de mes parents endormis me parvenait par la porte entrouverte et que le feu s’éteignait dans le poêle, j’emportai la statue dans la salle à manger pour l’installer sur le napperon amidonné où, jusque-là, trônait la poule en verre et mouraient les mouches. Je m’emmitouflai dans mon édredon – le froid de l’hiver 1981 était terrible – et je restai si longtemps à monter la garde dans l’obscurité que la statue s’éleva légèrement au-dessus du napperon. Rassemblant alors tout mon courage, je demandai à Jésus de ressusciter mon Asphalte.
Petite table, sois mise !
Réveillée à l’aube, j’aperçus une silhouette s’avançant dans la pièce sur la pointe des pieds. C’était mon père. Avec sa pèlerine et ses bottes en caoutchouc, on aurait dit Don Pedro le mystérieux dans le dessin animé L’enlèvement de Balthazar Éponge. Le grincement des gonds de la porte lui arracha un juron. Nos regards se croisèrent dans la pénombre. Papa posa le doigt sur ses lèvres pour que je ne fasse pas de bruit et ne réveille pas maman, mais elle était déjà debout depuis longtemps. Elle savait bien à quelle heure papa revenait de la pêche le dimanche. J’entendais des bruits de casseroles et de fourneau qu’on allume. Mon père ôta sa pèlerine, s’assit sur le canapé, plongea la résistance dans le petit pot rempli d’eau et s’endormit aussitôt. L’eau dansait, giclait au plafond et retombait en petites gouttes sur la table dont les fentes étaient imprégnées du sang de la belette empaillée cette semaine-là. Un quart d’heure plus tard, ma mère entra dans la pièce.
— Rysiek, lève-toi ! Allez, lève-toi ! murmura-t-elle à mon père qui dans son rêve pourchassait un cerf magnifique.
— Hum, hum, grogna-t-il. Ah, je l’empaillerais bien celui-là, et je l’exposerais devant la maison, tout le village viendrait l’admirer.
— Rysiek, je t’ai pas fait ton omelette pour rien. Viens la manger, elle va refroidir.
Ce haussement de ton le ramena à la réalité, mais il eut sans doute le temps d’apercevoir la chevelure dorée de sa femme scintiller entre les buissons. Elle avait l’air de sainte Cunégonde tombée amoureuse d’un cerf.
— Mais d’où elle sort ? dit-il en se frottant les yeux. Oscillant entre rêve et réalité, il lui semblait avoir les cuisses hérissées d’aiguilles de pin et les chaussures pleines de ronces. Bizarrement, quand il se réveilla, je sentis une odeur de forêt dans la pièce. Mon père alla s’asseoir et se pencha au-dessus de son assiette comme un pêcheur au-dessus de la rivière.
— Il va sûrement me falloir un kilo d’alun et quelques mètres de fil de fer.
— Encore tes empaillages ? Ne me dis pas que tu as encore rapporté une charogne à la maison ! Il y a déjà trois cadavres dans l’entrée. À quoi ça te sert, tout ça ? Toutes ces bêtes crevées ? C’est notre maison, ici, pas celle du garde forestier. Tu fais tituber Wiolka avec ta colle.





























