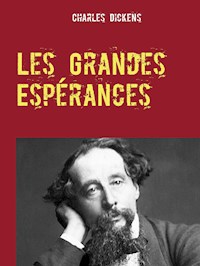
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Philip Pirrip, surnommé Pip, est un jeune Anglais qui habite un petit village du Kent, dans le Sud-Est de l'Angleterre. Orphelin, il vit chez sa soeur, mariée à Joe Gargery, le forgeron du village, un homme au coeur bon et à l'âme honnête. C'est par un soir de Noel que commence son histoire.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 998
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les Grandes Espérances
Pages de titreTOME PREMIER – CHAPITRE I.CHAPITRE II.CHAPITRE III.CHAPITRE IV.CHAPITRE V.CHAPITRE VI.CHAPITRE VII.CHAPITRE VIII.CHAPITRE IX.CHAPITRE X.CHAPITRE XI.CHAPITRE XII.CHAPITRE XIII.CHAPITRE XIV.CHAPITRE XV.CHAPITRE XVI.CHAPITRE XVII.CHAPITRE XVIII.CHAPITRE XIX.CHAPITRE XX.CHAPITRE XXI.CHAPITRE XXII.CHAPITRE XXIII.CHAPITRE XXIV.CHAPITRE XXV.CHAPITRE XXVI.CHAPITRE XXVII.CHAPITRE XXVIII.CHAPITRE XXIX.TOME SECOND – CHAPITRE I.CHAPITRE II. - 1CHAPITRE III. - 1CHAPITRE IV. - 1CHAPITRE V. - 1CHAPITRE VI. - 1CHAPITRE VII. - 1CHAPITRE VIII. - 1CHAPITRE IX. - 1CHAPITRE X. - 1CHAPITRE XI. - 1CHAPITRE XII. - 1CHAPITRE XIII. - 1CHAPITRE XIV. - 1CHAPITRE XV. - 1CHAPITRE XVI. - 1CHAPITRE XVII. - 1CHAPITRE XVIII. - 1CHAPITRE XIX. - 1CHAPITRE XX. - 1CHAPITRE XXI. - 1CHAPITRE XXII. - 1CHAPITRE XXIII. - 1CHAPITRE XXIV. - 1CHAPITRE XXV. - 1CHAPITRE XXVI. - 1CHAPITRE XXVII. - 1CHAPITRE XXVIII. - 1CHAPITRE XXIX. - 1Page de copyrightLes Grandes Espérances
Charles Dickens
TOME PREMIER – CHAPITRE I.
Le nom de famille de mon père étant Pirrip, et mon nom de
baptême Philip, ma langue enfantine ne put jamais former de ces
deux mots rien de plus long et de plus explicite que Pip. C’est ainsi
que je m’appelai moimême Pip, et que tout le monde m’appela Pip.
Si je donne Pirrip comme le nom de famille de mon père, c’est
d’après l’autorité de l’épitaphe de son tombeau, et l’attestation de ma
sœur, Mrs Joe Gargery, qui a épousé le forgeron. N’ayant jamais vu
ni mon père, ni ma mère, même en portrait puisqu’ils vivaient bien
avant les photographes, la première idée que je me formai de leur
personne fut tirée, avec assez peu de raison, du reste, de leurs pierres
tumulaires. La forme des lettres tracées sur celle de mon père me
donna l’idée bizarre que c’était un homme brun, fort, carré, ayant les
cheveux noirs et frisés. De la tournure et des caractères de cette
inscription : Et aussi Georgiana, épouse du cidessus, je tirai la
conclusion enfantine que ma mère avait été une femme faible et
maladive. Les cinq petits losanges de pierre, d’environ un pied et
demi de longueur, qui étaient rangées avec soin à côté de leur tombe,
et dédiées à la mémoire de cinq petits frères qui avaient quitté ce
monde après y être à peine entrés, firent naître en moi une pensée que
j’ai religieusement conservée depuis, c’est qu’ils étaient venus en ce
monde couchés sur leurs dos, les mains dans les poches de leurs
pantalons, et qu’ils n’étaient jamais sortis de cet état d’immobilité.
Notre pays est une contrée marécageuse, située à vingt milles de
la mer, près de la rivière qui y conduit en serpentant. La première
impression que j’éprouvai de l’existence des choses extérieures
semble m’être venue par une mémorable aprèsmidi, froide, tirant
vers le soir.
À ce moment, je devinai que ce lieu glacé, envahi par les orties,
était le cimetière ; que Philip Pirrip, décédé dans cette paroisse, et
Georgiana, sa femme, y étaient enterrés ; que Alexander,
Bartholomew, Abraham, Tobias et Roger, fils desdits, y étaient
également morts et enterrés ; que ce grand désert plat, audelà du
cimetière, entrecoupé de murailles, de fossés, et de portes, avec des
bestiaux qui y paissaient çà et là, se composait de marais ; que cette
petite ligne de plomb plus loin était la rivière, et que cette vaste
étendue, plus éloignée encore, et d’où nous venait le vent, était la
mer ; et ce petit amas de chairs tremblantes effrayé de tout cela et
commençant à crier, était Pip.
« Taistoi ! s’écria une voix terrible, au moment où un homme
parut au milieu des tombes, près du portail de l’église. Tienstoi
tranquille, petit drôle, où je te coupe la gorge ! »
C’était un homme effrayant à voir, vêtu tout en gris, avec un
anneau de fer à la jambe ; un homme sans chapeau, avec des souliers
usés et troués, et une vieille loque autour de la tête ; un homme
trempé par la pluie, tout couvert de boue, estropié par les pierres,
écorché par les cailloux, déchiré par les épines, piqué par les orties,
égratigné par les ronces ; un homme qui boitait, grelottait, grognait,
dont les yeux flamboyaient, et dont les dents claquaient, lorsqu’il me
saisit par le menton.
« Oh ! monsieur, ne me coupez pas la gorge !… m’écriaije avec
terreur. Je vous en prie, monsieur… ne me faites pas de mal !…
— Dismoi ton nom, fit l’homme, et vivement !
— Pip, monsieur…
— Encore une fois, dit l’homme en me fixant, ton nom… ton
nom ?…
— Pip… Pip… monsieur…
— Montrenous où tu demeures, dit l’homme, montrenous ta
maison. »
J’indiquai du doigt notre village, qu’on apercevait parmi les
aulnes et les peupliers, à un mille ou deux de l’église.
L’homme, après m’avoir examiné pendant quelques minutes, me
retourna la tête en bas, les pieds en l’air et vida mes poches. Elles ne
contenaient qu’un morceau de pain. Quand je revins à moi, il avait
agi si brusquement, et j’avais été si effrayé, que je voyais tout sens
dessus dessous, et que le clocher de l’église semblait être à mes
pieds ; quand je revins à moi, disje, j’étais assis sur une grosse
pierre, où je tremblais pendant qu’il dévorait mon pain avec avidité.
« Mon jeune gaillard, dit l’homme, en se léchant les lèvres, tu as
des joues bien grasses. »
Je crois qu’effectivement mes joues étaient grasses, bien que je
fusse resté petit et faible pour mon âge.
« Du diable si je ne les mangerais pas ! dit l’homme en faisant un
signe de tête menaçant, je crois même que j’en ai quelque envie. »
J’exprimai l’espoir qu’il n’en ferait rien, et je me cramponnai plus
solidement à la pierre sur laquelle il m’avait placé, autant pour m’y
tenir en équilibre que pour m’empêcher de crier.
« Allons, dit l’homme, parle ! où est ta mère ?
— Là, monsieur ! » répondisje.
Il fit un mouvement, puis quelques pas, et s’arrêta pour regarder
pardessus son épaule.
« Là, monsieur ! reprisje timidement en montrant la tombe.
Aussi Georgiana. C’est ma mère !
— Oh ! ditil en revenant, et c’est ton père qui est là étendu à côté
de ta mère ?
— Oui, monsieur, disje, c’est lui, défunt de cette paroisse.
— Ah ! murmuratil en réfléchissant, avec qui demeurestu, en
supposant qu’on te laisse demeurer quelque part, ce dont je ne suis
pas certain ?
— Avec ma sœur, monsieur… Mrs Joe Gargery, la femme de Joe
Gargery, le forgeron, monsieur.
— Le forgeron… hein ? » ditil en regardant le bas de sa jambe.
Après avoir pendant un instant promené ses yeux alternativement
sur moi et sur sa jambe, il me prit dans ses bras, me souleva, et, me
tenant de manière à ce que ses yeux plongeassent dans les miens, de
haut en bas, et les miens dans les siens, de bas en haut, il dit :
« Maintenant, écoutemoi bien, c’est toi qui vas décider si tu dois
vivre. Tu sais ce que c’est qu’une lime ?
— Oui, monsieur…
— Tu sais aussi ce que c’est que des vivres ?
— Oui, monsieur… »
Après chaque question, il me secouait un peu plus fort, comme
pour me donner une idée plus sensible de mon abandon et du danger
que je courais.
« Tu me trouveras une lime… »
Il me secouait.
« Et tu me trouveras des vivres… »
Il me secouait encore.
« Tu m’apporteras ces deux choses… »
Il me secouait plus fort.
« Ou j’aurai ton cœur et ton foie… »
Et il me secouait toujours.
J’étais mortellement effrayé et si étourdi, que je me cramponnai à
lui en disant :
« Si vous vouliez bien ne pas tant me secouer, monsieur, peutêtre
n’auraisje pas mal au cœur, et peutêtre entendraisje mieux… »
Il me donna une secousse si terrible, qu’il me sembla voir danser
le coq sur son clocher. Alors il me soutint par les bras, dans une
position verticale, sur le bloc de pierre, puis il continua en ces termes
effrayants :
« Tu m’apporteras demain matin, à la première heure, une lime et
des vivres. Tu m’apporteras le tout dans la vieille Batterie làbas. Tu
auras soin de ne pas dire un mot, de ne pas faire un signe qui puisse
faire penser que tu m’as vu, ou que tu as vu quelque autre personne ;
à ces conditions, on te laissera vivre. Si tu manques à cette promesse
en quelque manière que ce soit, ton cœur et ton foie te seront
arrachés, pour être rôtis et mangés. Et puis, je ne suis pas seul, ainsi
que tu peux le croire. Il y a là un jeune homme avec moi, un jeune
homme auprès duquel je suis un ange. Ce jeune homme entend ce
que je te dis. Ce jeune homme a un moyen tout particulier de se
procurer le cœur et le foie des petits gars de ton espèce. Il est
impossible, à n’importe quel moucheron comme toi, de le fuir ou de
se cacher de lui. Tu auras beau fermer la porte au verrou, te croire en
sûreté dans ton lit bien chaud, te cacher la tête sous les couvertures,
et espérer que tu es à l’abri de tout danger, ce jeune homme saura
s’approcher de toi et t’ouvrir le ventre. Ce n’est qu’avec de grandes
difficultés que j’empêche en ce moment ce jeune homme de te faire
du mal. J’ai beaucoup de peine à l’empêcher de fouiller tes entrailles.
Eh bien ! qu’en distu ? »
Je lui dis que je lui procurerais la lime dont il avait besoin, et
toutes les provisions que je pourrais apporter, et que je viendrais le
trouver à la Batterie, le lendemain, à la première heure.
« Répète après moi : « Que Dieu me frappe de mort, si je ne fais
pas ce que vous m’ordonnez », fit l’homme.
Je dis ce qu’il voulut, et il me posa à terre.
« Maintenant, repritil, souvienstoi de ce que tu promets,
souvienstoi de ce jeune homme, et rentre chez toi !
— Bon… bonsoir… monsieur, murmuraije en tremblant.
— C’est égal ! ditil en jetant les yeux sur le sol humide. Je
voudrais bien être grenouille ou anguille. »
En même temps il entoura son corps grelottant avec ses grands
bras, en les serrant tellement qu’ils avaient l’air d’y tenir, et s’en alla
en boitant le long du mur de l’église. Comme je le regardais s’en
aller à travers les ronces et les orties qui couvraient les tertres de
gazon, il sembla à ma jeune imagination qu’il éludait, en passant, les
mains que les morts étendaient avec précaution hors de leurs tombes,
pour le saisir à la cheville et l’attirer chez eux.
Lorsqu’il arriva au pied du mur qui entoure le cimetière, il
l’escalada comme un homme dont les jambes sont roides et en
gourdies, puis il se retourna pour voir ce que je faisais. Je me tournai
alors du côté de la maison, et fis de mes jambes le meilleur usage
possible. Mais bientôt, regardant en arrière, je le vis s’avancer vers la
rivière, toujours enveloppé de ses bras, et choisissant pour ses pieds
malades les grandes pierres jetées çà et là dans les marais, pour servir
de passerelles, lorsqu’il avait beaucoup plu ou que la marée y était
montée.
Les marais formaient alors une longue ligne noire horizontale, la
rivière formait une autre ligne un peu moins large et moins noire, les
nuages, eux, formaient de longues lignes rouges et noires,
entremêlées et menaçantes. Sur le bord de la rivière, je distinguais à
peine les deux seuls objets noirs qui se détachaient dans toute la
perspective qui s’étendait devant moi : l’un était le fanal destiné à
guider les matelots, ressemblant assez à un casque sans houppe placé
sur une perche, et qui était fort laid vu de près ; l’autre, un gibet, avec
ses chaînes pendantes, auquel on avait jadis pendu un pirate.
L’homme, qui s’avançait en boitant vers ce dernier objet, semblait
être le pirate revenu à la vie, et allant se raccrocher et se reprendre
luimême. Cette pensée me donna un terrible moment de vertige ; et,
en voyant les bestiaux lever leurs têtes vers lui, je me demandais s’ils
ne pensaient pas comme moi. Je regardais autour de moi pour voir si
je n’apercevais pas l’horrible jeune homme, je n’en vis pas la
moindre trace ; mais la frayeur me reprit tellement, que je courus à la
maison sans m’arrêter.
CHAPITRE II.
Ma sœur, Mrs Joe Gargery, n’avait pas moins de vingt ans de plus
que moi, et elle s’était fait une certaine réputation d’âme charitable
auprès des voisins, en m’élevant, comme elle disait, « à la main. »
Obligé à cette époque de trouver par moimême la signification de ce
mot, et sachant parfaitement qu’elle avait une main dure et lourde,
que d’habitude elle laissait facilement retomber sur son mari et sur
moi, je supposai que Joe Gargery était, lui aussi, élevé à la main.
Ce n’était pas une femme bien avenante que ma sœur ; et j’ai
toujours conservé l’impression qu’elle avait forcé par la main Joe
Gargery à l’épouser. Joe Gargery était un bel homme ; des boucles
couleur filasse encadraient sa figure douce et bonasse, et le bleu de
ses yeux était si vague et si indécis, qu’on eût eu de la peine à définir
l’endroit où le blanc lui cédait la place, car les deux nuances
semblaient se fondre l’une dans l’autre. C’était un bon garçon, doux,
obligeant, une bonne nature, un caractère facile, une sorte d’Hercule
par sa force, et aussi par sa faiblesse.
Ma sœur, Mrs Joe, avec des cheveux et des yeux noirs, avait une
peau tellement rouge que je me demandais souvent si, peutêtre, pour
sa toilette, elle ne remplaçait pas le savon par une râpe à muscade.
C’était une femme grande et osseuse ; elle ne quittait presque jamais
un tablier de toile grossière, attaché parderrière à l’aide de deux
cordons, et une bavette imperméable, toujours parsemée d’épingles et
d’aiguilles. Ce tablier était la glorification de son mérite et un
reproche perpétuellement suspendu sur la tête de Joe. Je n’ai jamais
pu deviner pour quelle raison elle le portait, ni pourquoi, si elle
voulait absolument le porter, elle ne l’aurait pas changé, au moins
une fois par jour.
La forge de Joe attenait à la maison, construite en bois, comme
l’étaient à cette époque plus que la plupart des maisons de notre pays.
Quand je rentrai du cimetière, la forge était fermée, et Joe était
assis tout seul dans la cuisine. Joe et moi, nous étions compagnons de
souffrances, et comme tels nous nous faisions des confidences ;
aussi, à peine eusje soulevé le loquet de la porte et l’eusje aperçu
dans le coin de la cheminée, qu’il me dit :
« Mrs Joe est sortie douze fois pour te chercher, mon petit Pip ; et
elle est maintenant dehors une treizième fois pour compléter la
douzaine de boulanger.
— Vraiment ?
— Oui, mon petit Pip, dit Joe ; et ce qu’il y a de pire pour toi,
c’est qu’elle a pris Tickler avec elle. »
À cette terrible nouvelle, je me mis à tortiller l’unique bouton de
mon gilet et, d’un air abattu, je regardai le feu. Tickler était un jonc
flexible, poli à son extrémité par de fréquentes collisions avec mon
pauvre corps.
« Elle se levait sans cesse, dit Joe ; elle parlait à Tickler, puis elle
s’est précipitée dehors comme une furieuse. Oui, comme une
furieuse », ajouta Joe en tisonnant le feu entre les barreaux de la
grille avec le poker.
— Y atil longtemps qu’elle est sortie, Joe ? disje, car je le
traitais toujours comme un enfant, et le considérais comme mon égal.
— Hem ! dit Joe en regardant le coucou hollandais, il y a bien
cinq minutes qu’elle est partie en fureur… mon petit Pip. Elle
revient !… Cachetoi derrière la porte, mon petit Pip, et rabats
l’essuiemains sur toi. »
Je suivis ce conseil. Ma sœur, Mrs Joe, entra en poussant la porte
ouverte, et trouvant une certaine résistance elle en devina aussitôt la
cause, et chargea Tickler de ses investigations.
Elle finit, je lui servais souvent de projectile conjugal, par me jeter
sur Joe, qui, heureux de cette circonstance, me fit passer sous la
cheminée, et me protégea tranquillement avec ses longues jambes.
« D’où vienstu, petit singe ? dit Mrs Joe en frappant du pied. Dis
moi bien vite ce que tu as fait pour me donner ainsi de l’inquiétude et
du tracas, sans cela je saurai bien t’attraper dans ce coin, quand vous
seriez cinquante Pips et cinq cents Gargerys.
— Je suis seulement allé jusqu’au cimetière, disje du fond de ma
cachette en pleurant et en me grattant.
— Au cimetière ? répéta ma sœur. Sans moi, il y a longtemps que
tu y serais allé et que tu n’en serais pas revenu. Qui donc t’a élevé ?
— C’est toi, disje.
— Et pourquoi y estu allé ? Voilà ce que je voudrais savoir,
s’écria ma sœur.
— Je ne sais pas, disje à voix basse.
Je ne sais pas ! reprit ma sœur, je ne le ferai plus jamais ! Je
connais cela. Je t’abandonnerai un de ces jours, moi qui n’ai jamais
quitté ce tablier depuis que tu es au monde. C’est déjà bien assez
d’être la femme d’un forgeron, et d’un Gargery encore, sans être ta
mère ! »
Mes pensées s’écartèrent du sujet dont il était question, car en
regardant le feu d’un air inconsolable, je vis paraître, dans les
charbons vengeurs, le fugitif des marais, avec sa jambe ferrée, le
mystérieux jeune homme, la lime, les vivres, et le terrible
engagement que j’avais pris de commettre un larcin sous ce toit
hospitalier.
« Ah ! dit Mrs Joe en remettant Tickler à sa place.
Au cimetière, c’est bien cela ! C’est bien à vous qu’il appartient
de parler de cimetière. Pas un de nous, entre parenthèses, n’avait
soufflé un mot de cela. Vous pouvez vous en vanter tous les deux,
vous m’y conduirez un de ces jours, au cimetière. Ah ! quel j… o…
l… i c… o… u… p… l… e vous ferez sans moi ! »
Pendant qu’elle s’occupait à préparer le thé, Joe tournait sur moi
des yeux interrogateurs, comme pour me demander si je prévoyais
quelle sorte de couple nous pourrions bien faire à nous deux, si le
malheur prédit arrivait. Puis il passa sa main gauche sur ses favoris,
en suivant de ses gros yeux bleus les mouvements de Mrs Joe,
comme il faisait toujours par les temps d’orage.
Ma sœur avait adopté un moyen de nous préparer nos tartines de
beurre, qui ne variait jamais. Elle appuyait d’abord vigoureusement
et longuement avec sa main gauche, le pain sur la poitrine, où il ne
manquait pas de ramasser sur la bavette, tantôt une épingle, tantôt
une aiguille, qui se retrouvait bientôt dans la bouche de l’un de nous.
Elle prenait ensuite un peu (très peu de beurre) à la pointe d’un
couteau, et l’étalait sur le pain de la même manière qu’un apothicaire
prépare un emplâtre, se servant des deux côtés du couteau avec
dextérité, et ayant soin de ramasser ce qui dépassait le bord de la
croûte. Puis elle donnait le dernier coup de couteau sur le bord de
l’emplâtre, et elle tranchait une épaisse tartine de pain que,
finalement, elle séparait en deux moitiés, l’une pour Joe, l’autre pour
moi.
Ce jourlà, j’avais faim, et malgré cela je n’osai pas manger ma
tartine. Je sentais que j’avais à réserver quelque chose pour ma
terrible connaissance et son allié, plus terrible encore, le jeune
homme mystérieux.
Je savais que Mrs Joe dirigeait sa maison avec la plus stricte
économie, et que mes recherches dans le gardemanger pourraient
bien être infructueuses. Je me décidai donc à cacher ma tartine dans
l’une des jambes de mon pantalon.
L’effort de résolution nécessaire à l’accomplissement de ce projet
me paraissait terrible. Il produisait sur mon imagination le même
effet que si j’eusse dû me précipiter d’une haute maison, ou dans une
eau très profonde, et il me devenait d’autant plus difficile de m’y
résoudre finalement, que Joe ignorait tout. Dans l’espèce de franc
maçonnerie, déjà mentionnée par moi, qui nous unissait comme
compagnons des mêmes souffrances, et dans la camaraderie
bienveillante de Joe pour moi, nous avions coutume de comparer nos
tartines, à mesure que nous y faisions des brèches, en les exposant à
notre mutuelle admiration, comme pour stimuler notre ardeur. Ce
soirlà, Joe m’invita plusieurs fois à notre lutte amicale en me
montrant les progrès que faisait la brèche ouverte dans sa tartine ;
mais, chaque fois, il me trouva avec ma tasse de thé sur un genou et
ma tartine intacte sur l’autre. Enfin, je considérai que le sacrifice était
inévitable, je devais le faire de la manière la moins extraordinaire et
la plus compatible avec les circonstances. Profitant donc d’un
moment où Joe avait les yeux tournés, je fourrai ma tartine dans une
des jambes de mon pantalon.
Joe paraissait évidemment mal à l’aise de ce qu’il supposait être
un manque d’appétit, et il mordait tout pensif à même sa tartine des
bouchées qu’il semblait avaler sans aucun plaisir. Il les tournait et
retournait dans sa bouche plus longtemps que de coutume, et finissait
par les avaler comme des pilules.
Il allait saisir encore une fois, avec ses dents, le pain beurré et
avait déjà ouvert une bouche d’une dimension fort raisonnable,
lorsque, ses yeux tombant sur moi, il s’aperçut que ma tartine avait
disparu.
L’étonnement et la consternation avec lesquels Joe avait arrêté le
pain sur le seuil de sa bouche et me regardait, étaient trop évidents
pour échapper à l’observation de ma sœur.
« Qu’y atil encore ? ditelle en posant sa tasse sur la table.
— Oh ! oh ! murmurait Joe, en secouant la tête d’un air de
sérieuse remontrance, mon petit Pip, mon camarade, tu te feras du
mal, ça ne passera pas, tu n’as pas pu la mâcher, mon petit Pip, mon
ami !
— Qu’estce qu’il y a encore, voyons ? répéta ma sœur avec plus
d’aigreur que la première fois.
— Si tu peux en faire remonter quelque parcelle, en toussant, mon
petit Pip, faisle, mon ami ! dit Joe. Certainement chacun mange
comme il l’entend, mais encore, ta santé !… ta santé !… »
À ce moment, ma sœur furieuse avait attrapé Joe par ses deux
favoris et lui cognait la tête contre le mur, pendant qu’assis dans mon
coin je les considérais d’un air vraiment piteux.
« Maintenant, peutêtre vastu me dire ce qu’il y a, gros niais que
tu es ! » dit ma sœur hors d’haleine.
Joe promena sur elle un regard désespéré, prit une bouchée
désespérée, puis il me regarda de nouveau :
« Tu sais, mon petit Pip, ditil d’un ton solennel et confidentiel,
comme si nous eussions été seuls, et en logeant sa dernière bouchée
dans sa joue, tu sais que toi et moi sommes bons amis, et que je
serais le dernier à faire aucun mauvais rapport contre toi ; mais faire
un pareil coup… »
Il éloigna sa chaise pour regarder le plancher entre lui et moi ;
puis il reprit :
« Avaler un pareil morceau d’un seul coup !
— Il a avalé tout son pain, n’estce pas ? s’écria ma sœur.
— Tu sais, mon petit Pip, reprit Joe, en me regardant, sans faire la
moindre attention à Mrs Joe, et ayant toujours sous la joue sa
dernière bouchée, que j’ai avalé aussi, moi qui te parle… et souvent
encore… quand j’avais ton âge, et j’ai vu bien des avaleurs, mais je
n’ai jamais vu avaler comme toi, mon petit Pip, et je m’étonne que tu
n’en sois pas mort ; c’est par une permission du bon Dieu ! »
Ma sœur s’élança sur moi, me prit par les cheveux et m’adressa
ces paroles terribles :
« Arrive, mauvais garnement, qu’on te soigne ! »
Quelque brute médicale avait, à cette époque, remis en vogue
l’eau de goudron, comme un remède très efficace, et Mrs Joe en avait
toujours dans son armoire une certaine provision, croyant qu’elle
avait d’autant plus de vertu qu’elle était plus dégoûtante. Dans de
meilleurs temps, un peu de cet élixir m’avait été administré comme
un excellent fortifiant ; je craignis donc ce qui allait arriver,
pressentant une nouvelle entrave à mes projets de sortie. Ce soirlà,
l’urgence du cas demandait au moins une pinte de cette drogue. Mrs
Joe me l’introduisit dans la gorge, pour mon plus grand bien, en me
tenant la tête sous son bras, comme un tirebottes tient une chaussure.
Joe en fut quitte pour une demipinte, qu’il dut avaler, bon gré, mal
gré, pendant qu’il était assis, mâchant tranquillement et méditant
devant le feu, parce qu’il avait peutêtre eu mal au cœur.
Jugeant d’après moi, je puis dire qu’il y aurait eu mal après, s’il
n’y avait eu mal avant.
La conscience est une chose terrible, quand elle accuse, soit un
homme, soit un enfant ; mais quand ce secret fardeau se trouve lié à
un autre fardeau, enfoui dans les jambes d’un pantalon, c’est (je puis
l’avouer) une grande punition. La pensée que j’allais commettre un
crime en volant Mrs Joe, l’idée que je volerais Joe ne me serait
jamais venue, car je n’avais jamais pensé qu’il eût aucun droit sur les
ustensiles du ménage ; cette pensée, jointe à la nécessité dans
laquelle je me trouvais de tenir sans relâche ma main sur ma tartine,
pendant que j’étais assis ou que j’allais à la cuisine chercher quelque
chose ou faire quelques petites commissions, me rendait presque fou.
Alors, quand le vent des marais venait ranimer et faire briller le feu
de la cheminée, il me semblait entendre audehors la voix de
l’homme à la jambe ferrée, qui m’avait fait jurer le secret, me criant
qu’il ne pouvait ni ne voulait jeûner jusqu’au lendemain, mais qu’il
lui fallait manger tout de suite. D’autre fois, je pensais que le jeune
homme, qu’il était si difficile d’empêcher de plonger ses mains dans
mes entrailles, pourrait bien céder à une impatience constitutionnelle,
ou se tromper d’heure et se croire des droits à mon cœur et à mon
foie ce soir même, au lieu de demain ! S’il est jamais arrivé à
quelqu’un de sentir ses cheveux se dresser sur sa tête, ce doit être à
moi. Mais peutêtre cela n’estil jamais arrivé à personne.
C’était la veille de Noël, et j’étais chargé de remuer, avec une tige
en cuivre, la pâte du pudding pour le lendemain, et cela de sept à huit
heures, au coucou hollandais.
J’essayai de m’acquitter de ce devoir sans me séparer de ma
tartine, et cela me fit penser une fois de plus à l’homme chargé de
fers, et j’éprouvai alors une certaine tendance à sortir la malheureuse
tartine de mon pantalon, mais la chose était bien difficile.
Heureusement, je parvins à me glisser jusqu’à ma petite chambre, où
je déposai cette partie de ma conscience.
« Écoute ! disje, quand j’eus fini avec le pudding, et que je revins
prendre encore un peu de chaleur au coin de la cheminée avant qu’on
ne m’envoyât coucher. Pourquoi tireton ces grands coups de canon,
Joe ?
— Ah ! dit Joe, encore un forçat d’évadé !
— Qu’estce que cela veut dire, Joe ? »
Mrs Joe, qui se chargeait toujours de donner des explications,
répondit avec aigreur :
« Échappé ! échappé !… » administrant ainsi la définition comme
elle administrait l’eau de goudron.
Tandis que Mrs Joe avait la tête penchée sur son ouvrage
d’aiguille, je tâchai par des mouvements muets de mes lèvres de faire
entendre à Joe cette question :
« Qu’estce qu’un forçat ? »
Joe me fit une réponse grandement élaborée, à en juger les
contorsions de sa bouche, mais dont je ne pus former que le seul
mot : « Pip !… »
« Un forçat s’est évadé hier soir après le coup de canon du
coucher du soleil, reprit Joe à haute voix, et on a tiré le canon pour en
avertir ; et maintenant on tire sans doute encore pour un autre.
— Qu’estce qui tire ? demandaije.
— Qu’estce que c’est qu’un garçon comme ça ? fit ma sœur en
fronçant le sourcil pardessus son ouvrage. Quel questionneur éternel
tu fais… Ne fais pas de questions, et on ne te dira pas de
mensonges. »
Je pensais que ce n’était pas très poli pour ellemême de me
laisser entendre qu’elle me dirait des mensonges, si je lui faisais des
questions. Mais elle n’était jamais polie avec moi, excepté quand il y
avait du monde.
À ce moment, Joe vint augmenter ma curiosité au plus haut degré,
en prenant beaucoup de peine pour ouvrir la bouche toute grande, et
lui faire prendre la forme d’un mot qui, au mouvement de ses lèvres,
me parut être :
« Boudé… »
Je regardai naturellement Mrs Joe et dis :
« Elle ? »
Mais Joe ne parut rien entendre du tout, et il répéta le mouvement
avec plus d’énergie encore ; je ne compris pas davantage.
« Mistress Joe, disje comme dernière ressource, je voudrais bien
savoir… si cela ne te fait rien… où l’on tire le canon ?
— Que Dieu bénisse cet enfant ! s’écria ma sœur d’un ton qui
faisait croire qu’elle pensait tout le contraire de ce qu’elle disait. Aux
pontons !
— Oh ! disje en levant les yeux sur Joe, aux pontons ! »
Joe me lança un regard de reproche qui disait :
1
« Je te l’avais bien dit .
— Et s’il te plaît, qu’estce que les pontons ? reprisje.
— Voyezvous, s’écria ma sœur en dirigeant sur moi son aiguille
et en secouant la tête de mon côté, répondezlui une fois, et il vous
fera de suite une douzaine de questions. Les pontons sont des
vaisseaux qui servent de prison, et qu’on trouve en traversant tout
droit les marais.
— Je me demande qui on peut mettre dans ces prisons, et
pourquoi on y met quelqu’un ? » disje d’une manière générale et
avec un désespoir calme.
C’en était trop pour Mrs Joe, qui se leva immédiatement.
« Je vais te le dire, méchant vaurien, fitelle. Je ne t’ai pas élevé
pour que tu fasses mourir personne à petit feu ; je serais à blâmer et
non à louer si je l’avais fait. On met sur les pontons ceux qui ont tué,
volé, fait des faux et toutes sortes de mauvaises actions, et ces gens
là ont tous commencé comme toi par faire des questions. Maintenant,
va te coucher, et dépêchons ! »
On ne me donnait jamais de chandelle pour m’aller coucher, et en
gagnant cette fois ma chambre dans l’obscurité, ma tête tintait, car
Mrs Joe avait tambouriné avec son dé sur mon crâne, en disant ces
derniers mots et je sentais avec épouvante que les pontons étaient
faits pour moi ; j’étais sur le chemin, c’était évident ! J’avais
commencé à faire des questions, et j’étais sur le point de voler Mrs
Joe.
Depuis cette époque, bien reculée maintenant, j’ai souvent pensé
combien peu de gens savent à quel point on peut compter sur la
discrétion des enfants frappés de terreur. Cependant, rien n’est plus
déraisonnable que la terreur. J’éprouvais une terreur mortelle en
pensant au jeune homme qui en voulait absolument à mon cœur et à
mes entrailles. J’éprouvais une terreur mortelle au souvenir de mon
interlocuteur à la jambe ferrée. J’éprouvais une terreur mortelle de
moimême, depuis qu’on m’avait arraché ce terrible serment ; je
1 En anglais : « Sulks » – bouder – ayant la même terminaison que « hulks »
– pontons – la méprise de Pip est tout expliquée.
n’avais aucun espoir d’être délivré de cette terreur par ma toute
puissante sœur, qui me rebutait à chaque tentative que je faisais ; et je
suis effrayé rien qu’en pensant à ce qu’un ordre quelconque aurait pu
m’amener à faire sous l’influence de cette terreur.
Si je dormis un peu cette nuitlà, ce fut pour me sentir entraîné
vers les pontons par le courant de la rivière. En passant près de la
potence, je vis un fantôme de pirate, qui me criait dans un portevoix
que je ferais mieux d’aborder et d’être pendu tout de suite que
d’attendre. J’aurais eu peur de dormir, quand même j’en aurais eu
l’envie, car je savais que c’était à la première aube que je devais
piller le gardemanger. Il ne fallait pas songer à agir la nuit, car je
n’avais aucun moyen de me procurer de la lumière, si ce n’est en
battant le briquet, ou une pierre à fusil avec un morceau de fer, ce qui
aurait produit un bruit semblable à celui du pirate agitant ses chaînes.
Dès que le grand rideau noir qui recouvrait ma petite fenêtre eût
pris une légère teinte grise, je descendis. Chacun de mes pas, sur le
plancher, produisait un craquement qui me semblait crier : « Au
voleur !… Réveillezvous, mistress Joe !… Réveillezvous !… »
Arrivé au gardemanger qui, vu la saison, était plus abondamment
garni que de coutume, j’eus un moment de frayeur indescriptible à la
vue d’un lièvre pendu par les pattes. Il me sembla même qu’il fixait
sur moi un œil beaucoup trop vif pour sa situation. Je n’avais pas le
temps de rien vérifier, ni de choisir ; en un mot, je n’avais le temps
de rien faire. Je pris du pain, du fromage, une assiette de hachis, que
je nouai dans mon mouchoir avec la fameuse tartine de la veille, un
peu d’eaudevie dans une bouteille de grès, que je transvasai dans
une bouteille de verre que j’avais secrètement emportée dans ma
chambre pour composer ce liquide enivrant appelé « jus de réglisse »,
remplissant la bouteille de grès avec de l’eau que je trouvai dans une
cruche dans le buffet de la cuisine, un os, auquel il ne restait que fort
peu de viande, et un magnifique pâté de porc.
J’allais partir sans ce splendide morceau, quand j’eus l’idée de
monter sur une planche pour voir ce que pouvait contenir ce plat de
terre si soigneusement relégué dans le coin le plus obscur de
l’armoire et que je découvris le pâté, je m’en emparai avec l’espoir
qu’il n’était pas destiné à être mangé de sitôt, et qu’on ne
s’apercevrait pas de sa disparition, de quelque temps au moins.
Une porte de la cuisine donnait accès dans la forge ; je tirai le
verrou, j’ouvris cette porte, et je pris une lime parmi les outils de Joe.
Puis, je remis toutes les fermetures dans l’état où je les avais
trouvées ; j’ouvris la porte par laquelle j’étais rentré le soir
précédent ; je m’élançai dans la rue, et pris ma course vers les marais
brumeux.
CHAPITRE III.
C’était une matinée de gelée blanche très humide. J’avais trouvé
l’extérieur de la petite fenêtre de ma chambre tout mouillé, comme si
quelque lutin y avait pleuré toute la nuit, et qu’il lui eût servi de
mouchoir de poche. Je retrouvai cette même humidité sur les haies
stériles et sur l’herbe desséchée, suspendue comme de grossières
toiles d’araignée, de rameau en rameau, de brin en brin ; les grilles,
les murs étaient dans le même état, et le brouillard était si épais, que
je ne vis qu’en y touchant le poteau au bras de bois qui indique la
route de notre village, indication qui ne servait à rien car on ne
passait jamais par là. Je levai les yeux avec terreur sur le poteau, ma
conscience oppressée en faisant un fantôme, me montrant la rue des
Pontons.
Le brouillard devenait encore plus épais, à mesure que
j’approchais des marais, de sorte qu’au lieu d’aller vers les objets, il
me semblait que c’étaient les objets qui venaient vers moi. Cette
sensation était extrêmement désagréable pour un esprit coupable. Les
grilles et les fossés s’élançaient à ma poursuite, à travers le
brouillard, et criaient très distinctement : « Arrêtezle ! Arrêtezle !…
Il emporte un pâté qui n’est pas à lui !… » Les bestiaux y mettaient
une ardeur égale et écarquillaient leurs gros yeux en me lançant par
leurs naseaux un effroyable : « Holà ! petit voleur !… Au voleur ! Au
voleur !… » Un bœuf noir, à cravate blanche, auquel ma conscience
troublée trouvait un certain air clérical, fixait si obstinément sur moi
son œil accusateur, que je ne pus m’empêcher de lui dire en passant :
« Je n’ai pas pu faire autrement, monsieur ! Ce n’est pas pour moi
que je l’ai pris ! »
Sur ce, il baissa sa grosse tête, souffla par ses naseaux un nuage de
vapeur, et disparut après avoir lancé une ruade majestueuse avec ses
pieds de derrière et fait le moulinet avec sa queue.
Je m’avançais toujours vers la rivière.
J’avais beau courir, je ne pouvais réchauffer mes pieds, auxquels
l’humidité froide semblait rivée comme la chaîne de fer était rivée à
la jambe de l’homme que j’allais retrouver. Je connaissais
parfaitement bien le chemin de la Batterie, car j’y étais allé une fois,
un dimanche, avec Joe, et je me souvenais, qu’assis sur un vieux
canon, il m’avait dit que, lorsque je serais son apprenti et directement
sous sa dépendance, nous viendrions là passer de bons quarts
d’heure. Quoi qu’il en soit, le brouillard m’avait fait prendre un peu
trop à droite ; en conséquence, je dus rebrousser chemin le long de la
rivière, sur le bord de laquelle il y avait de grosses pierres au milieu
de la vase et des pieux, pour contenir la marée. En me hâtant de
retrouver mon chemin, je venais de traverser un fossé que je savais
n’être pas éloigné de la Batterie, quand j’aperçus l’homme assis
devant moi. Il me tournait le dos, et avait les bras croisés et la tête
penchée en avant, sous le poids du sommeil.
Je pensais qu’il serait content de me voir arriver aussi
inopinément avec son déjeuner. Je m’approchai donc de lui et le
touchai doucement à l’épaule. Il bondit sur ses pieds, mais ce n’était
pas le même homme, c’en était un autre !
Et pourtant cet homme était, comme l’autre, habillé tout en gris ;
comme l’autre, il avait un fer à la jambe ; comme l’autre, il boitait, il
avait froid, il était enroué ; enfin c’était exactement le même homme,
si ce n’est qu’il n’avait pas le même visage et qu’il portait un
chapeau bas de forme et à larges bords. Je vis tout cela en un
moment, car je n’eus qu’un moment pour voir tout cela ; il me lança
un gros juron à la tête, puis il voulut me donner un coup de poing ;
mais si indécis et si faible qu’il me manqua et faillit luimême rouler
à terre car ce mouvement le fit chanceler ; alors, il s’enfonça dans le
brouillard, en trébuchant deux fois et je le perdis de vue.
« C’est le jeune homme ! » pensaije en portant la main sur mon
cœur.
Et je crois que j’aurais aussi ressenti une douleur au foie, si j’avais
su où il était placé.
J’arrivai bientôt à la Batterie. J’y trouvai mon homme, le
véritable, s’étreignant toujours et se promenant çà et là en boitant,
comme s’il n’eût pas cessé un instant, toute la nuit, de s’étreindre et
de se promener en m’attendant. À coup sûr, il avait terriblement
froid, et je m’attendais presque à le voir tombé inanimé et mourir de
froid à mes pieds. Ses yeux annonçaient aussi une faim si
épouvantable que, quand je lui tendis la lime, je crois qu’il eût essayé
de la manger, s’il n’eût aperçu mon paquet. Cette fois, il ne me mit
pas la tête en bas, et me laissa tranquillement sur mes jambes,
pendant que j’ouvrais le paquet et que je vidais mes poches.
« Qu’y atil dans cette bouteille ? ditil.
— De l’eaudevie », répondisje.
Il avait déjà englouti une grande partie du hachis de la manière la
plus singulière, plutôt comme un homme qui a une hâte extrême de
mettre quelque chose en sûreté, que comme un homme qui mange ;
mais il s’arrêta un moment pour boire un peu de liqueur. Pendant tout
ce temps, il tremblait avec une telle violence, qu’il avait toute la
peine du monde à ne pas briser entre ses dents le goulot de la
bouteille.
« Je crois que vous avez la fièvre, disje.
— Tu pourrais bien avoir raison, mon garçon, réponditil.
— Il ne fait pas bon ici, reprisje, vous avez dormi dans les
marais, ils donnent la fièvre et des rhumatismes.
— Je vais toujours manger mon déjeuner, ditil, avant qu’on ne
me mette à mort.
J’en ferais autant, quand même je serais certain d’être repris et
ramené làbas, aux pontons, après avoir mangé ; et je te parie que
j’avalerai jusqu’au dernier morceau. »
Il mangeait du hachis, du pain, du fromage et du pâté, tout à la
fois : jetant dans le brouillard qui nous entourait des yeux inquiets, et
souvent arrêtant, oui, arrêtant jusqu’au jeu des mâchoires pour
écouter. Le moindre bruit, réel ou imaginaire, le murmure de l’eau,
ou la respiration d’un animal le faisait soudain tressaillir, et il me
disait tout à coup :
« Tu ne me trahis pas, petit diable ?… Tu n’as amené personne
avec toi ?
— Non, monsieur !… non !
— Tu n’as dit à personne de te suivre ?
— Non !
— Bien ! disaitil, je te crois. Tu serais un fier limier, en vérité, si
à ton âge tu aidais déjà à faire prendre une pauvre vermine comme
moi, près de la mort, et traquée de tous côtés, comme je le suis. »
Il se fit dans sa gorge un bruit assez semblable à celui d’une
pendule qui va sonner, puis il passa sa manche de toile grossière sur
ses yeux.
Touché de sa désolation, et voyant qu’il revenait toujours au pâté
de préférence, je m’enhardis assez pour lui dire :
« Je suis bien aise que vous le trouviez bon.
— Estce toi qui as parlé ?
— Je dis que je suis bien aise que vous le trouviez bon…
— Merci, mon garçon, je le trouve excellent. »
Je m’étais souvent amusé à regarder manger un gros chien que
nous avions à la maison, et je remarquai qu’il y avait une similitude
frappante dans la manière de manger de ce chien et celle de cet
homme.
Il donnait des coups de dent secs comme le chien ; il avalait, ou
plutôt il happait d’énormes bouchées, trop tôt et trop vite, et regardait
de côté et d’autres en mangeant, comme s’il eût craint que, de toutes
les directions, on ne vînt lui enlever son pâté. Il était cependant trop
préoccupé pour en bien apprécier le mérite, et je pensais que si
quelqu’un avait voulu partager son dîner, il se fût jeté sur ce
quelqu’un pour lui donner un coup de dent, tout comme aurait pu le
faire le chien, en pareille circonstance.
« Je crains bien que vous ne lui laissiez rien, disje timidement,
après un silence pendant lequel j’avais hésité à faire cette
observation : il n’en reste plus à l’endroit où j’ai pris celuici.
— Lui en laisser ?… À qui ?… dit mon ami, en s’arrêtant sur un
morceau de croûte.
— Au jeune homme. À celui dont vous m’avez parlé. À celui qui
se cache avec vous.
— Ah ! ah ! repritil avec quelque chose comme un éclat de rire ;
lui !… oui !… oui !… Il n’a pas besoin de vivres.
— Il semblait pourtant en avoir besoin », disje.
L’homme cessa de manger et me regarda d’un air surpris.
« Il t’a semblé ?… Quand ?…
— Tout à l’heure.
— Où cela ?
— Làbas !… disje, en indiquant du doigt ; làbas, où je l’ai
trouvé endormi ; je l’avais pris pour vous. »
Il me prit au collet et me regarda d’une manière telle, que je
commençai à croire qu’il était revenu à sa première idée de me
couper la gorge.
« Il était habillé tout comme vous, seulement, il avait un chapeau,
disje en tremblant, et… et… (j’étais très embarrassé pour lui dire
ceci), et… il avait les mêmes raisons que vous pour m’emprunter une
lime. N’avezvous pas entendu le canon hier soir ?
— Alors on a tiré ! se ditil à luimême.
— Je m’étonne que vous ne le sachiez pas, reprisje, car nous
l’avons entendu de notre maison, qui est plus éloignée que cet
endroit ; et, de plus, nous étions enfermés.
— C’est que, ditil, quand un homme est dans ma position, avec la
tête vide et l’estomac creux, à moitié mort de froid et de faim, il
n’entend pendant toute la nuit que le bruit du canon et des voix qui
l’appellent… Écoute ! Il voit des soldats avec leurs habits rouges,
éclairés par les torches, qui s’avancent et vont l’entourer ; il entend
appeler son numéro, il entend résonner les mousquets, il entend le
commandement : en joue !… Il entend tout cela, et il n’y a rien.
Oui… je les ai vus me poursuivre une partie de la nuit, s’avancer en
ordre, ces damnés, en piétinant, piétinant… j’en ai vu cent… et
comme ils tiraient !… Oui, j’ai vu le brouillard se dissiper au canon,
et, comme par enchantement, faire place au jour !… Mais cet
homme ; il avait dit tout le reste comme s’il eût oublié ma réponse ;
astu remarqué quelque chose de particulier en lui ?
— Il avait la face meurtrie, disje, en me souvenant que j’avais
remarqué cette particularité.
— Ici, n’estce pas ? s’écria l’homme, en frappant sa joue gauche,
sans miséricorde, avec le plat de la main.
— Oui… là !
— Où estil ? »
En disant ces mots, il déposa dans la poche de sa jaquette grise le
peu de nourriture qui restait.
« Montremoi le chemin qu’il a pris, je le tuerai comme un chien !
Maudit fer, qui m’empêche de marcher ! Passemoi la lime, mon
garçon. »
Je lui indiquai la direction que l’autre avait prise, à travers le
brouillard. Il regarda un instant, puis il s’assit sur le bord de l’herbe
mouillée et commença à limer le fer de sa jambe, comme un fou,
sans s’inquiéter de moi, ni de sa jambe, qui avait une ancienne
blessure qui saignait et qu’il traitait aussi brutalement que si elle eût
été aussi dépourvue de sensibilité qu’une lime. Je recommençais à
avoir peur de lui, maintenant que je le voyais s’animer de cette
façon ; de plus j’étais effrayé de rester aussi longtemps dehors de la
maison. Je lui dis donc qu’il me fallait partir ; mais il n’y fit pas
attention, et je pensai que ce que j’avais de mieux à faire était de
m’éloigner. La dernière fois que je le vis, il avait toujours la tête
penchée sur son genou, il limait toujours ses fers et murmurait de
temps à autre quelque imprécation d’impatience contre ses fers ou
contre sa jambe. La dernière fois que je l’entendis, je m’arrêtai dans
le brouillard pour écouter et j’entendis le bruit de la lime qui allait
toujours.
CHAPITRE IV.
Je m’attendais, en rentrant, à trouver dans la cuisine un constable
qui allait m’arrêter ; mais, nonseulement il n’y avait là aucun
constable, mais on n’avait encore rien découvert du vol que j’avais
commis. Mrs Joe était tout occupée des préparatifs pour la solennité
du jour, et Joe avait été posté sur le pas de la porte de la cuisine pour
éviter de recevoir la poussière, chose que malheureusement sa
destinée l’obligeait à recevoir tôt ou tard, toutes les fois qu’il prenait
fantaisie à ma sœur de balayer les planchers de la maison.
« Où diable astu été ? »
Tel fut le salut de Noël de Mrs Joe, quand moi et ma conscience
nous nous présentâmes devant elle.
Je lui dis que j’étais sorti pour entendre chanter les noëls.
« Ah ! bien, observa Mrs Joe, tu aurais pu faire plus mal. »
Je pensais qu’il n’y avait aucun doute à cela.
« Si je n’étais pas la femme d’un forgeron, et ce qui revient au
même, une esclave qui ne quitte jamais son tablier, j’aurais été aussi
entendre les noëls, dit Mrs Joe, je ne déteste pas les noëls, et c’est
sans doute pour cette raison que je n’en entends jamais.
Joe, qui s’était aventuré dans la cuisine après moi, pensant que la
poussière était tombée, se frottait le nez avec un petit air de
conciliation pendant que sa femme avait les yeux sur lui ; dès qu’elle
les eut détournés, il mit en croix ses deux index, ce qui signifiait que
2
Mrs Joe était en colère .
2 Jeu de mot impossible à rendre exactement « Cross » – signifie : « croix » et
Cet état était devenu tellement habituel, que Joe et moi nous
passions des semaines entières à nous croiser les doigts, comme les
anciens croisés croisaient leurs jambes sur leurs tombes.
Nous devions avoir un dîner splendide, consistant en un gigot de
porc mariné aux choux et une paire de volailles rôties et farcies. On
avait fait la veille au matin un magnifique mincepie, (ce qui
expliquait qu’on n’eût pas encore découvert la disparition du hachis),
et le pudding était en train de bouillir. Ces énormes préparatifs nous
forcèrent, avec assez peu de cérémonie, à nous passer de déjeuner.
« Je ne vais pas m’amuser à tout salir, après avoir tout nettoyé,
tout lavé comme je l’ai fait, dit Mrs Joe, je vous le promets ! »
On nous servit donc nos tartines dehors, comme si, au lieu d’être
deux à la maison, un homme et un enfant, nous eussions été deux
mille hommes en marche forcée ; et nous puisâmes notre part de lait
et d’eau à même un pot sur la table de la cuisine, en ayant l’air de
nous excuser humblement de la grande peine que nous lui donnions.
Cependant Mrs Joe avait fait voir le jour à des rideaux tout blancs et
accroché un volant à fleurs tout neuf au manteau de la cheminée,
pour remplacer l’ancien ; elle avait même découvert tous les
ornements du petit parloir donnant sur l’allée, qui n’étaient jamais
découverts dans un autre temps, et restaient tous les autres jours de
l’année enveloppés dans une froide et brumeuse gaze d’argent, qui
s’étendait même sur les quatre petits caniches en faïence blanche qui
ornaient le manteau de la cheminée, avec leurs nez noirs et leurs
paniers de fleurs à la gueule, en face les uns des autres et se faisant
pendant.
Mrs Joe était une femme d’une extrême propreté, mais elle
s’arrangeait pour rendre sa propreté moins confortable et moins
acceptable que la saleté même. La propreté est comme la religion,
bien des gens la rendent insupportable en l’exagérant.
Ma sœur avait tant à faire qu’elle n’allait jamais à l’église que par
procuration, c’estàdire quand Joe et moi nous y allions. Dans ses
habits de travail, Joe avait l’air d’un brave et digne forgeron ; dans
aussi « contrariant, hostile, furieux, de mauvaise humeur. » En mettant ses
doigts en croix, Joe indiquait à Pip l’humeur de Mrs Joe.
ses habits de fête, il avait plutôt l’air d’un épouvantail dans de
bonnes conditions que de toute autre chose. Rien de ce qu’il portait
ne lui allait, ni ne semblait lui appartenir. Toutes les pièces de son
habillement étaient trop grandes pour lui, et lorsqu’à l’occasion de la
présente fête il sortit de sa chambre, au son joyeux du carillon, il
représentait la Misère revêtue des habits prétentieux du dimanche.
Quant à moi, je crois que ma sœur avait eu quelque vague idée que
j’étais un jeune pécheur, dont un policemanaccoucheur s’était
emparé, et qu’il lui avait remis pour être traité selon la majesté
outragée de la loi. Je fus donc toujours traité comme si j’eusse insisté
pour venir au monde, malgré les règles de la raison, de la religion et
de la morale, et malgré les remontrances de mes meilleurs amis.
Toutes les fois que j’allais chez le tailleur pour prendre mesure de
nouveaux habits, ce dernier avait ordre de me les faire comme ceux
des maisons de correction et de ne me laisser sous aucun prétexte, le
libre usage de mes membres.
Joe et moi, en nous rendant à l’église, devions nécessairement
former un tableau fort émouvant pour les âmes compatissantes.
Cependant ce que je souffrais en allant à l’église, n’était rien auprès
de ce que je souffrais en moimême.
Les terreurs qui m’assaillaient toutes les fois que Mrs Joe se
rapprochait de l’office, ou sortait de la chambre, n’étaient égalées
que par les remords que j’éprouvais de ce que mes mains avaient fait.
Je me demandais, accablé sous le poids du terrible secret, si l’Église
serait assez puissante pour me protéger contre la vengeance de ce
terrible jeune homme, au cas où je me déciderais à tout divulguer.
J’eus l’idée que je devais choisir le moment où, à la publication des
bans, le vicaire dit : « Vous êtes priés de nous en donner
connaissance », pour me lever et demander un entretien particulier
dans la sacristie. Si, au lieu d’être le saint jour de Noël, c’eût été un
simple dimanche, je ne réponds pas que je n’eusse procuré une
grande surprise à notre petite congrégation, en ayant recours à cette
mesure extrême.
M. Wopsle, le chantre, devait dîner avec nous, ainsi que M.
Hubble ; le charron, et Mrs Hubble ; et aussi l’oncle Pumblechook
(oncle de Joe, que Mrs Joe tâchait d’accaparer), fort grainetier de la
ville voisine, qui conduisait luimême sa voiture. Le dîner était
annoncé pour une heure et demie. En rentrant, Joe et moi nous
trouvâmes le couvert mis, Mrs Joe habillée, le dîner dressé et la porte
de la rue (ce qui n’arrivait jamais dans d’autres temps), toute grande
ouverte pour recevoir les invités. Tout était splendide. Et pas un mot
sur le larcin.
La compagnie arriva, et le temps, en s’écoulant, n’apportait
aucune consolation à mes inquiétudes. M. Wopsle, avec un nez
romain, un front chauve et luisant, possédait, en outre, une voix de
basse dont il n’était pas fier à moitié. C’était un fait avéré parmi ses
connaissances, que si l’on eût pu lui donner une autre tête, il eût été
capable de devenir clergyman, et il confessait luimême que si
l’Église eût été « ouverte à tous », il n’aurait pas manqué d’y faire
figure ; mais que l’Église n’étant pas « accessible à tout le monde »,
il était simplement, comme je l’ai dit, notre chantre.
Il entonnait les réponses d’une voix de tonnerre qui faisait
trembler, et quand il annonçait le psaume, en ayant soin de réciter le
verset tout entier, il regardait la congrégation réunie autour de lui
d’une manière qui voulait dire : « Vous avez entendu mon ami, là
bas derrière ; eh bien ! faitesmoi maintenant l’amitié de me dire ce
que vous pensez de ma manière de répéter le verset ? »
C’est moi qui ouvris la porte à la compagnie, en voulant faire
croire que c’était dans nos habitudes, je reçus d’abord M. Wopsle,
puis Mrs Hubble, et enfin l’oncle Pumblechook. – N. B. Je ne devais
pas l’appeler mon oncle, sous peine des punitions les plus sévères.
« Mistress Joe, dit l’oncle Pumblechook, homme court et gros et à
la respiration difficile, ayant une bouche de poisson, des yeux ternes
et étonnés, et des cheveux roux se tenant droits sur son front, qui lui
donnaient toujours l’air effrayé, je vous apporte, avec les
compliments d’usage, madame, une bouteille de Sherry, et je vous
apporte aussi, madame, une bouteille de porto. »
Chaque année, à Noël, il se présentait comme une grande
nouveauté, avec les mêmes paroles exactement, et portant ses deux
bouteilles comme deux sonnettes muettes. De même, chaque année à
la Noël, Mrs Joe répliquait comme elle le faisait ce jourlà :
« Oh !… mon… on… cle… Pum… ble… chook !… c’est bien
bon de votre part ! »
De même aussi, chaque année à la Noël, l’oncle Pumblechook
répliquait : comme il répliqua en effet ce même jour :
« Ce n’est pas plus que vous ne méritez… Êtesvous tous bien
portants ?… Comment va le petit, qui ne vaut pas le sixième d’un
sou ? »
C’est de moi qu’il voulait parler.
En ces occasions, nous dînions dans la cuisine, et l’on passait au
salon, où nous étions aussi empruntés que Joe dans ses habits du
dimanche, pour manger les noix, les oranges, et les pommes. Ma
sœur était vraiment sémillante ce jourlà, et il faut convenir qu’elle
était plus aimable pour Mrs Hubble que pour personne. Je me
souviens de Mrs Hubble comme d’une petite personne habillée en
bleu de ciel des pieds à la tête, aux contours aigus, qui se croyait
toujours très jeune, parce qu’elle avait épousé M. Hubble je ne sais à
quelle époque reculée, étant bien plus jeune que lui. Quant à M.
Hubble, c’était un vieillard voûté, haut d’épaules, qui exhalait un
parfum de sciure de bois ; il avait les jambes très écartées l’une de
l’autre ; de sorte que, quand j’étais tout petit, je voyais toujours entre
elles quelques milles de pays, lorsque je le rencontrais dans la rue.
Au milieu de cette bonne compagnie, je ne me serais jamais senti
à l’aise, même en admettant que je n’eusse pas pillé le gardemanger.
Ce n’est donc pas parce que j’étais placé à l’angle de la table, que cet
angle m’entrait dans la poitrine et que le coude de M. Pumblechook
m’entrait dans l’œil, que je souffrais, ni parce qu’on ne me permettait
pas de parler (et je n’en avais guère envie), ni parce qu’on me
régalait avec les bouts de pattes de volaille et avec ces parties
obscures du porc dont le cochon, de son vivant, n’avait eu aucune
raison de tirer vanité. Non ; je ne me serais pas formalisé de tout cela,
s’ils avaient voulu seulement me laisser tranquille ; mais ils ne le
voulaient pas.
Ils semblaient ne pas vouloir perdre une seule occasion d’amener
la conversation sur moi, et ce jourlà, comme toujours, chacun
semblait prendre à tâche de m’enfoncer une pointe et de me
tourmenter. Je devais avoir l’air d’un de ces infortunés petits
taureaux que l’on martyrise dans les arènes espagnoles, tant j’étais
douloureusement touché par tous ces coups d’épingle moraux.
Cela commença au moment où nous nous mîmes à table. M.
Wopsle dit les Grâces d’un ton aussi théâtral et aussi déclamatoire,
du moins cela me fait cet effetlà maintenant, que s’il eût récité la
scène du fantôme d’Hamlet ou celle de Richard III, et il termina avec
la même emphase que si nous avions dû vraiment lui en être
reconnaissants. Làdessus, ma sœur fixa ses yeux sur moi, et me dit
d’un ton de reproche :
« Tu entends cela ?… rends grâces… sois reconnaissant !
— Rends surtout grâces, dit M. Pumblechook, à ceux qui t’ont
élevé, mon garçon. »
Mrs Hubble secoua la tête, en me contemplant avec le triste
pressentiment que je ne ferais pas grandchose de bon, et demanda :
« Pourquoi donc les jeunes gens sontils toujours ingrats ? »
Ce mystère moral sembla trop profond pour la compagnie, jusqu’à
ce que M. Hubble en eût, enfin, donné l’explication en disant :
« Parce qu’ils sont naturellement vicieux. »
Et chacun de répondre :
« C’est vrai ! »
Et de me regarder de la manière la plus significative et la plus
désagréable.
La position et l’influence de Joe étaient encore amoindries, s’il est
possible, quand il y avait du monde ; mais il m’aidait et me consolait
toujours quand il le pouvait ; par exemple, à dîner, il me donnait de
la sauce quand il en restait.
Ce jourlà, la sauce était très abondante et Joe en versa au moins
une demipinte dans mon assiette.
Un peu plus tard M. Wopsle fit une critique assez sévère du
sermon et insinua dans le cas hypothétique où l’Église « aurait été
ouverte à tout le monde » quel genre de sermon il aurait fait. Après
avoir rappelé quelquesuns des principaux points de ce sermon, il
remarqua qu’il considérait le sujet comme mal choisi ; ce qui était
d’autant moins excusable qu’il ne manquait certainement pas
d’autres sujets.
« C’est encore vrai, dit l’oncle Pumblechook. Vous avez mis le
doigt dessus, monsieur ! Il ne manque pas de sujets en ce moment, le
tout est de savoir leur mettre un grain de sel sur la queue comme aux
moineaux. Un homme n’est pas embarrassé pour trouver un sujet, s’il
a sa boîte à sel toute prête. »
M. Pumblechook ajouta, après un moment de réflexion :
« Tenez, par exemple, le porc, voilà un sujet ! Si vous voulez un
sujet, prenez le porc !
— C’est vrai, monsieur, reprit M. Wopsle, il y a plus d’un
enseignement moral à en tirer pour la jeunesse. »
Je savais bien qu’il ne manquerait pas de tourner ses yeux vers
moi en disant ces mots.
« Astu écouté cela, toi ?… Puissestu en profiter, me dit ma
sœur » d’un ton sévère, en matière de parenthèse.
Joe me donna encore un peu de sauce.
« Les pourceaux, continua M. Wopsle de sa voix la plus grave, en
me désignant avec sa fourchette, comme s’il eût prononcé mon nom
de baptême, les pourceaux furent les compagnons de l’enfant
prodigue. La gloutonnerie des pourceaux n’estelle pas un exemple
pour la jeunesse ? (Je pensais en moimême que cela était très bien
pour lui qui avait loué le porc d’être aussi gras et aussi savoureux.)
Ce qui est détestable chez un porc est bien plus détestable encore
chez un garçon.
— Ou chez une fille, suggéra M. Hubble.
— Ou chez une fille, bien entendu, monsieur Hubble, répéta M.
Wopsle, avec un peu d’impatience ; mais il n’y a pas de fille ici.
— Sans compter, dit M. Pumblechook, en s’adressant à moi, que
tu as à rendre grâces de n’être pas né cochon de lait…
— Mais il l’était, monsieur ! s’écria ma sœur avec feu, il l’était
autant qu’un enfant peut l’être. »
Joe me redonna encore de la sauce.
« Bien ! mais je veux parler d’un cochon à quatre pattes, dit M.
Pumblechook. Si tu étais né comme cela, seraistu ici maintenant ?
Non, n’estce pas ?
— Si ce n’est sous cette forme, dit M. Wopsle en montrant le plat.
— Mais je ne parle pas de cette forme, monsieur, repartit M.
Pumblechook, qui n’aimait pas qu’on l’interrompît. Je veux dire qu’il
ne serait pas ici, jouissant de la vue de ses supérieurs et de ses aînés,
profitant de leur conversation et se roulant au sein des voluptés.
Auraitil fait tout cela ?… Non, certes ! Et quelle eût été ta destinée,
ajoutatil en me regardant de nouveau ; on t’aurait vendu moyennant
une certaine somme, selon le cours du marché, et Dunstable, le
boucher, serait venu te chercher sur la paille de ton étable ; il t’aurait
enlevé sous son bras gauche, et, de son bras droit il t’aurait arraché à
la vie à l’aide d’un grand couteau. Tu n’aurais pas été « élevé à la
main »… Non, rien de la sorte ne te fût arrivé ! »
Joe m’offrit encore de la sauce, que j’avais honte d’accepter.
« Cela a dû être un bien grand tracas pour vous, madame, dit Mrs
Hubble, en plaignant ma sœur.
— Un enfer, madame, un véritable enfer, répéta ma sœur. Ah ! si
vous saviez !… »
Elle commença alors à passer en revue toutes les maladies que
j’avais eues, tous les méfaits que j’avais commis, toutes les
insomnies dont j’avais été cause, toutes les mauvaises actions dont je
m’étais rendu coupable, tous les endroits élevés desquels j’étais
tombé, tous les trous au fond desquels je m’étais enfoncé, et tous les
coups que je m’étais donné. Elle termina en disant que toutes les fois
qu’elle aurait désiré me voir dans la tombe, j’avais constamment
refusé d’y aller.
Je pensais alors, en regardant M. Wopsle, que les Romains avaient
dû pousser à bout les autres peuples avec leurs nez, et que c’est peut
être pour cette raison qu’ils sont restés le peuple remuant que nous
connaissons. Quoi qu’il en soit, le nez de M. Wopsle m’impatientait
si fort que pendant le récit de mes fautes, j’aurais aimé le tirer
jusqu’à faire crier son propriétaire. Mais tout ce que j’endurais
pendant ce temps n’est rien auprès des affreux tourments qui
m’assaillirent lorsque fut rompu le silence qui avait succédé au récit
de ma sœur, silence pendant lequel chacun m’avait regardé, comme
j’en avais la triste conviction, avec horreur et indignation.
« Et pourtant, dit M. Pumblechook qui ne voulait pas abandonner
ce sujet de conversation, le porc… bouilli… est un excellent manger,
n’estce pas ?
— Un peu d’eaudevie, mon oncle ? » dit ma sœur.
Ô ciel ! le moment était venu ! l’oncle allait trouver qu’elle était
faible ; il le dirait ; j’étais perdu ! Je me cramponnai au pied de la
table, et j’attendis mon sort.
Ma sœur alla chercher la bouteille de grès, revint avec elle, et
versa de l’eaudevie à mon oncle, qui était la seule personne qui en
prît. Ce malheureux homme jouait avec son verre ; il le soulevait, le
plaçait entre lui et la lumière, le remettait sur la table ; et tout cela ne
faisait que prolonger mon supplice. Pendant ce temps, Mrs Joe, et
Joe luimême faisaient table nette pour recevoir le pâté et le pudding.
Je ne pouvais les quitter des yeux. Je me cramponnais toujours
avec une énergie fébrile au pied de la table, avec mes mains et mes
pieds. Je vis enfin la misérable créature porter le verre à ses lèvres,
rejeter sa tête en arrière et avaler la liqueur d’un seul trait. L’instant
d’après, la compagnie était plongée dans une inexprimable
consternation. Jeter à ses pieds ce qu’il tenait à la main, se lever et
tourner deux ou trois fois sur luimême, crier, tousser, danser dans un
état spasmodique épouvantable, fut pour lui l’affaire d’une seconde ;
puis il se précipita dehors et nous le vîmes, par la fenêtre, en proie à
de violents efforts pour cracher et expectorer, au milieu de
contorsions hideuses, et paraissant avoir perdu l’esprit.
Je tenais mon pied de table avec acharnement, pendant que Mrs
Joe et Joe s’élancèrent vers lui. Je ne savais pas comment, mais sans
aucun doute je l’avais tué.
Dans ma terrible situation, ce fut un soulagement pour moi de le
voir rentrer dans la cuisine. Il en fit le tour en examinant toutes les
personnes de la compagnie, comme si elles eussent été cause de sa
mésaventure ; puis il se laissa tomber sur sa chaise, en murmurant
avec une grimace significative :
« De l’eau de goudron ! »
J’avais rempli la bouteille d’eaudevie avec la cruche à l’eau de
goudron, pour qu’on ne s’aperçût pas de mon larcin. Je savais ce qui
pouvait lui arriver de pire. Je secouais la table, comme un médium de
nos jours, par la force de mon influence invisible.
« Du goudron !… s’écria ma sœur, étonnée au plus haut point.
Comment l’eau de goudron atelle pu se trouver là ? »
Mais l’oncle Pumblechook, qui était tout puissant dans cette
cuisine, ne voulut plus entendre un seul mot de cette affaire : il
repoussa toute explication sur ce sujet en agitant la main, et il
demanda un grog chaud au gin. Ma sœur, qui avait commencé à
réfléchir et à s’alarmer, fut alors forcée de déployer toute son activité
en cherchant du gin, de l’eau chaude, du sucre et du citron. Pour le
moment, du moins, j’étais sauvé ! Je continuai à serrer entre mes
mains le pied de la table, mais cette fois, c’était avec une affectueuse
reconnaissance.
Bientôt je repris assez de calme pour manger ma part de pudding.
M. Pumblechook luimême en mangea sa part, tout le monde en
mangea. Lorsque chacun fut servi, M. Pumblechook commença à
rayonner sous la bienheureuse influence du grog. Je commençais,
moi, à croire que la journée se passerait bien, quand ma sœur dit à
Joe de donner des assiettes propres… pour manger les choses froides.
Je ressaisis le pied de la table, que je serrai contre ma poitrine,
comme s’il eût été le compagnon de ma jeunesse et l’ami de mon
cœur. Je prévoyais ce qui allait se passer, et cette fois je sentais que
j’étais réellement perdu.
« Vous allez en goûter, dit ma sœur en s’adressant à ses invités
avec la meilleure grâce possible ; vous allez en goûter, pour faire
honneur au délicieux présent de l’oncle Pumblechook ! »
Devaientils vraiment y goûter ! qu’ils ne l’espèrent pas !
« Vous saurez, dit ma sœur en se levant, que c’est un pâté, un
savoureux pâté au jambon. »
La société se confondit en compliments. L’oncle Pumblechook,
enchanté d’avoir bien mérité de ses semblables, s’écria :
« Eh bien ! mistress Joe, nous ferons de notre mieux ; donnez
nous une tranche dudit pâté. »
Ma sœur sortit pour le chercher. J’entendais ses pas dans l’office.
Je voyais M. Pumblechook aiguiser son couteau. Je voyais l’appétit
renaître dans les narines du nez romain de M. Wopsle. J’entendais M.
Hubble faire remarquer qu’un morceau de pâté au jambon était
meilleur que tout ce qu’on pouvait s’imaginer, et n’avait jamais fait
de mal à personne. Quant à Joe, je l’entendis me dire à l’oreille :
« Tu y goûteras, mon petit Pip. »
Je n’ai jamais été tout à fait certain si, dans ma terreur, je proférai
un hurlement, un cri perçant, simplement en imagination, ou si les
oreilles de la société en entendirent quelque chose. Je n’y tenais plus,
il fallait me sauver ; je lâchai le pied de la table et courus pour
chercher mon salut dans la fuite.
Mais je ne courus pas bien loin, car, à la porte de la maison, je me
trouvai en face d’une escouade de soldats armés de mousquets.
L’un d’eux me présenta une paire de menottes en disant :
« Ah ! te voilà !… Enfin, nous le tenons ; en route !… »





























