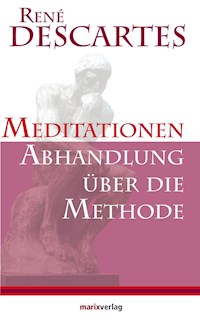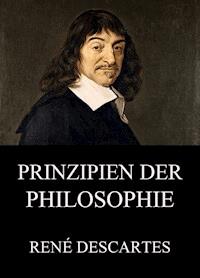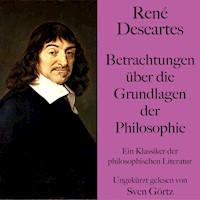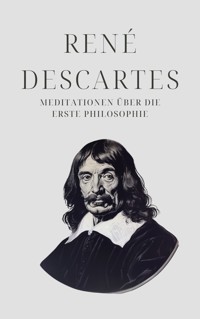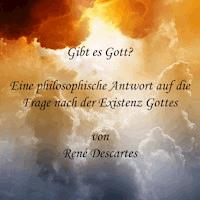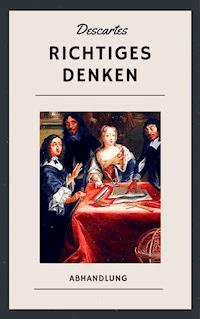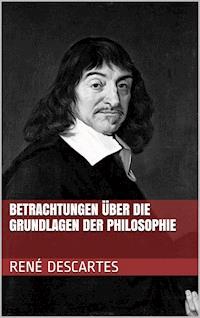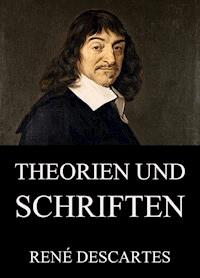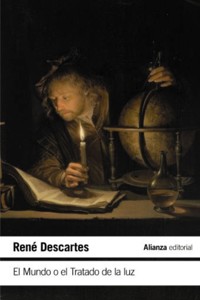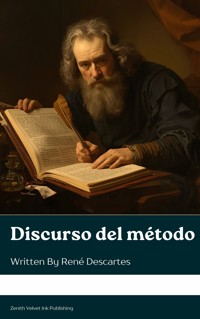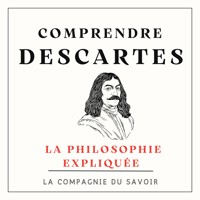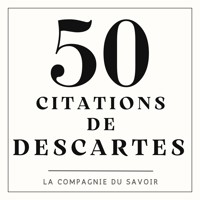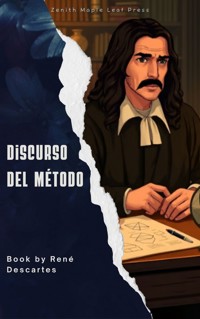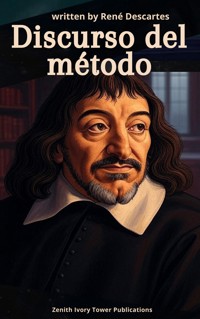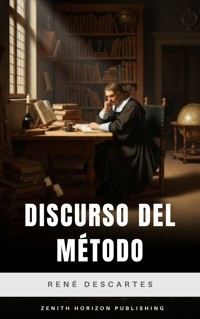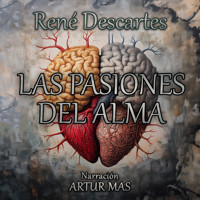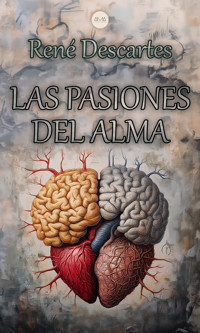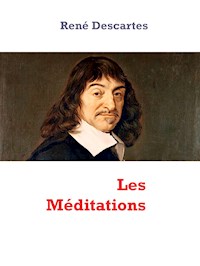
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Les Méditations métaphysiques (ou Méditations sur la philosophie première) sont une oeuvre philosophique de René Descartes, parue pour la première fois en latin en 1641. Du point de vue de l'histoire de la philosophie, elles constituent l'une des expressions les plus influentes du rationalisme classique.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les Méditations
Pages de titrerévoquer en doute.corps.et le corps de l’homme.Page de copyrightLes Méditations
René Descartes
À Messieurs LES DOYENS ET DOCTEURS De
La Sacrée Faculté De Théologie De Paris
MESSIEURS,
La raison qui me porte à vous présenter cet ouvrage est si juste, et,
quand vous en connaîtrez le dessein, je m’assure que vous en aurez
aussi une si juste de le prendre en votre protection, que je pense ne
pouvoir mieux faire, pour vous le rendre en quelque sorte
recommandable, qu’en vous disant en peu de mots ce que je m’y suis
proposé.
J’ai toujours estimé que ces deux questions, de Dieu et de l’âme,
étaient les principales de celles qui doivent plutôt être démontrées par
les raisons de la philosophie que de la théologie : car bien qu’il nous
suffise, à nous autres qui sommes fidèles, de croire par la foi qu’il y a
un Dieu, et que l’âme humaine ne meurt point avec le corps ;
certainement il ne semble pas possible de pouvoir jamais persuader
aux infidèles aucune religion, ni quasi même aucune vertu morale, si
premièrement on ne leur prouve ces deux choses par raison naturelle.
Et d’autant qu’on propose souvent en cette vie de plus grandes
récompenses pour les vices que pour les vertus, peu de personnes
préféreraient le juste à l’utile, si elles n’étaient retenues, ni par la
crainte de Dieu, ni par l’attente d’une autre vie. Et quoiqu’il soit
absolument vrai, qu’il faut croire qu’il y a un Dieu, parce qu’il est
ainsi enseigné dans les Saintes Écritures, et d’autre part qu’il faut
croire les Saintes Écritures, parce qu’elles viennent de Dieu ; et cela
parce que, la foi étant un don de Dieu, celuilà même qui donne la
grâce pour faire croire les autres choses, la peut aussi donner pour
nous faire croire qu’il existe : on ne saurait néanmoins proposer cela
aux infidèles, qui pourraient s’imaginer que l’on commettrait en ceci
la faute que les logiciens nomment un Cercle. Et de vrai, j’ai pris
garde que vous autres, Messieurs, avec tous les théologiens,
n’assuriez pas seulement que l’existence de Dieu se peut prouver par
raison naturelle, mais aussi que l’on infère de la Sainte Écriture, que
sa connaissance est beaucoup plus claire que celle que l’on a de
plusieurs choses créées, et qu’en effet elle est si facile que ceux qui
ne l’ont point sont coupables. Comme il paraît par ces paroles de la
Sagesse, chapitre 13, où il est dit que leur ignorance n’est point
pardonnable : car si leur esprit a pénétré si avant dans la
connaissance des choses du monde, comment estil possible qu’ils
n’en aient point trouvé plus facilement le souverain Seigneur ? Et
aux Romains, chapitre premier, il est dit qu’ils sont inexcusables. Et
encore au même endroit, par ces paroles : Ce qui est connu de Dieu,
est manifeste dans eux, il semble que nous soyons avertis, que tout ce
qui se peut savoir de Dieu peut être montré par des raisons qu’il n’est
pas besoin de chercher ailleurs que dans nousmêmes, et que notre
esprit seul est capable de nous fournir.
C’est pourquoi j’ai pensé qu’il ne serait point hors de propos, que
je fisse voir ici par quels moyens cela se peut faire, et quelle voie il
faut tenir, pour arriver à la connaissance de Dieu avec plus de facilité
et de certitude que nous ne connaissons les choses de ce monde.
Et pour ce qui regarde l’âme, quoique plusieurs aient cru qu’il
n’est pas aisé d’en connaître la nature, et que quelquesuns aient
même osé dire que les raisons humaines nous persuadaient qu’elle
mourait avec le corps, et qu’il n’y avait que la seule Foi qui nous
enseignait le contraire, néanmoins, d’autant que le Concile de Latran,
tenu sous Léon X, en la session 8, les condamne, et qu’il ordonne
expressément aux philosophes chrétiens de répondre à leurs
arguments, et d’employer toutes les forces de leur esprit pour faire
connaître la vérité, j’ai bien osé l’entreprendre dans cet écrit.
Davantage, sachant que la principale raison, qui fait que plusieurs
impies ne veulent point croire qu’il y a un Dieu, et que l’âme
humaine est distincte du corps, est qu’ils disent que personne jusques
ici n’a pu démontrer ces deux choses ; quoique je ne sois point de
leur opinion, mais qu’au contraire je tienne que presque toutes les
raisons qui ont été apportées par tant de grands personnages,
touchant ces deux questions, sont autant de démonstrations, quand
elles sont bien entendues, et qu’il soit presque impossible d’en
inventer de nouvelles : si estce que je crois qu’on ne saurait rien
faire de plus utile en la philosophie, que d’en rechercher une fois
curieusement et avec soin les meilleures et plus solides, et les
disposer en un ordre si clair et si exact, qu’il soit constant désormais
à tout le monde, que ce sont de véritables démonstrations.
Et enfin, d’autant que plusieurs personnes ont désiré cela de moi,
qui ont connaissance que j’ai cultivé une certaine méthode pour
résoudre toutes sortes de difficultés dans les sciences ; méthode qui
de vrai n’est pas nouvelle, n’y ayant rien de plus ancien que la vérité,
mais de laquelle ils savent que je me suis servi assez heureusement
en d’autres rencontres ; j ’ai pensé qu’il était de mon devoir de tenter
quelque chose sur ce sujet.
Or j’ai travaillé de tout mon possible pour comprendre dans ce
traité tout ce qui s’en peut dire. Ce n’est pas que j’aie ici ramassé
toutes les diverses raisons qu’on pourrait alléguer pour servir de
preuve à notre sujet : car je n’ai jamais cru que cela fût nécessaire,
sinon lorsqu’il n’y en a aucune qui soit certaine ; mais seulement j’ai
traité les premières et principales d’une telle manière, que j’ose bien
les proposer pour de très évidentes et très certaines démonstrations.
Et je dirai de plus qu’elles sont telles, que je ne pense pas qu’il y ait
aucune voie par où l’esprit humain en puisse jamais découvrir de
meilleures ; car l’importance de l’affaire, et la gloire de Dieu à
laquelle tout ceci se rapporte, me contraignent de parler ici un peu
plus librement de moi que je n’ai de coutume. Néanmoins, quelque
certitude et évidence que je trouve en mes raisons, je ne puis pas me
persuader que tout le monde soit capable de les entendre.
Mais, tout ainsi que dans la géométrie il y en a plusieurs qui nous
ont été laissées par Archimède, par Apollonius, par Pappus, et par
plusieurs autres, qui sont reçues de tout le monde pour très certaines
et très évidentes, parce qu’elles ne contiennent rien qui, considéré
séparément, ne soit très facile à connaître, et qu’il n’y a point
d’endroit où les conséquences ne cadrent et ne conviennent fort bien
avec tes antécédents ; néanmoins, parce qu’elles sont un peu longues,
et qu’elles demandent un esprit tout entier, elles ne sont comprises et
entendues que de fort peu de personnes : de même, encore que
j’estime que celles dont je me sers ici, égalent, voire même
surpassent en certitude et évidence les démonstrations de géométrie,
j’appréhende néanmoins qu’elles ne puissent pas être assez
suffisamment entendues de plusieurs, tant ; parce qu’elles sont aussi
un peu longues, et dépendantes les unes des autres, que
principalement parce qu’elles demandent un esprit entièrement libre
de tous préjugés et qui se puisse aisément détacher du commerce des
sens. Et en vérité, il ne s’en trouve pas tant dans le monde qui soient
propres pour les spéculations métaphysiques, que pour celles de
géométrie. Et de plus il y a encore cette différence que, dans la
géométrie chacun étant prévenu de l’opinion, qu’il ne s’y avance rien
qui n’ait une démonstration certaine, ceux qui n’y sont pas
entièrement versés, pèchent bien plus souvent en approuvant de
fausses démonstrations, pour faire croire qu’ils les entendent, qu’en
réfutant les véritables.
Il n’en est pas de même dans la philosophie, où, chacun croyant
que toutes ses propositions sont problématiques, peu de personnes
s’adonnent à la recherche de la vérité ; et même beaucoup, se voulant
acquérir la réputation de forts esprits, ne s’étudient à autre chose qu’à
combattre arrogamment les vérités les plus apparentes.
C’est pourquoi, Messieurs, quelque force que puissent avoir mes
raisons, parce qu’elles appartiennent à la philosophie, je n’espère pas
qu’elles fassent un grand effort sur les esprits, si vous ne les prenez
en votre protection.
Mais l’estime que tout le monde fait de votre compagnie étant si
grande, et le nom de Sorbonne d’une telle autorité, que non
seulement en ce qui regarde la Foi, après les sacrés Conciles, on n’a
jamais tant déféré au jugement d’aucune autre compagnie, mais aussi
en ce qui regarde l’humaine philosophie, chacun croyant qu’il n’est
pas possible de trouver ailleurs plus de solidité et de connaissance, ni
plus de prudence et d’intégrité pour donner son jugement ; je ne
doute point, si vous daignez prendre tant de soin de cet écrit, que de
vouloir premièrement le corriger ; car ayant connaissance non
seulement de mon infirmité, mais aussi de mon ignorance, je
n’oserais pas assurer qu’il n’y ait aucunes erreurs, puis après y
ajouter les choses qui y manquent, achever celles qui ne sont pas
parfaites, et prendre vousmêmes la peine de donner une explication
plus ample à celles qui en ont besoin, ou du moins de m’en avertir
afin que j’y travaille, et enfin, après que les raisons par lesquelles je
prouve qu’il y a un Dieu, et que l’âme humaine diffère d’avec le
corps, auront été portées jusques au point de clarté et d’évidence : où
je m’assure qu’on les peut conduire, qu’elles devront être tenues pour
de très exactes démonstrations, vouloir déclarer cela même, et le
témoigner publiquement : je ne doute point, disje, que si cela se fait,
toutes les erreurs et fausses opinions qui ont jamais été touchant ces
deux questions, ne soient bientôt effacées de l’esprit des hommes.
Car la vérité fera que tous les doctes et gens d’esprit souscriront à
votre jugement ; et votre autorité, que les athées, qui sont pour
l’ordinaire plus arrogants que doctes et judicieux, se dépouilleront de
leur esprit de contradiction, ou que peutêtre ils soutiendront eux
mêmes les raisons qu’ils verront être reçues par toutes les personnes
d’esprit pour des démonstrations, de peur qu’ils ne paraissent n’en
avoir pas l’intelligence ; et enfin tous les autres se rendront aisément
à tant de témoignages, et il n’y aura plus personne qui ose douter de
l’existence de Dieu, et de la distinction réelle et véritable de l’âme
humaine d’avec le corps. C’est à vous maintenant à juger du fruit qui
reviendrait de cette créance, si elle était une fois bien établie, qui
voyez les désordres que son doute produit ; mais je n’aurais pas ici
bonne grâce de recommander davantage la cause de Dieu et de la
Religion, à ceux qui en ont toujours été les plus fermes colonnes.
Abrégé Des Six Méditations Suivantes
DANS la première, je mets en avant les raisons pour lesquelles
nous pouvons douter généralement de toutes choses, et
particulièrement des choses matérielles, au moins tant que nous
n’aurons point d’autres fondements dans les sciences, que ceux que
nous avons eus jusqu’à présent. Or, bien que l’utilité d’un doute si
général ne paraisse pas d’abord, elle est toutefois en cela très grande,
qu’il nous délivre de toutes sortes de préjugés, et nous prépare un
chemin très facile pour accoutumer notre esprit à se détacher des
sens, et enfin, en ce qu’il fait qu’il n’est pas possible que nous ne
puissions plus avoir aucun doute, de ce que nous découvrirons après
être véritable.
Dans la seconde, l’esprit, qui, usant de sa propre liberté, suppose
que toutes les choses ne sont point, de l’existence desquelles il a le
moindre doute, reconnaît qu’il est absolument impossible que
cependant il n’existe pas luimême. Ce qui est aussi d’une très grande
utilité, d’autant que par ce moyen il fait aisément distinction des
choses qui lui appartiennent, c’estàdire à la nature intellectuelle, et
de celles qui appartiennent au corps. Mais parce qu’il peut arriver
que quelquesuns attendent de moi en ce lieulà des raisons pour
prouver l’immortalité de l’âme, j’estime les devoir maintenant
avertir, qu’ayant tâché de ne rien écrire dans ce traité, dont je n’eusse
des démonstrations très exactes, je me suis vu obligé de suivre un
ordre semblable à celui dont se servent les géomètres, savoir est,
d’advancer toutes les choses desquelles dépend la proposition que
l’on cherche, avant que d’en rien conclure.
Or la première et principale chose qui est requise, avant que de
connaître l’immortalité de l’âme, est d’en former une conception
claire et nette, et entièrement distincte de toutes les conceptions que
l’on peut avoir du corps : ce qui a été fait en ce lieulà. Il est requis,
outre cela, de savoir que toutes les choses que nous concevons
clairement et distinctement sont vraies, selon que nous les
concevons : ce qui n’a pu être prouvé avant la quatrième Méditation.
De plus, il faut avoir une conception distincte de la nature corporelle,
laquelle se forme, partie dans cette seconde, et partie dans la
cinquième et sixième Méditation. Et enfin, l’on doit conclure de tout
cela que les choses que l’on conçoit clairement et distinctement être
des substances différentes, comme l’on conçoit l’esprit et le corps,
sont en effet des substances diverses, et réellement distinctes les unes
d’avec les autres : et c’est ce que l’on conclut dans la sixième
Méditation. Et en la même aussi cela se confirme, de ce que nous ne
concevons aucun corps que comme divisible, au lieu que l’esprit, ou
l’âme de l’homme, ne se peut concevoir que comme indivisible : car,
en effet, nous ne pouvons concevoir la moitié d’aucune âme, comme
nous pouvons faire du plus petit de tous les corps ; en sorte que leurs
natures ne sont pas seulement reconnues diverses, mais même en
quelque façon contraires.
Or il faut qu’ils sachent que je ne me suis pas engagé d’en rien
dire davantage en ce traitéci, tant parce que cela suffit pour montrer
assez clairement que de la corruption du corps la mort de l’âme ne
s’ensuit pas, et ainsi pour donner aux hommes l’espérance d’une
seconde vie après la mort ; comme aussi parce que les prémisses
desquelles on peut conclure l’immortalité de l’âme, dépendent de
l’explication de toute la physique : premièrement, afin de savoir que
généralement toutes les substances, c’estàdire toutes les choses qui
ne peuvent exister sans être créées de Dieu, sont de leur nature
incorruptibles, et ne peuvent jamais cesser d’être, si elles ne sont
réduites au néant par ce même Dieu qui leur veuille dénier son
concours ordinaire. Et ensuite, afin que l’on remarque que le corps,
pris en général, est une substance, c’est pourquoi aussi il ne périt
point ; mais que le corps humain, en tant qu’il diffère des autres
corps, n’est formé et composé que d’une certaine configuration de
membres, et d’autres semblables accidents ; et l’âme humaine, au
contraire, n’est point ainsi composée d’aucuns accidents, mais est
une pure substance. Car encore que tous ses accidents se changent,
par exemple, qu’elle conçoive de certaines choses, qu’elle en veuille
d’autres, qu’elle en sente d’autres, etc., c’est pourtant toujours la
même âme ; au lieu que le corps humain n’est pus le même, de cela
seul que la figure de quelquesunes de ses parties se trouve changée.
D’où il s’ensuit que le corps humain peut facilement périr, mais que
l’esprit, ou l’âme de l’homme (ce que je ne distingue point), est
immortelle de sa nature.
Dans la troisième Méditation, il me semble que j’ai expliqué assez
au long le principal argument dont je me sers pour prouver
l’existence de Dieu. Toutefois, afin que l’esprit du lecteur se pût plus
aisément abstraire des sens, je n’ai point voulu me servir en ce lieulà
d’aucunes comparaisons tirées des choses corporelles, si bien que
peutêtre il y est demeuré beaucoup d’obscurités, lesquelles, comme
j’espère, seront entièrement éclaircies dans les réponses que j’ai
faites aux objections qui m’ont depuis été proposées. Comme, par
exemple, il est assez difficile d’entendre comment l’idée d’un être
souverainement parfait, laquelle se trouve en nous, contient tant de
réalité objective, c’estàdire participe par représentation à tant de
degrés d’être et de perfection, qu’elle doive nécessairement venir
d’une Cause souverainement parfaite. Mais je l’ai éclairci dans ces
réponses, par la comparaison d’une machine fort artificielle, dont
l’idée se rencontre dans l’esprit de quelque ouvrier ; car, comme
l’artifice objectif de cette idée doit avoir quelque cause, à savoir la
science de l’ouvrier, ou de quelque autre duquel il l’ait apprise, de
même il est impossible que l’idée de Dieu, qui est en nous, n’ait pas
Dieu même pour sa cause.
Dans la quatrième, il est prouvé que les choses que nous
concevons fort clairement et fort distinctement sont toutes vraies ; et
ensemble est expliqué en quoi consiste la raison de l’erreur ou
fausseté : ce qui doit nécessairement être su, tant pour confirmer les
vérités précédentes, que pour mieux entendre celles qui suivent.
Mais cependant il est à remarquer que je ne traite nullement en ce
lieulà du péché, c’estàdire de l’erreur qui se commet dans la
poursuite du bien et du mal, mais seulement de celle qui arrive dans
le jugement et le discernement du vrai et du faux ; et que je n’entends
point y parler des choses qui appartiennent à la foi, ou à la conduite
de la vie, mais seulement de celles qui regardent les vérités
spéculatives et connues par l’aide de la seule lumière naturelle.
Dans la cinquième, outre que la nature corporelle prise en général
y est expliquée, l’existence de Dieu y est encore démontrée par de
nouvelles raisons, dans lesquelles toutefois il se peut rencontrer
quelques difficultés, mais qui seront résolues dans les réponses aux
objections qui m’ont été faites ; et aussi on y découvre de quelle sorte
il est véritable, que la certitude même des démonstrations
géométriques dépend de la connaissance d’un Dieu.
Enfin, dans la sixième, je distingue l’action de l’entendement
d’avec celle de l’imagination ; les marques de cette distinction y sont
décrites. J’y montre que l’âme de l’homme est réellement distincte
du corps, et toutefois qu’elle lui est si étroitement conjointe et unie,
qu’elle ne compose que comme une même chose avec lui. Toutes les
erreurs qui procèdent des sens y sont exposées, avec les moyens de
les éviter.
Et enfin, j’y apporte toutes les raisons desquelles on peut conclure
l’existence des choses matérielles : non que je les juge fort utiles
pour prouver ce qu’elles prouvent, à savoir, qu’il y a un monde, que
les hommes ont des corps, et autres choses semblables, qui n’ont
jamais été mises en doute par aucun homme de bon sens ; mais parce
qu’en les considérant de près, l’on vient à connaître qu’elles ne sont
pas si fermes ni si évidentes, que celles qui nous conduisent à la
connaissance de Dieu et de notre âme ; en sorte que cellesci sont les
plus certaines et les plus évidentes qui puissent tomber en la
connaissance de l’esprit humain. Et c’est tout ce que j’ai eu dessein
de prouver dans ces six Méditations ; ce qui fait que j’omets ici
beaucoup d’autres questions, dont j’ai aussi parlé par occasion dans
ce traité.