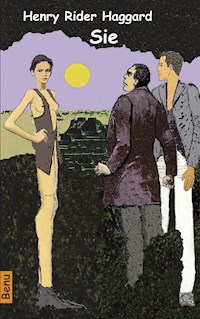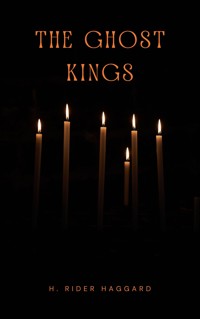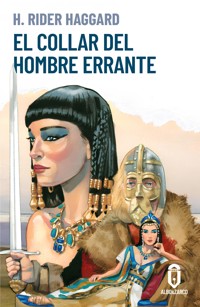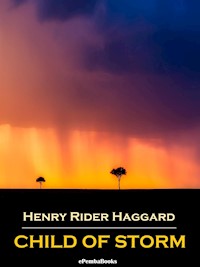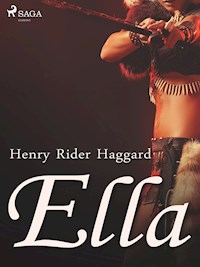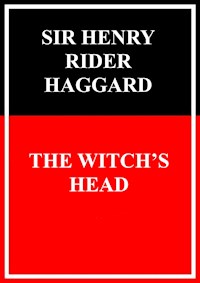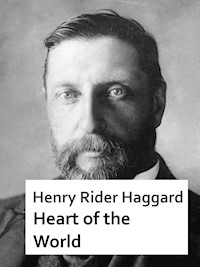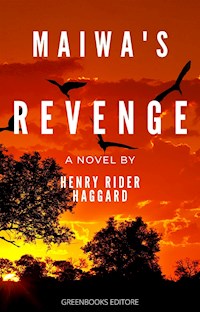Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Terre de Brume
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Suivez les aventures d’Allan Quatermain, l’Indiana Jones du XIXe siècle
Dans les années 1880, trois Anglais s’aventurent dans des contrées inconnues de l’Afrique du Sud, à la recherche de Neville Curtis, parti en quête des fameuses mines de diamants du roi Salomon. Conduit par Allan Quatermain, le groupe d’aventuriers doit affronter de multiples dangers avant de trouver une contrée perdue, celle des Kukuanas, dirigée par le tyran Twala et la sorcière Gagool. Mais qui est le mystérieux Umbopa qui suit l’expédition depuis le départ ? Et comment les aventuriers sauront-ils se sortir des situations les plus périlleuses et gagner la confiance de la population opprimée par Twala ? Il est le premier d’un genre qui s’est constitué à une époque où le continent noir recélait encore de nombreux mystères. Adapté plusieurs fois au cinéma, ce roman ouvre la voie à plusieurs récits mettant en scène Allan Quatermain, véritable archétype de l’aventurier anglais de la période coloniale, dont la célèbre "Ligue des Gentlemen extraordinaires" n’a pas manqué de faire son leader.
Avec L’Île au trésor de Stevenson, Les Mines du roi Salomon est sans conteste le roman d’aventures le plus célèbre de la littérature anglaise
EXTRAIT
Lorsqu’on y réfléchit, c’est quand même une chose bizarre que l’idée me soit venue, à mon âge, c’est-à-dire à cinquante-cinq ans bien sonnés, de prendre la plume pour essayer d’écrire un livre. Je serais curieux de savoir quelle tournure il aura quand il sera terminé, si toutefois j’ai la patience d’aller jusqu’au bout de l’aventure ! J’ai accompli bon nombre de choses au cours de mon existence, qui me paraît fort longue, sans doute parce que j’ai commencé à me débrouiller très jeune. À l’âge où les autres enfants vont encore à l’école, je gagnais déjà mon pain dans le commerce dans la vieille colonie du Natal. Depuis lors, je n’ai pas cessé de m’occuper de négoce, ou de chasse, ou de pêche, ou d’exploitations minières. Et, malgré cela, il y a seulement huit mois que j’ai réussi à faire fortune. Cette fois, c’est un fort joli magot que je possède—je ne sais même pas encore à quel chiffre il faut l’évaluer —, mais je ne crois pas que je consentirais, pour le reconquérir, à revivre les quinze ou seize mois que je viens de passer ; non, pas même si j’étais sûr d’en sortir indemne et doté de mes richesses. Il est vrai que je suis un timide, que j’ai horreur de la violence. Surtout, je suis dégoûté des aventures. À vrai dire, je me demande pourquoi j’entreprends d’écrire ce livre: une tâche qui n’est guère de ma compétence. Je ne suis pas un homme de lettres, quoique je lise avec assiduité l’Ancien Testament et les
Légendes d’Ingoldsby.
A PROPOS DE L’AUTEUR
Henry Rider Haggard est un écrivain britannique, qui se distingue notamment par ses romans d’aventures qui ont influencé de nombreuses œuvres et personnages de cinéma, comme par exemple Indiana Jones. Il a entrepris de nombreux voyages en Afrique, décor de choix pour nombre de ces romans. Bien que ceux-ci témoignent de la domination coloniale britannique, l’écrivain présente les autochtones sous un angle positif. Il a également entretenu pendant de longues années une correspondance avec Rudyard Kipling.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PRÉFACE
Henry Rider Haggard était le huitième d’une famille de dix enfants. Son père, qui avait déjà dû envoyer cinq fils dans de bons lycées privés, décida qu’il était temps de faire des économies ; Henry fréquenta donc le lycée public d’Ipswich, qu’il quitte à dix-sept ans pour passer l’examen d’entrée au ministère des Affaires étrangères. Il fut ensuite expédié en Afrique avec le personnel de sir Henry Bulwer, qui venait d’être nommé lieutenant-gouverneur du Natal. Pour ajouter encore au ressentiment occasionné par ce traitement désinvolte, la jeune fille qu’Henry dut laisser en Angleterre — jeune fille avec laquelle il était, comme le disent les Anglais, « pratiquement fiancé » — ne voulut pas attendre son retour et épousa quelqu’un d’autre.
Haggard fit contre mauvaise fortune bon cœur et adopta pratiquement Henry Bulwer comme nouvelle figure paternelle ; il épousa également avec enthousiasme les théories philosophiques de Bulwer sur le « colonialisme éclairé ». Et peut-être fut-il inspiré par le fait que l’oncle de Bulwer, le premier baron Lytton de Kneb-worth, avait été l’un des auteurs à succès de l’Angleterre de Victoria, et qu’on le considérait encore comme un homme à la carrière immense et diverse.
Haggard fut affecté à l’équipe de l’administrateur Theophilus Shepstone lorsque celui-ci partit annexer le Transvaal, mais il mit un terme prématuré à sa carrière diplomatique en 1879, alors qu’il n’avait que vingt-trois ans. Il acheta un élevage d’autruches, avec l’intention de s’installer dans le veld africain et d’y créer sa propre niche existentielle. Malheureusement, à son retour d’un voyage en Angleterre (pendant lequel il s’était marié), il trouva les Boers en révolte contre la domination anglaise et son élevage d’autruches en ruine. Il dut bientôt rentrer définitivement en Angleterre avec sa femme ; dans l’espoir de trouver une nouvelle carrière, il reprit des études de droit.
Bientôt, la colère qu’avait suscitée en lui la démission du gouvernement anglais face à la rébellion des Boers, laquelle avait ruiné son rêve africain, le poussa à écrire un livre. Ses revendications s’exprimèrent dans un récit qui ne devait rien à la fiction, Cetewayo and his White Neighbours (1882). Cetewayo était un chef zoulou élu en 1873, qui avait mené une révolte contre les Anglais en 1878 ; ses impis avaient infligé une défaite humiliante aux forces britanniques à Isandhlwana, bien qu’ils eussent ensuite dû céder à une artillerie bien plus forte que la leur ; Cetewayo avait alors été fait prisonnier. Haggard tenait les Zoulous en haute estime, et son ouvrage joua un rôle important dans une chaîne d’événements qui eut pour résultat d’amener le prisonnier Cetewayo en Angleterre, où il devint une sorte de célébrité. Les Britanniques essayèrent en conséquence de l’imposer à nouveau comme roi de la nation zouloue, mais les tribus n’en voulurent pas et les Britanniques durent le protéger et le maintenir comme roi fantoche jusqu’à sa mort en 1884.
Haggard fit suivre ce premier livre d’un roman, Dawn (1884), dont le but était, de son propre aveu, de « produire le portrait d’une femme parfaite de corps comme d’esprit, et de montrer comment son personnage mûrissait et devenait de plus en plus élevé sous l’effet de diverses affections ». L’éditeur de son premier livre avait donné un accord par avance, pour s’en assurer la publication, mais le lecteur à qui le manuscrit fut confié demanda une réécriture poussée, en grande partie parce que cette première version finissait par la mort de l’héroïne. Haggard retrouva un terrain littéraire plus prometteur avec The Witch’s Head (1884), roman inspiré de l’histoire vraie qu’il avait racontée dans son premier livre. The Witch’s Head comprenait notamment une description détaillée de la bataille d’Isandhlwana. Quand ses éditeurs refusèrent de le ressortir dans une édition de poche, Haggard décida de se consacrer à sa carrière d’avocat. Il décrocha son diplôme en 1885.
Ce qui incita Haggard à reprendre la plume fut l’immense succès commercial de L’Île au trésor (1883), le classique « pour enfants » de Robert Louis Stevenson. L’un de ses frères aînés, Andrew, se vantait même d’avoir incité Henry à l’action en pariant qu’il n’arriverait pas à en faire autant, mais la version d’Henry était différente : l’idée lui était venue, après avoir lu « un article très intelligent sur les livres pour enfants », de recycler sa connaissance de l’Afrique dans une œuvre de ce genre. Il produisit donc Les Mines du roi Salomon (1885) en un temps record, avec bien moins de soin que ses romans précédents. Quand il lui fallut superviser une édition révisée de l’ouvrage, quelques années plus tard, il dut corriger de petites erreurs, et une impossibilité majeure. L’éclipse dont la prédiction permet aux aventuriers blancs de passer pour de puissants magiciens était dans la première version une éclipse de soleil, mais on fit remarquer à Haggard que les éclipses solaires ne durent que quelques minutes, et non plusieurs heures. L’éclipse devint donc lunaire… Mais la manière désinvolte dont le livre fut écrit lui donne un rythme vif, un ton enlevé, qui contrastent profondément avec la solennité de ses premières œuvres.
Les Mines du roi Salomon connurent un succès instantané. Témoignent de cette immense popularité tant les parodies que le roman suscite que ses multiples imitations. Le livre devint, comme L’Île au trésor, un classique en son genre. Le « truc » de la prédiction de l’éclipse était un coup de théâtre1 si efficace qu’il fut maintes fois copié, notamment dans A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court2 (1889), de Mark Twain.
Dans les années 1880, la littérature regroupée sous l’étiquette de « livres pour garçons » (boys’ books) n’était pourtant pas destinée aux seuls jeunes lecteurs. Les élèves de l’enseignement secondaire étaient supposés lire les mêmes ouvrages que les adultes, mais ils avaient bien sûr leurs préférences à eux. Les boys’ books incluaient aussi nombre d’œuvres pour adultes à but éducatif, bien qu’elles ne le fussent pas dans le même sens que les classiques latins étudiés par ces mêmes élèves.
Un boys’ book typique devait pouvoir être mis sans risque dans les mains d’un futur administrateur de l’empire britannique, afin de lui enseigner les attitudes et les valeurs nécessaires à sa fonction future. En règle générale, il était formaté de façon à glorifier l’aventure impériale en elle-même : il allait de soit qu’il n’y avait guère d’entreprise plus noble pour un jeune homme. Ces livres célébraient également les « vertus masculines » qu’un bon impérialiste se devait d’illustrer par son travail. Les boys’ books n’avaient pas nécessairement de jeunes garçons pour héros, mais ils mettaient un accent très fort sur l’acquisition de la maturité masculine : soit par l’exemple direct, soit par la mise en scène de modèles appropriés.
Cette insistance sur les valeurs masculines va généralement jusqu’à supprimer des boys’ books toute considération du sexe féminin. Les mères, les épouses et les sœurs sont toutes reléguées à la périphérie. Les seuls personnages féminins qui jouent un rôle central dans ces livres sont en général des créatures exotiques ; et leur séduction potentielle paraît aussi dangereuse que la menace plus directe exercée par quelques malfaisantes mégères.
L’Île au trésor, roman historique de pirates, écrit par un Écossais qui n’avait aucun goût pour l’aventure coloniale, avait soigneusement évité de se mêler de la politique de l’empire, pour jouer en toute simplicité avec les autres composantes du genre. Le héros est un jeune garçon, entouré cependant par des hommes adultes, modèles de comportement, tandis que toutes les femmes sont écartées sans pitié de l’action principale. Le génie du roman réside dans le personnage de Long John Silver, ce modèle fort peu convenable vers lequel le jeune héros, Jim Hawkins, est d’abord attiré, avant de se rendre compte des abîmes de perfidie que voile l’apparence joviale du pirate. Mais Haggard avait joué un rôle dans la croisade impériale, et il n’est guère surprenant qu’il se soit révélé bien plus sensible aux courants politiques du moment. Il avait pourtant renoncé à ce rôle, apparemment dégoûté par la tournure que prenait la croisade. Les Mines du roi Salomon ont, en conséquence, plus à dire sur la mission centrale du boys’ book que leur rival ; mais le roman est également plus direct, sans être pour autant plus naïf, dans sa présentation des modèles masculins.
Il n’y a dans Les Mines du roi Salomon aucun « méchant » aussi complexe que peut l’être Long John Silver, mais ce manque est compensé par les caractéristiques problématiques de certains des héros, notamment dans l’exhibition de leur masculinité. La « virilité » était un sujet sur lequel Haggard avait des opinions partagées. Lorsque les éditeurs du magazine The Idler, Robert Barr et Jerome K. Jerome, lui demandèrent de contribuer à une série d’articles sur le thème du « premier livre », en 1893, il put ainsi écrire qu’un « ami candide » avait dit du héros de Dawn « que ce type, Arthur, n’avait de très masculin que son bulldog ». L’article en question était illustré de photographies de Haggard chez lui : pas un seul trophée de chasse dans ces pièces tendues de chintz. La seule présence africaine consistait en un ou deux objets artisanaux exposés sur un manteau de cheminée. Il y avait bien une photographie de Haggard posant avec un fusil à la main, mais il avait l’air peu à son aise et détournait ostensiblement le regard de l’objectif — ce qui n’était pas le cas sur une autre photo, où il tenait ses deux filles sur ses genoux. Quiconque réfléchit à cette citation et aux photographies qui l’accompagnent ne pourra guère s’étonner de ce que la célébration des vertus masculines à l’œuvre dans Les Mines du roi Salomon ne soit pas entièrement conforme au genre du boys’ book. Et cependant, ce sont bien ces valeurs que défend le roman, et la façon assez curieuse dont il choisit de les décrire et de les célébrer ne lui donne que plus d’intérêt.
Le narrateur des Mines du roi Salomon, l’émérite chasseur d’éléphants Allan Quatermain, ne se considère pas comme un héros, et il va même jusqu’à avouer, dans le chapitre XIV, au cœur d’une scène de bataille ( !), que, « pour être honnête, je suis assez peureux ; et vraiment pas porté à la bagarre ». Il ne cesse de répéter tout au long de son récit qu’il n’est pas non plus un aventurier. Il a entendu parler des mines du roi Salomon bien avant d’être contacté par les hommes qu’il accepte d’y conduire, sir Henry Curtis et le capitaine John Good, mais il n’a jamais voulu s’y rendre. De fait, il a même transmis une copie de la carte au trésor, qu’il avait depuis longtemps en sa possession, au frère de Curtis, George, dont la disparition finit par fournir un motif à l’expédition. Quand Quatermain, enfin, accepte de partir, il s’attend à y laisser la vie ; mais il a dépassé ses plus belles années (il a une bonne cinquantaine) et considère l’expédition comme un jeu de hasard à long terme tout juste susceptible de lui procurer une sorte de capital pour son fils, qui vit en Angleterre.
En fait, Quatermain est un bien meilleur modèle que cette description ne le suggère, car sa discrétion ne le conduit jamais à éviter les obstacles ; il a beau être fataliste quand il s’agit de ses motifs et des risques qu’il court, il se montre chaque fois, autant que faire se peut, à la hauteur de la situation. L’effet premier de sa modestie en tant que narrateur n’est pas d’amoindrir l’impression de virilité qu’il donne, mais plutôt de la replacer dans un contexte plus lucide ; l’effet second est de donner force à la description de ses trois compagnons, à ses yeux les véritables héros de l’histoire. Ainsi deviennent-ils de beaux personnages aux yeux du lecteur, ce qui n’aurait pas été le cas avec une narration à la troisième personne ou un narrateur d’une autre sorte.
Si on le compare au petit Jim Hawkins de Stevenson, le vieux Quatermain peut sembler un curieux narrateur à proposer au public cible des boys’ books. Mais le choix se révèle excellent. Ce qui est le plus significatif dans des romans tels que L’Île au trésor et Les Mines du roi Salomon, ce sont les observations et les remarques que leurs héros-narrateurs font à propos d’autres personnages héroïques en quête d’un trésor, et ce que l’on peut apprendre de ces observations. Les jeunes lecteurs glaneront bien des choses des études naïves que Jim fait de ses amis et de ses ennemis, mais c’est précisément la lassitude que Quatermain éprouve vis-à-vis du monde qui donne à son récit toute son autorité, toute son utilité ; son culte des héros peut être pris plus au sérieux que celui de Jim, et contrairement à celui de Jim, il n’est jamais contredit par la réalité.
L’aristocratique Curtis a sans doute quelque chose de sir Henry Bulwer, mais il n’est certainement pas un portrait fidèle de celui qui servit un temps à Haggard de figure paternelle. Le trentenaire Curtis n’est pas un administrateur colonial mais un gentleman anglais, héritier du domaine de son père ; la façon dont il est présenté au lecteur met en valeur sa taille et sa probable ascendance viking. Haggard appréciait grandement les sagas nordiques et se lança d’ailleurs peu après la publications des Mines du roi Salomon dans un roman d’heroic fantasy inspiré de l’une d’entre elles et intitulé Eric Brighteyes (1891) ; il y trouvait de toute évidence ce qui était pour lui la quintessence même de la virilité héroïque.
Il n’est pas anodin que Quatermain pense aux « anciens Danois » comme à des « Zoulous blancs »; Curtis reçoit dans le cours du récit un comparse à sa taille, l’Africain Umbopa, qui rejoint l’expédition et en transforme le but. C’est grâce à Umbopa que les hommes blancs partis à la recherche du frère perdu de Curtis, George, et du trésor des mines du roi Salomon, finissent par y subordonner la quête d’Umbopa, qui est de retrouver ses propres terres, un projet bien plus noble et bien plus exotique que celui de Curtis.
Le compagnon de Curtis dans l’expédition de départ, John Good, est un officier de marine qui a pris sa retraite à l’âge très précoce de trente-cinq ans et se retrouve donc sans but dans l’existence. « Voilà ce que l’on gagne à servir la Reine », remarque Haggard par le biais de Quatermain, « se voir soudain rejeté dans le monde inhospitalier et obligé de se créer une nouvelle situation au moment même où l’on commence à connaître son métier à fond et où l’on se trouve dans toute la force de l’âge. » Haggard fait grand cas des lunettes de Good et de ses fausses dents, qui deviennent les symboles de la vie civilisée, de même que les inévitables armes à feu — dont il fournit amoureusement, par deux fois, la liste et les catégories. Symboles ironiquement contrastés. L’almanach de Good se révèle décisif pour l’intrigue, puisqu’il permet la prédiction de l’éclipse ; mais le fait que les jambes nues du marin, exhibées par mégarde aux Kukuanas lors de leur première rencontre, fournissent un symbole plus durable de son exotique charisme offre un contraste ironique.
Cette surabondance de modèles masculins s’accompagne de la traditionnelle minimisation de l’influence féminine. Au début de sa narration, Quatermain explique que les femmes y ont peu d’importance, bien qu’il admette que deux d’entre elles y sont présentes. La première, Foulata, est la séductrice potentielle ; elle tombe amoureuse de Good, circonstance qui sauve d’ailleurs la vie du marin mais n’empêche pas Foulata d’être présentée comme un embarras constant. La seconde est Gagool, qui joue du mieux qu’elle le peut le rôle de la vile harpie — c’est peut-être même le plus beau spécimen du genre. Bien que Haggard n’en ait sans doute pas eu conscience, il y a un symbole frappant dans la manière dont ces deux personnages scellent chacun le sort de l’autre. Ce qui est encore plus frappant, naturellement, est la manière dont le deuxième de ses boys’ books déviera intentionnellement de la tradition en mettant en scène un personnage principal qui est, de fait, un mélange des caractéristiques essentielles de Gagool et de Foulata : l’anti-héroïne éponyme de She (1886) ; mais cela est une autre histoire.
Au regard de tous ces éléments, l’on peut dire que Les Mines du roi Salomon utilisent une combinaison très profitable de motifs centraux de la tradition des boys’ books, l’établissant ainsi de façon incontestable dans son canon, et d’attitudes relativement plus inhabituelles, ce qui lui assure une précieuse originalité. Cette combinaison s’exprime avec une énergie et une ingéniosité considérables dans une intrigue dont les divers segments marient avec le même bonheur l’attendu et le surprenant.
L’histoire des Mines du roi Salomon peut aussi offrir quelques grandes scènes, et ses faiblesses sont secondaires. La description du voyage vers les terres légendaires est aussi riche en rebondissements que le genre l’exige ; elle comprend en particulier un moment splendidement mémorable, là-haut dans les montagnes ; les scènes de bataille sont rendues avec un intéressant mélange d’énergie et d’amertume, causée par la perte de vies humaines ; la découverte captivante des mines est si merveilleusement mélodramatique que plusieurs de ses détails secondaires, maintes fois copiés, engendrèrent de nombreux clichés.
L’on doit sans doute souhaiter, en particulier lorsqu’ils découvrent ce dernier passage, que les lecteurs essaient de chasser de leur esprit cette cohorte d’imitations et qu’ils abordent le texte comme s’il était aussi neuf qu’en 1885, à sa parution. Même s’ils n’y parviennent pas, ils trouveront un récit solide et une imagerie des plus puissantes. C’est dans la révélation des mines que la stratégie narrative de Haggard reçoit sa récompense la plus évidente, car la découverte du trésor qui lui a servi d’appât produit un décor d’un dramatisme bien plus convaincant qu’un coffre de pirate au couvercle entrouvert, ou que l’excavation d’un trésor enfoui. L’énergie intrinsèque de toutes les séquences de l’intrigue est cependant fortement augmentée par les interactions entre les quatre personnages principaux et le contexte grandiose dans lequel leurs diverses quêtes s’inscrivent.
Toutes les chasses au trésor littéraires qui valent la peine d’être lues sont aussi symboliques que réelles, et toutes finissent sur la relégation du simple gain financier à un rang secondaire. Ce qui importe, c’est une victoire d’un ordre moins matériel. En vérité, les meilleures histoires de chasse au trésor sont celles dont les auteurs prennent ce tournant dans le fil du récit, de sorte que cette transformation spirituelle les surprend tout autant que leurs lecteurs. Les Mines du roi Salomon relèvent de toute évidence de cette catégorie. Haggard était parti pour écrire au débotté une simple aventure, et, de ce point de vue, son roman est une réussite spectaculaire ; mais en atteignant à des richesses moins bien définies, au-delà de la poignée de diamants sur laquelle Quatermain est décidé à mettre la main, il parvint aussi à trouver en lui-même quelque chose qu’il passa le reste de sa vie à essayer de développer.
Umbopa, de même que Henry Curtis, est une extrapolation fantastique à partir d’un personnage réel. En se voyant enfin restituer son héritage et le trône du Kukuanaland, il parvient à une sorte de destin narratif bien plus extrême que ceux de ses compagnons. Alors qu’on les retrouve tous dans la suite des Mines, Allan Quatermain (1887), Umbopa y est remplacé par un certain Umslopogaas, très fidèle double du vrai Zoulou qui lui servit de modèle (lequel, apparemment, fut très heureux d’avoir servi Haggard de cette façon, et put exprimer sa gratitude pour la publicité ainsi faite à sa cause bien plus longtemps que l’infortuné Cetewayo).
Représentation plus exacte de la réalité, Umslopogaas, qui figure également au premier plan de Nada the Lily (1892), sans aucun compagnon blanc pour lui faire de l’ombre, est un personnage moins exotique qu’Umbopa, mais il est en mesure de rendre à Curtis la faveur accordée à Umbopa dans Les Mines du roi Salomon, en permettant à l’Anglais d’atteindre à un but bien plus noble que celui de retrouver son frère perdu. C’était l’objectif premier de Curtis et de son créateur au début des Mines du roi Salomon, mais au fil du récit leurs intentions et leurs moyens ont pris une tout autre dimension. Comme Umbopa dans le premier des deux romans, Curtis découvre son propre paradis terrestre à la fin d’Allan Quatermain : il peut enfin devenir un Zoulou blanc, et atteindre à une relation avec sa terre et son peuple bien meilleure que ce qui fut jamais imaginé (sans parler de la réalité) pendant toute la durée de l’aventure impériale britannique.
De manière significative (et assez maladroite, étant donné que le roman se présente également comme une narration à la première personne), Allan Quatermain meurt à la fin du livre qui porte son nom, comme il s’y attendait au début des Mines du roi Salomon. Cela ne porte pas le coup final à sa carrière littéraire : Haggard en effet continua de rapporter les événements de sa vie passée quelque trente années durant, dans plus d’une douzaine de romans dont l’action se situe avant celle des Mines. Cette mort cependant sert bel et bien à confirmer de la façon la plus catégorique la fragilité de ce en quoi il croyait : la tentative de l’homme blanc de trouver un rôle convenable et un modus vivendi dans une Afrique australe que l’incapacité de ses colons blancs à vivre dans un équilibre sain avec les populations indigènes était en train de ravager.
Les thèses de Rider Haggard et la façon dont Allan Quatermain s’exprime peuvent paraître racistes au lecteur moderne et engendrer un certain malaise ; de plus, l’idée que Haggard se fait de la culture zouloue est romanesque à l’absurde. Reste qu’il fut bien plus proche des indigènes africains qu’aucun écrivain de sa génération. Sa célébration d’un « noble sauvage » à la Rousseau n’était guère nouvelle et surprend essentiellement en ce que la fin du règne de Victoria était sans doute l’environnement culturel le plus hostile à l’extrapolation d’un « culte de la sensibilité ». Mais ce qui différencie Haggard, surtout en tant qu’auteur de boys’ books, est le mépris à peine déguisé qu’il nourrit vis-à-vis du projet impérial et de sa conduite, et la conviction qu’il a en conséquence de la fin catastrophique de ce projet. Les Mines du roi Salomon est, dans le plein sens du terme, un roman d’évasion : mais ce que ses personnages fuient (avec succès pour trois d’entre eux à la fin d’Allan Quatermain), c’est un problème qui n’offre pas d’autre solution.
Un autre aspect remarquable d’Allan Quatermain, outre la mort de son personnage éponyme, est sa dédicace. Celle des Mines du roi Salomon est expressément attribuée à Allan Quatermain : « À tous les enfants petits et grands qui le liront ». Mais Allan Quatermain, bien que l’auteur s’efforce de démontrer l’existence réelle du narrateur en publiant son portrait et son autographe en frontispice, est dédié par Haggard à son fils, Arthur (baptisé du prénom du héros de Dawn, et non celui de sir Henry Bulwer ou le sien). Voici ce que dit cette dédicace : « Je dédie ce roman d’aventures à mon fils, Arthur John Rider Haggard, dans l’espoir que dans les jours à venir lui et d’autres garçons que je ne connaîtrai jamais pourront, dans les actions et les réflexions d’Allan Quatermain et de ses compagnons, tels qu’elles sont ici rapportées, trouver quelque chose qui les aidera à atteindre ce qui est, à mon sens et à celui de sir Henry Curtis, le rang le plus haut de ce à quoi nous pouvons aspirer — la qualité et la dignité d’un gentilhomme anglais. »
Vain espoir : Arthur mourut dans son enfance en 1891 ; les éditions postérieures sont ornées de son portrait, à côté de celui d’Allan Quatermain. Espoir du reste condamné dès le début, comme le montre bien la façon dont l’histoire se développe à partir de la dédicace… Car ce que le texte d’Allan Quatermain nous dit haut et fort est que l’Angleterre n’est plus le milieu qui convient à un gentilhomme anglais, et que le monde réel de l’Afrique coloniale est encore pire, car le seul environnement dans lequel un vrai gentilhomme anglais peut réaliser ses idéaux se trouve au-delà des limites du monde connu. Tout comme Les Mines du roi Salomon, le roman dans lequel Haggard parvint pour la première fois à cette conclusion (ce qui dut sans doute le surprendre lui-même), Allan Quatermain est traversé encore de la faible et fugitive illusion que ce lieu puisse malgré tout se trouver encore au cœur encore inexploré de l’Afrique. Mais Haggard savait qu’il ne s’agissait que d’un rêve bien avant d’écrire le post-scriptum qu’il ajouta aux éditions tardives des Mines du roi Salomon, en 1905. Voici ce qu’il y proclame, sarcastique : « Les faits ont corroboré la fiction ; les mines du roi Salomon que j’avais imaginées ont été découvertes, et elles ont recommencé de fournir leur or ainsi que, d’après de récents témoignages, des diamants. Les Kukuanas, ou plutôt les Matabélés, ont été domptés par les balles de l’homme blanc, mais de nombreux lecteurs trouveront encore beaucoup de plaisir dans ces modestes pages. »
Nous savons très bien que le rêve de Haggard, bien avant 1905, était aussi défunt que le petit Arthur et qu’Allan Quatermain, mais nous comprenons, nous aussi, tout le plaisir qui jaillit encore de ces pages.
BRIAN STABLEFORD
AVERTISSEMENT
Un certain nombre de notes ont été ajoutées pour la présente édition : elles sont signées du traducteur ou de l’éditeur. Les notes de l’édition originale ont été conservées et sont signées « A.Q. » et « H.R.H. » (à la place de la mention « The Editor »).
1. En français dans le texte. (N.d.T.)
2. Traduction française : Un Yankee à la cour du roi Arthur, traduction de Odette Ferry, Terre de Brume, Rennes, 1994.
LES MINES DU ROI SALOMON
Ce compte rendu fidèle, mais sans prétention,
d’une aventure des plus remarquables,
est respectueusement dédié ici par son auteur,
Allan Quatermain, à tous les enfants
petits et grands qui le liront.
1885
Fac-similé de la carte de la route des mines du roi Salomon, aujourd’hui en possession d’Allan Quatermain, Esq., dessinée par dom José da Silvestra avec son propre sang, sur un bout de tissu en lin, en l’an de grâce 1590. (Pour la traduction du texte, se reporter au chapitre II.)
NOTE DE L’AUTEUR
L’auteur se permet de saisir l’opportunité qui lui est offerte de remercier ses lecteurs du chaleureux accueil qu’ils ont réservé aux éditions successives de ce récit au cours des douze dernières années. Il forme le vœu que, dans sa présente parution, celui-ci tombe entre les mains d’un public encore plus large et que, dans les années à venir, il continue de distraire ceux qui ont gardé un cœur assez jeune pour goûter les joies d’un récit où il est question de trésor, de guerre et d’aventure.
Ditchingham 11 mars 1898
POST-SCRIPTUM
Aujourd’hui, en 1905, à l’occasion de la parution de cette édition illustrée, je ne puis qu’ajouter combien je suis heureux que mon récit continue de séduire tant de lecteurs. Les faits ont corroboré la fiction ; les mines du roi Salomon que j’avais imaginées ont été découvertes, et elles ont recommencé de fournir leur or ainsi que, d’après de récents témoignages, des diamants. Les Kukuanas, ou plutôt les Matabélés1, ont été domptés par les balles de l’homme blanc, mais de nombreux lecteurs trouveront encore beaucoup de plaisir dans ces modestes pages. Qu’ils continuent de le faire, même jusqu’à la troisième et la quatrième génération, voire plus longtemps, serait, j’en suis sûr, l’espoir de notre vieil ami perdu, Allan Quatermain.
H. RIDER HAGGARDDitchingham 15 juillet 1905
1. Ou Ndebele, peuple d’origine zoulou conquis par les Anglais en 1893, parfois surnommé « le peuple invisible » en raison des larges boucliers qui les dissimulaient lors des batailles. Le Matabeleland constitua l’une des deux principales régions de la Rhodésie, créée en 1895 (actuellement république du Zimbabwe). (N.d.É.)
INTRODUCTION
À présent que cet ouvrage est imprimé, et sur le point d’être offert au monde, le poids de ses défauts, tant dans son style que dans son contenu, pèse lourdement sur moi. En ce qui concerne ce dernier, tout ce que je peux dire est que ce récit n’a pas la prétention d’être un compte rendu exhaustif de tout ce que nous fîmes et vîmes. Il y a de nombreux événements liés à notre voyage au Kukuanaland sur lesquels j’aurais aimé m’attarder davantage mais auxquels, en fait, j’ai à peine fait allusion. Parmi ceux-ci se trouvent les curieuses légendes que j’ai recueillies, à propos de la cotte de mailles qui nous a sauvés de la mort au cours de la grande bataille de Loo, ou des Gardiens du Silence, ou Colosses, à l’entrée de la grotte de stalactites. Une fois de plus, si j’avais laissé libre cours à ma fantaisie, j’aurais aimé approfondir les différences, dont certaines sont à mes yeux très parlantes, entre les dialectes zoulou et kukuana. De plus, j’aurais pu consacrer avec profit quelques pages à la flore et à la faune indigènes du Kukuanaland1. Il reste enfin le passionnant sujet — qui, en fait, n’a été qu’effleuré — du magnifique système d’organisation militaire en vigueur dans ce pays, laquelle, à mon avis, est nettement supérieure à celle inaugurée par Chaka2 au Zoulouland, dans la mesure où elle permet une mobilisation encore plus rapide, et ne nécessite pas le recours au système pernicieux du célibat forcé. Enfin, j’ai très peu évoqué les usages domestiques et familiaux des Kukuanas, dont la plupart sont extraordinairement pittoresques, ainsi que leur maîtrise de l’art de fondre et de souder les métaux. Ils portent cette science à une impressionnante perfection, dont on peut voir un bon exemple dans leurs tollas, ou lourds couteaux à lancer, le manche de ces armes étant constitué de fer martelé et la lame d’un superbe acier soudé avec une grande adresse à la monture de fer. En vérité, ai-je pensé avec sir Henry Curtis et le capitaine Good, le mieux serait de raconter mon histoire de façon simple et sans détour et, par conséquent, de traiter ces questions de la façon qui semblera la plus appropriée lorsqu’elles se présenteront. En attendant, je serai bien sûr ravi de fournir toutes les informations dont je dispose à quiconque serait intéressé par ces sujets.
À présent, il ne me reste plus qu’à présenter mes excuses pour la rudesse de mon style. Tout ce que je puis dire pour ma défense est que je suis plus habitué à manier le fusil que la plume et n’ai aucune prétention aux grandes envolées fleuries que je lis dans les romans — car il m’arrive parfois d’apprécier d’en lire. Je suppose qu’elles — je parle des grandes envolées fleuries — sont souhaitables, et je regrette de ne pas être capable d’en produire ; mais en même temps, je ne peux m’empêcher de penser que la simplicité est toujours efficace, et que les livres sont plus faciles à comprendre lorsqu’ils sont écrits dans un langage simple, bien que, peut-être, rien ne m’autorise à émettre un avis sur un tel sujet. « Une lance pointue », dit un dicton kukuana, « n’a pas besoin d’être aiguisée »; et dans le même esprit, j’ose espérer qu’une histoire vraie, aussi étrange qu’elle soit, n’a pas besoin d’être ornée de fioritures.
ALLAN QUATERMAIN
1. J’ai découvert huit variétés d’antilopes, à propos desquelles j’étais auparavant totalement ignorant, et de nombreuses nouvelles espèces végétales, pour la plupart bulbeuses. (A.Q.)
2. Chaka (ou Tchaka, Tshaka) : ancien roi des Zoulous de 1818 à 1828, célèbre pour avoir été l’organisateur du système militaire zoulou. (N.d.É.)
CHAPITRE PREMIER
OÙ JE FAIS LA CONNAISSANCE DE SIR HENRY CURTIS
Lorsqu’on y réfléchit, c’est quand même une chose bizarre que l’idée me soit venue, à mon âge, c’est-à-dire à cinquante-cinq ans bien sonnés, de prendre la plume pour essayer d’écrire un livre. Je serais curieux de savoir quelle tournure il aura quand il sera terminé, si toutefois j’ai la patience d’aller jusqu’au bout de l’aventure ! J’ai accompli bon nombre de choses au cours de mon existence, qui me paraît fort longue, sans doute parce que j’ai commencé à me débrouiller très jeune. À l’âge où les autres enfants vont encore à l’école, je gagnais déjà mon pain dans le commerce dans la vieille colonie du Natal. Depuis lors, je n’ai pas cessé de m’occuper de négoce, ou de chasse, ou de pêche, ou d’exploitations minières. Et, malgré cela, il y a seulement huit mois que j’ai réussi à faire fortune. Cette fois, c’est un fort joli magot que je possède — je ne sais même pas encore à quel chiffre il faut l’évaluer —, mais je ne crois pas que je consentirais, pour le reconquérir, à revivre les quinze ou seize mois que je viens de passer ; non, pas même si j’étais sûr d’en sortir indemne et doté de mes richesses. Il est vrai que je suis un timide, que j’ai horreur de la violence. Surtout, je suis dégoûté des aventures. À vrai dire, je me demande pourquoi j’entreprends d’écrire ce livre : une tâche qui n’est guère de ma compétence. Je ne suis pas un homme de lettres, quoique je lise avec assiduité l’Ancien Testament et les Légendes d’Ingoldsby1. Examinons donc un peu les raisons qui m’incitent à le faire, ne seraitce que pour voir si véritablement il y en a.
Première raison : sir Henry Curtis et le capitaine John Good me l’ont demandé.
Deuxième raison : je suis bloqué ici, à Durban, en raison de la souffrance que m’occasionne ma jambe gauche. Depuis le jour où ce maudit lion y a planté ses crocs, elle ne s’est jamais complètement guérie, et comme elle me tracasse plus que de coutume en ce moment, je boite encore davantage. Il faut croire que les dents du lion sécrètent un venin quelconque, sinon comment se fait-il que ces blessures-là aient toujours tendance, une fois fermées, à se rouvrir, en général, notez-le, à l’époque de l’année à laquelle l’accident vous est advenu ? Il est vexant, lorsqu’on a tué comme moi soixante-cinq lions dans sa vie, de voir le soixante-sixième vous mâcher la jambe comme une vulgaire chique de tabac. Cela vous dérange dans vos habitudes et, toute autre considération mise à part, moi qui suis un homme d’ordre, cela me déplaît. Mais, en somme, c’est d’une importance secondaire.
Troisième raison : je désire que mon fils, Harry, qui fait sa médecine à Londres, ait quelque chose pour le distraire et l’empêcher, pendant une ou deux semaines, de commettre quelque bêtise. Le travail d’hôpital doit être parfois bien fastidieux et monotone, car on doit se lasser même de disséquer des cadavres. Et comme mon récit, s’il a d’autres défauts, n’aura certainement pas celui d’être monotone, il devrait divertir Henry un jour ou deux, soit le temps qu’il lui faudra pour lire nos aventures.
Quatrième et dernière raison : je me propose de relater ici l’aventure la plus singulière que je connaisse. La chose peut paraître bizarre, surtout si l’on considère qu’il n’y a pas de rôle de femme dans cette histoire — à part celui de Foulata. Ah ! pardon ! j’allais oublier Gagoola, si tant est qu’il s’agissait d’une femme et non d’un démon. Mais après tout, je ne pouvais pas l’épouser, puisqu’elle était au moins centenaire, par conséquent, je ne la compte pas. Quoi qu’il en soit, je peux affirmer en toute certitude qu’il n’y a pas un seul cotillon dans toute cette histoire.
Mais assez de préambule : il est temps que je prenne le joug. C’est une rude tâche, et j’ai l’impression d’être embourbé jusqu’aux essieux. Mais « sutjes, sutjes », comme disent les Boers — je suis absolument certain de ne pas savoir comment ils l’écrivent —, c’est-à-dire « doucement ». Un bon attelage s’en sortira, du moins s’il n’est pas trop faible — on n’arrive jamais à rien si les bœufs sont maigres. À présent, allons-y !
Moi, Allan Quatermain, de Durban, dans le Natal, et gentleman, je jure et j’atteste… C’est ainsi que je commençai ma déposition devant le juge après la triste fin de ce pauvre Khiva et de ce malheureux Ventvögel ; mais ceci est-il la bonne façon d’entamer un récit ? D’ailleurs, suis-je bien un gentleman ? Et qu’est-ce qu’un gentleman ? Je ne le sais pas exactement, et pourtant, j’ai eu affaire à des nègres — non, je barre ce mot de « nègres », car je ne l’aime pas —, j’ai connu des indigènes qui en étaient, et vous en direz autant, Harry, mon fils, une fois que vous aurez achevé votre lecture, et j’ai connu au pays des blancs vils, les uns riches, les autres non, qui n’en étaient pas.
Quoi qu’il en soit, je suis né gentleman, bien que je n’aie rien été d’autre qu’un pauvre chasseur et négociant itinérant toute ma vie. Je ne sais pas si je le suis resté, vous en jugerez par vous-même. Dans tous les cas, le ciel m’est témoin que j’ai tout fait pour cela. Si j’ai plus d’un meurtre sur la conscience, je n’ai jamais tué gratuitement, mais seulement en cas de légitime défense, ni taché ma main d’un sang innocent. Le Tout-Puissant nous donna la vie, et je suppose qu’Il attendait de nous que nous la préservions, du moins ai-je toujours agi selon ce principe, et j’espère que cela ne sera pas retenu contre moi lorsque mon heure sonnera. Ah ! le monde est bien méchant et bien cruel et, pour un homme aussi timide que moi, j’ai été mêlé à beaucoup de carnages. Je ne sais si ma conduite a toujours été exemplaire, mais ce qu’il y a de certain, c’est que je n’ai jamais volé personne, à part ce Cafre auquel j’ai subtilisé une fois un troupeau de bestiaux. Seulement, il faut dire qu’il m’avait joué un sale tour, et, malgré cela, j’en ai toujours eu un peu de remords.
Bref, il y a dix-huit mois environ, je fis la connaissance de sir Henry Curtis et du capitaine Good. Cela se passa de la façon suivante. J’étais allé chasser l’éléphant jusqu’au-delà de Bamangwato2, mais je jouai de malchance. Le sort s’acharna contre moi au cours de cette expédition et, comble de malheur, je fus terrassé par une fièvre maligne. Aussitôt que je fus rétabli, je gagnai les Champs de Diamants, vendis le peu d’ivoire que je possédais ainsi que mon chariot et mes bœufs, congédiai mes chasseurs et pris la malle-poste pour Le Cap. Après avoir passé une semaine à Cape Town, trouvant qu’on m’écorchait par trop à l’hôtel, et ayant d’ailleurs visité tout ce qu’il y avait à voir dans la ville, y compris les jardins botaniques, lesquels me parurent de nature à apporter un grand bénéfice au pays, ainsi que les nouvelles chambres du Parlement, lesquelles, je pensai, ne feraient rien de tel, je résolus de retourner au Natal à bord du Dunkeld, qui était alors ancré dans le port, où il attendait l’arrivée de l’Edimburg-Castle, venant d’Angleterre. Je réservai une couchette et embarquai donc sans plus tarder et, dans le courant de l’après-midi, les passagers en provenance du Natal à bord de l’Edimburg-Castle nous ayant rejoints, nous appareillâmes et gagnâmes la haute mer.
Parmi ces nouveaux venus, il y en avait deux qui excitaient ma curiosité. Le premier, qui pouvait avoir une trentaine d’années, était surtout remarquable par sa carrure et la longueur de ses bras. Il avait les cheveux jaunes, une grande barbe jaune, des traits admirablement ciselés et de grands yeux gris profondément enfoncés dans leurs orbites. Jamais je n’avais eu l’occasion de voir un homme aussi beau, et il me fit aussitôt songer à quelque Danois de l’ancien temps. Non pas que je possède des connaissances très approfondies sur les anciens Danois, bien que j’aie gardé un mauvais souvenir d’un Danois moderne qui m’a refait de dix livres ; mais je me rappelle avoir vu un tableau représentant un groupe de ces gens-là qui, si je ne m’abuse, devaient être comme une manière de Zoulous blancs. Ils buvaient dans de longues cornes et leurs longs cheveux leur flottaient sur les épaules. En regardant celui dont je parle, et qui se tenait debout près de l’échelle de la dunette, je songeai qu’il aurait suffi de laisser pousser un peu ses cheveux, de mettre une cotte de mailles sur ses larges épaules ainsi qu’une hache d’armes et une corne entre ses mains, pour le transformer en un parfait modèle pour ce tableau. Or, particularité bizarre, et qui prouve bien que nos origines se révèlent toujours plus ou moins, j’appris par la suite que sir Henry Curtis — c’était le nom de ce géant — avait précisément du sang danois dans les veines3. Il me rappelait en outre quelqu’un que j’avais connu ; mais, sur le moment, je fus incapable de préciser de qui il s’agissait.
Le second de ces nouveaux passagers, lequel causait avec sir Henry Curtis, était un homme massif et brun, d’un type essentiellement différent. Je me doutai tout de suite que ce devait être un officier de marine. Je ne sais à quoi cela tient, mais ces gens de mer ont toujours quelque chose qui les distingue des autres. Au cours de mes expéditions de chasse, j’ai eu l’occasion d’en fréquenter plusieurs, et j’ai toujours trouvé en eux des hommes charmants et courageux, auxquels on aurait seulement pu reprocher la trivialité parfois un peu outrée de leur vocabulaire. Je posais tout à l’heure cette question : qu’est-ce qu’un gentleman ? Eh bien, je crois pouvoir répondre : c’est un officier de marine. Il est évident qu’il peut y avoir parmi ceux-ci des brebis galeuses, mais, d’une façon générale, ils méritent certainement cette épithète. J’imagine que l’immensité de l’océan et le souffle sacré du grand large purifient leur cœur, chassent de leur esprit toute amertume et font d’eux les modèles de ce que devrait être l’humanité.
Bref, pour en revenir à mon récit, cette fois encore, j’étais tombé juste ; l’homme brun était bel et bien un officier de marine, un lieutenant de trente et un ans qui, après dix-sept ans au service de Sa Gracieuse Majesté, avait été mis à la retraite avec, pour toute compensation, le titre de commandant, au motif qu’il était impossible de lui accorder une promotion. Voici ce que l’on gagne à servir la Reine : se voir soudain rejeté dans le monde inhospitalier et obligé de se créer une nouvelle situation au moment même où l’on commence à connaître son métier à fond et où l’on se trouve dans toute la force de l’âge. Enfin, chacun voit les choses à sa manière, mais, pour ma part, je préfère de beaucoup n’être qu’un chasseur. C’est un métier où l’on ne gagne pas gros non plus mais où, du moins, on reste son maître.
En consultant la liste des passagers, je constatai qu’il s’appelait Good — capitaine John Good. Il était large, de taille moyenne, brun et massif, et dans l’ensemble, c’était un homme plutôt curieux à étudier. On ne le voyait jamais que vêtu d’une façon irréprochable, rasé de frais et avec un monocle vissé sur l’œil, car ce monocle était dépourvu de cordon et semblait faire partie de son individu, à tel point que je ne le lui ai jamais vu retirer que pour l’essuyer. Au début, je fus même tenté de croire qu’il le gardait pour dormir, mais j’appris plus tard que je m’étais trompé. En se mettant au lit, il le glissait dans la poche de son pantalon en même temps que son dentier, dont la fabrication magnifique excitait mon envie, au risque de me faire enfreindre à plusieurs reprises le dixième commandement. Le mien était si médiocre ! Mais n’anticipons pas.
Peu de temps après que nous eûmes levé l’ancre, la nuit tomba, et elle nous apporta du fort mauvais temps. Un vent très vif se mit à souffler de la côte, et nous fûmes bientôt enveloppés d’une sorte de brouillard écossais, en pire, qui chassa tout le monde du pont. En outre, comme ce Dunkeld était un sabot à fond très plat, et comme il était peu chargé, nous roulions effroyablement. On aurait dit qu’il allait se renverser tout à fait, mais il n’en était rien. Tout déplacement étant impossible, je m’accotai auprès des machines, où il faisait plus chaud, m’amusant à suivre les mouvements du pendule qui était fixé en face de moi, et qui oscillait tantôt dans un sens, tantôt dans l’autre, marquant l’angle qu’atteignait le bateau à chaque inclinaison.
– Ce pendule ne va pas ; il est mal lesté, grommela tout à coup derrière moi une voix quelque peu bourrue.
Je me retournai et me trouvai face à face avec l’officier de marine que j’avais remarqué quand les passagers étaient montés à bord.
– Vraiment ? Qui vous fait supposer cela ? lui demandai-je.
– Supposer ? Je ne suppose rien du tout. Tenez, ajouta-t-il, tandis que le navire se redressait après un nouveau coup de roulis, si le bateau était réellement incliné comme cet instrument l’indique, eh bien ! il n’aurait jamais pu recommencer ça une deuxième fois, voilà tout. Mais ces commandants de la marine marchande sont tous les mêmes !… D’une négligence !…
À ce moment, la cloche du dîner se mit à tinter, et je n’en fus pas fâché, car on en entend de toutes les couleurs quand un officier de la Royal Navy aborde ce sujet-là. Je ne connais rien de pire, sinon lorsqu’un commandant de la marine marchande entreprend d’exprimer son opinion sur les officiers de la Royal Navy.
Le capitaine Good et moi descendîmes donc nous mettre à table, et nous y trouvâmes sir Henry Curtis déjà installé. Le capitaine Good s’assit à côté de lui pendant que je prenais place en face d’eux. Le capitaine et moi nous mîmes rapidement à parler de chasse et de différents sujets ; et il me posa une foule de questions — car il est très curieux de toutes sortes de choses —, auxquelles je m’efforçai de répondre du mieux que je pus. À un moment donné, il aborda la question des éléphants.
– Ah ! commandant, s’écria quelqu’un qui se trouvait auprès de moi, vous ne sauriez mieux tomber ; si quelqu’un est à même de vous documenter sur les éléphants, c’est bien le chasseur émérite qu’est M. Quatermain.
Sir Henry, qui jusqu’alors était resté très calme et s’était borné à écouter notre conversation, tressaillit visiblement.
– Excusez-moi, dit-il en se penchant pour me parler par-dessus la table et en s’exprimant d’une voix profonde et grave que je trouvai très en rapport avec sa carrure, excusez-moi, monsieur, mais votre nom n’est-il pas Allan Quatermain ?
Je lui répondis que oui.
Le colosse ne formula aucune observation, mais je l’entendis qui murmurait dans sa barbe : « C’est de la chance. »
Quelque temps après, le dîner se termina et, comme nous allions sortir, sir Henry Curtis m’invita à rejoindre sa cabine pour y fumer une pipe. J’acceptai sa proposition, et il nous conduisit à la cabine principale du Dunkeld, qui était très confortable. En réalité, elle avait été primitivement composée de deux cabines distinctes, mais on avait abattu la cloison de séparation à l’époque où sir Garnet Wolseley, ou quelque autre rupin, avait navigué à bord du Dunkeld, et on ne l’avait jamais remontée. Il y avait là un sofa, devant lequel se trouvait une petite table. Sir Henry envoya le steward chercher une bouteille de whisky, et, dès que nous fûmes assis tous les trois, nous sortîmes nos pipes.
– Monsieur Quatermain, commença sir Henry Curtis lorsque le steward eut apporté le whisky et allumé la lampe, il y a deux ans, vers cette époque-ci, vous étiez, si je ne me trompe, dans une région appelée le Bamangwato, au nord du Transvaal ?
– En effet, repartis-je un peu surpris de voir mon interlocuteur si bien renseigné sur mes faits et gestes qui, je m’en rendais compte, ne pouvaient présenter qu’un bien mince intérêt pour des étrangers.
– Vous y faisiez du trafic, n’est-il pas vrai ? demanda le capitaine Good avec sa vivacité coutumière.
– En effet. J’avais emmené un chariot chargé de marchandises, établi mon campement devant l’exploitation, et j’y suis resté tant qu’elles ne furent pas écoulées.
Sir Henry était assis en face de moi dans un large fauteuil, les coudes appuyés sur la table. Il leva vers moi ses grands yeux gris et me considéra fixement. Il me sembla lire dans son regard une curieuse anxiété.
– N’y avez-vous pas rencontré par hasard un homme appelé Neville ?
– Oui, il a campé à côté de moi pendant une quinzaine pour faire reposer ses bœufs avant de s’enfoncer dans l’intérieur. Il y a quelques mois, j’ai reçu d’un homme d’affaires une lettre me demandant si je savais ce qu’il était devenu. Je lui ai répondu en lui communiquant tous les renseignements que je possédais sur lui à ce moment-là.
– Je le sais, répondit sir Henry, et votre lettre m’a été transmise. Vous y expliquiez que ce M. Neville avait quitté Bamangwato au commencement de mai dans un chariot avec un conducteur — un voorlooper — et un chasseur cafre appelé Jim, en annonçant qu’il avait l’intention de pousser, si possible, jusqu’à Inyati4, le comptoir le plus avancé qui existe en pays matabélé, où il se proposait de vendre son chariot afin de poursuivre sa route à pied. Vous ajoutiez qu’il avait effectivement vendu son chariot, puisque, six mois après, vous aviez revu le même véhicule en possession d’un négociant portugais qui vous avait dit l’avoir acheté à Inyati à un Blanc, dont il avait oublié le nom, lequel, accompagné d’un serviteur indigène, était parti vers l’intérieur pour une expédition de chasse, croyait-il.
– Oui.
Il y eut une pause.
– Monsieur Quatermain, reprit tout à coup sir Henry, vous ne savez, je présume, ni ne pouvez rien deviner de plus quant aux raisons de mon… du voyage de ce M. Neville vers le nord, ni quant au but de son voyage ?
« N’y avez-vous pas rencontré par hasard un homme appelé Neville ? »
– J’ai bien entendu parler de quelque chose… commençai-je.
Mais je m’arrêtai court. C’était un sujet qu’il me répugnait d’aborder.
Sir Henry et le capitaine Good se regardèrent, et ce dernier hocha la tête.
– Monsieur Quatermain, reprit sir Henry, je vais d’abord vous raconter une histoire ; puis je vous demanderai de me donner un conseil et peut-être de me prêter votre appui. La personne qui m’a renvoyé votre lettre m’a dit que je pouvais avoir toute confiance en votre parole, attendu que vous étiez bien connu et respecté dans le Natal, en même temps que fort apprécié pour votre discrétion.
Je m’inclinai et, comme je suis d’une nature très modeste, je bus une gorgée de grog pour dissimuler ma confusion. Sir Henry poursuivit:
– M. Neville était mon frère.
– Oh ! murmurai-je en sursautant malgré moi, car cette déclaration venait de me révéler à qui j’avais tout de suite songé en voyant pour la première fois mon interlocuteur.
Son frère était de bien plus petite taille que lui et portait une barbe sombre mais, à présent que j’y réfléchissais, ses yeux possédaient la même nuance de gris et il avait le même regard perçant ; ses traits non plus n’étaient pas très différents.
– C’était mon seul frère, continua sir Henry ; il était mon cadet et, jusqu’à ces cinq dernières années, nous ne nous étions jamais quittés plus d’un mois. Mais il y a cinq ans, un malheur, comme il en survient parfois dans les familles, nous advint. Nous eûmes une discussion des plus violentes et, aveuglé par la colère, je me conduisis d’une façon on ne peut plus injuste envers mon frère.
Le capitaine Good opina énergiquement de la tête. À ce moment, un coup de roulis plaça, pendant l’espace de quelques secondes, au-dessus de nos têtes, la glace qui se trouvait en face de nous, à tribord, de sorte que, étant assis les mains dans les poches et les yeux en l’air, je pus y voir le reflet de sa figure.
– Vous n’ignorez sans doute pas, reprit sir Henry, que si un homme meurt intestat et ne possède pour toute fortune que de la terre, sa propriété foncière, comme on dit en Angleterre, tout cela revient de plein droit à son fils aîné. Or, il se trouve que notre père mourut précisément intestat à l’époque où nous eûmes cette brouille. Il avait toujours reculé la rédaction de son testament, jusqu’à ce qu’il fût trop tard. Il en résulta que mon frère, auquel on n’avait enseigné aucune profession, se trouva du jour au lendemain sans le sou. Il va de soi que mon devoir aurait été de lui venir en aide, mais à ce moment-là nous avions tant d’animosité l’un contre l’autre que, je le dis à ma grande honte, je ne tentai rien pour le secourir.
Il poussa un gros soupir, puis reprit:
– N’allez pas croire que mon intention était de me montrer inébranlable à son égard. Seulement, j’aurais voulu qu’il fît le premier pas ; et il ne le fit pas. Excusez-moi de vous ennuyer avec toutes ces explications, monsieur Quatermain, mais elles sont nécessaires pour que vous compreniez… n’est-ce pas, Good ?
– Absolument, absolument, approuva le capitaine Good. D’ailleurs, j’en suis convaincu, M. Quatermain saura garder cette histoire pour lui.
– Soyez tranquilles, répondis-je, étant très fier de ma discrétion, dont la réputation était parvenue jusqu’aux oreilles de sir Henry.
– Bref, continua celui-ci, mon frère, qui avait, à cette époque, quelques centaines de livres sterling sur son compte, retira de la banque ce maigre pécule. Sans me mettre au courant de rien et se faisant appeler Neville, il s’embarqua pour l’Afrique du Sud, avec la folle espérance d’y faire fortune. Cela, je ne l’ai su que plus tard. Trois ans passèrent, et je ne reçus aucune nouvelle de mon frère, bien que je lui eusse écrit plusieurs fois. Sans doute mes lettres ne lui parvinrent-elles pas. Mais mon inquiétude grandissait à mesure que le temps passait. J’ai appris par là, monsieur Quatermain, que les liens du sang sont d’une grande puissance.
– C’est exact, répondis-je en songeant à mon fils Harry.
– Je me suis même aperçu, monsieur Quatermain, que j’aurais donné la moitié de ma fortune pour savoir que mon frère George, le seul parent qui me restât au monde, était sain et sauf, et que je le reverrais un jour.
– Et cependant, vous ne l’avez jamais revu, Curtis, dit le capitaine Good en regardant fixement le géant.
– Eh bien, monsieur Quatermain, plus le temps passait, plus je désirais savoir si mon frère était vivant ou mort, et, dans le cas où il serait vivant, le ramener à la maison. J’entrepris des recherches, et votre lettre fut l’un des résultats que j’obtins. La teneur en était satisfaisante puisqu’elle indiquait que, tout dernièrement encore, George était vivant. Mais les renseignements qu’elle me fournissait étaient si vagues que je décidai d’aller les vérifier par moi-même. Le capitaine Good a eu l’amabilité de m’accompagner.
– Oui, ponctua le capitaine Good, vous comprenez, je n’avais rien à faire, l’Amirauté m’ayant congédié avec une retraite qui me laissait tout juste de quoi ne pas mourir de faim… Et maintenant, monsieur, j’espère que vous voudrez bien nous exposer ce que vous savez ou ce que vous avez entendu dire sur ce soi-disant M. Neville.
1. Célèbre recueil de légendes et de poèmes — la plupart sont surnaturels — de l’écrivain anglais Richard Harris Barham (1788-1845) et publié en plusieurs séries entre 1840 et 1847. (N.d.É.)
2. Renvoit au district de résidence d’un groupe indigène Bechuana d’Afrique du Sud. Tribu de l’actuel Botswana (anciennement Bechuanaland). (N.d.É.)
3. Les idées que forme M. Quatermain sur les Danois paraissent un peu confuses ; pour notre part, nous avons toujours entendu dire qu’ils étaient bruns. Il y a tout lieu de croire qu’il voulait plutôt parler des Saxons. (H. R. H.)
4. Localité de l’actuelle république du Zimbabwe, située au nord-est de Bulawayo. (N.d.É.)
CHAPITRE II
LA LÉGENDE DES MINES DE SALOMON
« Allons, que savez-vous sur le voyage de mon frère à Bamangwato ? me demanda sir Henry, voyant que je m’arrêtais pour bourrer ma pipe avant de répondre au capitaine Good.
– Ce que j’en sais, répliquai-je, le voici, et jamais je n’en ai soufflé mot à âme qui vive. On m’a assuré qu’il voulait aller aux mines de Salomon.
– Les mines de Salomon ! s’écrièrent en même temps mes deux interlocuteurs. Où sont-elles ?
– Je l’ignore, repartis-je ; mais je sais où l’on prétend qu’elles sont. Une fois même, j’ai vu les pics des montagnes derrière lesquelles elles se trouvent, mais j’en étais séparé par un désert d’une étendue de cent trente miles, et, ce désert, je ne crois pas qu’il ait jamais été traversé par des hommes blancs, à l’exception d’un seul. Mais le mieux est peut-être que je vous répète la légende des mines de Salomon telle qu’elle me fut contée. Je ne vous demanderai qu’une chose, c’est de me donner votre parole de n’en rien révéler à quiconque sans ma permission. Dites-moi si vous y consentez. J’ai mes raisons pour cela.
Sir Henry hocha la tête en signe d’affirmation, et le capitaine répondit :
– Certainement, certainement.
– Eh bien, commençai-je, comme vous devez vous en douter, les chasseurs d’éléphants sont, pour la plupart, des hommes rudes, qui ne se soucient guère d’approfondir les mœurs des Cafres auxquels ils ont affaire. Mais, de temps à autre, on rencontre un homme qui se donne la peine de glaner les traditions des indigènes et s’efforce de déchiffrer quelque lambeau de l’histoire de cette terre obscure. Ce fut un de ces hommes-là qui, il y a bientôt trente ans, me conta pour la première fois la légende des mines de Salomon. Je fis sa connaissance lors de ma première chasse à l’éléphant en pays matabélé. Il s’appelait Evans ; il fut tué l’année suivante, le pauvre diable, par un buffle blessé, et il est enterré près des chutes du Zambèze. Un soir, je me rappelle, j’étais en train de raconter à Evans qu’en chassant l’élan et le koudou, dans la région qui est maintenant devenue le district de Lydenburg du Transvaal, j’avais rencontré de prodigieux travaux de mines. Il paraît que, tout dernièrement, des chercheurs d’or ont rencontré ces travaux à leur tour ; mais, moi, il y avait déjà des années que je les connaissais. Il y a là une grande et large route pour les chariots, qui est taillée en plein roc et qui conduit à l’entrée de la galerie souterraine. À l’orifice de cette galerie sont empilés des blocs de quartz aurifère, prêts à être calcinés, ce qui prouve que les ouvrier qui travaillaient dans cette mine, quels qu’ils fussent, ont dû se sauver précipitamment. De plus, à une distance d’environ vingt pas en profondeur, la galerie est murée par une cloison en maçonnerie admirablement construite.
«“En effet, me dit Evans ; mais moi, je vous citerai un fait bien plus curieux encore”. Et il me raconta qu’en s’enfonçant très loin dans l’intérieur, il avait découvert une cité en ruine qu’il croyait être la fameuse Ophir, dont il est fait mention dans dans l’Ancien Testament1