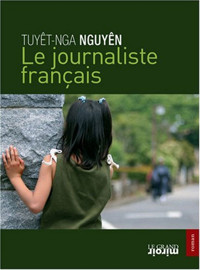Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Renaissance du livre
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
C’est l’histoire d’un homme infidèle, d’une femme bafouée. C’est l’histoire d’un homme qui aime jouer au poker, d’une femme qui aime les mots d’amour. C’est l’histoire d’un pacte du silence, d’un cheminement intérieur accompli dans la solitude du coureur de fond. C’est l’histoire d’une bataille gagnée au forceps, car apprendre à désaimer est un chemin long et douloureux. « Ce qui se construit avec le temps demande du temps pour se déconstruire. Attachement, arrachement, détachement, dans ce processus de l’amour qui naît et qui meurt, je suis seulement au stade de l’arrachement, et à la douleur qui va avec », dit la narratrice. C’est l’histoire d’une victoire. Née au Viêt-Nam, Tuyêt-Nga Nguyên a fait ses études supérieures en Belgique, a vécu aux États-Unis où elle a participé à l’accueil des boat people, a habité en Afrique où elle a enseigné à l’École belge, un parcours qu’elle résume en quatre mots : j’étais globalisée avant l’heure. Devenue Belge par adoption à la fin de la guerre du Viêt-Nam (1975), elle est venue à l’écriture en 2007, comme à un rendez-vous avec l’évidence et maintes fois postposé. Ses premiers livres, des romans historiques, sont consacrés à son pays d’origine et forment une trilogie. Le premier volet (Le journaliste français ) obtient le Prix des Lycéens et le Prix Soroptimist, les deux autres ( Soleil fané , Les Guetteurs de vent) sont finalistes de divers prix, dont celui de la Fédération Bruxelles-Wallonie 2016. Elle vit aujourd’hui à Bruxelles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Une partie de cet ouvrage a été rédigée à la Maison des Écrivains Marguerite Yourcenar en France.
Avenue du Château Jaco, 1 - 1410 Waterloo
www.renaissancedulivre.be
Renaissance du Livre
@editionsrl
Les mots d’amour, je les aime tant
Tuyêt-Nga Nguyên
Couverture : Emmanuel Bonaffini
Mise en page : Josiane Dostie
ISBN : 978-2-50705-597-4
© Renaissance du Livre, 2018
Tous droits réservés. Aucun élément de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans une banque de données ni publié sous quelque forme que ce soit, soit électronique, soit mécanique ou de toute autre manière, sans l’accord écrit et préalable de l’éditeur.
Tuyêt-Nga Nguyên
Les mots d’amour, je les aime tant
À Dog
Prologue
J’habite entre ciel et terre. De ma fenêtre, la vue ne se heurte pas à la jointure de ces deux forces. Une vaste prairie me la dérobe dont les lignes douces font penser aux rondeurs de l’enfance. Quand le temps est favorable, des chevaux y galopent sous le regard tranquille des vaches qui ruminent leurs pensées en même temps que leur nourriture, une herbe que je devine grasse et tendre.
En hiver, la neige venue, la prairie se couvre d’un manteau blanc sur lequel se dressent, immobiles et amaigris, les arbres dépouillés de leur feuillage. Leurs têtes griffent la peau du ciel et me dessinent un horizon dentelé, à l’image de l’existence et ses aspérités.
Quand arrive le printemps, le vent m’apporte le craquement des branches gonflées par la sève nouvelle. Le lait de la terre accomplit son voyage fixé depuis l’éternité. Vigoureux et tenace, il perce l’écorce encore roidie. Là où il suintera écloront feuilles et fleurs, d’où nous viendront fruits et miel.
L’été, la nature à son apogée ploie sous le poids de l’exubérance. Le soleil ardent brouille pistes et frontières. L’or qu’il jette met le feu au désir. Le désir source de souffrances, mais aussi de vie.
Rien ne continue. L’automne est là. Les feuilles rougeoient, s’empourprent, flamboient. Au crépuscule, la prairie s’embrase et prolonge un ciel agonisant en rouge et noir, dans une beauté qui me transperce.
Puis revoilà l’hiver, sa splendeur, sa blancheur, la virginité originelle.
L’éternel recommencement.
C’est ici, devant ce panorama changeant mais toujours éblouissant, que j’ai retrouvé ma paix. Elle m’avait quittée, par un soir comme un autre, par un soir comme celui-ci, un soir d’été.
C’était en 1997. Je peux l’affirmer avec certitude, car cette année-là mourait la princesse de Galles, Lady Diana Spencer, ou Lady Di, après que la voiture dans laquelle elle se trouvait, prise en chasse par les paparazzi, s’était écrasée à vive allure contre la paroi d’un tunnel parisien. Épouse de l’héritier de la Couronne, Diana était promise à un destin de reine. Point aimée par son prince, qui n’avait jamais cessé d’aimer une autre et dont elle finit par divorcer, elle n’était guère que la princesse triste, ainsi qu’on la surnommait. Mais elle était reine dans une multitude de cœurs conquis par sa grâce et sa beauté puis touchés par ses rêves fracassés. Et sans surprise, sa disparition dans la fleur de l’âge – elle avait 36 ans – souleva une vague d’émotion planétaire. Des messages de sympathie affluèrent des quatre coins du monde. Des montagnes de fleurs furent déposées devant la grille de Kensington Palace, sa résidence londonienne. Sous la pression populaire, Buckingham Palace organisa des funérailles nationales pour rendre hommage à celle que sa belle-mère, Sa Très Gracieuse Majesté, n’avait pas non plus choyée. Mais la foule était là, au rendez-vous, venue de tous horizons pour dire adieu à sa Dame de cœur. Composée pour Marilyn, disparue elle aussi dans la fleur de l’âge dans des circonstances tragiques – et toujours non élucidées –, la chanson Candle in the Wind fut adaptée pour rendre hommage à Diana. À sa sortie, interprété par Elton John, le titre pulvérisa les records de vente et passait en boucle sur les ondes, et à chaque fois que je l’entendais, j’avais envie d’être morte moi aussi, non pas pour être regrettée par la terre entière, mais parce que j’aspirais à la paix éternelle en quittant cette vie.
Aujourd’hui, cette idée me fait sourire, et il m’arrive, en surprenant mon reflet dans la vitrine d’un grand magasin, de me demander si cette femme que je vois, le pas long et l’allure dynamique, est bien celle que je fus, l’épouse dévastée, désespérée, quémandant des pilules pour dormir et oublier.
Oui, elle fut moi. Je fus elle.
Le vent a soufflé, très fort, mais pas assez pour éteindre la bougie. Malmenée, fouettée, couchée, sa flamme s’est redressée, timide et vacillante d’abord, droite et fière ensuite. Le contraire eût été dommage, car que n’aurais-je pas raté si elle ne s’était pas relevée !
C’est ce que je me dis, c’est ce qu’on se dit.
Après.
Quand les passions sont éteintes et les cendres, froides.
Quand le douloureux cheminement est terminé.
Quand, attachement, arrachement, détachement, le cycle est complété.
Quand l’histoire est devenue ancienne et qu’une autre a commencé.
Ce soir, pourtant, je me souviens.
Comment m’en empêcher, après ce que je viens d’apprendre ?
La vie ne cessera jamais de m’étonner.
Je suis fatiguée : j’ai marché toute la nuit pour semer ton souvenir. Assise sur un banc, abrutie malgré moi par l’approche du matin, je cesse de me rappeler que j’essaie de t’oublier.
Marguerite Yourcenar
Ce soir de juin 1997, deux mois et demi avant la mort de Diana survenue le 31 août, Fernando est revenu dans ma vie. Je l’aurais bien tué. Mais il était déjà mort. Et c’est lui qui me tue, de sa tombe.
Né dans un Far West saisi par la fièvre de l’or, de la race des desperados pour qui la vie, y compris la leur, ne valait pas un peso, tirant plus vite que dix Lucky Luke locaux réunis, Fernando tuait déjà de son vivant, à tour de bras. Quand il avait le temps, il y mettait la manière, et la Californie se souvient encore de ce jour funeste et lointain où son irruption dans un saloon à la façon d’un Lee Van Cleef en brute finie ou, pire, d’un Clint Eastwood en justicier fâché effraya tant la salle qu’elle se signa, croyant sa dernière heure venue. Le front ombrageux sous le bord de son Stetson, les mains frôlant les pistolets accrochés à son ceinturon, la poitrine barrée de chapelets de cartouches, il s’en amusa comme un gamin, puis lança à la ronde un « Hi guys! » qu’il accompagna d’un large sourire, lequel lui creusa deux belles fossettes dans les joues, ce que voyant, la salle derechef se signa, remerciant le Seigneur pour le sursis. « My name is Fernando and I come from New Mexico. » La politesse ! Une denrée encore plus rare que l’or, dans le coin ! La salle sourit, aux anges. « I kill people for money but you, you are my friends... » La salle leva son verre à sa santé. Il dégaina des deux mains : « … and I’ll kill you for nothing, ha ha! » et tira.
Cette histoire m’a été racontée par mon mari, il y a quelques années. Ce soir, elle est devenue la mienne. Faut-il le préciser ? Je ne suis pas du bon côté des revolvers. La place est occupée par mon mari. Moi, je suis au tapis, comme les friends de Fernando, et ce ne sont pas des coups de feu qui m’y ont expédiée, mais des mots.
Les mots sont pires que les balles : ils ne ratent jamais leur cible.
–Chérie, j’ai quelque chose à te dire, m’a-t-il annoncé, après le dîner.
Nous étions dans la cuisine, lieu de nos repas en famille. Nos trois garçons venaient de quitter la table pour la pièce à côté, où nous lisons, écoutons de la musique, regardons la télé ou bavardons et que nous appelons « petit salon » pour le distinguer du « grand », où nous recevons. Dans une quinzaine de minutes, le temps de finir tranquillement notre verre de vin en discutant de choses et d’autres, travail, école, projets, nous irions les rejoindre. Nous resterions avec eux jusqu’à l’heure de leur coucher, les embrasserions pour la nuit. Plus tard, sur le chemin de notre chambre, nous irions jeter un œil dans les leurs pour voir si tout allait bien, et plus tard encore, nous éteindrions notre lumière et glisserions ensemble dans le sommeil, jusqu’à l’arrivée du nouveau jour. Ainsi le veut la routine, hiver comme été. Ce soir, c’était l’été. Chaude, lumineuse et longue, la journée avait été magnifique. Assise contre la fenêtre basse aux volets grands ouverts, je la regardais s’en aller, légère et parfumée. Je pouvais aussi apercevoir, de l’autre côté de son champ jouxtant notre jardin, le fermier rentrer ses bêtes lentement, sans se presser, sa silhouette se découpant sur un ciel orangé glissant lentement vers le mauve. Ensuite viendrait le bleu, le bleu qui annonce la nuit, le bleu nuit, qui serait piqueté d’étoiles car le ciel était clair. Tant de beauté à notre fenêtre. Je ne m’en lasserais jamais. J’allais lui en faire la réflexion, une énième fois. Je n’en ai pas eu le temps. Il m’a devancée :
–Chérie, j’ai quelque chose à te dire.
–Moi aussi, ai-je répondu, le regard toujours par la fenêtre.
–Je veux que tu saches d’abord une chose : je t’aime et t’aimerai toujours, quoi qu’il arrive, nous vieillirons ensemble, comme nous l’avons toujours dit.
Quel sentimentalisme, soudain. Était-ce l’effet de l’été ? Mais je n’allais pas m’en plaindre. Qui s’en plaindrait ?
–J’y compte bien ! J’ai tourné la tête vers lui, un sourire radieux aux lèvres. Et maintenant, je t’écoute : qu’as-tu à me dire ?
–Cela va te faire très mal.
J’ai pensé à sa santé, car il venait de faire un check-up approfondi dont les résultats avaient dû lui être communiqués le matin. J’ai pensé à ses affaires, qui étaient en fort mauvais état.
J’ai pensé à tort et à travers, car voici ce qu’il m’a dit, après ses jamais et ses toujours :
–Je vois une femme depuis six ans. Elle vient d’avoir un enfant de moi. Il est né il y a dix jours.
J’ai éclaté de rire.
Mon mari aime raconter des histoires drôles. Il les ramasse à foison Dieu sait où et les teste sur moi, qui m’y prête volontiers. Cela se passe généralement après le dîner, durant notre quart d’heure à deux. Si je m’esclaffe, elles sont prêtes pour d’autres oreilles, et je m’esclaffe souvent, car il a un talent fou. Fernando, par exemple, m’a pliée en deux. « But you, you are my friends, and I’ll kill you for nothing! » Il fallait d’abord la trouver, celle-là, et ensuite voir l’artiste en action. Mais d’où sortait-il ces mimiques plus vraies que nature, cette voix rocailleuse sentant la poussière et le désert chauffé à blanc, cet accent californien, nasillard comme il se devait ? Le reste est à l’avenant. Il entre dans la peau de ses personnages avec tant de naturel que trois fois sur quatre, je prends pour de la réalité ce qui n’est que fiction, d’autant qu’il démarre ses histoires sans avoir l’air d’y toucher, les introduisant d’un « Tu sais quoi, il est arrivé un accident au bureau » ou d’un « Hier, un inconnu m’a abordé dans la rue », etc. Je l’écoute avec sérieux, compatis, m’indigne, et son récit terminé, il s’exclame, l’œil malicieux : « Ah, je t’ai eue, comme d’habitude ! », « Mais tu avales tout ce que je dis, c’est pas croyable ! » Ce soir, il n’en aurait pas l’occasion, ce soir, je l’avais percé à jour. Il y avait bien son menton qui tremblait légèrement comme s’il allait pleurer, ses épaules qui s’affaissaient comme sous le poids de toutes les infidélités commises dans le monde, mais ce n’étaient qu’artifices de comédien, et c’était pour lui faire comprendre que cette fois, il ne m’avait pas « eue », que cette fois, je l’avais démasqué, que j’ai éclaté de rire.
Mais il ne comprenait pas.
–Chérie, tu as entendu ce que je viens de dire ?
–Oui : tu viens d’avoir un enfant avec une autre femme.
–Et cela te fait rire ?
–Oh, arrête les frais, c’est une blague. Et une très mauvaise, en plus. Mon conseil : ne la raconte à personne, on ne te croira pas !
Il m’a regardée comme on regarde toute la misère de la terre.
–Comment peux-tu penser que je pourrais te faire une blague pareille ?
Sa voix était tendre, assez tendre pour que mon rire s’éteigne, pour que le doute m’envahisse, pour que mes certitudes s’effondrent.
Pour que je le croie.
On dit que ceux qui se savent en train de mourir revoient en un éclair toute leur vie. J’ai revu notre première rencontre. Les étudiants en médecine donnaient une soirée dansante. Venue avec des potes, dont mon petit ami, je n’avais pas remarqué celui qui, comme il me l’apprendrait plus tard, flasha sur moi dès mon arrivée et ne me quitta plus des yeux. Le DJ mettait surtout de la musique qui déménage, comme on dit de nos jours. Quand enfin arriva un slow et que les spots s’adoucirent et que l’ambiance se fit plus intime, il surgit à mes côtés et sans aucun préambule, me demanda : « Tu danses ? » Prise de court, je me tournai vers mon copain. Bon prince, celui-ci me fit signe d’accepter. La danse finie, il me reconduisit à ma place, ne s’en alla pas, posa sa main sur mon épaule. La bande le remarqua. Mon copain m’entraîna sur la piste. Nous y gesticulâmes une bonne dizaine de minutes. À notre retour, il était toujours là. Il laissa mon épaule tranquille, mais lorsque je quittai la soirée, il me suivit et me barra le chemin : « Quand pourrai-je te revoir ? » Il n’avait pas demandé s’il pouvait me revoir mais quand, nonobstant ma main dans celle de mon ami. Son air sûr de lui me déplut, ainsi que son insolence. Je ne répondis pas. Il insista. Mon ami commença à s’énerver. « Je déjeune parfois au resto U », finis-je par lâcher afin qu’il me lâche. Le resto étant fréquenté par des centaines d’étudiants, ses chances de m’y apercevoir étaient celles de trouver une aiguille dans une botte de foin. Non, mais pour qui se prenait-il ?
Vingt-cinq ans ont passé depuis lors, dont vingt de mariage, et trois enfants nous sont nés. Il venait d’en avoir un quatrième, mais pas avec moi. Un instant oublié, le présent a rappliqué, cruel et brutal. Une lame s’est enfoncée dans ma chair et m’a traversée de part en part, lentement, en prenant tout son temps. La douleur m’a crucifiée. Et comme l’avaient sûrement fait les « amis » de Fernando avant de mourir, j’ai porté la main à mon cœur et ai demandé :
–Pourquoi ?
« Pourquoi ? » ne sert à rien quand le mal est fait, quand aucune réponse ne peut nous apaiser, quand c’est trop tard.
Il s’est penché en avant. Vers moi. Sans que je ne lui aie rien dit, mon corps s’est rejeté en arrière, a quitté la table, s’est éloigné de lui, à reculons. Mon cœur en loques a suivi, cahin-caha. Je ne voulais pas fuir. Seulement mettre de la distance entre lui et moi, comme on s’écarte d’un danger, comme on veut échapper à une menace, comme on se protège d’un ennemi. Alors qu’il était mon havre et mon abri, mon mari et mon ami.
La cuisine est grande, dans les trente mètres carrés. J’ai continué à reculer, jusqu’au moment où, me rentrant dans le dos, le tranchant d’un tiroir ouvert m’a arrêtée. J’étais à quatre mètres de lui. Lui, inerte sur sa chaise, les épaules toujours voûtées, le menton toujours bas, muet comme une pierre. Lui m’offrant le spectacle d’une détresse infinie. Aussi infinie que la mienne ? Plus ? Quelque part en moi, une fibre a bougé. J’ai dit :
–C’est pas grave.
Il n’a pas compris.
–C’est pas grave ! Je viens de t’apprendre que je t’ai trompée avec un enfant à la clé et tout ce que tu trouves à me dire, c’est que c’est pas grave ?
Sans le meuble dans mon dos pour me soutenir, je serais à genoux, le savait-il ? Et puis, que voulait-il que je fasse ? Que je crie, que je hurle, que je me précipite en larmes chez nos enfants, que je quitte la maison, que je le jette à la porte ? Oui, je devais le jeter à la porte, question de dignité. Mais il faut du courage pour être digne dans l’adversité, et je n’en avais pas. Je n’avais plus rien, sauf le sentiment, à le voir à ce point effondré, que nous étions unis dans un même désespoir, lui de m’avoir trahie, moi d’être trahie, et j’ai répété, comme on cherche à conjurer le sort et défier le destin :
–C’est pas grave.
Il s’est levé, a esquissé un pas dans ma direction. Pour me prendre dans ses bras ? Pour me consoler ? Certaines choses sont inconsolables. Certains actes tuent pour toujours. De nouveau, mon corps a parlé, et j’ai vu mes bras jaillir devant moi, mes paumes ouvertes face à lui, en un double « Stop ! » Il s’est arrêté, s’est balancé sur ses jambes, indécis, perdu. Ses beaux yeux noirs ont commencé à s’embuer. C’est un homme sensible. Il pleure sur les chats errants, les chiens perdus, les oiseaux blessés, les enfants abandonnés, quand un film est triste. Tout le monde le dit, moi la première. Là, il pleurait sur ma personne.
Pourquoi donc ?
Quelle était mon infortune ?
D’où venait-elle ?
Lui qui se porte si volontiers au secours des autres, comment pouvait-il me secourir, moi, sa femme, puisque ma douleur venait de lui ? Puisqu’il était ma douleur ? Qu’il me touche et je me désintégrerais, redeviendrais poussière et retournerais à la terre. Qu’il m’effleure et je me liquéfierais, me transformerais en rivière et rejoindrais la mer. Et j’ai reposé la question, vaine et dérisoire :
–Pourquoi ?
Il a secoué la tête. Le pas lent, il a regagné sa chaise. Mais c’est un homme qui rebondit vite, tout le monde le dit aussi, et c’est les épaules redressées et le menton haut qu’il a répété, à peine s’était-il rassis, qu’il m’aimait et m’aimerait toujours, quoi qu’il arrive ; que rien ni personne ne pourrait nous séparer, quoi qu’il advienne ; que nous serions toujours ensemble, avec nos enfants aujourd’hui et nos petits-enfants plus tard, tel que nous l’avions toujours envisagé ; que c’est avec moi qu’il voulait vieillir et terminer sa vie, point final.
J’ai bu ses paroles avec délice, avec ferveur. Les mots d’amour, je les aime tant. Ils gonflent mes veines de cette sève qui fait pousser les fleurs dans le désert, de cette chaleur qui fait que la solitude n’existe pas, de cette espérance qui fait que la vie est joie. Ils lissent mes chagrins, défroissent mes tristesses, colmatent mes fissures. Avec eux, je franchis les mers, escalade les montagnes, dépasse les horizons. L’amour rend invincible, tel est mon credo.
Mais s’il m’aimait, pourquoi avait-il fait un enfant avec une autre ? « But you, you are my friends, and I’ll kill you for nothing! » Ta gueule, Fernando !
Il continuait à parler et moi, à invectiver le desperado défunt.
–Chérie, tu m’écoutes ?
–Oui.
–Qu’est-ce que je viens de dire ?
–Que tu m’aimes, qu’on ne se quittera jamais, qu’on sera toujours ensemble.
–Et ensuite ?
–Je ne sais pas. J’avais l’esprit ailleurs.
⁂
Après la soirée dansante, il allait manger tous les midis au resto U. Il arrivait de bonne heure, garnissait son plateau et s’asseyait face à l’entrée pour ne pas me rater si je me montrais. Je ne me montrais point, déjeunant à la cafétéria, sur la pelouse du campus, chez moi, partout, sauf là où il me guettait. Je ne le faisais pas exprès, afin de l’éviter. C’était comme ça. Et pour tout dire, je l’avais oublié.
Nos pas se recroisèrent cependant, non pas à l’intérieur de la cantine, mais dans un escalier adjacent. Il le montait alors qu’avec mon copain, je le descendais. Quand il m’aperçut, il s’immobilisa un pied en l’air et ne bougea plus, comme statufié. Ce fut ainsi que je sus que c’était lui car, l’ayant à peine regardé de la soirée, je n’avais de son visage qu’un vague souvenir. Mon ami, lui, devait l’avoir examiné sous toutes les coutures car il s’empara de ma main et, le pas nerveux, m’entraîna. « Qu’est-ce que tu as ? » lui demandai-je une fois en bas des marches, la voix innocente. « Ce type ! » « Quel type ? » Je continuai mon numéro. « Celui que ta vue a paralysé là-haut ! – Mais encore ? – C’est lui qui t’a invitée à danser à la soirée de médecine et qui te collait après comme une sangsue ! – Ah bon ? C’est le même ? T’en es sûr ? – Et comment ! Il te draguait sous mon nez ! Je pouvais compter tous ses cheveux ! Vu l’état dans lequel tu viens de le mettre, il en pince toujours pour toi, ce salaud ! – T’énerve pas, ça lui passera ! »
Cela ne lui passa pas. Il continua à aller déjeuner à la cantine et à m’y guetter, et quelques jours après l’escalier, j’atterris à sa table. Sa persévérance avait payé, mais le hasard avait aussi joué car assis face à l’entrée, il me tournait le dos alors que je cherchais une place, de sorte que c’était bien involontairement que j’avais posé mon plateau devant le sien. Sa vigilance avait-elle été prise en défaut ? Avait-il eu un moment de distraction ? Il sursauta en me voyant. Réprimant tant bien que mal ma propre surprise en le reconnaissant, je m’assis, lui dis bonjour ainsi qu’à son voisin, un monsieur grisonnant, probablement un employé de l’université. L’homme me rendit mon bonjour. Lui resta pétrifié, comme sur la marche de l’escalier. Faisant mine de rien, j’attaquai mon repas. Il voulut me parler, bégaya et laissa tomber. Il leva son verre, le déposa aussitôt tant sa main tremblait. Rouge comme une pivoine, il réessaya, n’alla pas plus loin que le bout de son menton. Quelques autres tentatives suivirent, sans plus de succès. Le voisin, qui n’avait pas ses yeux dans sa poche ni sa langue, se tourna vers moi, facétieux : « Qu’avez-vous fait à ce garçon ? » Il plongea le nez dans son assiette comme on veut rentrer sous terre, sans savoir que par ce comportement à mille lieues de celui de la soirée où il s’était montré arrogant et sûr de lui, il avait ému la fleur bleue qui sommeille dans toutes les femmes. Sans savoir qu’il venait de me toucher.
⁂
–Je t’expliquais comment tout ça est arrivé. Je vais recommencer et cette fois, je voudrais que tu m’écoutes. Il est important que tu connaisses l’histoire : tu verras, ce n’est pas ce que tu crois.
Mais je ne croyais rien, moi. Je croyais en lui. En ses jamais et en ses toujours. En ces mots que j’aime parce qu’ils me peignent le ciel en bleu et la vie en rose. Mais ils n’étaient pas de mise, ce soir. Ce soir, c’étaient des mots que je n’aime pas, qui jetaient du gris dans mon ciel et faisaient des trous dans ma vie, les mots de leur histoire.
Ils s’étaient rencontrés sur leur lieu de travail, quelle banalité. Dès le moment où l’assistante de direction vit le cadre supérieur, ce fut l’éblouissement. Elle l’avait toujours attendu. Il était enfin là. Il était marié ? Elle aussi. Il avait des enfants ? Elle pareil. Mais qu’importait cela, tout cela : il était l’homme de sa vie. Elle lui fit des avances. Il les repoussa : il aimait sa femme. Elle ne se découragea pas, le complimenta au contraire d’être un homme fidèle, une qualité qu’elle appréciait. C’était dommage qu’il fût marié et heureux de l’être, c’était pas de chance. Mais n’avait-elle pas droit au bonheur, elle aussi, un bonheur qu’elle ne pouvait concevoir qu’avec lui ? Et puisqu’il n’était pas libre, elle se satisferait de peu. Le voir de temps en temps, à sa meilleure convenance, en toute discrétion, lui suffirait. L’aimer dans l’ombre, façon Back Street, c’était tout ce qu’elle lui demandait. Combien d’hommes résisteraient à un tel chant, la sirène étant de surcroît loin d’être un laideron ? Après de multiples non, il dit oui. Mais qu’elle le comprenne bien : jamais il ne quitterait sa femme pour elle. Ni engagement ni promesse, telle était la condition de la relation. Elle ignora le mot condition, pleura de bonheur devant le mot relation. Peu de temps après, il quitta la société pour s’établir à son compte. Restée derrière, elle se lança dans des études en management en cours du soir. Son diplôme en main, elle démissionna et déménagea de 100 kilomètres pour s’installer dans la même ville que lui, créa une entreprise dont elle lui confia la partie comptable, divorça à ses torts, lui prêta de l’argent quand ses affaires à lui allaient mal. De fil en aiguille, elle resserra leurs liens, de sacrifices en abnégations, elle transforma la relation en liaison. Et six ans après leur première rencontre, elle accoucha de son enfant.
Voilà.
Je l’avais écouté, fascinée. Par un amour fou sans autre loi que la sienne qui est de ne pas en avoir, par une passion portée jusqu’à l’incandescence brûlant tout sur son passage, telle la lave en fusion. Aimer avec fureur, avec douleur, à cœur perdu, à se perdre, à perdre les autres, ainsi l’aimait-elle. Il ne fait pas bon se trouver sur le chemin d’une telle tornade. Je n’étais pas seulement fascinée. J’étais aussi terrifiée.
Qui est-elle ? me suis-je demandé, et à la seconde, j’ai su. J’ai dit son nom comme on pose une question. Il a fait oui de la tête. Et dans la mienne, j’ai revécu la première fois où je l’avais vue, car il y en avait eu plusieurs.
C’était à la maison. Elle avait déjà monté sa société et il travaillait déjà pour elle, une activité qui lui prenait un après-midi par semaine et qu’il ne m’avait jamais cachée, m’en parlant au contraire dès le début. Cela nous permettra de mettre un peu de beurre dans les épinards, me disait-il, faisant allusion à ses affaires qui commençaient à battre de l’aile. Je m’en étais réjouie avec lui, et quand il m’avait demandé si elle pouvait venir à la maison pour un travail urgent, ce samedi-là, j’avais dit bien sûr. J’ai vu arriver une femme aux alentours de la quarantaine, belle en effet. Un brin plus petite que moi qui mesure un mètre soixante-sept, devant s’habiller en 40, une taille au-dessus de la mienne, elle portait un tailleur jupe, un collier fantaisie mais chic, des talons hauts mais non aiguilles et un maquillage léger. Rien d’une vamp. Il n’aurait pas aimé. Il était pour l’élégance, pas pour le tape-à-l’œil. Elle me souriait. Rien d’un sourire carnassier. Je lui ai souri en retour : « Mon mari m’a parlé de vous, il paraît que vous êtes une super businesswoman ! » Après ce compliment que le succès de sa boîte justifiait, je lui ai offert à boire et je suis partie faire les courses. Partir faire les courses ! Alors qu’elle se trouvait sous mon toit, seule avec lui ! Aller acheter des fruits et des fleurs ! Alors que le loup était dans la bergerie ! « Est-ce que vous avez tout ce qu’il faut ? » lui avais-je même demandé avant de sortir. Pauvre idiote, triple imbécile : ce qu’il lui fallait, c’était mon mari ! Le travail urgent n’était qu’un prétexte pour me rencontrer chez moi et voir à quoi ressemblait l’épouse de l’homme de sa vie ainsi que son intérieur, cela me sautait aux yeux, à présent.
Avec le recul toujours, comment ne pas m’apercevoir, aussi, que tout s’étalait devant mon nez, les après-midis où il travaillait à sa compta comme autant de rendez-vous, les activités de promotion pour sa boîte à elle où il devait l’épauler comme autant de moments à deux ? Mais confite dans le bonheur comme une oie dans sa graisse, bercée par des never et des forever, je n’avais rien vu venir, ou beaucoup trop tard, formulant alors des soupçons qu’il balayait de la main et du sourire mais tu dis n’importe quoi, c’est une relation professionnelle rien de plus je t’assure. Il était très convaincant. Comme avec ses blagues. Et je l’ai cru.
On récolte ce qu’on a semé. J’ai récolté leur enfant, qui a dix jours, qui sent le lait et fait « Ouin ! Ouin ! ».
–L’enfant, tu l’as voulu ? ai-je demandé, la voix faiblarde et l’espoir gigantesque.
–Non.
Dieu soit loué, un million de fois.
–C’est la vérité ? J’ai insisté, pour le seul plaisir de l’entendre me dire que c’en était une.
–Oui, et je peux jurer sur la tête de qui tu veux si tu ne me crois pas.
–Pas la peine, je te crois. Et elle, elle l’a voulu ?
–Non plus.
–Et pourtant, il est là !
–C’est un accident.
–Un accident ? À son âge ?
–Ça peut arriver et c’est ce qui est arrivé.
–Supposons. Mais de nos jours, une grossesse non désirée peut s’interrompre. Pourquoi ne l’a-t-elle pas fait ?
–Elle ne savait pas qu’elle était enceinte et après, c’était trop tard : elle était déjà à plus de trois mois.
J’avais peut-être mal entendu.
–Donc, non seulement elle est tombée enceinte par accident, comme la première adolescente venue, mais en plus, il lui a fallu trois mois pour s’en apercevoir, alors qu’elle avait déjà deux enfants. C’est bien ce que tu me dis ?
–Oui.
–Et si tu arrêtais de me prendre pour une imbécile ? On n’est plus dans les blagues, je ne ris plus. Que tu me trompes passe encore. Une femme ou un homme, on peut les oublier, même après les avoir aimés à en crever. Mais un enfant ! Un enfant, c’est un lien indestructible entre deux êtres, c’est le souvenir constant de l’autre, c’est l’assurance de ne pas disparaître avec le temps, c’est pour la vie ! Elle le savait, elle a voulu cet enfant et elle l’a fait, et désormais, elle fait partie de ta vie. Voilà ce que je crois et voilà pourquoi je suis terrifiée, car je le suis : elle a tout planifié, depuis le début, et elle ne s’arrêtera pas là.
–Tu te trompes : elle n’est pas comme ça, c’est vraiment un accident !
À quoi bon poursuivre mon pseudo-interrogatoire ? De bonne foi ou non, il s’en tiendrait à sa version, et de mon côté, je n’avais aucune preuve matérielle pour étayer la mienne, seulement des convictions intimes qu’il lui serait facile d’écarter en vertu de ce principe sacré qui veut qu’on ne peut pas être à la fois juge et partie. Et puis, du moment qu’il s’agissait d’un accident chez lui, que m’importait de savoir ce qui avait pu être chez elle ? J’ai laissé tomber.
⁂
Lorsque je me levai avec mon plateau, il bondit sur ses pieds. « Je peux t’offrir un verre quelque part ? » me demanda-t-il, sans plus trébucher sur aucun mot. Le voisin en sursauta de plaisir et me regarda, l’air de dire : « Acceptez, Mademoiselle : ce garçon n’a rien bu de tout le repas, il doit avoir très soif. » Il – le voisin – me convainquit.
C’était l’été indien. Température de soie et de l’or partout, dans l’air, sur les arbres, sur les murs, sur la peau. Notre choix se porta sur une terrasse au soleil, à quelques pas du campus. Il commanda les boissons, une bière pour lui, un jus de fruit pour moi. Sur le chemin de l’établissement, j’avais remarqué que les filles se retournaient sur lui. Là, elles le regardaient carrément, certaines avec insistance. Ce fut alors que, l’examinant de plus près à travers mes cils, je m’aperçus qu’il était beau, très beau. Il le devait à la régularité de ses traits, à l’harmonie d’ensemble qui en résultait. Il le devait aussi à ses cheveux, une tignasse indisciplinée, pas assez longue pour être hirsute, assez longue pour pouvoir doucement onduler, dans laquelle on avait envie de fourrer ses doigts. Mais c’étaient surtout ses yeux. Presque noirs (comme ses cheveux), un chouia étirés vers les tempes, bordés de cils épais et interminables, ils lui donnaient un regard qu’on qualifie de velours, qu’on dit caressant, qu’on trouve romantique et, ce qui ne gâchait rien, un tantinet mélancolique. Il était mince et grand. On peut être grand et avoir les jambes courtes. Les siennes étaient longues. Avec un tel physique, pas étonnant qu’il fît fondre les filles, les plus effrontées le draguant sans vergogne, des yeux et du sourire. Sur la terrasse, il ne semblait pas le remarquer, ou n’y prêtait pas attention. Nos noms ayant été échangés en cours de route, nous continuâmes les présentations. Il m’apprit qu’il avait 20 ans et étudiait la finance. Je lui dis que j’étais plus âgée que lui et faisais le droit. Je lui dis aussi de quel pays je venais. La conversation se porta ensuite sur les cours, les profs, les examens, l’été qui se prolongeait et les bienfaits qui en découlaient. À aucun moment, il ne me posa de question sur mon copain.
Une petite demi-heure passa. Je me levai et lui tendis la main.
– Je dois y aller. Merci pour le verre, c’était sympa.
–Tu as cours ? Il repoussa sa chaise.
–Oui, mais à la prochaine heure.
–Tu rentres chez toi ?
–Je dois rassembler mes notes.
–J’ai une voiture. Je te dépose.
Il aurait au moins pu me demander mon avis.
–Merci, mais cela n’en vaut pas la peine : j’habite à 300 mètres, je vais marcher.
–Alors je t’accompagne.
– En fait, c’est un kilomètre, peut-être un peu plus.
–Tant mieux, nous marcherons plus longtemps ensemble.
Il décidait tout pour moi. Il était redevenu le garçon de la soirée.
– Je ne suis pas sûre d’en avoir envie. Écoute, je n’aurais pas dû accepter ton invitation. Je te prie de m’excuser. Au revoir.
⁂
–Qu’est-ce qu’on va faire ?
J’ai sursauté à sa question. Qu’est-ce qu’on va faire ? Il me le demandait à moi ? Où étais-je pendant toutes ces années où il la voyait ? Où étais-je quand il avait accepté qu’elle emménage à un jet de pierre de notre maison pour être plus près de lui et faciliter les visites qu’il lui rendait ? Quantité négligeable dont il avait oublié l’existence pour vivre ses amours clandestines, j’étais promue au rang de conseillère car la situation sentait le roussi, si pas la tragédie. Je voulais hurler de rire. J’ai demandé, la voix faiblarde et l’espoir gigantesque :
–Est-ce que tu l’aimes ?
–Je ne sais pas, par contre, je sais que je t’aime et que je veux rester vivre avec toi.
Dieu soit loué, un million de fois.
–Alors, romps avec elle, cela me semble logique.
–Je ne peux pas : elle vient d’avoir un enfant de moi.
CQFD. Allais-je pour autant jubiler : qu’est-ce je te disais, elle a fait l’enfant non pas par accident mais pour t’empêcher de la quitter, et c’est exactement ce qui se passe ! De nouveau, j’ai laissé tomber. Certains triomphes sont trop amers pour être glorieux. À la place, j’ai précisé, la voix si douce que je me demandais si c’était la mienne :
–