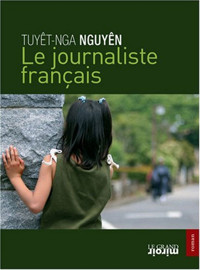Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Renaissance du livre
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
« Sans pays, sans famille, des projets réduits à néant, un avenir laminé par les tanks et mouliné par les rotors, que me reste-t-il ? Le vide que je ressens est absolu, terrifiant. Je n’ai que vingt-deux ans », ainsi parle Tuyêt ce 30 avril 1975, date de la victoire communiste clôturant vingt ans de lutte fratricide au Viêt-Nam. Une semaine plus tard, le pays sombre dans la dictature. Roman sur le chagrin de la guerre et l’utopie égalitaire, entre révolutions sanguinaires et histoires d’amour sublimes, Soleil fané s’inscrit dans la continuité du Journaliste français, un premier titre salué par la critique et couronné par le Prix Soroptimist 2008 et le Prix des Lycéens 2009.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La publication de cet ouvrage a été encouragée par le Fonds d’aide à l’Édition de la Communauté française de Belgique et avec le mécénat des magasins Carrefour.
©Tournesol Conseils SA – Le Grand Miroir
Quai aux Pierres de Taille, 37/39 – 1000 Bruxelles
www.legrandmiroir.eu
Mise en page: CW Design
Conception de la couverture: Emmanuel Bonaffini
Photo de couverture et de quatrième de couverture: Hoài Nam – Ao Trang Calendar
ISBN: 978-2-507-00472-9
Dépôt légal: D/2009/6840/124
Achevé d’imprimer en octobre 2009
par l’imprimerie Chauveheid (Stavelot, Belgique)
Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays.
Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est strictement interdite.
Tuyêt-Nga Nguyên
soleil fané
roman
le grand miroir
À ma mère
À mes enfants
À la terre où je suis née
Prologue
Il était une fois un général.
Au lendemain d’une grande victoire qu’il venait de remporter, le Fils du Ciel le manda et lui dit:
– Tu viens de réussir l’impossible, Grand Général, et je veux terécompenser dignement. Qu’est-ce qui te ferait plaisir? Des terres? Del’or? D’autres titres de noblesse?
–Sire, vous me faites beaucoup d’honneur et je n’aurai pas assez de mille vies pour vous manifester ma reconnaissance. Cependant, permettez-moi de ne pas accepter de récompense car j’en ai déjà une: celle d’avoir su bien vous servir.
L’Empereur caressa sa barbe: les mots qu’il venait d’entendre le remplissaient d’aise, mais un bon monarque doit veiller à reconnaîtrepubliquement le mérite de ses sujets.
–Tu as bien parlé, raison de plus pour que je t’honore. Dis-moi, si tu ne veux rien de ce que je t’ai proposé, peut-être voudrais-tu une femme. Que dirais-tu de la plus belle de mes concubines?
Le Général se courba en deux mais persista dans son refus. L’Empereur se fâcha:
–Quoi? Tu oses dire non à ton Souverain? Ignores-tu que c’estun crime de lèse-majesté qui peut coûter la vie à quiconque le commet?
L’auguste courroux jeta le Général à terre.
–Sire, si je vous ai offensé, châtiez-moi car ce ne sera que justice.
L’Empereur caressa de nouveau sa barbe: un bon monarque doitaussi savoir conserver les talents.
–Hum, pour toi, je saurai me montrer magnanime, à la condition, toutefois, que tu fasses preuve de plus de modestie et saches accepterles récompenses lorsqu’elles sont méritées. Alors, que choisis-tu parmi celles que je t’ai proposées? À moins que tu aies un souhait spécial à formuler, auquel cas, dis-le moi sans crainte.
–Alors, Sire, je voudrais rentrer chez moi sans tarder dessiner les sourcils de ma Bien-Aimée.
Le Général a vraiment existé. Il m’a été raconté par ma grand-mère. Elle disait qu’il appartenait à cette race d’hommesvua danh giac vua lam tho, à la fois guerriers et poètes, parce qu’ils maniaient avec la même virtuosité et le sabre et la plume. Elle disait que les victoires éblouissantes qu’ils remportaient sur les champs de bataille n’avaient d’égal que les chants inoubliables qu’ils composaient dans la solitude du soldat. Elle disait: «Tu vois, ma petite-fille, il faut bien trouver un équilibre entre douceur et violence, aimer et tuer, entre la lune et le soleil, le yin et le yang».
Des saisons sont venues s’ajouter aux saisons et ma grand-mère est partie depuis longtemps, mais ses paroles demeurent enmoi et ce que, enfant, je ne comprenais pas, la vie s’est chargée de mel’apprendre. Elle est parfois très brutale, la vie. Elle vous jette dessus des choses cruelles sans crier gare, sans prendre de gants, à vous de vous débrouiller, avec ce que vous avez reçu, avec ce quevous n’avez pas reçu, pour ne pas crever. C’est ainsi que j’ai comprisla notion d’équilibre dont me parlait ma grand-mère, et que voulait-elle dire sinon que le monde nécessite de la douceur, puisqu’il produit de la violence? qu’il a besoin de poètes, puisqu’il fabrique des guerriers? Et de ces hommesvua danh giac vua lam thodontelle me parlait,j’en ai rencontré deux: Luân, étudiant à Bruxelles, et Lâp, pensionnaire dans un camp de réfugiés en Floride, etentendu parler d’un troisième: Manh, un révolutionnaire du Viêt-Nam, figure éblouissante que j’aurais tant voulu connaître et qu’à défaut, j’ai élevée au rang de mythe.
C’était à l’époque de mes vingt ans, cet âge doré où tout est concevable et rien n’est impossible. Je souriais aux oiseaux et cueillais des étoiles. Violent comme une bourrasque, dévastateur commeun ouragan, le vent s’était levé, dispersant mes oiseaux, éteignant mes étoiles. Et j’ai dû me débrouiller. Comme j’ai pu.
Il y avait la télé, et nous quatre plantés devant: Oncle Quang et seslarmes lourdes et silencieuses, Petit Lôc et ses six ans effarés, Lan et ses nerfs à vif, et moi, anesthésiée.
Sur l’écran, la chute de Saigon, le triomphe de Hanoi, la mort de notre pays.
Climat apocalyptique, spectacle hallucinant, scènes de fin dumonde, etc., aucun mot n’était trop fort dans la bouche des expertsconviés sur le plateau pour décrire le chaos qui présidait à la fin dela guerre du Viêt-Nam, ce lundi 30 avril 1975, et qu’ils attribuaientcomme un seul homme au caractère foudroyant de la victoire communiste. Si foudroyant que vainqueurs et vaincus en étaient également stupéfaits, les uns ne s’y attendant pas avant un an, les autres croyant jusqu’au bout à une solution négociée.
Point n’était besoin de tellement insister là-dessus, d’ailleurs, il suffisait de regarder les images qui défilaient sur l’écran, en vrac, en boucle et en technicolor: une foule hystérique, une ambassade américaine transformée en forteresse et défendue par des Marinescasqués et armés jusqu’aux dents comme s’il s’agissait du Fort Knox,des gens essayant d’en escalader la grille et se faisant refouler sanspitié, ou glissant leurs enfants entre les barreaux, une offrande dontpersonne ne voulait, d’autres agrippés aux arbres ou aux lampadaires et brandissant des passeports, des passe-droits, des n’importe quoi censés leur valoir un billet pour un voyage sans retour, le pont aérien assuré, dans un vacarme assourdissant, par des hélicoptères entre le toit de l’ambassade et les navires qui croisaient au large dans l’attente des derniers évacués, les corps se balançant dans le vide, pendus à des filins jetés du ciel, et que je m’accroche et me décroche, et que je tombe et m’écrabouille au sol, le désespoir des laissés-pour-compte lorsque le dernier appareil s’envolait, emportant avec lui un ambassadeur serrant sur sa poitrine, telle une relique de la terre maudite, leStars and Stripesen perdition.
Monotone à mourir, finalement, que ce spectacle toujours recommencé, agrémenté d’inévitables documents d’archives surle pourquoi, où, quand, comment du conflit qui vient de s’éteindre, le tout saupoudré de statistiques à donner la chair de poule: durée de la guerre: vingt ans, nombre de tués: deux millions, nombrede blessés et de mutilés: près de trois millions, quantité de bombeslarguées: plus de trois fois celles tombées pendant la Seconde guerremondiale, sur tous les fronts.
Puis voilà qu’Oncle Quang a poussé un «Oh!» avant de s’effondrer en sanglots: la caméra zoomait la descente du drapeau auxtrois bandes rouges sur fond jaune, puis l’ascension du drapeau à l’étoile jaune sur fond rouge.Requiem in pace.
Devant le chagrin bruyant de son grand-père, Petit Lôc était encore plus effaré, un spectacle insupportable pour Lan qui serrait ses mains à en blanchir les jointures. Au bout de la chaîne, j’ai jugébon de me payer un fou rire, m’attirant fatalement la question d’un gamin à présent totalement perdu:
– Pourquoi tu ris,Di(Tante) Tuyêt? Grand-Père pleure, lui!
– Ce sont les nerfs, j’ai répondu entre deux hoquets.
– C’est quoi, les nerfs?
Ceux de Lan, en tout cas, ont craqué. Elle a bondi sur ses pieds, a pris son fils par la main.
– Chéri, tout ceci n’est pas pour toi. Viens, je t’emmène chez Mary jouer avec Geoffrey.
Sortie au pas de charge et revenue en trombe, elle s’est jetée sur la télécommande, a envoyé, d’un coup de pouce rageur, les images, les cris, les hurlements, la mort du pays, au diable, le tout, dans un silence sidéral.
– Mais, Lan, on regarde! j’ai protesté.
– Eh bien, vous ne regardez plus! Le spectacle est terminé, comme cette maudite guerre, et c’est tant mieux!
– Comment peux-tu parler comme ça: les communistes ont gagné! j’étais scandalisée.
– Et alors? Vingt ans à s’étriper, ça ne te suffit pas? Lamentez-vous tous les deux, pleurez, agonisez. Moi, je suis contente que le rideau soit tombé sur ce cauchemar, même de cette façon, oui,même de cette façon! Désormais, fini de tuer! fini d’enterrer! C’est pas trop tôt car à l’allure où ça allait, il n’y aurait bientôt plus de place pour les tombes!
La stupeur m’a ôté la voix. Un silence d’une tonne est tombé dans la pièce, puis Oncle Quang a dit, doucement:
– Il n’y a pas que la guerre qui tue, ma chérie, certaines paix tuent aussi, en silence.
Les murs en ont frémi. Lan, elle, ne s’en est pas laissé conter:
– Toi, il faut toujours que tu aies réponse à tout! Et d’abord, qu’est-ce que tu en sais, de ce qu’il va arriver? Moi, je suis sûre d’une chose: ton combat est vain! La preuve était là, devant tes yeux! Toutes ces années que tu as passées à faire la guerre, contre les colonialistes, contre les faux nationalistes, contre les vrais communistes, pour la liberté de ton pays, et pour arriver à quoi? As-tu vécu, d’abord? Depuis la mort de Maman, tout s’est refroidi en toi, à part la Cause, à part la Flamme. Eh bien, aujourd’hui, il n’y a plus de cause, il n’y a plus de flamme. Il n’y a que la réalité: tu as perdu! Per…
– Silence, Lan, ça suffit!
Non, le cri n’avait pas fusé de la poitrine d’Oncle Quang mais de la mienne: on ne tire pas sur un homme à terre! Lan m’a lancé un regard noir et l’espace de quelques tic-tac, j’ai cru qu’elle allait me remettre à ma place en me rappelant que j’étais sous son toit et qu’elle s’adressait à son père et non à moi, mais elle s’est contentée de hausser les épaules avant de s’en aller, dans un violent claquement de porte, retrouver Petit Lôc chez Mary.
– Ouf, je l’ai échappé belle! Mon intervention était vraiment inappropriée, ai-je dit en me tournant vers Oncle Quang, soulagée de m’en être tirée à si bon compte.
– Cela devait arriver, a-t-il répondu, sans plus.
– Ah, vous me comprenez, cela me fait plaisir.
– Je ne parle pas de ton intervention, mais de la colère de Lan.
– Ne vous en faites pas. C’est à cause de ses idées pacifistes: elle se serait emportée contre n’importe qui pleurant la fin de n’importe quelle guerre! ai-je voulu le consoler.
– Je sais bien, mais dans ce cas-ci, il y avait également autre chose.
– Quoi donc?
– Le souvenir de Quôc, de sa mort: la colère est une forme de souffrance, Chau (Nièce) Tuyêt.
Il ne m’a pas fallu un siècle pour comprendre ce qu’il voulaitdire, pour me rappeler cette histoire entendue quelques jours auparavant, qui m’avait fait pleurer mais que j’avais pourtant oubliée, assez, en tout cas, pour ne pas réaliser son impact, ce 30 avril, sur l’âme de celle qui me l’avait racontée.
C’est l’histoire d’une femme hostile aux choses de la guerre mais qui, épouse de soldat, a dû réprimer son sentiment, jusqu’au jour où ce soldat est tombé, le corps tellement déchiqueté qu’on a prié instamment sa veuve de ne pas ouvrir le poncho qui le recouvrait entièrement, qui ne dévoilait que son visage, ses yeux ferméspour toujours. La saison était aux moussons. Sous une tente percéepar la pluie drue des Hauts-Plateaux, sur une bâche détrempée déroulée à même le sol, d’autres dormaient aussi, d’un sommeilsans réveil, le corps plus ou moins entier. C’était pour Lan la goutted’eau, l’écroulement, l’anéantissement, et en même temps qu’àgenoux elle embrassait l’être aimé pour la dernière fois, elle a résolud’emmener son fils loin de la violence de son pays, loin des passions meurtrières des humains, de «cette faucille aveugle qui brille de mille éclats avant de s’enfoncer dans la chair des hommes, dans le cœur des femmes, dans la vie des enfants», pour la citer. Interprète pour les Américains, Lan connaissait l’anglais à la perfection, un atout qu’elle a exploité auprès de ses employeurs pour obtenir unvisa d’immigrant dans leur pays. De leur côté, ils n’avaient pas oubliésa douleur agenouillée et se sont mis en devoir de lui procurer le document demandé. Celui-ci en sa possession, Lan a choisi la Floride pour le climat et s’est installée à Orlando. C’était au début de l’année 1973. Elle avait à peine trente ans.
Et dans cette guerre qui vient de se terminer, elle ne voit effectivement que la fin des ponchos fermés, ainsi qu’est venu me le rappeler l’amour d’un père qui, noble dans la défaite, a su mettre une sourdine à sa propre douleur afin de respecter celle de sa fille. Je ne l’en ai admiré que davantage, moi qui l’admire déjà tant.
Oncle Quang n’est pas n’importe qui, en effet. Proche de la soixantaine, l’allure frêle mais le dos droit, le visage marqué mais le regard clair, il jouit dans son pays d’un statut de héros amplement justifié par un parcours de haut vol et à hauts risques pour servir son idéal de la liberté, la «Cause» dans la bouche de Lan. Des geôles, il en a connu, et de toutes sortes: françaises, japonaises, re-françaises, et même vietnamiennes lors de la purge communiste des années quarante, ramenant de ces séjours un corps couturé de cicatrices, une jambe droite qui n’est plus très droite et une toux chronique. En 1954 et en signe de refus de la doctrine de Hô Chi Minh, il a quitté, avec femme et enfant, le Nord pour le Sud où ila de nouveau fréquenté les prisons de Diêm et des généraux qu’il fâchait par ses exhortations bruyantes et incessantes à plus de démocratie, clamant et re-clamant, du haut et au dehors de sa chaire d’histoire à l’université de Saigon, que c’était la seule arme pour sauver cette moitié du pays du communisme. Sans son aura et l’affection de ses étudiants, il aurait pu disparaître de la circulation. Tout cela, je l’ai appris de Kiêu, ma mère, qui non seulement voue un immense respect à cet ami dont elle partage le combat depuis Mathusalem, mais me l’a érigé en modèle voici des années. Pour tout dire, c’est à cause d’Oncle Quang que j’ai quitté Bruxelles, où je suis étudiante, et fait le voyage jusqu’en Floride, Kiêu ayant voulu que je profite de sa visite dans sa famille pour aller le voir et me faire «conseiller sur mon avenir». Oncle Quang est arrivé de Saigon un mois auparavant, moi, il y a dix jours.
Dans le salon que Lan venait de quitter, j’ai demandé à Oncle Quang s’il voulait qu’on rallume la télé. Il a refusé: à quoi bon fâcher sa fille, et puis, des émotions, il en a assez eu pour aujourd’hui, n’est-ce pas? Il a préféré se retirer dans sa chambre. Je l’ai regardé s’éloigner et mon cœur s’est serré: le dos voûté, le regard éteint, il donnait l’impression d’un chêne foudroyé par la tempête.
Chahutée, la journée avait passé comme elle pouvait, cassée comme une vieille dame. La nuit est arrivée, douce et étoilée. Assise dans la véranda d’une maison silencieuse à mourir, je m’efforce de ne pas entendre le chant des grillons, de ne pas sentir le parfum du da ly huong, cette fleur qui n’embaume qu’à l’heure du crépuscule: chez moi, les grillons chantent aussi, et la fleur y est présente dans bien des jardins que l’on hume le soir en prenant le frais sur le pas de sa porte, avant d’aller se coucher.
Chez moi.
Après quatre années de fac, je devais le retrouver en septembre, diplôme en poche. C’est la saison où, dans mon pays, les flamboyants sont en fleurs, et dans une Saigon qui resplendit, ma famille se réunirait au complet pour fêter mon retour, ma mère me féliciterait, fière et émue. «Viens, je t’emmène à Cap St-Jacques où tu pourras prendre quelques jours de vacances et après, on se mettra au travail, il y a tant de choses à faire dans ce pays», ne manquerait-elle pas de me dire. J’ai caressé ce moment en pensée tant de fois, m’en suis fait une si grande joie. Mes espoirs illuminaient ma vie, mes rêves me hissaient jusqu’au ciel. Mais ce soir, emportés par la bourrasque qui a balayé le Sud, ils ont disparu. Sans pays, sans famille, des projets réduits à néant, un avenir laminé par les tanks et mouliné par les rotors, que me reste-t-il? Le vide que je ressens est absolu, terrifiant. Je n’ai que vingt-deux ans.
C’est pour ça, aussi, que j’ai crié sur Lan tout à l’heure, parce que j’avais mal, pour le père prostré, bien sûr, mais aussi pour moi, et parce que j’avais peur pour ma mère restée là-bas. Rappelée au chagrin de la jeune femme par son père, j’ai cependant tenu à lui présenter mes excuses dès son retour de chez Mary. «Oh, je méritais que tu me fasses taire, oublions donc cet incident, Petite Sœur Tuyêt», m’a-t-elle répondu, le front sans plis, la voix sans aspérités, ce qui ne m’a pas étonnée outre mesure. De fait et pour autant que je puisse en juger après l’avoir côtoyée pendant dix jours, Lan a le tempérament pondéré et la personnalité tranquille, si tranquille qu’elle peut sembler de l’indifférence aux yeux de quelqu’un prompt à s’émouvoir comme moi, moi qui me suis ainsi émue de la voir vaquer le reste de la journée à ses occupations routinières et, l’heure venue, se mettre aux fourneaux pour préparer le dîner, comme les autres jours, comme les autres soirs, comme si on n’était pas le 30 avril 1975, et je n’ai pas pu m’empêcher de penser que, sous la gracilité de l’orchidée, la fleur à laquelle elle emprunte son nom, la jeune femme abrite la résistance du bambou: si le poids du souvenir l’avait ployée cet après-midi, il ne l’a pas rompue. À table où, en l’absence de Petit Lôc, déjà nourri par Mary, et d’Oncle Quang, claquemuré dans sa chambre, nous n’étions finalement que deux, mon impression s’est renforcée: alors que j’avais le nez dans mon bol et les baguettes oisives, Lan a mangé la même quantité que d’habitude, au grain de riz près.
Plongée dans ma méditation, je n’ai pas entendu la jeune femme sortir dans la véranda.
– Tiens, couvre-toi les épaules: il est dix heures passées, tu peux attraper froid, me dit-elle en me tendant un plaid.
Je la remercie et m’exécute tout en me poussant pour lui faire de la place, puis nous contemplons les étoiles.
– Comment ça va? sa voix me parvient au bout d’unmoment.
– Plutôt mal, je lui réponds.
– Tu as peur, n’est-ce pas?
– Oui, les communistes ont gagné et personne n’est dans leur tête pour savoir ce qu’ils vont faire. Je crains le pire.
– Je comprends, mais je crois néanmoins qu’il est trop tôt pour avoir peur. Attendons de voir comment la situation va évoluer.
J’ai beau savoir que les événements ne nous affectent pas de la même façon, je m’agace soudain:
– Je veux bien, Lan, mais la peur ne se raisonne pas, ne s’invite pas. On ne peut pas lui dire «Couche-toi! Tu te lèveras quandje t’en donnerai l’ordre!» Et puis, regardons la réalité en face: Hanoi a souffert mille maux pour vaincre, ne sera-t-elle pas tentée de le faire payer à ceux qui en sont à l’origine, ces «renégats sudistes» qui avaient fait alliance avec la première puissance du monde pour lui résister?
– Peut-être que oui, peut-être que non. Actuellement, on en est réduit à des hypothèses, alors, pourquoi ne pas envisager celle qui nous rassure, plutôt que le contraire?
Elle laisse passer une seconde avant de répéter son leitmotiv, d’un ton si lisse qu’une fourmi y patinerait:
– Cette guerre n’avait plus de sens. Il était temps qu’elle se termine, d’une manière ou d’une autre.
Elle ne m’agace plus. Elle me fâche, carrément.
– Excuse-moi, Lan, mais c’est facile pour toi de parler comme tu le fais. Tu es ici, en sécurité, quoi qu’il arrive, avec ton père et ton fils auprès de toi. Mais les autres, là-bas, que devront-ils faire si le Nord se venge? Planter leur échelle et monter demander des comptes au Ciel?
Au Viêt-Nam, on s’adresse en effet au ciel pour tout et n’importe quoi, et on lui donne alors du Monsieur le Ciel (Ông Troi), comme on appelle parfois la terre Madame la Terre (Bà Dât), question de mieux les interpeller sur nos malheurs ou de les soudoyer et obtenir leurs faveurs, le cas échéant.
– Tu as raison, je suis en sécurité ici. Mais j’en ai payé le prix, tu ne crois pas?
Elle n’a pas élevé la voix, cette voix qui avait tant pleuré il y a deux ans, auprès d’un poncho fermé. Je fais marche arrière.
– Pardonne-moi, Lan, je ne veux ni te blesser ni raviver ton chagrin au sujet de Quôc. Tout ce que je veux dire, c’est que le sort de ma mère m’inquiète et que je t’envie d’avoir ton père ici, avec toi.
– Question de chance, répond-elle, laconique.
Qu’elle dit! Car si chance il y avait, elle l’avait provoquée. De fait, Lan aurait voulu emmener son père avec elle en Amérique, il y a deux ans, mais à ses multiples tentatives, il lui avait opposé un refus catégorique: quitter sa terre pour une autre? jamais! abandonner la tombe de sa femme? jamais! laisser derrière ses amis de lutte? jamais! Et ses étudiants, a-t-elle pensé à ses étudiants? Elle s’était alors promis de le faire venir plus tard, une fois son installation dans le Nouveau Monde achevée. La chose fut menée tambour battant: le pied à peine posé à Orlando, Lan avait retroussé ses manches et nettoyé les locaux de la Vocational School – une école professionnelle pour adultes – et de la bibliothèque municipale. Quelques mois plus tard, elle enseignait l’anglais dans la première tout en s’occupant à mi-temps du secrétariat de la seconde, une réussite qui lui avait permis, peu avant Noël, d’emménager dans une maison achetée à crédit, pas un palais, certes, mais neuve, avec trois chambres (elle en avait prévu une pour son père) et un jardin (où elle a planté des essences du pays, dont le da ly huong). Ainsi parée pour accueillir son père, elle l’avait relancé et finalement réussi à le convaincre de laisser ses affaires de côté pour venir lui rendre visite. Il est arrivé pour un séjour d’un mois. Les événements en ont décidé autrement et son retour a toutes les chances d’être reporté aux calendes grecques. C’est bien pour ça qu’il a tant pleuré, tout à l’heure, exaspérant sa fille qui se félicitait de l’avoir ici, par ces temps incertains. Chance pour l’une. Pas de chance pour l’autre.
Sur la véranda, Lan me touche la main.
– La journée a été éprouvante pour tout le monde et je suis sûrement maladroite dans mes paroles, mais je comprends ce que tu ressens. Essaie cependant de ne pas trop te laisser influencer par ce que dit mon père.
Je hoche la tête, ni oui ni non.
– Dans tous les cas, sache une chose, Petite Sœur Tuyêt: quoi qu’il advienne désormais, tu fais à présent partie de la famille et tu es ici chez toi. Reste le temps que tu voudras, je t’aiderai à demander une prolongation de ton visa, si nécessaire. Voilà, je l’ai dit, et ne me remercie pas car tu ferais la même chose à ma place. Maintenant, je dois te laisser: il est tard et du travail m’attend demain.
Joignant le geste à la parole, elle disparaît aussitôt dans la maison. Déconcertée et me sentant de nouveau en faute pour n’avoir pas su me dominer, je lui adresse un merci qu’elle n’entend pas.
Restée seule, je médite comme une forcenée sur mon sort. Pour l’heure, telle que la situation se présente, il n’y a pas trente-six mille façons de faire face à l’adversité mais deux: m’effondrer là tout de suite, ou essayer de rester debout en adoptant lepositive thinking, la voie que m’a conseillée Lan finalement, et qu’à yréfléchir, me recommande aussi le bon sens. Àquoi bon souffrir deuxfois, en effet, d’abord en envisageant le pire, et ensuite si le pirearrive? Une fois (si le pire arrive) est plus qu’assez, et zéro fois si lemeilleur nous sourit.
Le meilleur, c’est le Printemps vietnamien.
L’image est loin d’être originale: à l’exception des sceptiques de service, politologues et politiciens de tous niveaux et de tous âges l’ont évoquée à foison à la télé. Le visage heureux, ils ont assimilé la fin de la guerre à celle des «souffrances d’un peuple», y voyant le début d’une ère de paix dans un pays qui «en a tant vu et pleuré», et je parie tout ce qu’on veut qu’il doit s’en trouver pas mal dans le monde pour abonder dans le même sens. Pourquoi se démarquer de l’opinion générale, me susurré-je, d’autant qu’un tel Printemps ne fera que couronner en beauté une entreprise de libération, au contraire d’autres qui, suscités par des peuples opprimés, ont été écrasés dans le sang. Différent, il vivra. Les bourgeons de Saigon auront le temps d’éclore et de s’épanouir. Je reverrai le flamboyant devant ma maison parée de sa couronne de feu. Je serrerai ma mère entre mes bras. Alléluia!
L’esprit ainsi apaisé, je vais me chercher un verre d’eau dans la cuisine, y trouve Oncle Quang occupé à préparer sa énième tasse de thé. Ses traits ravagés m’incitent à lui communiquer ma positive thinking.
– Une entreprise de libération! Quelle libération? me réplique-t-il avec humeur.
Je ne me tiens pas pour battue, lui rappelle les promesses de Hanoi entendues à la télé et que je récite comme un perroquet:
– Ils parlaient de clémence, de pardon, de fraternité. Ils ont même promis que le Sud serait libre de choisir son avenir, par la voie des élections générales, qu’il n’y aurait donc pas d’annexion forcée, que la réunification se ferait en douceur, dans un esprit de réconciliation nationale et de concorde.
Mal m’en a pris car là, il se fâche tout rouge et me reprend vertement:
–ChauTuyêt, avec les études que tu fais, tu devrais savoir que les communistes n’ont aucune parole, que tout ce qu’ils pro-mettent relève de la pure propagande! Pourquoi des nationalistes ont-ils quitté le Nord en 1954, tu crois?
– Mais ils ont gagné! Tout le pays est à eux. Que pourraient-ils vouloir de plus?
– Écraser le Sud.
– Mais pour quoi faire? Qu’est-ce que ça leur rapporterait?
– C’est vrai, ta scolarité française ne t’a pas permis de bien connaître l’histoire de notre pays. Mais il est tard. Je te répondrai un autre jour, si tu veux bien.
Moi, je n’ai entendu qu’une chose, dont je tire le corollaire sans attendre:
– Écraser le Sud! Mais ce sera terrible pour des gens comme ma mère!
Il soupire et lève les yeux au ciel, comme pour mesurer la hauteur de l’échelle que nous aurons à planter pour aller demander des comptes à Ông Troi.
Plus démoralisant, tu meurs. Lan a raison, il ne faut pas que je me laisse trop influencer par son père. Mon verre d’eau à la main, je retourne à la véranda, et dans le chant des grillons et le parfum du da ly huong, je m’accroche au Printemps vietnamien.
Ô joie! Là-bas, les bourgeons s’ouvriront! les flamboyants refleuriront! Sur ma terre, les moineaux chantent et ma mère m’attend! Personne n’écrasera personne, qu’on se le dise!
On est le lendemain du 30 avril et nous sommes devant la télé, Oncle Quang et moi.
Ce matin, Lan a soupiré à la vue des paupières gonflées de sonpère, de sa jambe droite qui se dérobait plus que d’habitude, et avant de partir à son travail, me l’a confié: «Tiens-lui compagnie, il en a besoin en ce moment».
Moi, je voulais bien. Mais lui? Le petit-déjeuner qu’elle avait préparé à son intention, il n’y a même pas touché. Il a fait sem-blant de farfouiller dans ses papiers et dès qu’il a entendu la voiture de sa fille tourner le coin de la rue, s’est précipité pour allumer la télé. Diable, diable, me suis-je dit, avant de le rejoindre dare-dare avec le plateau et le thé et les biscuits.
– Je peux regarder avec vous, Oncle Quang?
– Bien sûr, Chau Tuyêt.
J’ai pris place à ses côtés, le cœur battant toutefois: quelles seront les nouvelles du jour? Printemps ou pas Printemps? Quelques secondes après, mon appréhension s’est envolée, et là, je suis carrément euphorique.
Les commentateurs sont enthousiastes. Les journalistes sur place affichent un air radieux. Tout se passe bien, disent-ils dans leur micro, aucune effusion de sang, aucun acte de représailles. De fait, des images montrent une Saigon pacifiée, à tout le moins, paisible. Les rues ne sont pas vides, les commerces sont ouverts, les marchés sont animés. Tout est comme d’habitude, si ce n’est la présence desbô-dôi, soldats nordistes, reconnaissables à leur uniforme vert olive. Mais ils ne semblent pas méchants, bien au contraire. Ils déambulent tranquillement, le sourire aux lèvres et un mot courtois à la bouche à l’adresse de la population. La plupart sont très jeunes, vingt ans à tout casser, et devant les devantures des magasins, ils se comportent comme des grands enfants. On devine qu’ils n’ont jamais vu un tel étalage de marchandises diverses allant des articles de luxe aux appareils tous plus sophistiqués les uns que les autres. Ils sont curieux, étonnés, ébahis. Là d’où ils viennent, rien de cela n’existe. Ils n’ont connu, pour la plupart, que des privations, des sacrifices. Pourtant, leur expression ne traduit aucune envie, leurs yeux ne trahissent aucune cupidité. Ils regardent, simplement. Ils ne poussent pas la porte pour entrer. Pour quoi faire? Ils n’ont pas d’argent. Quant à seservir gratuitement, à voler, à piller, l’idée ne semble même pas leur effleurer l’esprit. On ne libère pas un pays pour le mettre ensuite à sac.
Je suis transportée de bonheur. Ce ciel-là, je pourrai le retrouver, pas tout de suite, bien sûr, mais prochainement, mais bientôt. Et ces tamariniers, ces flamboyants, ce soleil à nul autre pareil. Et ma maison avec mes affaires rangées dans les tiroirs, Cap-St-Jacques, la ville adorée avec ses plages de sable fin et ses cocotiers qui inclinent leur tête au vent et la face lisse de son eau sur laquelle je faisais la planche, les yeux dans les nuages.
Et ma mère. Ma mère qui n’aura pas fui et qui n’aura plus de motif de le faire et pourvu qu’elle ne l’ait pas fait, c’était tellement dangereux avec le sauve-qui-peut général d’hier, à Saigon.
– Vous voyez, ils ont l’air de tenir leurs promesses, me tourné-je vers Oncle Quang, rayonnante.
– Ne parle pas trop vite! il me remballe aussi sec.
Pas démontée pour un sou, je décide qu’il ne supporte pas de voir ses prévisions déjouées, d’avoir tort, que son ego est atteint, bref, qu’il est un rabat-joie. Grand bien lui fasse. Moi, je suis en route pour retrouver mes racines, ma source, mon embarcadère. Mon programme s’inscrit en lettres d’or devant mes yeux: retourner à Bruxelles, passer mes derniers examens, défendre monmémoire, décrocher mon diplôme. Et rentrer!
Je sirote mon thé avec délice, mange les biscuits avec appétit, guette avec impatience le passage du livreur de journaux, un étu-diant qui les lance devant les maisons sans descendre de son vélo. Aujourd’hui, il sonne à la porte. Je me précipite. Un sourire jus-qu’aux oreilles, il me tend notre numéro dans son plastique transparent. Il sait que nous sommes Vietnamiens. Il doit être content que la guerre soit finie, même si son pays y a laissé des plumes, et pas que des plumes. Une vraie bérézina, une authentique retraite de Russie sur la terre d’Asie. Mais c’est du passé. Place au présent et à l’avenir.
À l’intérieur, je tends le journal à Oncle Quang. Les yeux toujours sur l’écran, il secoue la tête.
– Lis-le d’abord. J’écoute encore un peu ce qu’ils racontent.
Je le laisse à ses doutes et à ses suspicions, me plonge dans les pages du quotidien. Bien entendu, l’événement fait la une. Photos,articles, analyses, commentaires, interviews des VIP. Soulagement, espoir. Une page est tournée. Le Viêt-Nam émerge d’une longue nuit. Le monde se mobilise pour participer à sa reconstruction. Waouh!
Oncle Quang se lève.
– Vous allez où, Oncle Quang? je demande, inquiète, en me rappelant que Lan me l’a confié.
– Parler à mes fleurs.
Voilà Petit Lôc de retour de l’école, ramené par Mary qui le reprend avec son fils au point de ramassage scolaire où Lan les dépose le matin, sur le chemin de son travail. Je donne son goûter au gamin puis l’emmène avec Geoff faire un raid dans l’orangeraie à deux pas de la maison, un grand cabas destiné à recueillir le produit de notre larcin dansant sur mon épaule.
Lan à peine rentrée du bureau, je lui brandis le journal devant les yeux même si je sais qu’elle est déjà au courant.
– Tu as vu? Tu as vu?
– Oui, me répond-elle en effet, pas plus excitée que ça. Où est mon père?
– Dans ses notes. Il refuse d’y croire!
– Calmons-nous, calmons-nous, elle me tapote l’épaule.
Mais qu’est-ce qu’ils ont?
C’est fini.
Le Printemps vietnamien aura duré moins d’une semaine.
Avant-hier, les journalistes occidentaux ont été priés de quitterle territoire. Conduits sous bonne escorte jusqu’à l’avion spécialement affrété pour l’occasion, ils ont grimpé la passerelle et se sont envolés loin du pays libéré. Pas besoin de dire que leur cœur était lourd ni d’écrire mille pages pour en donner la raison: un régimeinterdit la présence de la presse étrangère quand il ne veut pas qu’onsache ce qui se passe dans son pays; accueillis à bras ouvertsau Viêt-Nam pour rapporter au monde entier une victoire éblouissante, pourquoi y sont-ils devenus subitement persona non grata?Que s’y passera-t-il qu’ils ne pourront plus rapporter? La question