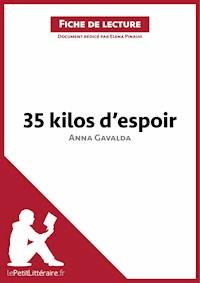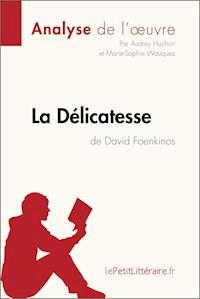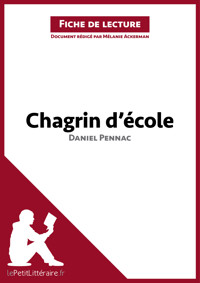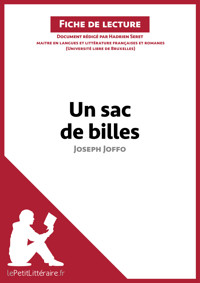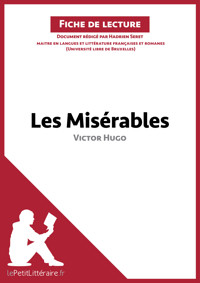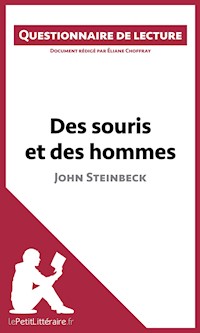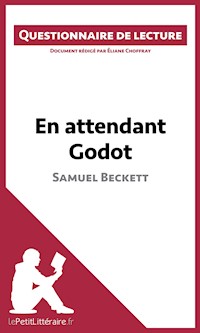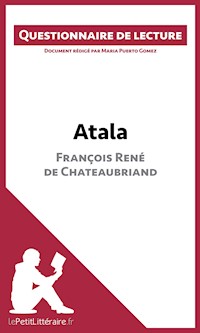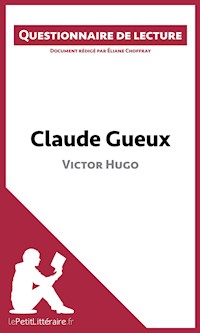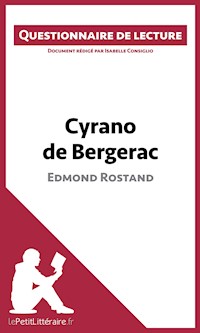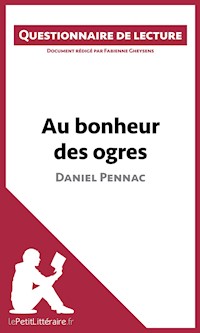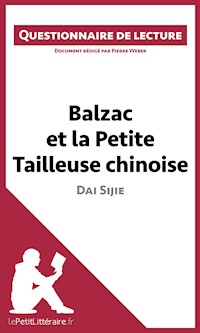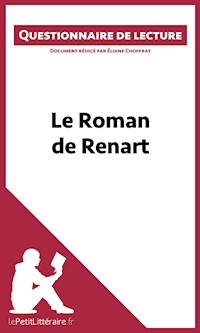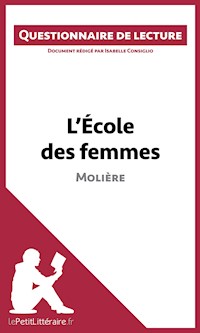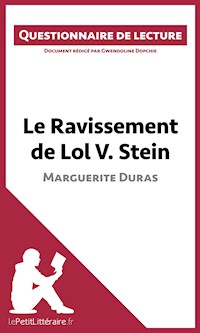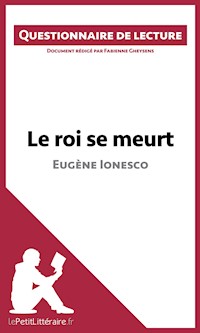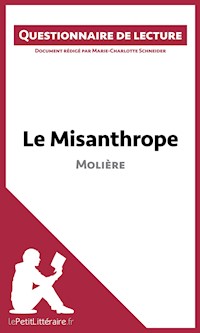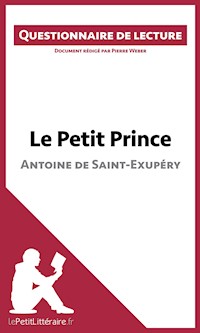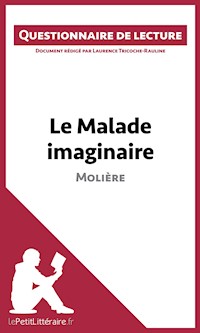Les mouvements littéraires - Le classicisme, les Lumières, le romantisme, le réalisme et bien d'autres (Fiche de révision) E-Book
lePetitLittéraire
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: lePetitLitteraire.fr
- Kategorie: Bildung
- Serie: Réussir le bac de français
- Sprache: Französisch
Tout ce qu’il faut savoir sur les mouvements littéraires à travers un dossier clair et détaillé !
Ce document développe une réflexion sur ce qu’est un mouvement littéraire, puis propose une présentation des principaux courants qui ont marqué la littérature française, siècle par siècle : le classicisme, les Lumières, le romantisme, le réalisme, etc. Pour chaque mouvement, on trouve une description du contexte historique qui a favorisé son apparition, ses caractéristiques essentielles et ses représentants majeurs.
Un dossier de référence, l’idéal pour préparer efficacement le bac !
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 35
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
QU’EST-CE QU’UN MOUVEMENT LITTÉRAIRE ?
Un mouvement littéraire (ou courant) regroupe, durant une période qu’il est parfois difficile de déterminer, différents écrivains et leurs œuvres autour d’une esthétique et d’un projet communs. Il est souvent lié à un imprimeur ou à une maison d’édition qui publie la production du groupe (citons par exemple les Éditions de Minuit pour le nouveau roman). Ces écrivains partagent initialement les mêmes idéaux, que ce soit concernant la vie politique et sociale ou le traitement littéraire de leurs œuvres. Grâce à leurs publications, le courant prend de l’ampleur puis, après quelque temps, il commence à s’essouffler et finit par disparaitre pour laisser place à un nouveau mouvement. C’est la raison pour laquelle il est souvent difficile de leur donner avec précision une date de fin. Il existe, encore aujourd’hui, de nombreuses querelles portant sur la définition de dates ou d’évènements précis pour délimiter leur période d’activité.
Certains se sont formés librement, d’autres ont été désignés à postériori et d’autres encore sont le fruit de réflexions de la part d’un chef de file (comme, par exemple, André Breton pour le surréalisme). Celui-ci peut, s’il le désire, rédiger un manifeste ou un texte théorique qui reprend l’ensemble des règles et des idéaux qui régissent le courant (citons à titre d’exemple Le Manifeste du surréalisme d’André Breton, 1924).
Aujourd’hui, la plupart des cours de littérature offre une image de celle-ci comme étant subdivisée en de nombreux courants. Cette vision est apparue au XIXe siècle, époque à laquelle les critiques littéraires ont analysé les caractéristiques propres à chaque œuvre majeure des siècles passés et ont constaté que certaines avaient des similitudes. Ils les ont alors classées et étiquetées sous différents courants afin de donner à l’ensemble une certaine cohérence. En effet, chaque mouvement est mis en rapport avec d’autres, que ce soit parce qu’ils s’opposent, ou parce qu’ils sont considérés comme leurs précurseurs ou leurs successeurs. Cela a permis de donner à la littérature une chronologie logique et de faire apparaitre une certaine évolution.
LE XVIe SIÈCLE
L’HUMANISME
L’humanisme est un mouvement intellectuel né en Italie au XIVe siècle qui s’est propagé en Europe aux XVe et XVIe siècles. À l’origine, le terme vient du latin humanitas et renvoie aux lettrés qui connaissaient les lettres grecques et latines antiques. Ce n’est qu’au XIXe siècle qu’il est utilisé pour désigner le courant littéraire. Les théoriciens de la littérature considèrent que le courant se termine avec la fin des guerres de religion en 1598.
Les humanistes sont avant tout des érudits qui se replongent dans les textes antiques qu’ils dépouillent de toutes les gloses laissées par les copistes et les commentateurs au fil des siècles. Par cette démarche, ils s’opposent au Moyen Âge, considéré comme une période historique sombre et peu encline au développement de la pensée. Ils désirent également développer leur esprit critique et acquièrent une grande culture encyclopédique.
Forts de leur nouvel esprit critique, ils n’hésitent pas à s’interroger sur la politique, la morale ou encore la religion. Ils émettent ainsi des jugements sur la traduction latine de la Bible réalisée par saint Jérôme (père et docteur de l’Église latine, 347-419), et tentent de retrouver le sens originel de la parole divine. Suite à cela, de nombreux humanistes expriment le désir d’une réforme de l’Église qui permettrait un retour aux enseignements du Christ.
Par ailleurs, ces penseurs placent l’homme au centre de toute chose, et cherchent à expliquer la nature humaine et à défendre ses valeurs. Ils développent donc une réflexion philosophique afin que l’homme puisse s’épanouir et s’émanciper. En ce sens, ils accordent une grande importance à l’enseignement, à l’instar de Rabelais dans son cycle pantagruélique. Leurs productions deviennent alors souvent des objets de culture qui visent à instruire et à rendre le savoir plus accessible.