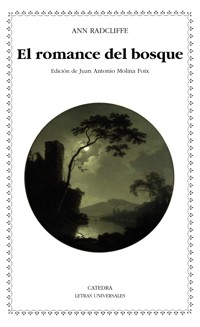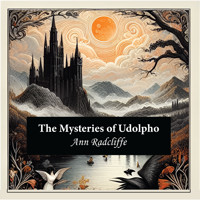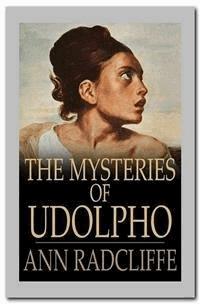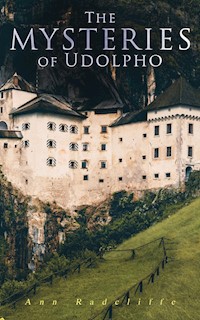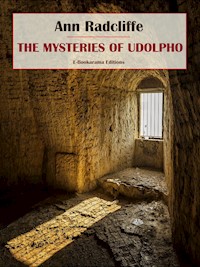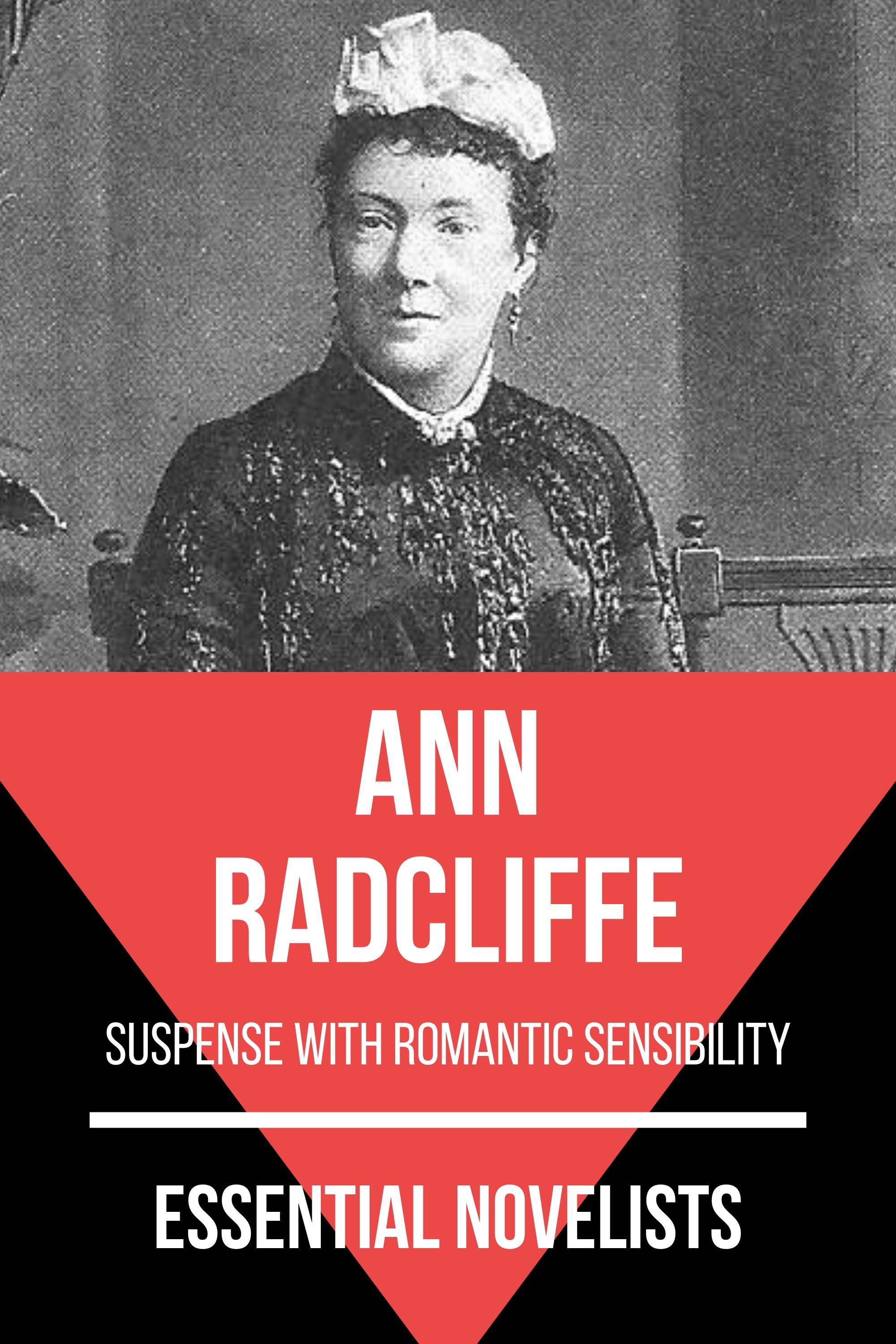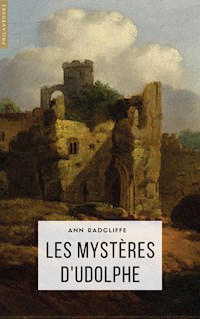
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Philaubooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Émilie regarda le château avec une sorte d’effroi, le style gothique et grandiose de son architecture, ses hautes et vieilles murailles grises, faisaient de ce géant de pierre un objet imposant et terrible. La clarté du soleil couchant, s’affaiblissant peu à peu, ne répandit bientôt plus sur les murs qu’une teinte empourprée qui, s’effaçant à son tour, laissa le château, les montagnes et les forêts environnantes dans la plus profonde obscurité.
Cette masse isolée semblait dominer toute la contrée. Plus la nuit devenait sombre plus ses tours élevées paraissaient menaçantes. Émilie ne cessa de l’examiner, jusqu’à ce que l’épaisseur du bois, dans lequel les voitures commençaient à s’engager, lui en interceptât la vue. Ces immenses forêts, que l’esprit troublé d’Émilie peuplait d’images effrayantes, ne semblaient propres qu’à servir de refuges aux bandits.
Extrait.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Les mystères du château d’Udolphe
Ann Radcliffe
Traduction parNarcisse Fournier
Copyright © 2019 Philaubooks, pour ce livre numérique, à l’exclusion du contenu appartenant au domaine public ou placé sous licence libre.
ISBN : 979-10-372-0084-6
Table des matières
Tome I
1. La vallée.
2. Le portrait.
3. Une rencontre.
4. Le blessé.
5. Le château des Tourelles.
6. L'adieu suprême.
7. L’orpheline.
8. L’isolement
9. Un éclair de bonheur.
10. L’Italien.
11. Â Venise.
12. Les apprêts de noces.
13. L e château d’Udolphe
14. Le tableau voilé.
15. Une visite nocturne.
16. Une voix.
17. Valancourt.
18. La chambre secrète.
19. La tour de l’Est.
20. Les sons mystérieux.
21. Le rendez-vous de nuit.
22. Le piége.
23. L'apparition.
Tome II
24. Suite de l'apparition.
25. Le présage de mort.
26. Un chant de Gascogne.
27. Encore la voix.
28. Â travers bois.
29. Une pastorale.
30. Le retour au chateau d’Odolphe.
31. L’évasion.
32. Un mystère éclairci.
33. Le manoir de Blangy.
34. Le retour.
35. L'entrevue
36. La chambre de la morte.
37. La veillée.
38. Soeur Agnès.
39. Les traces du passé.
40. Les contrebandiers.
41. Histoire de Ludovico.
42. Une pécheresse à son lit de mort.
43. Histoire de la signora Laurentini d’Udolphe.
44. Explications.
45. Conclusion
Couverture
Quelques dates clés
Tome I
Date d'édition : 1874
1
La vallée.
En 1584, s’élevait sur les bords de la Garonne un petit château dont les fenêtres donnaient sur une riche vallée de la Guyenne, couverte au loin de bois, de vignes et d’oliviers. La vue était bornée au midi par l’imposante chaîne des Pyrénées, dont les pics nus et sauvages se perdaient dans les vapeurs bleuâtres de l’horizon, tandis que leurs flancs, bizarrement découpés, se hérissaient de noirs mélèzes, sans cesse balancés par les vents. De larges abîmes s’ouvraient au milieu des pâturages verts, et le regard, en remontant de ces noirs précipices, se reposait sur de riantes cabanes suspendues le long des rochers. Au nord et à l’orient, s’étendaient les vastes plaines du Languedoc, et le couchant noyait ses indécises perspectives dans les eaux du golfe de Gascogne.
Le maître de ce château, M. Saint-Aubert, était le dernier rejeton mâle de la branche cadette d’une illustre famille. Après la mort de son père, il épousa une femme digne de tout son amour, et d’une naissance égale à la sienne. Leur fortune à tous deux était médiocre. M. Saint-Aubert avait trouvé son patrimoine tellement obéré parle luxe et par les prodigalités généreuses de son père, qu’il se vit forcé d’en aliéner une partie. Ce fut à M. Quesnel, un frère de sa femme, qu’il vendit ses biens, en se réservant cette petite terre en Gascogne, appelée la Vallée, lieu cher à ses souvenirs d’enfance, paisible retraite de son âge mûr, où son temps devait se partager entre ses joies d’époux, ses devoirs de père et les douceurs de l’étude.
Le bâtiment, tel qu’il existait alors, n’était guère qu’un pavillon ; un étranger en eût sans doute admiré l’ordonnance à la fois élégante et sévère ; mais une famille ne pouvait s’y loger sans des agrandissements considérables. Saint-Aubert, pénétré d’une sorte de respect pour les murs qui avaient abrité son berceau, ne voulut pas qu’on en dérangeât une seule pierre ; de sorte que les nouvelles constructions, quoique adaptées au style de l’ancienne, ne produisirent qu’un tout irrégulier, demeure plus commode qu’harmonieuse. La décoration de l’intérieur fut confiée à madame Saint-Aubert, qui se laissa guider dans le choix des embellissements par la simplicité de ses goûts et de ses habitudes.
Quant aux dispositions extérieures, M. Saint-Aubert, voué au culte des souvenirs, avait sacrifié presque partout ses convenances à ses sentiments. Ainsi deux vieux mélèzes, placés devant le bâtiment, interceptaient un coin du point de vue ; mais il se prononça pour leur conservation, disant que s’il les voyait périr, il aurait la faiblesse d’en pleurer. Près de ces mélèzes, il planta un petit bosquet de hêtres, de pins et de frênes de montagne. Sur une petite terrasse qui dominait la rivière, il groupa des orangers et des citronniers, dont les fruits et les fleurs mêlaient leurs senteurs embaumées. C’était là, que sous un large platane, dont les branches s’étendaient jusqu’à la rivière, il venait s’asseoir, par de belles soirées d’été, entre sa femme et ses enfants, et qu’il voyait, à travers le feuillage, le soleil descendre à l’horizon et confondre peu à peu les reflets empourprés de ses derniers rayons avec les tons grisâtres du crépuscule. C’était là aussi qu’il se plaisait aux lectures variées, aux aimables causeries, aux jeux de ses enfants, enfin à toutes ces affections douces, compagnes ordinaires d’un cœur droit et d’une conscience pure.
Souvent il se disait, les larmes aux yeux, que ces simples occupations avaient mille fois plus de charme que les plaisirs bruyants et agités d’un monde où il n’avait recueilli que chagrins et déceptions amères. À cette époque troublée, entre le déclin du régime féodal et l’enfantement d’une civilisation nouvelle, dans une société imbue des mœurs italiennes, à la fois raffinées et barbares, les esprits paisibles, que leur vocation n’appelait pas dans les cloîtres, se réfugiaient dans la famille.
M. Saint-Aubert ne jouit pas longtemps de ce bonheur sans mélange. Il perdit successivement ses deux fils, enlevés à l’âge où les grâces enfantines ont tant d’attrait ; et quoiqu’il modérât l’expression de sa douleur pour ménager celle de sa femme, quoiqu’il s’efforçât de supporter ce double malheur en philosophe, il sentit bien qu’il n’y avait pas de philosophie à l’épreuve de pareils coups. Toute sa tendresse, tous ses soins se concentrèrent dès lors sur sa fille, l’unique enfant qui lui restât. Émilie avait annoncé, dès ses premières années une rare délicatesse de cœur, des affections vives et une bienveillance facile, auxquelles se joignait malheureusement une sorte d’exaltation de sensibilité, et une certaine susceptibilité nerveuse, d’un augure inquiétant pour son repos à venir. Cette disposition, en se développant avant l’âge, donna aux pensées de la jeune fille un tour mélancolique et à ses manières une grâce pensive, qui ne la rendaient que plus intéressante, mais son père avait trop de bon sens pour n’en pas comprendre le danger. Il s’appliqua donc à fortifier le caractère d’Émilie, en l’habituant de bonne heure à dominer ses penchants, à surmonter son premier mouvement et à supporter avec calme les innombrables vicissitudes de la vie.
Émilie ressemblait à sa mère, dont elle avait la taille et les traits délicats ; mêmes yeux bleus, même chevelure blonde. Mais ce qui lui prêtait un charme irrésistible, c’était moins la beauté des lignes de son visage, que l’expression de sa physionomie, aussi mobile que ses sensations.
Saint-Aubert mit un soin extrême à cultiver son esprit ; il lui donna une teinture des sciences, et lui fit faire une étude approfondie des littératures italienne et latine, mères de tant de chefs-d’œuvre. Une instruction variée, pensait-il, était le meilleur préservatif contre la contagion des folies du siècle : un esprit vide a toujours besoin d’amusements, et se plonge dans la dissipation pour éviter l’ennui ; le mouvement des idées, au contraire, fait de la réflexion une source de plaisirs, et les observations que le monde fournit sur lui-même compensent les dangers des tentations qu’il présente. Partout la méditation et l’étude sont nécessaires au bonheur ; à la campagne, elles préviennent les langueurs d’une existence apathique et enseignent à comprendre le grand spectacle de la nature ; à la ville, elles dispensent de ces vaines distractions qui ouvrent la porte à tant de dangers.
Grâce aux leçons prodiguées par la tendresse paternelle, Émilie, lorsqu’elle eut accompli sa seizième année, réunissait en sa personne les plus précieux dons de l’esprit et du cœur. Les arts non plus n’avaient pas été négligés. Dans son cabinet d’étude, à gauche de la terrasse, en regard des plaines du Languedoc, elle s’était plu à réunir ses livres, ses crayons, ses instruments, quelques oiseaux et quelques fleurs rares. Les fenêtres de cette pièce s’ouvraient sur le parterre qui bordait la maison, et de là elle pouvait sans se déranger de ses travaux, porter ses regards le long des allées d’amandiers, d’acacias ou de myrtes fleuris jusque vers les rivages arrosés de la Garonne.
Sa promenade de prédilection était une petite pêcherie dépendante des propriétés de son père sur les bords d’un ruisseau qui, descendu des Pyrénées en cascades écumantes, reprenait là un cours paisible, et s’enfuyait en silence sous les ombrages que son onde pure réfléchissait. Du pavillon de cette pêcherie l’œil aimait à s’égarer au milieu des rocs élevés, des riantes cabanes et des bouquets de bois qui variaient l’aspect de la rive.
Ce lieu était aussi le rendez-vous habituel de la famille ; elle venait y chercher un abri contre les chaleurs du jour ou écouter le soir, à l’heure du repos et du silence, les chants plaintifs du rossignol. Quelquefois M. Saint-Aubert apportait là sa musique, et confiait à son tour aux échos les soupirs prolongés de son hautbois, auxquels se mariait la voix mélodieuse d’Émilie.
Un jour, après un de ces délicieux passe-temps, la jeune fille aperçut, dans un coin de la boiserie du pavillon, quelques vers écrits au crayon :
De mes chagrins trop faibles interprètes.
Vous que je laisse échapper de mon cœur,
Allez, mes vers, à l’objet enchanteur
Dont la présence embellit ces retraites,
De mon amour allez peindre l’ardeur.
Le jour fatal où ces forêts discrètes
Ont abrité sa grâce et ta candeur,
J’ai de mes yeux savouré la douceur ;
Et dans mes sens un seul regard vainqueur
A fait passer mille flammes secrètes.
Lorsque tu viens, tout est vie et splendeur !
Lorsque tu pars, en quel deuil tu nous jettes !
Sur la terre ainsi le soleil voyageur
Laisse après lui des ténèbres complètes.
Tu laisses l’ombre dans mon cœur !
Ces vers ne nommaient personne. Émilie ne songea pas à se les appliquer, quoiqu’elle fût, sans rivale possible, la nymphe de ces bocages. À qui donc s’adressaient-ils ? Heureusement elle n’avait pas le loisir de s’occuper longtemps d’une bagatelle, ni d’en exagérer l’importance en y revenant sans cesse ; et elle retourna à ses livres et à ses études.
Peu de temps après, ses inquiétudes furent éveillées par une indisposition de son père. La fièvre qui le saisit, sans présenter un danger grave, altéra sensiblement sa constitution. Madame Saint-Aubert le veilla jour et nuit avec sa fille ; mais ces soins devaient coûter cher à la pauvre femme ; pendant que son mari se rétablissait lentement, elle prenait à son insu le germe de la même maladie.
À peine convalescent, M. Saint-Aubert voulut visiter la pêcherie. Une corbeille de provisions, ses livres et le luth1d'Émilie y furent envoyés à l’avance. Un repas délicieux fut servi sous ces ombrages. M. Saint-Aubert se sentait parfaitement heureux ; la jouissance que procure la première vue de la nature, au sortir d’une chambre de malade, ne peut guère se concevoir ni se décrire quand on a toujours eu une santé florissante ; alors la verdure des bois et des prés, l’éclat varié des fleurs, la voûte bleue du ciel, le parfum de l’air, le murmure des eaux, le bourdonnement des insectes, tout semble vivifier l’âme et donne un prix nouveau à l’existence.
Madame Saint-Aubert, tout entière au bonheur de cette journée fit peu d’attention à son léger malaise pendant quelle se promenait avec son mari et sa fille ; malgré elle toutefois, en les regardant, elle se sentait émue jusqu’aux larmes ; aux doux reproches qu’ils lui en faisaient elle ne pouvait répondre qu’en leur serrant les mains ; l’attendrissement gagna aussi M. Saint-Aubert ; une sorte de pressentiment pénible s’y joignit, et des soupirs lui échappèrent. Peut-être, se disait-il, peut-être ce moment est-il le terme de mon bonheur, comme il en est le comble ; mais ne l’abrégeons pas nous-mêmes par des craintes prématurées. Espérons que Dieu ne m’a pas rendu la vie pour que j’aie à la regretter un jour, en pleurant les seuls êtres qui me la font chérir !
Pour dissiper ces idées mélancoliques il pria Émilie d’aller chercher son luth et d’essayer quelques accords. Comme elle approchait de la pêcherie, elle fut surprise d’entendre les cordes de son instrument touchées par une main habile, et accompagnant un chant triste et doux qui cessa presque aussitôt. Elle s’avança, quoiqu’avec hésitation, vers le pavillon. Elle n’y vit personne ; chaque chose était à la place où on l’avait laissée, excepté le luth qu’elle avait posé en sortant sur l’appui de la croisée, et qu’elle retrouva sur la table. Alarmée sans trop savoir pourquoi, elle sentait ses craintes augmenter encore par l’approche de l’obscurité et par le silence du lieu, que troublait seulement le frémissement du feuillage. Comme elle essayait de se remettre, ses yeux rencontrèrent les vers écrits au crayon ; elle tressaillit en s’apercevant que d’autres stances avaient été ajoutées aux premières, et cette fois son nom y figurait.
Plus de doute : c’était bien à elle que l’hommage était adressé.
Tandis qu’elle rêvait à cet étrange incident, elle crut entendre le bruit de quelques pas derrière le pavillon ; effrayée, elle prit son luth, s’échappa, et rencontra bientôt M. et madame Saint-Aubert sur un tertre couvert de figuiers, d’où l’on découvrait les plaines de la Gascogne ; là, ils s’assirent sur la pelouse tapissée de fleurs odorantes, jusqu’à ce que le crépuscule, en s’abaissant, voilât la ligne blanche qui dessinait le cours de la Garonne. Ils se levèrent alors, et s’éloignèrent à regret du bois, comme si madame Saint-Aubert eût pressenti qu’elle ne devait jamais y revenir.
Arrivée à la pêcherie, la mère d’Émilie ne retrouva plus son bracelet. Elle l’avait ôté en se mettant à table, et l’avait laissé sur un meuble du pavillon, on chercha longtemps, mais en vain, il fallut y renoncer. Ce bracelet, simple et sans valeur, avait cependant un grand prix pour madame Saint-Aubert ; il était orné du portrait de sa fille. Quand Émilie fut certaine de cette perte, elle rougit et devint pensive. Un étranger s’était introduit à la pêcherie pendant leur absence. Le poète, le musicien et le ravisseur du bracelet ne seraient-ils donc qu’une même personne ? Elle n’osa s’avouer cette idée si naturelle pourtant ; encore moins osa-t-elle en parler. Elle se promit seulement de ne plus visiter la pêcherie sans son père. et sa mère.
Ils revinrent au château, diversement préoccupés ; comme ils en approchaient, ils distinguèrent un bruit confus de voix ; plusieurs valets traversèrent les allées et une voiture se montra dans l’avenue ; Saint-Aubert reconnut la livrée de son beau-frère, et quelques instants après, il trouva au salon M. et madame Quesnel. Ils avaient quitté Paris depuis fort peu de jours et se rendaient à leur terre, belle propriété, à dix lieues environ de la Vallée, que Saint-Aubert leur avait vendue. M. Quesnel était l’unique frère de madame Saint-Aubert, mais aucun rapport de caractère n’avait fortifié les liens de la nature, et leur correspondance avait toujours été assez languissante. Lancé dans le plus grand monde, M. Quesnel visait à se donner de l’importance ; son faste et ses intrigues y avaient presque réussi. C’était avec peine qu’il avait vu le mariage de sa sœur avec Saint-Aubert, homme simple et sans ambition ; car il avait rêvé quelque alliance plus utile à ses projets, et il eût volontiers sacrifié le bonheur de sa sœur à l’avancement de sa propre fortune. Quant à lui, il avait épousé une riche héritière, une Italienne, personne aussi frivole que vaine.
Il ne tarda pas à faire étalage de ses hautes liaisons et de ses brillantes connaissances, parlant de la cour de Henri III, du duc de Joyeuse, d’un traité secret négocié soi-disant avec la Porte, et de la manière dont Henri de Navarre était traité à la cour, toutes choses qu’il croyait faites pour éblouir un pauvre campagnard. D’un autre côté, madame Quesnel, pour exciter l’envie de sa belle-sœur, l’entretenait des fêtes splendides, des bals et des banquets dont les noces du duc de Joyeuse et de Marguerite de Lorraine, sœur de la reine, avaient été l’occasion. Tous deux décrivaient avec la même précision et ce qu’ils avaient vu, et ce qu’il ne leur avait pas été permis de voir. L’imagination vive d’Émilie accueillait ces récits avec l’ardente curiosité de la jeunesse, mais son père et sa mère en reportant leurs yeux sur elle, se disaient que le bonheur n’est pas dans toutes ces pompes extérieures, mais dans les joies intimes de la famille.
— Saint-Aubert, dit Quesnel, il y a bien douze ans que j’ai acheté votre propriété d’Epourville.
— À peu près, répondit Saint-Aubert en retenant un soupir.
— Eh bien, il y a au moins cinq ans que je n’y suis allé. Paris est le seul lieu où l’on puisse vivre ; les affaires d’ailleurs m’absorbent à tel point que je puis à peine m’esquiver pour un mois ou deux. Mais je compte dépenser chez moi trente ou quarante mille livres en embellissements, afin d’y recevoir mes amis l’été prochain. Le duc de Durfort, le marquis de Gramont me donneront bien quelques semaines.
Saint-Aubert le questionna sur ses projets d’amélioration ; il s’agissait de démolir l’aile droite du château pour la remplacer par des écuries ; puis de construire une salle à manger, un salon, une grande salle commune, et des logements pour tous les gens de service.
— Car à présent, ajouta Quesnel, je n’ai pas de quoi caser le tiers des miens.
— Tous ceux de mon père y logeaient, répondit simplement Saint-Aubert.
— Oh, nos idées se sont un peu agrandies depuis ce temps-là, répliqua Quesnel d’un air de suffisance ; ce qu’on trouvait convenable alors ne serait plus tolérable aujourd’hui.
Le flegmatique Saint-Aubert rougit à ces derniers mots ; mais il se contint et ne fit que sourire.
— Le château est encombré d’arbres de toute sorte poursuivit Quesnel, mais nous allons faire un abattage.
— Vous couperez les arbres ?
— Assurément ; ils gênent la vue ; il y a surtout un vieux châtaignier, si vieux que douze hommes tiendraient dans le creux de son tronc ; mais à quoi est-il bon ? à être brûlé, voilà tout. v
— Au nom du ciel ! s’écria Saint-Aubert, ne détruisez pas ce majestueux châtaignier qui a vu tant de siècles ! c’est l’ornement du pays ! il était déjà grand quand le château fut bâti ; souvent dans ma jeunesse, je me le rappelle, j’ai grimpé jusqu’à ses plus hautes branches ; là, perdu dans son feuillage, j’entendais la pluie inonder tout à l’entour, sans qu’une seule goutte m’atteignît. Combien d’heures j’y ai passées un livre à la main !
— Je l’abattrai certainement, reprit Quesnel, mais je pourrai bien planter à la place quelques peupliers d’Italie. Madame Quesnel aime beaucoup le peuplier ; elle me vante souvent la maison de son oncle, près de Venise, où cette plantation fait un superbe effet.
Oui, dit Saint-Aubert, sur les bords de la Brenta, où sa taille droite et élancée, dominant les pins et les cyprès, accompagne d’élégants portiques et de sveltes colonnades, cet arbre peut compléter les lignes d’une perspective harmonieuse ; mais parmi les géants de nos forêts, à côté d’une gothique et massive architecture, que deviendra-t-il ?
— Bien, bien, mon cher monsieur, dit Quesnel, je ne discuterai pas là-dessus avec vous. Il faut que vous ayez revu Paris avant que nos idées puissent se rapprocher. Mais à propos de Venise, j’ai envie d’y faire un voyage. Certains événements pourraient me rendre propriétaire de la maison dont je vous parle et que l’on dit charmante. Dans ce cas, je remettrais mes projets d’embellissements à l’année prochaine et je passerais toute la belle saison en Italie.
Émilie, dans sa naïveté, fut un peu surprise de nouveau dessein. Un homme dont la présence était si nécessaire à Paris, entreprendre un si long voyage ! Quant à Saint-Aubert, il connaissait trop bien la vanité du personnage pour s’étonner de ce nouveau trait. Il espéra du moins que les beaux projets d’embellissements, ajournés ainsi, finiraient par être abandonnés.
Les nouveaux hôtes passèrent la nuit au château ; leurs nombreux domestiques n’y pouvant trouver place, fut envoyé au village voisin. Le lendemain, avant de partir, Quesnel prit son beau-frère à part et s’entretint longuement avec lui. Le sujet de cette conférence demeura un secret pour tout le monde. Seulement quand Saint-Aubert reparut, on remarqua sur ses traits des traces d’émotion dont sa femme fut vivement alarmée. Cependant elle s’abstint de lui en demander la cause, aimant mieux attendre que provoquer ses confidences.
Après le départ des voyageurs, Émilie revint avec joie à ses travaux et à ses promenades accoutumés. Mais le soir même, sa mère se dispensa de l’accompagner, elle se plaignait d’un peu de fatigue, et M. Saint-Aubert se dirigea seul avec sa fille vers les cabanes de la montagne, où de pauvres gens vivaient des aumônes que lui permettait un revenu modique.
Leur absence fut assez longue. À leur retour, ils trouvèrent madame. Saint-Aubert plus souffrante. Sa langueur et son abattement, que l’arrivée des étrangers avait comme suspendus, étaient revenus avec des symptômes encore plus fâcheux. Le lendemain, la fièvre se déclara ; le médecin y reconnut les caractères de celle à laquelle Saint-Aubert venait d’échapper. Mais la complexion plus faible de sa femme y opposait moins de résistance. Saint-Aubert, plein d’inquiétudes, retint le médecin au château. Celui-ci ne se prononçait pas encore, mais déjà la malade semblait éclairée sur son état ; elle tournait les yeux vers ses pauvres amis avec une expression de pitié et de tendresse, comme si elle eût senti d’avance leur douleur, regrettant surtout la vie, à cause du chagrin qu’elle laisserait après elle.
Le septième jour était celui de la crise. Peu à peu le médecin devint plus grave. La pauvre femme s’en aperçut, et profitant d’un moment où elle était seule avec lui, elle lui déclara qu’elle ne se faisait pas illusion.
— N’essayez pas de me tromper, dit-elle, je sens que je n’ai plus que peu de temps à vivre ; mais je suis préparée à mourir. Ne cédez pas à une fausse compassion, ne flattez pas ma famille d’un vain espoir, car le coup qui va la frapper n’en serait que plus terrible. Que tous deux sachent la vérité ; je tâcherai de leur inspirer la résignation par mon exemple.
Le docteur attendri promit de lui obéir, et, sur-le-champ, il alla trouver Saint-Aubert, à qui d’un mot il enleva toute espérance. La philosophie du malheureux n’était pas à l’épreuve d’un pareil choc ; cependant il sut, en présence de sa femme, modérer l’excès de sa douleur, de peur d’en accabler la mourante. Émilie, d’abord atterrée, mais abusée ensuite par l’ardeur même de ses vœux, conserva de l’espoir jusqu’au dernier moment.
Cependant la résignation de madame Saint-Aubert semblait s’accroître avec la gravité du mal. Mais sa fermeté en face de la mort, puisée dans une conscience qui avait toujours eu Dieu pour témoin, et dans l’attente d’un monde meilleur, fléchit à la fin devant la douleur des derniers adieux. Prête à quitter les êtres qui lui étaient si chers, elle les entretint doucement de la vie à venir et de l’espoir de les retrouver dans l’éternité…
La séparation sur cette terre n’en fut pas moins déchirante. Émilie resta anéantie sous le poids de sa douleur ; et le père à son tour, était trop accablé pour songer à consoler sa fille.
1Le luth et la mandoline, instruments portatifs étaient alors à la mode. Le luth a précédé la harpe qui aujourd'hui est supplantée par le piano. Si l'art y a beaucoup gagné, la commodité de l'artiste n'y a pas moins perdu.
2
Le portrait.
La sainte femme fut enterrée dans l’église du village voisin. Toute la population lui fit cortège derrière son mari et sa fille, et des larmes sincères furent répandues sur sa tombe.
Au retour de la cérémonie funèbre, Saint-Aubert, la pâleur sur le front, mais le cœur armé de courage, convoqua au salon toutes les personnes de sa maison. Il alla chercher Émilie qui s’était retirée dans sa chambre pour pleurer en liberté, et l’emmena en silence au milieu de l’assemblée. Là, il lut solennellement l’office du soir, en y joignant une prière pour les âmes des trépassés. La voix lui manqua plus d’une fois pendant cette lecture, il s’arrêta, ses pleurs coulèrent sur le livre ; mais enfin les sublimes élans d’une dévotion pure l’enlevèrent au-dessus de ce monde, au-dessus de lui-même dans la région des consolations divines.
Ce devoir rempli, et resté seul avec Émilie, il l’embrassa tendrement.
— Ma fille, lui dit-il, je me suis efforcé de vous faire acquérir, dès vos premières années, cet empire absolu sur vous-même, dont l’importance se fera sentir dans tout le cours de votre vie. C’est cette force qui nous soutient contre les tentations les plus périlleuses ; c’est encore elle qui tempère l’excès de nos émotions les plus louables, car il est un degré où elles cessent de mériter ce nom, c’est lorsqu’elles engendrent un mal. Tout excès est blâmable ; le chagrin même, quelque légitime que soit son principe, devient une passion répréhensible, quand on s’y livre aux dépens de ses devoirs ; et par devoirs, j’entends ce que l’on se doit à soi-même, aussi bien que ce que l’on doit aux autres. Une douleur sans mesure nous énerve et nous brise ; et la vôtre, chère Émilie, la vôtre, hélas, est désormais inutile. Ah ! ne regardez pas cette triste vérité comme un lien commun de consolation, mais comme une raison pour reprendre courage. Dieu me garde de vouloir étouffer votre sensibilité, mon enfant ! je ne veux qu’en modérer les élans. On peut craindre les maux dont le cœur est la cause ; on ne doit rien espérer de celui qui n’a point de cœur. Vous savez si ma douleur est profonde, vous savez si mes paroles sont de ces propos légers qu’on jette au hasard pour dessécher l’émotion dans sa source, et pour faire étalage de philosophie. Je vous montrerai, mon Émilie, que je sais pratiquer les conseils que je donne. Si je ne vous ai pas parlé plus tôt, c’est qu’il y a un moment où tous les raisonnements doivent céder à la nature ; mais si nous le prolongeons à l’excès, l’accablement devient une habitude qui use tous les ressorts de notre esprit. Vous touchez à cet écueil, mon enfant ; faites voir que vous voulez l’éviter.
Émilie, en pleurant, s’efforça de sourire.
— Oh ! mon père ! s’écria-t-elle, je veux… Mais sa voix s’éteignit dans un sanglot. Elle aurait sans doute ajouté : Je veux me montrer digne d’être votre fille.
Quelques jours après, Saint-Aubert reçut la visite de madame Chéron, l’unique sœur qui lui restât. Elle était veuve depuis plusieurs années et vivait dans ses terres, près de Toulouse. Dès qu’elle arriva, ce ne furent pas les phrases de condoléance qui lui manquèrent, mais cette puissance sympathique du regard, cette voix de l’âme, cet accent inimitable dont la douceur verse un baume sur les blessures ; rien de tout cela n’était à son usage. Elle assura son beau-frère et sa nièce qu’elle prenait une part sincère à leur douleur ; elle loua les vertus de la défunte, et ajouta à ce panégyrique tout ce qu’elle put imaginer de plus consolant. Après quoi, elle fut la femme la plus étonnée du monde de voir qu’Émilie n’avait cessé de pleurer en l’écoutant. Saint-Aubert, plus calme, la laissa parler tant qu’elle voulut, et changea de conversation.
En les quittant, elle les engagea à venir bientôt la voir.
— Le changement de lieu vous distraira, dit-elle, c’est un tort de se complaire ainsi dans sa douleur.
Saint-Aubert sentait la justesse de ces paroles, mais il lui en coûtait plus que jamais de s’éloigner d’un lieu sanctifié par tant de bonheur. À chaque pas il retrouvait les traces de celle qu’il avait perdue, et chaque jour, en calmant l’amertume de ses regrets, ravivait le charme de ses souvenirs.
Il avait pourtant certains devoirs à remplir et le premier de tous était la visite promise à M. Quesnel, son beau-frère. Il désirait d’ailleurs tirer Émilie de son abattement ; il se décida donc à prendre avec elle la route d’Épourville.
Quand la voiture pénétra dans la forêt qui entourait son ancien patrimoine, et qu’il découvrit l’avenue de châtaigniers et les tourelles du château, il soupira profondément au souvenir des jours écoulés. Peu à peu l’édifice, développant sa masse imposante, il reconnut la grosse tour, la porte voûtée, le pont-levis et le fossé à sec qui servait de ceinture au vieux manoir. Le bruit de la voiture attira une troupe de domestiques sur le perron. Saint-Aubert descendit, et traversant cette foule, il conduisit Emilie dans une salle gothique, d’où avaient disparu les armes et les anciennes bannières de la famille. Les boiseries de cœur de chêne et les plafonds avaient été recouverts d’une couche de blanc. L’énorme table où le seigneur déployait tous les jours sa magnificence hospitalière, et les bancs mêmes qui entouraient la salle avaient fait place à des ornements frivoles qui attestaient chez le propriétaire actuel aussi peu de goût que de sentiment.
Saint-Aubert suivit un élégant serviteur parisien qui l’introduisit au salon ; il y fut accueilli avec une politesse froide et cérémonieuse par M. et madame Quesnel, qui ne semblaient plus se souvenir qu’ils eussent jamais eu une sœur.
Après une conversation générale, Saint-Aubert désira, comme à la Vallée, entretenir son beau-frère en particulier. Pendant ce temps, Emilie, apprit de madame Quesnel qu’une nombreuse société avait reçu pour ce jour-là des invitations au château. Elle dont les larmes coulaient encore, elle dut se résigner à entendre dire qu’une perte sans remède n’était pas un motif pour se priver d’aucun plaisir.
Parmi les convives, se trouvaient deux gentilshommes italiens ; l’un, appelé Montent, parent éloigné de madame Quesnel, était un homme d’environ quarante ans ; brun, de haute taille, dont les traits accentués avaient autant de beauté que d’énergie ; leur expression dominante était une fierté mêlée d’audace, qui avait quelque chose d’impérieux.
L’autre, le signor Cavigni, n’avait guère qu’une trentaine d’années ; inférieur à son ami par la naissance, il suppléait par la grâce et la souplesse de ses manières à la dignité qui lui manquait.
Madame Chéron était au nombre des invités. Emilie fut choquée du ton dégagé dont elle aborda son père..
— Mon frère, lui dit-elle, je regrette de vous trouver si mauvais visage ; vous devriez consulter quelque médecin.
Saint-Aubert répondit avec un sourire mélancolique que, son chagrin à part, il se sentait à peu près comme à l’ordinaire. Cependant une fois les inquiétudes d’Emilie éveillées, elle crut en effet voir son père plus changé qu’il ne l’était réellement.
Dans toute autre situation d’esprit, la société où elle se trouvait, la diversité des caractères, la nouveauté des sujets de conversation, le service d’une table somptueuse, dont elle n’avait jusqu’alors aucune idée, tout cela n’eût pas manqué de la divertir. Le seigneur Montoni, nouvellement arrivé d’Italie, racontait les troubles auxquels ce beau pays était en proie ; il dépeignait avec chaleur les violences des différents partis, et déplorait les suites probables de ces affreux déchirements, exaltant d’ailleurs la supériorité de Venise, sa patrie, sur les autres pays d’Italie. Son ami, après avoir aussi payé un tribut de regret aux misères de ces contrées, se tourna vers les dames et les entretint avec la même éloquence des modes et des manières françaises et des spectacles français, flatterie délicate à leur adresse et surtout à l’intention d’Émilie, mais elle ne connaissait ni les modes, ni les spectacles de Paris, et n’avait guère en ce moment envie de les connaître ; aussi sa modestie et sa réserve formaient-elles un contraste parfait avec le ton de ses compagnes.
Après le dîner, Saint-Aubert se déroba à la foule des convives pour visiter encore une fois le vieux châtaignier que Quesnel voulait détruire ; il se reposa sous son vaste abri, regardant à travers ses feuilles tremblantes la voûte azurée des cieux. Les temps et les incidents de sa jeunesse lui revinrent alors en mémoire ; il revoyait ses anciens amis, il leur parlait, il les écoutait encore ; depuis de longues années pourtant ils avaient cessé d’exister ! Perdu dans la succession de ses souvenirs, il y rencontra l’image de sa pauvre femme mourante ; il tressaillit comme arraché à ses rêves, et se retrouva dans son isolement ; un seul être, sa fille chérie, le rattachait encore à la vie ; voulant secouer ces sombres idées, il rejoignit la compagnie, demanda ses chevaux de bonne heure et partit.
Emilie s’aperçut, pendant la route, que son père était plus silencieux et plus abattu qu’à l’ordinaire. Elle-même, en rentrant au château, sentit son affliction se renouveler plus vive que jamais ; où était cette mère chérie dont le sourire et les caresses l’accueillaient si tendrement après la moindre absence ? Aujourd’hui, tout était vide, morne et désert.
Mais ce que ne peuvent ni la raison ni les efforts, le temps vient à bout de l’opérer : les semaines, les mois s’écoulèrent et peu à peu l’horreur du désespoir, s’affaiblissant chez la jeune fille, fit place à cette douce mélancolie que le cœur aime à garder, comme le culte d’un souvenir sacré. Saint-Aubert, au contraire, perdait ses forces de jour en jour ; sa fille, qui ne le quittait jamais, était la dernière à s’en apercevoir ; mais il était trop clair que sa constitution ne s’était jamais bien remise de l’ébranlement causé par la maladie, et que la mort de madame Saint-Aubert avait porté le dernier coup à sa santé languissante ; son médecin lui conseilla de voyager, dans l’espoir que le mouvement et le changement de pays relèveraient son esprit abattu.
Emilie s’occupa des préparatifs de leur voyage, pendant que son père en calculait les dépenses ; et, lorsqu’Emilie, tout étonnée qu’il eût congédié tous leurs domestiques, Jacquot, François et Marie, pour ne garder que Thérèse, son ancienne femme de charge, se hasarda à lui en demander la raison.
— C’est par économie, répliqua-t-il, le voyage que nous allons faire sera très coûteux.
Le médecin avait prescrit l’air du Languedoc et de la Provence, ce fut donc vers ces provinces que Saint-Aubert résolut de s’acheminer, le long des côtes de la Méditerranée.
Le soir qui précéda leur départ, le père et la fille se séparèrent de bonne heure. Emilie avait des livres et divers autres objets à ranger, et minuit sonna avant qu’elle eût fini. Elle se souvint de ses crayons qu’elle avait laissés au salon ; elle s’y rendit, et, comme elle passait près de la chambre de son père, elle en vit la porte entr’ouverte ; elle pensa qu’il en était sorti peur se retirer dans son cabinet d’étude. C’était là qu’en effet, depuis la mort de sa femme, chassé de son lit par des insomnies cruelles, il allait souvent, dans le silence des nuits, chercher un peu de repos. — Quand elle fut au bas de l’escalier, elle regarda dans le cabinet : il n’y était pas. — Elle remonta et frappa légèrement à la porte de la chambre. — Pas de réponse. — Inquiète, elle s’avança doucement pour savoir où était son père.
La chambre était plongée dans l’obscurité ; mais à travers une porte vitrée, on voyait de la lumière au fond de la pièce voisine. Emilie jugea que son père devait être là ; l’idée qu’à une telle heure, il pouvait s’être trouvé mal, s’empara d’elle et l’engagea à s’avancer en laissant son flambeau dehors, de peur de l’effrayer par une trop brusque apparition. Quand elle fut près du vitrage, elle aperçut en effet son père, assis devant une petite table, et parcourant des papiers dont la lecture, en absorbant son attention, lui arrachait des soupirs, et même des sanglots. Emilie, qui n’avait été attirée là que par l’inquiétude, y fut retenue par un mélange de curiosité et de tendresse. La découverte d’un pareil chagrin l’amenait au désir d’en découvrir aussi la cause.
Elle continua d’observer son père en silence, ne doutant pas que ces papiers ne fussent autant de lettres. Tout à coup il s’agenouilla d’un air solennel, et en proie à une sorte d’égarement qui ressemblait à un sentiment d’horreur, il fit mentalement une longue prière.
Quand il se releva, une pâleur mortelle couvrait ses traits. Emilie allait se retirer, mais elle le vit s’approcher de nouveau des papiers ; il les écarta, prit une petite boîte, et en tira une miniature. La lumière, qui se projetait sur ce portrait, fit distinguer à Emilie un visage de femme — et cette femme n’était pas sa mère !
Saint-Aubert contempla le portrait avec une vive tendresse, le porta à ses lèvres, puis sur son cœur en poussant des soupirs convulsifs. Emilie n’en pouvait croire ses yeux ; elle regarda plus attentivement la miniature pour y retrouver les traits de sa mère, mais cet effort ne servit qu’à la convaincre que c’était l’image d’une inconnue ; à la fin, Saint-Aubert le remit dans la boîte, et la jeune fille, réfléchissant au tort qu’elle avait eu de surprendre ainsi les secrets de son père, se retira le plus discrètement possible.
3
Une rencontre.
Saint-Aubert, au lieu de prendre la route du Languedoc, en longeant le pied des Pyrénées, choisit cette qui passait sur les hauteurs, et qui offrait des perspectives plus étendues et plus pittoresques. Arrivé à la première colline, il se retourna pour jeter un regard d’adieu à son château. De tristes pressentiments vinrent alors obséder son esprit ; il se dit que peut-être il ne reverrait plus la Vallée, mais il rejeta bien vite cette pensée tout en continuant de-contempler la douce retraite dont il s’éloignait jusqu’à ce que cette image de plus en plus confuse, eût. disparu dans les brouillards de l’horizon.
Émilie, absorbée comme lui, gardait aussi un profond silence. Mais au bout de quelques lieues, son imagination frappée par la beauté des sites qu’elle traversait, céda aux impressions les plus vives et les plus variées. Tantôt la route côtoyait des précipices effroyables, tantôt elle dominait de délicieux paysages.
Prévoyant qu’ils ne trouveraient pas d’hôtellerie sur leur chemin, les voyageurs avaient emporté des vivres dans leur voiture. Ils étaient en même temps approvisionnes d’un livre de botanique et de quelques chefs-d’œuvre de poésie latine et italienne. Émilie avait d’ailleurs ses crayons, toujours prête à esquisser les points de vue les plus saisissants.
Bientôt ils atteignirent une cime d’où leurs regards embrassaient une partie de la Gascogne et du Languedoc. Saint-Aubert appelant le muletier Michel, s’informa du hameau le plus voisin et du temps que l’on mettrait à l’atteindre. Le muletier calcula que l’on pouvait gagner Mateau, mais que si l ’on voulait se jeter au sud, du côté du Roussillon, il y avait par là un village, où l’on arriverait avant le coucher du soleil.
Les voyageurs prirent ce dernier parti. Autour d’eux, comme au loin, régnaient la solitude et le silence. La clochette des troupeaux et les appels de leurs gardiens étaient les seuls bruits qui se fissent entendre, et les huttes des bergers, les seules habitations que l’on découvrît. La plus riante verdure tapissait le fond des vallées. Au-dessous de soi, à d’immenses profondeurs, on voyait à l’ombre des châtaigniers et des chênes, de nombreux troupeaux, dispersés ou réunis par groupes, les uns bondissant au hasard, les autres mollement couchés au bord des courants.
Déjà le soleil remontait la pente des vallons ; ses derniers rayons miroitaient sur les torrents, en glissant sur les genets et les bruyères en fleurs. Saint-Aubert inquiet interrogea Michel sur la distance probable du hameau dont celui-ci avait parlé, mais le muletier ne put répondre avec certitude. Émilie commença à craindre qu’il ne les eût égarés. Il n’y avait pas autour d’eux un être humain qui pût leur venir en aide ni les guider. Le crépuscule s’épaississait à chaque instant, l’œil avait peine à en percer l’obscurité ; seulement une raie lumineuse se dessinait encore à l’horizon, dernière clarté prête à disparaître. Michel tâchait de se donner du courage en chantant ; mais sa musique n’était pas faite pour chasser les idées mélancoliques ; il psalmodiait sur un ton si lugubre, qu’un chantre même eût peine à reconnaître les litanies qu’il adressait à son saint patron.
Ils continuèrent d’avancer, abimés dans ces rêveries profondes qu’inspirent toujours la nuit et la solitude. Michel ne chantait plus. On n’entendait que le sourd murmure du vent à travers les bois, où la fraîcheur descendait avec l’ombre, quand tout à coup la détonation d’une arme à feu tira les voyageurs de leurs médiations. Saint-Aubert tressaille et fait arrêter ; on écoute, et l’on entend courir dans les halliers. Saint-Aubert arme ses pistolets ; bientôt des sons de cor frappent son oreille ; il regarde et voit un jeune homme s’élancer sur la route ; deux chiens le suivent ; ses vêtements sont ceux d’un chasseur, il porte un fusil en bandoulière, un cor à sa ceinture, à la main une espèce de javeline qu’il brandit avec grâce et qui seconde l’agilité de sa marche.
Après un instant de réflexion, Saint-Aubert se décida à l’attendre, pour le questionner sur le gîte dont ils étaient en peine. L’étranger répondit que le village n’était plus qu’à une demi-lieue, qu’il s’y rendait lui-même, et qu’il serait heureux de leur servir de guide. Saint-Aubert le remercia, et touché de ses manières franches et simples, lui offrit une place dans la voiture, mais le jeune homme s’excusa de l’accepter, disant qu’il lui serait facile de suivre les mules. L’équipage se remit donc en marche. Au bout de quelque temps, on découvrit quelques masures, que faisait à peine discerner un pâle reflet du crépuscule dans le ruisseau qui les entourait.
L’étranger alla reconnaître ces misérables cabanes et revint dire qu’il n’existait là ni auberge ni maison habitable d’aucune espèce. Heureusement, le village n’était pas éloigné ; il offrit.de prendre les devants pour préparer le gîte de ses compagnons, près de celui qu’il occupait lui-même ; mais Saint-Aubert mit pied à terre et voulut l’accompagner, tandis qu’Émilie les suivait dans la voiture.
En cheminant, Saint-Aubert demanda à son compagnon s’il avait fait bonne chasse.
— Non, monsieur, répondit-il, ce n’était méme pas mon projet ; simple voyageur, mes chiens sont avec moi plutôt pour mon plaisir, que pour mon service. Ce costume de chasseur me sert d’ailleurs de prétexte, et vaut une considération qu’on refuserait sans doute à un étranger désœuvré.
— Je vous approuve fort, reprit Saint-Aubert, et si j’étais plus jeune, j’aimerais à partager vos excursions. Je voyage aussi, mais notre but n’est pas le-même ; vous cherchez l’agrément, et moi je cherche la santé.
Arrivés au village, ils se mirent à chercher un asile pour la nuit, mais ils ne trouvèrent dans la plupart des chaumières qu’un dénuement absolu et l’ignorance des objets réputés les plus indispensables à la vie usuelle. Rien, par exemple, qui ressemblât à un lit. Émilie, en observant l’air fatigué et souffrant de son pauvre père, regretta vivement qu’il eût pris une route si peu commode. Celles des cabanes qui paraissaient les moins sauvages étaient divisées en deux pièces, l’une pour les mules et le bétail, l’autre pour la famille, composée presque partout de sept ou huit enfants, couchés pêle-mêle. ainsi que les père et mère sur des peaux ou des feuilles sèches. Le jour n’avait d’accès, et la famée d’issue, que par un trou pratiqué au plafond, et la forte odeur de l’eau-de-vie, dont les contrebandiers-avaient introduit l’usage, suffoquait presque ceux qui entraient. Émilie, détournant les yeux, regarda son père avec une tendre sollicitude, dont l’expression n’échappa point au jeune étranger. Il tira aussitôt Saint-Aubert à l’écart et lui proposa son propre lit.
— Il est commode, dit-il, si nous le comparons à ce qui passe ici pour tel, quoique partout ailleurs j’eusse rougi de vous l’offrir.
Saint-Aubert lui témoigna sa reconnaissance et voulut refuser, mais l’étranger insista avec vivacité.
— Point d’excuses, je vous en conjure, répliqua-t-il, je souffrirais trop, monsieur, de vous savoir sur une de ces peaux grossières, tandis que je reposerais dans un lit. En repoussant ma proposition, vous me feriez penser qu’elle vous désoblige, venez, de grâce ; je vais vous montrer le chemin, et j’espère que mon hôtesse trouvera aussi moyen de satisfaire cette jeune dame.
Saint-Aubert se laissa persuader, surpris cependant, à part lui, que l’étranger fût assez peu galant pour se préoccuper d’un vieux malade plutôt que d’une jeune et charmante personne, mais Émilie ne pensa pas de même, et le sourire de reconnaissance qu’elle adressa au jeune homme fit assez voir combien elle était sensible à l’attention qu’il avait eue pour son père.
L’étranger, qui se nommait Valancourt, alla prévenir son hôtesse ; c’était une bonne femme qui mettait tous ses soins à bien accueillir les voyageurs, et dans la mesure de ses faibles ressources ; ceux-ci furent heureux d’accepter les deux seuls lits qui fussent dans sa maison. Elle n’avait que des œufs et du laitage ; mais Saint-Aubert recourut à ses provisions, et pria Valancourt d’en prendre sa part. L’invitation fut bien reçue, et pendant le souper la conversation s’anima. Saint-Aubert fut enchanté de la franchise et de la simplicité du jeune homme, ainsi que de l’enthousiasme qu’il témoignait pour les beautés de la nature. Un pareil culte, suivant lui, ne pouvait subsister dans une âme, sans être allié à une grande pureté de cœur et une rare élévation de sentiments.
Il était tard lorsque Saint-Aubert et sa fille se retirèrent dans leurs chambres. Valancourt, enveloppé de son manteau, s’étendit sur un banc devant la porte. Saint-Aubert fut un peu surpris de trouver sous sa main Homère, Horace et Pétrarque ; mais le nom de Valancourt, écrit sur les volumes, lui apprit de quelle part ils venaient.
4
Le blessé.
Saint-Aubert se réveilla de bonne heure ; le repos de la nuit avait rafraîchi ses sens ; il voulut aussitôt se remettre en route, Valancourt en déjeunant lui raconta que peu de mois auparavant il était allé jusqu’à Beaujeu, ville importante du Roussillon, et il lui conseilla de prendre cette route.
Le chemin de traverse et celui qui conduit à Beaujeu se rejoignent, ajouta-t-il, à une lieue et demie d’ici ; je puis, si vous le voulez, vous servir de guide jusque là.
Saint-Aubert agréa cette proposition ; ils repartirent donc ensemble ; mais le jeune homme ne voulut pas consentir à prendre place dans la voiture.
La route, au pied des montagnes, suivait une riante vallée toute parée de verdure, et parsemée de frais bocages. Le soleil ne paraissait pas encore, et déjà. les bergers conduisaient un nombreux bétail aux pâturages de la montagne. Saint-Aubert aspirait cet air pur du matin, toujours si salutaire pour les malades, et bien plus vivifiant encore dans ces régions favorisées où l’abondance et la variété des plantes aromatiques l’imprégnaient des plus doux parfums.
Le brouillard léger qui voilait les objets lointains se dissipa peu à peu ; les premiers reflets de l’aurore couronnaient les rochers d’une brillante auréole, tandis que leur base plongeait encore dans une masse de vapeurs. Bientôt les nuages de l’orient laissèrent échapper des rayons d’or, qui, glissant dans l’espace, en chassèrent les dernières ombres, descendirent au fond du vallon et vinrent se jouer dans le cristal du ruisseau. La nature resplendissante se réveillait. Saint-Aubert se sentit ranimé comme elle ; son cœur gonflé se soulagea par des larmes, et s’éleva plein de reconnaissance vers le Créateur de toutes choses.
Émilie, s’abandonnant aussi à une douce extase, voulut descendre pour fouler le gazon humide de rosée, et Valancourt se joignit aux voyageurs dans un commun sentiment d’admiration. Saint-Aubert éprouvait une attraction secrète pour ce jeune homme.
— Âme ardente, disait-il, aussi sincère que bonne, mais trop neuve peut-être pour son malheur ! On voit bien qu’il n’a jamais habité Paris.
Ce ne fut pas sans regret qu’il se vit arrivé à l’endroit où les deux chemins se rencontraient. Il prit congé de Valancourt avec plus d’affection que n’en inspire d’ordinaire une connaissance de si fraîche date. Le jeune homme causa longtemps encore près de la voiture, cherchant toujours des sujets d’entretien qui lui permissent de différer la séparation. À la fin cependant il fit ses adieux aux voyageurs. Quand il s’éloigna, Saint-Aubert put remarquer de quel air attentif et préoccupé il regardait Émilie. Elle le salua avec timidité, et la voiture partit.
Le pays changea bientôt d’aspect. Les voyageurs se trouvèrent entourés de montagnes à pic, que revêtaient de noires forêts de sapins. Des flèches de granit, s’élançant du fond même de la vallée, allaient cacher dans les nues leurs pointes couvertes de neige. On n’aperçut, pendant plusieurs lieues, ni village ni hameau ; à peine quelques rares cabanes de chasseurs. Cependant la route montait toujours. Peu à peu, les voyageurs avaient laissé les pins au-dessous d’eux ; des précipices se creusaient de tous côtés, et le crépuscule du soir ajoutait à l’horreur du site. Sans savoir à quelle distance il se trouvait de Beaujeu, Saint-Aubert se flattait d’en approcher ; mais les bois, les rocs, les torrents se confondaient déjà dans l’obscurité, et ne présentaient plus que des formes indécises. Michel avançait avec précaution ; à peine distinguait-il la route frayée, ses mules cependant cheminaient encore d’un pas sûr.
Au détour d’une montagne, une lumière parut tout à coup projetant son éclat à une assez grande distance. Elle provenait d’un grand feu allumé par accident ou à dessein, c’est ce qu’on ne pouvait encore deviner. Saint-Aubert à qui cet indice semblait révéler le voisinage d’une de ces troupes de bandits qui infestent les Pyrénées était en peine de savoir si la route passait près de ce feu. Il avait des armes pour se défendre, mais qu’était cette faible ressource contre une bande de voleurs déterminés ? Il réfléchissait au danger de sa fille et au sien, lorsqu’une voix, encore éloignée, qui se fit entendre derrière eux, cria au muletier d’arrêter. Saint-Aubert, alarmé d’un pareil ordre, en pareil lieu, enjoignit au contraire à Michel de presser le pas ; mais que ce fût entêtement de l’homme ou de l’attelage, ils n’avançaient pas plus vile. On distinguait cependant de plus en plus le galop d’un cheval, on entrevoyait déjà le cavalier qui cherchait à rejoindre la voiture, en renouvelant l’invitation de faire halte. Saint-Aubert ne doutant plus des mauvais desseins de cet individu, arma son pistolet, ajusta comme il put et fit feu par la portière. Le cavalier chancela et poussa un gémissement. Mais quel fut l’effroi de Saint-Aubert quand il crut reconnaître cette voix plaintive ! Il fit lui-même arrêter la voiture et s’élança… il ne se trompait pas ; c’était Valancourt !
Valancourt blessé, qui se tenait encore à cheval, mais dont le sang coulait en abondance ! La balle l’avait atteint au bras, et il paraissait beaucoup souffrir, quoiqu’il cherchât à consoler celui qui l’avait frappé, en assurant que c’était peu de chose. Saint-Aubert, aidé du muletier, l’enleva de son cheval et le posa à terre ; puis il essaya de bander sa blessure, mais les mains lui tremblaient tellement qu’il n’en put venir à bout. Voyant que Michel, pendant ce temps, s’était mis à la poursuite du cheval échappé, il appela Émilie, qui ne lui répondit pas. Il courut à la voiture, et trouva sa fille sans connaissance. Dans cette cruelle situation, craignant à la fois pour Émilie et pour le blessé dont le sang continuait de couler, il cria à Michel de lui apporter de l’eau du ruisseau qui bordait la route ; cependant Valancourt qui avait entendu le nom d’Émilie et compris ce qui était arrivé, fit un effort sur lui-même pour se porter au secours de la jeune fille ; mais quand il s’approcha, elle était déjà revenue à elle. Ainsi donc c’était la frayeur qu’elle avait éprouvée pour lui, qui avait causé cet accident ! D’une voix troublée par un tout autre sentiment que celui de la souffrance, il s’empressa de protester du peu de gravité de sa blessure. Saint-Aubert pourtant, voyant que le sang coulait toujours, déchira son linge pour lui faire un bandage ; pendant ce temps, le muletier avait ramené le cheval. On plaça Valancourt dans la voiture, et l’on reprit le chemin de Beaujeu.
Saint-Aubert, revenu de ses premières alarmes, témoigna sa surprise de cette rencontre, que le jeune homme se hâta d’expliquer.
— Après vous avoir quitté, dit-il, je me suis trouvé plus seul qu’auparavant, et puisque le plaisir est l’unique but de mes voyages, je me suis décidé à reprendre cette route, avec quelque espoir de vous rejoindre, et, faut-il le dire, de partager vos dangers, si par hasard vous en aviez à courir dans ces montagnes.
— J’ai cruellement répondu à tant de prévenances, répondit Saint-Aubert qui déplorait sa précipitation.
Ils approchaient alors de ce feu qui tranchait virement sur les ténèbres, éclairant au loin la route et toutes les figures. C’était le bivac d’une de ces bandes de bohémiens qui rôdaient habituellement dans les Pyrénées, et qui parfois détroussaient les voyageurs. Émilie ne remarqua pas sans effroi l’air farouche de ces vagabonds. Ils étaient en train de préparer leur souper. Une large chaudière était sur le feu, des hommes et quelques vieilles femmes, à mine hâve s’occupaient de la remplir. La flamme laissait voir une tente grossière, autour de laquelle jouaient pêle-mêle des enfants déguenillés et de gros chiens, tableau à la fois repoussant et grotesque. Les voyageurs sentirent leur danger. Valancourt se taisait mais il tenait la main sur un des pistolets de Saint-Aubert qui avait pris l’autre. Ils passèrent néanmoins sans recevoir d’insulte. Les voleurs n’étaient pas sans doute préparés à cette rencontre, et leur souper les occupaient trop en ce moment pour laisser place à un autre intérêt.
Au bout d’une lieue et demie, les voyageurs arrivèrent enfin à Beaujeu. Ils se rendirent à la seule auberge qui s’y trouvât et mandèrent aussitôt le chirurgien de la ville, si toutefois ce nom était dû à une espèce de maréchal qui soignait les hommes et les chevaux et qui de plus, dans l’occasion, faisait l’office de barbier. Il examina le bras du blessé, et voyant que la balle n’avait pas pénétré au delà des chairs, il se borna à lui recommander le repos. En même temps il interrogeait les traits pâles et fatigués de Saint-Aubert, comme s’il se fût dit à part lui : voilà un homme qui paraît plus malade que l’autre. Mais le père d’Émilie ne jugea pas à propos de confier ce qu’il éprouvait à un Esculape de village. Sachant cependant que dans les environs on n’en trouverait pas de plus habile, il engagea Valancourt à se soumettre à ses prescriptions et résolut d’attendre à Beaujeu la guérison du blessé. Celui-ci sembla vouloir l’en détourner, mais avec plus de civilité que de bonne foi.
Bientôt il se trouva en état de voyager, mais non pas de supporter la fatigue du cheval ; Saint-Aubert l’invita à l’accompagner pendant quelques jours dans sa voiture, et le jeune homme accepta encore cette offre avec cordialité.
Ils reprirent la route du Roussillon, voyageant sans se presser, et s’arrêtant quand le site méritait leur attention, ils gravissaient souvent des hauteurs que les mules n’auraient pu atteindre. Saint-Aubert s’écartait pour herboriser, tandis que ses jeunes compagnons couraient à la découverte d’une nouvelle merveille pittoresque. Assis devant quelque ravissant point de vue, Valancourt récitait à Émilie les plus beaux passages des poètes qu’elle aimait, et tous deux s’unissaient dans une admiration commune pour la nature et pour la poésie. Parfois le jeune homme, s’il ne se croyait pas observé, fixait ses regards sur cette angélique figure où rayonnait à la fois tant d’âme et d’intelligence. S’il parlait alors, la douceur et le tremblement de sa voix décelaient un trouble qu’il cherchait vainement à dissimuler. S’il se taisait au contraire, c’était Émilie, à son tour qui sortant de sa réserve, causait avec animation de tout ce qu’elle voyait, des bois, des vallons, des montagnes, plutôt que de subir certains intervalles de silence, d’une influence dangereusement sympathique.
Après un voyage de quelques lieues, ils commencèrent à descendre dans le Roussillon. Bientôt ils reconnurent un des grands passages qui s’ouvrent des Pyrénées sur l’Espagne. Saint-Aubert se sentait d’une extrême faiblesse. Cependant la ville la plus proche, Montigny, était encore éloignée, il fallait désespérer de l’atteindre avant la nuit. On continua donc d’avancer à la faveur du crépuscule ; mais la route était en si mauvais état qu’il parut plus sage de quitter la voiture. À ce moment, la cloche d’un couvent se fit entendre ; Saint-Aubert s’orientant sur la direction du son, prit le bras de sa fille et monta du côté des bois. Ses pas étaient chancelants ; Valancourt lui prêta son appui. La lune, qui éclairait leur sentier, leur permit alors d’apercevoir des tours qui s’élevaient au-dessus de la colline.
Après avoir monté quelque temps, Saint-Aubert se plaignit et l’on s’arrêta sur un tertre de gazon, où les arbres plus espacés, laissaient tomber les rayons de la lune. Le père d’Émilie s’assit entre sa fille et Valancourt.
Ils avaient sous les yeux la vallée qu’ils venaient de quitter. La lumière argentée qui se reflétait sur les rochers et les bois de la gauche, contrastait vivement avec les ténèbres dont les massifs à droite étaient enveloppés. Les sommets étaient éclairés par places, et le vallon se perdait dans un brouillard, dont le clair de lune ne servait qu’à faire ressortir l’épaisseur. Les voyageurs restèrent quelque temps en contemplation devant ce beau spectacle.
— De pareilles scènes, dit Valancourt, remuent le cœur comme les accords d’une musique suave. Elles réveillent nos plus purs sentiments. Ceux que j’aime, ajouta-t-il d’une voix tremblante, il me semble que je les aime encore mieux à cette heure.
Saint-Aubert se taisait. Émilie vit tomber une larme sur la main de son père, qu’elle tenait pressée entre les siennes. Elle devina ce qui se passait en lui, car sa pensée à elle-même s’était portée sur sa mère !...
— Oui, dit Saint-Aubert, voilà l’heure où nos âmes s’ouvrent doucement au souvenir des êtres qui nous furent chers ! C’est comme une harmonie lointaine entendue dans le silence des nuits. Le cœur qui n’en sent pas l’influence est à coup sûr un cœur dénaturé. Que de gens, hélas, sont ainsi !
— S’en trouve-t-il donc beaucoup ? demanda Émilie.
— Dans quelques années peut-être, répondit Saint-Aubert, vous sourirez, mon enfant, en vous rappelant cette question, si toutefois ce n’est pas une larme que ce souvenir vous arrache ! Mais venez, je suis un peu mieux, avançons.
Ils sortirent du bois, et aperçurent enfin, sur un plateau de rochers, le couvent qu’ils avaient tant cherché. Ils suivirent la haute muraille jusqu’à une porte gothique, à laquelle ils frappèrent. Un pauvre moine qui vint leur ouvrir, les conduisit chez le supérieur. Il était assis dans une chaise à bras, devant un large pupitre qui soutenait un gros volume. Il reçut les voyageurs poliment, leur adressa peu de questions, et les fit conduire dans la salle où le souper était servi. Saint - Aubert était trop souffrant pour manger, et Valancourt, muet et pensif, ne paraissait s’occuper que de soulager et de fortifier son ami.
Ils se séparèrent de bonne heure et se retirèrent dans leurs cellules, Émilie, toute pensive et préoccupée de l’état de langueur extrême où elle voyait son père.
Deux heures après, une cloche se fit entendre, et des pas précipités parcoururent les corridors. Émilie, alarmée, crut que son père était plus mal, et se leva à la hâte pour courir vers lui ; mais s’étant arrêtée à la porte pour laisser passer les religieux, elle eut le temps de se remettre et de comprendre qu’on venait de sonner matines, hors d’état de chercher le sommeil et invitée par l’éclat d’une lune brillante ; elle ouvrit sa fenêtre. La nuit était paisible et belle, le firmament sans nuages ; une légère brise agitait : les arbres de la vallée. En ce moment l’hymne nocturne des religieux s’éleva doucement de la chapelle, semblant monter au ciel à travers le silence et les molles clartés de la nuit. Pénétrée d’une dévotion pure, l’âme d’Émilie s’éleva avec le chant sacré au-dessus de l’univers visible, jusqu’à la source de toute grandeur et de toute bonté.