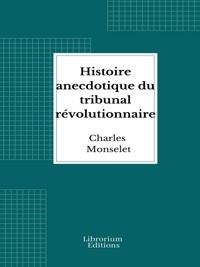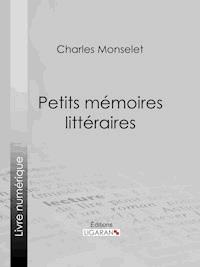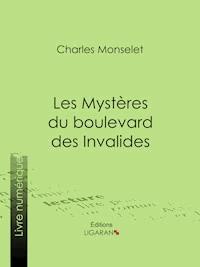
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Une foule considérable montait le grand escalier qui mène au somptueux péristyle de la Madeleine. Au lieu d'une foule, peut-être ferions-nous mieux de dire la foule, car c'était un assemblage étrange et particulièrement disparate que celui qui couvait les degrés du temple ce jour-là. Les femmes, qui étaient en majorité, appartenaient à toutes les classes de la société, aux plus élevées comme aux plus humbles, aux salons, aux comptoirs, aux ateliers..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Une foule considérable montait le grand escalier qui mène au somptueux péristyle de la Madeleine.
Au lieu d’une foule, peut-être ferions-nous mieux de dire la foule, car c’était un assemblage étrange et particulièrement disparate que celui qui couvait les degrés du temple ce jour-là. Les femmes, qui étaient en majorité, appartenaient à toutes les classes de la société, aux plus élevées comme aux plus humbles, aux salons, aux comptoirs, aux ateliers et même aux antichambres. L’heure n’était cependant rien moins que propice à la réunion de ces conditions si différentes : c’était le milieu du jour.
La même diversité, le même contraste se manifestaient dans la longue file de carrosses qui décrivait une imposante ceinture au monument. Il y avait là des calèches argentées à tous leurs axes et à tous leurs ressorts, attelées à d’impatientes bêtes qui faisaient sonner leurs sabots ; il y avait des coupés coquets et vernis, des cabriolets heureux d’une immobilité profitable, des fiacres énormes à contenir douze remplaçants militaires, et enfin quelques-uns de ces véhicules innommables, indescriptibles, qui semblaient tenir le milieu entre le caisson industriel, la tapissière sautillante et le coucou de grivoise allure.
Quel pouvait être l’évènement capable de faire affluer vers la Madeleine tant d’éléments opposés ?
On remarquera que nous avons dit le temple, le monument, la Madeleine, et que nous n’avons pas dit l’église. C’est qu’il nous est presque impossible d’évoquer l’Évangile sous cette frise grecque, pas plus que de retrouver Sainte-Geneviève dans le Panthéon. Il nous faut avant tout un clocher. Sans clocher, nous ne sommes plus qu’un croyant dépaysé et mal à l’aise.
C’était au maître autel de la Madeleine que se célébrait en grande pompe le mariage de Mlle d’Ingrande avec Philippe Beyle.
On sait que la comtesse avait quitté Paris exprès pour ne pas assister à cette cérémonie.
Néanmoins, une notable portion de l’aristocratie parisienne était représentée à ce mariage. La nef se trouvait encombrée au-delà des proportions ordinaires : il est vrai d’ajouter qu’il s’agissait d’une messe en musique, exécutée avec le concours d’un grand nombre de virtuoses renommés.
Un observateur très attentif aurait peut-être eu le droit de s’étonner en voyant les regards fréquents que la marquise de Pressigny jetait à droite et à gauche de l’édifice, dans les moments de distraction qu’entraîne inévitablement une messe en musique, et les coups d’œil d’intelligence qu’elle échangeait çà et là avec des femmes en apparence d’une condition au-dessous de la moyenne.
Mais, nous le répétons, il aurait fallu que cet observateur fut très attentif.
Pour nous, qui possédons des privilèges auxquels un simple observateur ne pourrait prétendre, nous dirons que la Franc-Maçonnerie des Femmes avait là un grand nombre de ses membres, et qu’on était venu de toutes parts pour honorer la marquise de Pressigny dans le mariage de sa nièce.
La messe eut une durée digne du rang et de l’opulence des nouveaux époux.
De temps en temps, quand les chanteurs se taisaient, les orgues se prenaient à rugir.
L’orgue est un instrument sacre, et nous ne saurions trop regretter qu’on en ait fait un instrument profane.
Quel était l’artiste qui s’était chargé, à l’occasion du mariage de Philippe Beyle, de rouler sur les têtes pieusement inclinées ces tonnerres d’opéra, de changer les tuyaux en batterie d’artillerie, et tantôt, par une opposition puérile et ridicule, de s’efforcer de leur faire rendre les sons nasillards du biniou breton ? Il se pourrait que ce fût un artiste de talent, mais certainement ce n’était qu’un médiocre chrétien.
Après une dernière décharge de notes qui ébranla tout l’énorme vaisseau de la Madeleine, il consentit à se taire. Il devait être en sueur. L’effet qu’il avait produit, du reste, n’était autre qu’une épouvante à peu près générale.
Le silence qui se fit ensuite, et qui dura quelques secondes, ramena les esprits au sentiment religieux.
Philippe Beyle portait son bonheur noblement, c’est-à-dire simplement. Il s’était retrempé dans son amour pour Amélie. En même temps qu’il s’élevait, sa pensée s’était élevée et purifiée. Maintenant il était vraiment à la hauteur de sa nouvelle position, et il se sentait préparé pour les devoirs qu’elle lui créait. Nous ne dirons pas qu’il était devenu un nouvel homme, mais il était devenu l’homme qu’il avait toujours rêvé d’être et que les évènements l’avaient jusqu’à présent empêché d’avoir été. On devinait, à la sérénité répandue sur son front, que Philippe allait désormais dater sa vie de cette heure solennelle et de cet amour unique ; on comprenait qu’il ne gardait même pas rancune à son passé, qu’il avait voulu l’oublier, et qu’il l’avait oublié en effet, entièrement, absolument.
La messe touchait à sa fin.
Les ténors avaient lancé leurs dernières notes vers la voûte dorée.
Le prêtre allait descendre de l’autel.
Il se faisait déjà dans l’assistance cette rumeur légère qui précède tous les dénouements, et, par habitude, les yeux se tournaient vers l’orgue. On attendait ces derniers accords qui, semblables à une marche triomphale, accompagnent ordinairement les époux au seuil de la sacristie.
Mais, à la place de la symphonie obligée, ce fut une voix qui s’éleva, puissante et terrible, et qui entonna ce chant funèbre :
« Ô jour d’ire et de vengeance qui réduira l’univers en cendre, comme l’attestent David et la Sibylle ! »
Une sensation de terreur parcourut toute l’assemblée.
La voix était magnifique d’ailleurs ; c’était une voix de femme.
Cette voix, comme si elle eût voulu profiter de la stupeur unanime, reprit, d’une voix plus vibrante encore :
« Quelle sera la frayeur des hommes quand le Juge paraîtra pour discuter rigoureusement leurs actions ! »
Ce cantique, que l’on n’entonne que dans les cérémonies de deuil, glaça tous les auditeurs.
Philippe Beyle, le premier, s’était redressé par un mouvement involontaire.
Sa physionomie s’était contractée ; pâle et fléchissant, il avait été obligé de s’appuyer au dossier de sa chaise pour ne pas tomber.
Il avait reconnu la voix de Marianna.
Philippe baissa la tête, et il eut peur pour la première fois de sa vie. C’était le passé qui venait ressaisir sa proie.
Amélie, en jetant les yeux sur lui, fut surprise de sa frayeur ; un nuage passa sur sa félicité, et mille suppositions s’éveillèrent dans son esprit innocent.
Sur ces entrefaites, le maître des cérémonies se hâta d’inviter les mariés à passer dans la sacristie pour signer l’acte sacramentel. Il fut obligé de s’adresser deux fois à Philippe, qui n’entendait rien, rien que cette voix d’en haut et ce sinistre Dies iræ, qui durait toujours !
À peine Philippe Beyle et Amélie eurent-ils disparu, suivis d’un long cortège de parents et d’amis, qu’un groupe de femmes, qui s’étaient comptées de l’œil et qu’un même dessein venait de rapprocher de la grande porte, s’élancèrent aussitôt par l’escalier qui mène à l’orgue.
Dans cet incident étrange elles avaient soupçonné tout de suite une pensée de maléfice, dans ce chant lugubre une malédiction sur les nouveaux époux, et elles voulaient connaître celle qui avait été assez hardie pour lancer cette malédiction jusque dans le temple de Dieu !
Elles se précipitèrent donc à sa rencontre.
Mais au moment où elles montaient en tumulte, une femme descendait tranquillement.
Cette femme s’arrêta.
Elle n’eut qu’un mot à prononcer, qu’un signe à faire ; – et les autres femmes, consternées, se rangèrent pour la laisser passer.
Encore sous l’impression pénible de la scène de l’église, Mme de Pressigny se trouvait seule dans son appartement, le lendemain, lorsqu’on lui apporta une lettre.
Cette lettre était datée de la petite ville d’Épernay.
« Accourez, madame, car j’ai à vous remettre mon testament, je suis mourante. »
Ce peu de mots était signé : Caroline Baliveau.
Mme Baliveau était une des sœurs les plus obscures de l’association féminine ; mais dans l’association, les degrés d’obscurité n’étaient pas plus comptés que les quartiers de noblesse.
Devant une invitation aussi pressante, la marquise de Pressigny ne pouvait pas hésiter.
Il s’agissait d’un testament à recevoir, car l’hérédité n’était pas une des bases de la Franc-Maçonnerie des Femmes. Chacune avait le droit de désigner celle qu’elle désirait voir appelée à sa succession mystérieuse.
La marquise fit immédiatement demander des chevaux de poste pour le soir.
À peine cet ordre était-il donné qu’on lui annonça une visite.
Elle se leva pour recevoir une femme qui était vêtue de deuil.
Mais elle recula immédiatement à cette vue.
– Est-ce que je me trompe ? murmura-t-elle.
– Non, madame la marquise, vous ne vous trompez pas ; je suis bien la Marianna, ou, si vous l’aimez mieux, Marianne Rupert.
– Vous ! dit la marquise en joignant les mains de terreur.
– Ne vous attendiez-vous point à me revoir, madame ?
– Mais, vous-même, ignorez-vous donc qu’on vous croit morte ?
– Oh ! vous vous êtes bien hâtée de croire à ma mort ! dit Marianna avec un sourire funeste.
– J’ai partagé l’erreur de tout le monde, reprit la marquise en frémissant.
– Vraiment ?
– À Marseille, où j’ai écrit, on raconte encore les moindres circonstances de votre suicide.
– Ah ! vous avez écrit ?
– Une personne de notre association m’a répondu : c’est sa conviction qui a décidé de la mienne. Plus tard, cette nouvelle a été confirmée par les journaux.
– Je l’ai lue, en effet, dit Marianna avec sang-froid.
– Mais vous, madame, qui paraissez me blâmer d’ajouter foi à cette lugubre comédie, quel était votre but en la jouant ?
– Mon but ? Ah ! un but impossible à atteindre ! répondit-elle en soupirant ; je voulais ne plus vivre que pour Irénée.
– Irénée ! dit la marquise avec une cruelle appréhension.
– C’est son deuil que je porte.
– Oh ! le malheur partout ! s’écria Mme de Pressigny ; vous êtes une fatale messagère, madame.
– Il est bien mort, lui ! reprit Marianna sans l’entendre et comme attendrie par ce souvenir.
– Pauvre enfant !
– Ses souffrances ont été affreuses, son agonie a été déchirante ; il est mort comme il a vécu, en martyr. Ah ! son sang crie vengeance aussi !
– Vengeance ? répéta la marquise en attachant sur elle un regard plein d’anxiété.
Il n’en fallut pas davantage à ces deux femmes pour se comprendre.
– Oui, madame, vengeance ! continua Marianna ; c’est le seul sentiment qui domine en moi. Je m’étais trompée en croyant pouvoir faire de ma vie un sacrifice à Irénée ; ma vie appartenait tout entière à la haine, et c’est à la haine que je viens la restituer aujourd’hui.
– Que voulez-vous dire ?
– Madame la marquise, laissez-là les détours ; vous savez pourquoi je suis venue… et surtout pour qui je suis venue.
La marquise demeura muette.
– Il y a trois ans environ, reprit Marianna, que la destinée de M. Philippe Beyle m’a été accordée par l’association.
– C’est vrai.
– En revenant à Paris, je m’attendais à le trouver écrasé sous le poids de votre justice. Je me surprenais déjà à intercéder, non pour qu’on lui fît grâce, mais pour qu’on ralentit son supplice. J’arrive : je le vois heureux, comblé d’honneurs, ivre d’orgueil. Qui a changé son sort ? une femme, vous !
– Mon excuse est dans ma bonne foi, madame, dit la marquise de Pressigny ; il est écrit dans nos statuts : « La mort d’une sociétaire fait cesser de droit toute œuvre entreprise pour elle, à moins que son héritière dans la Franc-Maçonnerie n’en réclame l’exécution. »
– Soit ; mais je suis vivante ! dit froidement Marianna.
– Pourquoi ne m’avoir pas mise en garde contre l’erreur où je pouvais tomber ?
Marianna la regarda.
– Qui sait ? Peut-être n’étais-je pas fâchée, après tout, de savoir quelle part avaient votre sagesse et votre prudence dans la direction de nos intérêts.
– Vous permettez-vous de douter de ma sincérité ? dit la marquise en relevant la tête.
– Je me permets de penser que vous vous êtes trop hâtée d’oublier mes droits pour ne songer qu’à l’amour de Mme d’Ingrande, votre nièce.
– Que je me sois hâtée ou non, Amélie est aujourd’hui la femme de M. Philippe Beyle.
– C’est un malheur pour elle, dit Marianna.
– Oh ! s’écria la marquise désespérée.
– Madame, vous êtes la grande-maîtresse de notre ordre ; vous avez juré de sacrifier à nos intérêts, non seulement votre existence, vos richesses, mais encore vos liens de famille.
Ces mots avaient été prononcés d’un ton ferme mais calme.
La marquise de Pressigny se sentit en lutte avec une nature implacable.
– Alors, que voulez-vous ? demanda-t-elle à Marianna.
– Je veux rentrer dans mes droits sur Philippe Beyle.
– Malgré l’alliance qui vient de l’introduire dans ma famille ?
– Malgré tout.
La marquise baissa la tête.
– La Franc-Maçonnerie l’a condamné sur mes justes griefs, reprit Marianna.
– Je m’en souviens ; je me souviens aussi que ma voix fut insuffisante à combattre cet arrêt. Vous l’emportâtes sur moi dans cette assemblée générale. Était-ce un pressentiment qui me faisait alors m’opposer à ce que je considérais comme un acte de despotisme trop ouvert ? je ne sais. Toutefois, je pensais alors ce que je pense encore aujourd’hui : c’est-à-dire que le but de notre association est plutôt de protéger que de punir.
– Punir les oppresseurs, c’est protéger les opprimés.
– Les torts de M. Beyle envers vous n’ont été que ceux d’un amant.
L’œil de Marianna étincela à ces paroles.
– Que ceux d’un amant, oui, madame, rien que cela ! répondit-elle avec ironie ; c’est la moindre des choses, en effet.
Il m’a torturée, il est entré violemment dans ma vie pour la briser. Ses torts ne sont que ceux d’un amant ! Est-ce donc à moi de vous rappeler que notre société est autant la sauvegarde des sentiments que la sauvegarde des intérêts ? Par quoi vivons-nous, nous autres femmes, sinon par le cœur, et quand on nous l’a broyé, quel plus grand crime pouvez-vous imaginer, dites-moi ?
– Madame…
– Mes griefs, qui étaient justes alors, se sont accrus depuis. Je vous le répète, cet homme m’appartient.
Après avoir disputé le terrain pied à pied, la marquise de Pressigny crut devoir changer de tactique.
– Soit, dit-elle ; mais en le frappant, n’atteindrez-vous pas du même coup Amélie, une enfant qu’il est impossible de haïr ?
Marianna eut un tressaillement.
– Elle m’a sauvé la vie, c’est ce que vous voulez me rappeler, n’est-ce pas ? Oh ! je ne l’ai pas oublié. Un jour que j’étais tombée dans le bassin d’Arcachon, l’enfant eut plus de courage que Philippe qui m’accompagnait, plus de courage que les misérables rameurs. Elle m’arracha à la mort ; me rendit-elle un véritable service ? : je l’ignore. Cependant je serais un monstre si le souvenir de ce qu’elle a fait pour moi s’était effacé de ma mémoire.
– Eh bien ? dit la marquise.
– Eh bien ! madame, je plains votre nièce, mais ce souvenir ne m’empêchera pas d’arriver jusqu’à Philippe. C’est parce que ma reconnaissance pour elle est grande que je serai sans pitié pour lui. Je vous le déclare, c’est une alliance monstrueuse que celle de cet ange et de ce démon. Je le connais : il avilira tout ce qu’elle a de pur et de charmant dans l’âme, il profanera une à une ses illusions de jeune fille et de jeune épouse. Cet homme ne croit pas à l’amour, il ne croit tout au plus qu’aux femmes qui flattent sa vanité ou servent son ambition. Madame, je rendrai à Amélie service pour service : je la délivrerai de cet homme.
– Que dites-vous ? s’écria la marquise hors d’elle-même.
– La vérité.
– C’est impossible ! vous ne ferez pas cela !
– Pourquoi donc ?
– Je m’y opposerai ! j’invoquerai mon pouvoir, mes privilèges !
Marianna dit lentement :
– Il est écrit dans nos statuts que la haine doit s’arrêter devant le mari ou les enfants d’une franc-maçonne. Philippe n’est pas le mari d’une franc-maçonne, et Amélie n’est pas votre enfant.
– Vous avez raison, je le reconnais, dit la marquise abattue.
– Enfin !
– Mais pitié ! pardon !
– Pitié ? pardon ? murmura Marianna comme quelqu’un qui entend pour la première fois une langue étrangère.
– Ah ! je vous supplie !
– Mon dernier mouvement de pitié est enfermé sous le couvercle de la tombe d’Irénée.
Marianna se disposa à sortir.
– Encore un mot ! s’écria la marquise de Pressigny.
– J’ai dit tout ce que j’avais à dire, madame ; vous êtes avertie.
– C’est donc aussi jusqu’à la tombe que vous voulez poursuivre Philippe Beyle ?
Marianna ne répondit pas, mais un sourire passa sur ses lèvres.
– Adieu, madame la marquise, dit-elle en s’inclinant profondément.
La marquise retomba dans son fauteuil.
Une longue méditation succéda à l’agitation provoquée par cet entretien.
Voici quel fut le résultat de cette méditation :
– Il n’y a qu’un moyen de sauver Philippe, pensa-t-elle, et pour cela il faut qu’Amélie soit franc-maçonne. Mais comment ?
À cet instant, ses yeux tombèrent sur la lettre signée Caroline Baliveau.
– J’ai un espoir ! dit-elle.
Le moment est venu de préciser les origines de la Franc-Maçonnerie des Femmes, et de déterminer l’époque de sa formation en France.
Les périodes de luttes et de dangers ont toujours inspiré aux âmes héroïques la pensée de se réunir pour opposer à la force brutale une intelligente protestation.
Cette pensée de protestation a dû naturellement être permanente chez un sexe que la législation de tous pays place dans une position subalterne et dépendante.
Aussi, à toutes les époques de l’histoire, voyons-nous se manifester tantôt par la ruse, tantôt par la grâce, souvent même par la cruauté, la résistance énergique des femmes ; résistance plus opiniâtre, plus persistante que celle des esclaves dans l’antiquité et des serfs au Moyen Âge. Les esclaves, en effet, devaient avoir leur Christ dans Spartacus ; les Jacques et les Maillotins devaient avoir 89 ; mais dans la lutte des femmes, lutte désespérée et qui ne prévoit pas encore son sauveur, les tentatives devaient être continuelles. Arria, la conjurée stoïque ; Galswinthe, cette touchante victime des âges mérovingiens ; Hermangarde, la compagne de l’empereur Franck ; Geneviève de Paris, Héloïse, Jeanne d’Arc, les femmes de Beauvais, Charlotte Corday, continuent la protestation du dévouement ; de même que Tullie, Frédégonde, Anne d’Angleterre, dona Olimpia, Christine de Suède, Théroigne représentant la rivalité ouverte, la protestation vindicative et féroce ; de même, enfin, que Sapho, les Sibylles, Hypathie, la religieuse Hroswita, Christine de Pisan et Mme de Staël continuent la protestation éclatante du génie et de la force intellectuelle.
Il est facile, à certaines périodes, sous l’influence égalitaire de certaines religions, de certaines civilisations, en Grèce, en Égypte, et plus tard en Gaule, de retrouver les traces d’une action plus générale. Qu’était-ce, par exemple, que le royaume des Amazones, sinon une franc-maçonnerie de femmes, admirablement et fièrement constituée ? Qu’étaient-ce que ces bacchantes de Thrace, qui mettaient en pièce les mortels assez osés pour essayer de pénétrer dans leurs mystères ? Et les comédies d’Aristophane n’insistent-elles pas sur l’intervention des femmes athéniennes dans les affaires publiques ? « Nous mettrons les biens en commun, dit Praxagora dans les Harangueuses ; tout appartiendra à toutes : pains, salaisons, terres, richesses mobilières, gâteaux, tuniques, vin, couronnes et pois chiches. »
Plus tard encore, ne voit-on pas éclater dans la servitude des harems, dans le silence des cloîtres, dans l’isolement des châteaux féodaux, parfois même en plein siècle, telles que la Guerre des Femmes et la Guerre des Servantes, des révoltes inopinées témoignant évidemment d’un accord, d’un concert ? Il est donc aisé, en remontant le courant des âges, de ressaisir la tradition d’un secret bien gardé, transmis de génération en génération, parfois importé d’un continent dans un autre, la filiation d’un complot quelquefois sommeillant, puis se réveillant à la faveur des conditions propices ou sous la pression d’un asservissement complet.
La Franc-Maçonnerie des Femmes se manifesta et se constitua graduellement, en France, à une époque relativement assez rapprochée de la nôtre ; née d’une fantaisie de grande dame, comme nous allons le voir, elle se propagea jusqu’à nous.
L’époque de la minorité de Louis XIV fut plus que toute autre une époque de dissolution et d’individualisme. Chacun alors tirait à soi et, dans l’absence d’une autorité légitime et bien définie, cherchait à absorber le plus qu’il pouvait de la force qui se déperdait autour de lui. D’un autre côté, la société, épuisée par les guerres de la Ligue, éprouvait un vif besoin de se reconstituer. Les familles divisées par l’antagonisme politique et religieux tendaient à se rapprocher ; on voyait se former sur tous les points de la France, notamment à Paris, des groupes, des milieux, tous plus ou moins influents, selon qu’ils étaient placés sur des degrés plus ou moins élevés de l’échelle sociale.
Jamais peut-être l’influence des femmes ne fut plus considérable ; c’est à elles qu’appartient la direction de ce double mouvement de la féodalité expirante et de la monarchie en voie de constitution. Il n’y avait pas un seul de ces groupes qui n’eût à sa tête quelqu’une de ces femmes vaillantes ou brillantes, dont les noms sont devenus historiques, soit par la violence, soit par la beauté, soit par des fautes éclatantes, soit par des vertus intrépides. L’état des esprits ou plutôt des intelligences concourait à assurer cette domination des femmes ; la vogue de la littérature espagnole avait importé chez nous l’héroïsme amoureux, la galanterie chevaleresque, dont les pièces de Corneille et les romans de Mme de Lafayette attestent l’acclimatation. Le succès inouï de l’Astrée, succès poussé au point que de graves légistes, des prélats, des Huet, des Patru, en faisaient, ouvertement leurs délices, tout conspirait à placer la femme dans une sorte de sanctuaire devant lequel il n’était honteux pour personne de s’incliner. Pas un ne rougissait alors de prononcer ces mots pompeux d’adoration, de martyre, d’esclavage, d’attraits divins, de beaux yeux, maîtres du monde. Le mourir d’amour semblait non seulement naturel, mais juste. Turenne soupirait pour Mme de Longueville, Condé pour la belle Mlle du Vigean, Nemours pour Mme de Monbazon, Retz pour Mme de Chevreuse, tout le monde pour Mlle de Rambouillet ; Charles II, roi d’Angleterre, tombait aux pieds de Mlle de Montpensier et recevait d’elle cet ordre à la romaine :
– Allez vous faire casser la tête ou remettre la couronne dessus !
Quoi donc d’étonnant à ce que les femmes aient pris au sérieux leur rôle de déesses et de souveraines, qu’elles aient tenté de faire une application positive de ce pouvoir qu’on leur accordait si libéralement au figuré ? Puisque les hommes étaient, même les plus braves, à genoux autour d’elles, elles devaient être nécessairement supérieures et maîtresses. Mme de Longueville assistait, cachée derrière une fenêtre, au combat de Guise et de Coligny, et voyait froidement désarmer et blesser à mort le champion de sa vertu et de sa beauté. Quelques-unes, comme Mlle de Vertus et Mlle Paulet, préféraient fièrement la liberté à l’engagement du mariage. Mademoiselle elle-même, la petite-fille de Henri IV, la nièce de Louis XIII, allait plus loin encore : elle érigeait le célibat en principe, et jetait fort sérieusement le plan d’une société sans amour et sans mariage, sorte d’abbayes de Thélèmes retournée, où les soupirants auraient soupiré sans espoir. Sa confidente, Mme de Motteville, qui a joué un peu dans cette circonstance le rôle d’un faux frère, nous a laissé sur ce plan quelques indications qui témoignent d’une résolution bien arrêtée.
La colonie, composée toutefois d’hommes et de femmes, devait s’établir dans quelque endroit charmant des rives de la Loire ou des rives de la Seine. Un couvent serait fondé dans le voisinage pour y exercer la charité et maintenir le niveau des esprits à la hauteur de l’ascétisme religieux. La galanterie, même la plus délicate, était bannie des relations avec les hommes ; la seule jouissance qui leur fût permise était le plaisir de la conversation.
« Ce qui a donné la supériorité aux hommes, disait Mademoiselle, a été le mariage ; et ce qui nous a fait nommer le sexe fragile a été cette dépendance où ils nous ont assujetties, souvent contre notre volonté et par des raisons de famille dont nous avons été les victimes. Tirons-nous de l’esclavage ; qu’il y ait un coin du monde où l’on puisse dire que les femmes sont maîtresses d’elles-mêmes, et qu’elles n’ont pas tous les défauts qu’on leur attribue ; distinguons-nous dans les siècles à venir par une vie qui nous fasse vivre éternellement ! »
Quelle fut la rive, quel fut le site enchanteur choisi par Mademoiselle ? N’est-il pas probable que la petite colonie hésita devant le scandale ou le ridicule d’une réalisation publique, peut-être devant l’appréhension de la colère de la reine, et se contenta d’une existence ignorée sous les ombrages de Saint-Germain ? Quant à la constitution de cette société, on ne saurait la mettre en doute, quand on voit Mademoiselle aller au secours d’Orléans avec un état-major tout composé de femmes de sa cour.
La deuxième Fronde marque visiblement l’existence politique de cette confrérie ; les lettres et les mémoires du temps ne laissent là-dessus aucun doute. Mademoiselle négociait par ambassadeur avec les puissances de son sexe. Elle congédiait les faibles comme Mme de Chevreuse et Mme de Châtillon ; elle rompait diplomatiquement par l’intermédiaire de Mme de Choisy, son ministre, avec la Palatine, son alliée de la veille. Il y a dans ses fameux mémoires tout un passage qui respire l’enivrement du triomphe et de la liberté. Comme on devine bien l’exaltation qui la possédait lorsqu’elle faisait acte de maître, acte d’homme et de guerrier, en forçant les portes de la ville d’Orléans ! lorsqu’elle traitait sur le pied d’égalité avec Beaufort ; et sa joie enfantine en tirant à la porte Saint-Antoine ce célèbre coup de canon, ce coup de canon que Louis XIV ne devait jamais lui pardonner, car il sentait que ce jour-là ce n’était pas seulement son autorité qu’avait tenté d’usurper cette fille des d’Orléans, de cette branche cadette toujours inquiétante pour son aînée, mais le privilège même de sa naissance et de son sexe. N’avait-elle pas rêvé, en effet, d’être roi de France ? La Fronde triomphant, elle montait sur le trône en y gardant son vœu de célibat et amenait avec elle son personnel de ministres-femmes, de conseillères et d’ambassadrices.
Quel avenir pour la Franc-Maçonnerie des Femmes !
La défaite définitive des Frondeurs, en ruinant cet affreux projet, rejeta le plan de Mademoiselle dans les ténèbres d’une société secrète. Là encore le rôle était beau : quelques personnes courageuses, bien nées, vaincues mais non soumises, se prêtant dans l’ombre un mutuel appui, c’était tout ce qu’avait pu rêver après la déroute la fière amazone. Toutefois, la force des évènements avait déjà pesé sur les formes de l’association féminine : la nécessité de chercher aux jours du danger aide et secours au-dessous de soi, de conquérir, par la confiance, des dévouements, avait entraîné dans plus d’un cas la violation du secret.
En un mot, il avait fallu s’adjoindre des femmes du peuple.
On sait quel fut le sort des personnages fameux de la Fronde et particulièrement des femmes qui y avaient joué un rôle ; c’est dire quel fut le sort des premiers membres de la Franc-Maçonnerie des Femmes en France. Mademoiselle expia, dans une union disproportionnée, sous les dédains d’un aventurier, son amour entêté de l’indépendance. Tous les autres chefs, les uns après des exils temporaires, les autres, fatigués de leur isolement, se retrouvèrent au rendez-vous commun de la pénitence, la plupart au couvent des Carmélites de la rue Saint-Jacques, où le souffle du jansénisme vint encore quelquefois caresser leurs idées d’opposition.
Néanmoins, des souvenirs d’un triomphe éphémère et de ces épreuves communes étaient résultées des affinités réelles, durables.
Un signe, un mot, un appel obtenaient des sacrifices ; on retrouvait en face de tel visage entrevu à travers la fumée de la poudre, sur les barricades, dans l’exil, dans la fuite, les forces de la jeunesse, les ressources d’un crédit qu’on croyait épuisé ; et c’est par cet échange de services, par ce commerce de protections que fut constituée, au dix-septième siècle, la Franc-Maçonnerie des Femmes.
Plus tard, cette franc-maçonnerie reçut son organisation ; elle eut son code, ses loges, ses titres, ses cérémonies. Il était naturel qu’elle eût été emprunter à la franc-maçonnerie des hommes les traditions indispensables de ses épreuves et de ses mystères. Aussi les rapports entre l’une et l’autre de ces institutions ne manqueront-ils pas de se produire dans le cours de cette histoire. La Franc-Maçonnerie des Femmes traversa le dix-huitième siècle avec éclat et s’y installa solidement ; elle pensa qu’après la police et la compagnie de Jésus, il y avait une troisième place à prendre, et cette place, elle, la prit. Ses relations s’accrurent en tous lieux, dans la magistrature, dans la finance, au théâtre, plus haut et plus bas encore. Ce fut la Franc-Maçonnerie des Femmes qui donna au trône Mme de Maintenon, la marquise de Pompadour et la comtesse du Barry ; elle compta dans ses rangs Mlle de Lespinasse, Sophie Arnould, la chevalière d’Éon, Mlle d’Oliva. Une des grandes-maîtresses fut la femme du comte de Cagliostro ; les séances se tenaient alors rue Verte, dans le faubourg Saint-Honoré.
Sous la Révolution, la Franc-Maçonnerie des Femmes, quoiqu’un peu dispersée par la chute de la noblesse, put encore se compter dans les réunions chez Catherine Théo, réunions tolérées par Robespierre ; dans les clubs exclusivement féminins, présidés par Rose Lacombe ; même dans les galeries de la Convention, où les mains de quelques tricoteuses échangeaient quelquefois en silence des signes mystérieux. Elle se reconstitua sous l’Empire et y acquit une nouvelle force, à laquelle les expéditions militaires laissèrent un libre essor à l’intérieur. Il existe encore des femmes, et nous en connaissons pour notre part, qui ont appartenu à la loge Caroline, une des plus importantes et surtout des plus influentes d’alors.
On ne sera pas étonné de voir se perpétuer la Franc-Maçonnerie des Femmes jusque sous le règne peu légendaire de Louis-Philippe. Son action y a été lente et peu mesurée, mais son autorité est demeurée la même. Cette ligue est encore aussi vivace de nos jours qu’il y a deux siècles ; une période véhémente la rejetterait immanquablement dans un milieu d’action et de direction. En attendant, elle se contente d’exercer son pouvoir dans les limites de la vie privée, ou, par elle, s’expliqueraient en partie bien des élévations et bien des chutes, bien des réputations et bien des fortunes. Elle est comme un souterrain dans la société, ou bien encore comme un autre conseil des Dix, moins les masques, les bravi et les Plombs. Le conseil des Dix entre les mains des femmes ! Il y a de quoi réfléchir.
La famille Baliveau occupait une maison sur le Jard.
Le Jard est la principale promenade d’Épernay : une place avec des arbres et fermée par un petit parapet circulaire en pierre ; ce que dans d’autres villes on appelle le Mail.
Modeste négociant en vins, Etienne Baliveau, âgé de cinquante ans environ, était un de ces véritables esclaves de l’honneur commercial, dont la tradition est heureusement encore vivace et forte en France. Humble Caton de comptoir, il se fût sûrement planté son canif dans le cœur le jour où il eût vu sa signature livrée aux hontes du protêt.
Casematé dans ses registres, il n’avait jamais laissé voir sur sa physionomie le moindre signe de satisfaction lorsqu’il réalisait des bénéfices, ni la moindre trace d’inquiétude lorsqu’il éprouvait des mécomptes. Sa femme avait employé vingt-cinq années de tendresse à essayer de pénétrer dans les mystères de sa situation. Il l’adorait ; mais quand elle lui faisait une demande relative à ses affaires, il lui répondait impitoyablement :
– Ne t’occupe pas de cela.
Il serait trop long de dire les ruses auxquelles elle eut recours pour n’arriver qu’à des renseignements imparfaits. Elle apprit la tenue des livres afin de pouvoir, deux ou trois fois par an, se glisser clandestinement dans le comptoir et y interroger les chiffres.
Le caractère taciturne d’Étienne Baliveau affligeait d’autant plus cette pauvre femme, qu’elle-même lui avait toujours caché un secret : atteinte d’épilepsie après une grossesse, elle s’était accoutumée à lutter silencieusement contre la souffrance ; car elle savait que cette maladie est une de celles qui, surtout en province, stigmatisent une famille et vouent ses enfants au célibat, à moins qu’ils ne possèdent une grande fortune.
Or, Mme Baliveau avait une fille de vingt-deux ans qu’elle cherchait à marier.
Voilà pourquoi cette héroïque bourgeoise s’efforçait de dissimuler ses douleurs physiques.
Une seule personne était dans la confidence : c’était Catherine, la vieille domestique ; et, pour rien au monde, Catherine ne l’aurait trahie ; elle savait protéger et même provoquer sa retraite dans son appartement, lorsque MmeBaliveau ressentait les approches de ce mal terrible, approches qu’il n’est pas impossible de prévoir dans de certains cas et sous de certaines influences. C’était Catherine qui faisait alors le guet aux alentours de la chambre à coucher, pendant que Mme Baliveau se débattait dans les convulsions et dans l’écume…