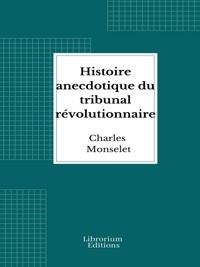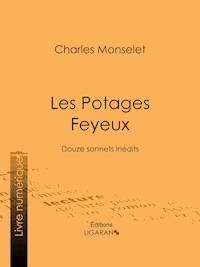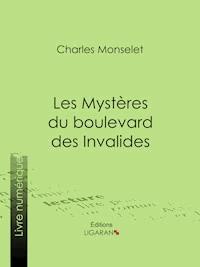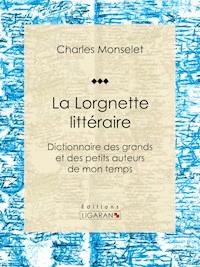Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Le premier nom qui se présente sous ma plume celui d'Henry Murger, de cet être aimable et doux dont le séjour sur la terre a été de si courte durée. On aperçoit Murger à quelque distance d'Alfred de Musset. C'est la même finesse de détails et la même élégance dans un milieu plus humble. Spécialistes d'amour tous les deux."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Une lecture au Quartier Latin. – Henry Murger et Théodore Barrière. – Je tue Mimi. – Les Vieux de la Vieille, de Théophile Gautier. – Rencontre avec Balzac.
Le premier nom qui se présente sous ma plume est celui d’Henry Murger, de cet être aimable et doux dont le séjour sur la terre a été de si courte durée.
On aperçoit Murger à quelque distance d’Alfred de Musset. C’est la même finesse de détails et la même élégance dans un milieu plus humble. Spécialistes d’amour tous les deux.
La vie a été rude pour lui du premier jour jusqu’au dernier. Sa seule arme de lutte a été l’esprit. Il s’est bien défendu ; – peut-être eût-il mieux fait d’attaquer.
J’avais vingt-deux ans et lui vingt-quatre, lorsque nous nous liâmes d’une amitié que rien ne devait jamais altérer ni troubler.
Henry Murger entra un dimanche matin chez moi, dans la chambre d’hôtel que j’occupais orgueilleusement vis-à-vis du palais des Tuileries, sur la place du Carrousel, à côté du guichet du pont des Saints-Pères.
Je serais presque tenté de dire qu’à la manière des personnages de roman, Murger fit d’abord cinq ou six tours dans ma chambre ; – mais l’amour de la vérité m’oblige à déclarer qu’il n’y avait pas moyen de faire cinq ou six tours dans ma chambre.
Il s’assit donc – sur mon lit – et me dit, en dirigeant vers moi son très fixe regard :
– N’êtes-vous pas humilié… comme moi… de nous voir moins richement vêtus que tant d’autres hommes ?
Étonné, je murmurai :
– En effet… peut-être… oui… je n’y avais jamais pensé.
Et ensuite, d’un ton qui essayait d’être dégagé :
– Ah ! bah ! m’écriai-je.
Mais Murger continua gravement :
– Retirez cet Ah ! bah !… Votre indifférence est coupable au premier chef… Il importe, croyez-moi, que nous relevions les jeunes lettres en nos personnes. Finissons-en avec les chapeaux insouciants et les redingotes douteuses. Devenons ce que nous sommes au moral : des gentlemen. Soyons irréprochables !
Je l’écoutais avec une stupeur mêlée d’intérêt.
– Qu’entendez-vous par irréprochables ? lui demandai-je.
– Être irréprochable, c’est être habillé de neuf.
– Ah ! très bien !
– Écoutez-moi, reprit Henry Murger sur un mode de plus en plus solennel ; je vous donne à vous comme à moi quinze jours pour être irréprochables… C’est bien le diable si, en quinze jours, un être intelligent n’a pas le temps de se procurer habit, veste et culotte.
– Je vous crois, dis-je.
– Rendez-vous de dimanche en quinze, au pont Neuf, midi sonnant, sous l’œil du bon roi.
– Pourquoi faire ?
– J’ai un programme de fête… vous verrez… Et puis, je vous présenterai un de mes amis, une sommité déjà…
– Qui s’appelle ?…
– Théodore Barrière… À dimanche !
Rien ne m’empêcherait, pour gagner une ligne, de répéter ici les mots : À dimanche ! comme dans les romans de dialogue, mais un vif sentiment de la haute littérature me retient.
Le dimanche indiqué, au dernier coup de midi, par une radieuse journée de printemps, deux jeunes hommes s’avançaient l’un vers l’autre, – sur le terre-plein du pont Neuf.
Ils avaient été sur le point de passer sans se reconnaître.
Ils resplendissaient, ils éblouissaient du col au talon ; l’un jouait négligemment avec un lorgnon, l’autre balançait un stick imperceptible.
Était-ce Brummel ?
Était-ce le comte d’Orsay ?
C’était Murger.
C’était moi.
Nous avions obéi scrupuleusement à la loi que nous nous étions imposée : nous étions irréprochables.
– Maintenant, me dit Murger en me prenant sous le bras, nous pouvons aller partout, dans les salons ariscrocratiques du faubourg Saint-Germain, dans les salons financiers de la chaussée-d’Antin, au bal de l’ambassade d’Autriche, dans tous les ministères.
– Allons à l’Estaminet belge.
À l’Estaminet belge, il me présenta à l’ami dont il m’avait parlé.
C’était un jeune homme d’un aspect un peu sévère, aux yeux enfoncés et brillant d’un feu sombre, l’air d’un officier en bourgeois.
C’était Théodore Barrière.
Il était employé au ministère de la guerre, dans le département des cartes ; mais il avait déjà fait représenter plusieurs vaudevilles, ce qui lui donnait un certain prestige parmi nous.
– La connaissance faite, nous nous acheminâmes tous les trois vers le logis de Murger, rue Mazarine, dans un hôtel fort triste, « tenu par Hautemule, » comme disait l’enseigne. M. P.J. Proudhon, à cette époque, occupait dans le même hôtel une chambre au-dessus de celle de Henry Murger.
Une fois arrivés, Murger alla mettre le verrou, et Barrière, avec fin horrible sang-froid, tira de dessous sa redingote cinq cahiers à couverture bleue, représentant cinq actes d’une comédie, qu’il déposa sur une table.
Je devins pâle.
J’étais tombé dans une lecture.
Il est vrai que cette comédie avait pour titre : la Vie de Bohême.
Je crois inutile de dire l’émotion dont je fus insensiblement gagné en écoutant cette œuvre folle d’esprit et navrante d’amour.
Le dénouement n’était pas alors arrêté.
Murger, avec sa douceur accoutumée, inclinait vers la guérison de Mimi ; il proposait un voyage en Italie.
Barrière, lui, était pour la mort.
Je fus de l’avis de Barrière.
Le meurtre de Mimi fut décidé. Je n’en ai jamais éprouvé de remords.
Cette journée est restée dans mon souvenir comme une des meilleures de ma jeunesse.
Un ou deux ans plus tard, je dus à mon tour écrire une pièce avec Théodore Barrière.
Je pris plusieurs rendez-vous chez lui.
Mais là, je me heurtai à un obstacle sérieux.
Quand je dis sérieux… vous allez voir.
Barrière vivait en famille, – avec une mère, le modèle de toutes les sollicitudes ; avec un père qui avait été lui-même un auteur dramatique.
Dans cet intérieur patriarcal, il y avait un perroquet nommé Coco, comme tous les perroquets.
Or, pour un nouveau collaborateur introduit chez Barrière, l’important était moins de plaire à son père et d’avoir l’agrément de sa mère – que de gagner les bonnes grâces de Coco.
Coco était un thermomètre dramatique.
On apportait son perchoir dans la salle à manger, pendant le dîner, et on le plaçait auprès du nouveau collaborateur.
Si Coco se familiarisait avec lui, s’il descendait sur son épaule, – le néophyte était admis par Barrière et par ses parents.
Si, au contraire, Coco restait sur son perchoir, sombre, battant des ailes, la crête hérissée et se refusant à toutes les avances, – le néophyte était refusé.
Les deux seules fois que je dînai chez Théodore Barrière, Coco resta sur son perchoir.
Théophile Gautier est un des hommes de lettres que j’ai le plus désiré voir, lors de mon arrivée à Paris. J’avais dévoré tous ses livres en province, et il m’apparaissait comme la plus parfaite incarnation du romantisme.
À mon admiration si légitime pour l’écrivain se joignait une vive curiosité pour l’homme, curiosité surexcitée, entretenue par des portraits et des récits étranges. Je savais que l’auteur de Fortunio portait des cheveux excessivement longs, qu’il s’habillait d’étoffes voyantes, destinées à épouvanter les bourgeois. Les jeunes gens se laissent prendre à ces jeux.
Je ne tardai pas à me faire présenter, et sa vue ne détruisit pas l’image que je m’étais créée du sectaire d’Hernani, du spectateur au pourpoint cerise légendaire. Il était dans toute la force et dans tout l’éclat de sa trente-sixième année ; sa myopie et son chapeau constamment fixé sur la tête contribuaient à lui donner un certain air de hauteur, auquel des étrangers ont pu se tromper. La vérité est qu’il m’accueillit avec une parfaite indifférence, – ce que je comprends bien.
Ce ne fut qu’au bout de quelques mois que, s’accoutumant à me voir dans les bureaux de rédaction de journaux, il me fit l’honneur de m’admettre insensiblement à son intimité. En ce temps-là, il avait le tutoiement très facile ; je pus le croire mon ami – mais à coup sûr j’étais devenu le sien, et pour toujours.
J’ai eu la grande joie, dans ma vie, d’inspirer à Théophile Gautier une de ses meilleures pièces de vers, celle qui porte le titre des Vieux de la Vieille.
Voici dans quelles circonstances.
C’était en 1848, après la révolution de février. La vie littéraire était devenue difficile pour moi, comme pour beaucoup d’autres. J’avais publié quelques feuilletons dans la Presse, mais le vent n’était plus aux feuilletons ; – j’en étais réduit à faire des physionomies de Paris, des tableaux de la rue ; j’agrandissais le fait divers.
Ce fut ainsi que, le 5 mai, jour anniversaire de la mort de Napoléon 1er, je publiai dans la Presse, à la place la plus modeste, et sans signature, un article qui commençait de la sorte :
« Un étrange spectacle a en lieu ce matin sur la place Vendôme. Entre dix et onze heures, autour de la colonne, on a vu se ranger successivement les derniers soldats de l’Empire ; la plupart avaient revêtu leur ancien uniforme chamarré de broderies et encore tout étincelant de galons, malgré la rouille du temps. De pauvres vieillards éteints, amaigris, se redressaient fièrement sous le casque à longue chevelure des dragons ou sous le plumet des hussards ; des têtes ridées jusqu’au crâne sortaient dessous d’immenses bonnets à poil. Il y en avait qui traînaient de riches sabretaches. Toutes ces splendeurs à demi mortes sur des corps à demi vivants donnaient un aspect fantastique à la place Vendôme ; on eût dit les ombres convoquées pour la fameuse revue dont parle le poète allemand :
L’énergie ressuscitée de quelques-unes de ces figures ressortait vigoureusement sous leur costume théâtral. Pourtant la majorité de ces bonnes gens se composait de boutiquiers, de petits commerçants et de bureaucrates ; mais tel qui eût été ridicule avec l’habit ou la redingote, devenait presque majestueux sous le plastron, des chasseurs de la garde. Quelques-uns d’entre eux se faisaient remarquer par leur stature colossale, tandis que d’autres, au contraire, laissaient deviner une maigreur extrême sous l’ampleur flottante de leur costume et sous les plis de leurs guêtres. Vers midi, cette vision empanachée s’ébranla, et un lancier octogénaire déploya un drapeau sur lequel était écrit : Les Vieux de la Vieille à la République française ! etc. etc. »
L’article avait une centaine de lignes sur le même ton. (Presse du 6 mai 1848.)
À quelque temps de là, je rencontrai Théophile Gautier.
– Tu as fait, l’autre jour, un joli article, me dit-il.
– Comment le sais-tu ? il n’était pas signé.
Gautier haussa légèrement les épaules et passa.
Pour moi ; j’étais rayonnant. Un tel suffrage avait à mes yeux une valeur si considérable !
Je me trouvai encore plusieurs fois avec Théophile Gautier, et chaque fois il revint avec complaisance sur mon article.
Décidément, cet article lui trottait en tête.
Bientôt l’idée que je n’avais fait qu’indiquer s’empara de lui tyranniquement ; il la mûrit, – et il la développa dans une trentaine de strophes, qui sont autant de merveilles de pittoresque et de sentiment. Tout le monde les connaît, ces Vieux de la Vieille, qui, publiés pour la première fois en 1848, figurent aujourd’hui dans le volume des Émaux et Camées.
À quoi bon continuer ? Ces beaux vers ne sont-ils pas dans toutes les mémoires ?
On ne se méprendra pas sur le sentiment qui me fait évoquer cette anecdote et m’enorgueillir d’avoir fourni à l’un des écrivains que j’admire le plus l’occasion de produire un chef-d’œuvre.
Mettons, si vous voulez, que j’ai été ce jour-là le chien qui fait lever le gibier.
Mais de quel triomphant coup de fusil le poète a abattu cette pièce !
En 1866, Théophile Gautier m’envoya un exemplaire de son Capitaine Fracasse, accompagné de l’amusante lettre que voici :
« MON CHER MONSELET,
Accepte ce Fracasse illustré, et parles-en dans les apiers où tu reluis comme une casserole de cuivre bien écurée dans une cuisine flamande. Considéré cet ouvrage au point de vue gastronomique ; l’absence de nourriture y est déplorée amèrement, mais quand la bonne chance ramène les mets succulents et les bons vins, ils sont célébrés avec non moins de soin que les charmes de l’héroïne. Protège ces goinfres, ces ivrognes et ces canailles variées ; saupoudre-les de quelques mots spirituels, en guise de muscade râpée. À propos de muscade, si on en mettait partout au temps de Boileau, on n’en met plus nulle part aujourd’hui ; le monde dégénère.
Adieu, soigne ton bedon, et ne t’efforce pas de le contenir au majestueux, comme cet imbécile de Brillat-Savarin.
Tuus
THÉOPHILE GAUTIER. »
La dernière fois que je me suis trouvé avec Balzac, c’était en 1848, dans les bureaux de l’Évènement, à la rédaction duquel j’appartenais.
L’Évènement venait d’être fondé sous le patronage de Victor Hugo. C’était un recueil vaillant et hardi, où avaient été conviés tous les écrivains qui étaient un nom, un talent, ou même simplement un espoir.
Léon Gozlan, Méry, Théophile Gautier coudoyaient Henry Murger, Champfleury, Théodore de Banville. Il se faisait là un joyeux tapage, un cordial échange d’idées, d’aspirations, de jugements, de traits spirituels. Anténor Joly et Polydore Millaud allaient et venaient dans la maison, toujours affairés, ou faisant semblant de l’être ; le premier s’occupant de la partie littéraire, dénichant des romans, harcelant les auteurs, dressant les manuscrits ; – le second donnant des conseils à propos de l’administration, la tête pleine de projets, les poches pleines… de plans ; l’un criant comme un sourd qu’il était, l’autre frappant le parquet de sa canne, tous les deux ouvrant et fermant les portes avec bruit.
Un soir, comme je corrigeais les épreuves d’un de mes feuilletons, dans la salle commune à tous les rédacteurs, entre neuf et dix heures environ, je vis entrer un homme que je reconnus au premier coup d’œil (je l’avais vu deux ans auparavant). C’était Balzac. Tout le monde se leva. Meurice et Vacquerie allèrent à lui les mains tendues.
Balzac avait promis un roman à l’Évènement ; il en avait même donné le titre. Il ne venait pas l’apporter ce soir-là ; il venait prendre congé de ses amis, car il partait le lendemain pour son dernier voyage en Russie.
Il était habillé avec un mauvais goût qui ne laissait rien à désirer. La redingote était d’un bronze vert. Une cravate rouge roulée en corde, un chapeau défraîchi, ses cheveux longs, lui donnaient l’air d’un comédien de province. Son apparence n’avait plus la jovialité puissante d’autrefois ; l’âge, sans détruire l’ensemble de la physionomie, en avait apaisé les tons. La gaieté était devenue de la bonté. Seul, l’œil était resté extraordinaire d’éclat et d’expression. Rien de plus exact que ces paillettes d’or que signalent les portraits écrits de Mme de Surville et de Théophile Gautier.
J’eus le temps d’examiner Balzac tout à mon aise. Il n’était point pressé de s’en aller. Une fois sorti de chez lui, il appartenait à chacun. Il n’était intraitable que pendant ses périodes de travail.
La conversation roula sur Tragaldabas, l’évènement littéraire du jour ; j’y pris part, et Balzac m’adressa plusieurs fois directement la parole. Sa voix avait beaucoup de charme. Mais, je le répète, la somme de vitalité était moins grande. Ressentait-il déjà les premières atteintes du mal qui devait l’emporter deux ans plus tard ?…
Au bout d’une heure, il prit congé. Ses traits étaient pour toujours gravés dans ma mémoire.
Il n’y a guère eu d’écrivain plus injurié que Balzac, – si ce n’est pourtant Victor Hugo.
Dans le commencement, on l’avait affublé de ce surnom insultant : le plus fécond de nos romanciers.
Lui, la conscience absolue ! lui, le travail douloureux ! lui, la pensée profonde ! On a pu se tromper à ce point de vouloir le comparer aux inventeurs du roman-feuilleton !
Pauvre, pauvre Balzac !
Une lettre intime de lui (n° 254 du catalogue Charavay) contient cet aveu désolant : « Je suis Vieux de souffrances… Je n’ai même pas eu de revers, j’ai toujours été courbé sous un poids terrible. Rien ne peut vous donner une idée de ma vie jusqu’à vingt-deux ans ! »
Au moment où il pouvait se croire à l’apogée de sa gloire, il eut un procès avec la Revue de Paris, qui devint pour lui une nouvelle source d’outrages. Cette fois, les avocats s’en mêlèrent, et l’on sait quel est leur atticisme lorsqu’ils se mettent en frais littéraires. Me Chaix d’Est-Ange sut joliment dire son fait à l’auteur de la Peau de chagrin :
« Un homme dont tout le monde sait l’importance, ou plutôt un homme qui donne une grande importanceà tout ce qu’il produit… » Voilà pour le début.
« M. de Balzac donna d’abord un ouvrage ; c’est ainsi qu’on appelle ses articles… »
Ses articles ! vous voyez l’intention de dédain.
Me Chaix d’Est-Ange ne se borna pas à défendre les intérêts de la Revue de Paris ; il se lança dans l’appréciation du Lys dans la Vallée ; et je vous laisse à penser les agréables plaisanteries, les gorges chaudes. Il termina ainsi : « Voilà l’analyse du livre… Eh quoi ! on nous laissé là. Mais que deviendront la comtesse et ce monsieur dont j’ignore le nom ? Comment cela finira-t-il ? Comment va-t-elle faire pour allier ses devoirs avec sa passion ? Celui-ci, à force de s’étendre comme une plante grimpante ; celle-là à force de l’envelopper dans ses blanches draperies, ont-ils ? Voyons, ont-ils ?… Ah ! que je voudrais bien parler comme écrit M. de Balzac, et trouver le secret de ce langage, que personne ne comprend, pour exprimer ici ce que je n’ose pas dire ! »
Et penser que c’était au nom du bon goût que Me Chaix d’Est-Ange croyait s’exprimer !
Je ne rappellerai pas les péripéties de ce procès, qui se termina d’ailleurs à la satisfaction de Balzac. La Revue de Paris fut outrée. Elle envoya une nouvelle bordée à son ancien collaborateur. La conclusion vaut la peine d’être citée :
« Que M. Balzac aille en paix ! Qu’il se repose à côté de ses illustres amis lord Byron, Walter Scott, Schiller ! Qu’il chante comme Rossini ; qu’il corrige ses épreuves plus souvent que Meyerbeer ; qu’il soit plus gentilhomme que Chateaubriand ! Il est son maître, il est quitte envers nous, ses bienfaiteurs !
Allez donc, emportez loin d’ici cette immense quantité d’œuvres dont vous dérobiez la plus belle moitié à l’admiration de l’Europe sous le manteau troué de Saint-Aubin, ce pauvre feu Saint-Aubin que vous avez voué au ridicule, et qui, nous en avons peur, vous le rendra bientôt… Allez, grand homme ! allez, Rétif de la Bretonne ! allez, Balzac ! allez, Saint-Aubin ! allez, de Balzac ! allez, Crébillon fils, quand vous écrivez le français et non le gaulois ! allez ! »
Ce n’est plus de la polémique, c’est de la rage.
La Revue de Paris – c’est-à-dire M. Buloz – n’a jamais pardonné à Balzac. Elle l’a constamment fait attaquer de son vivant, et même après sa mort.
Rien n’y a fait, par bonheur. Balzac a gagné son procès devant la postérité, comme il l’avait gagné devant ses juges.
L’édition définitive de ses œuvres complètes a dû entraîner la suppression d’un assez grand nombre de ses préfaces, que je regrette. Écrites au courant de la plume, sous l’action des évènements du dehors ou sous la pression d’un sentiment individuel, quelques-unes de ces préfaces ouvraient des jours soudains sur l’homme, – entre autres celle de la première édition de David Séchard, devenu plus tard Ève et David. On y lisait une apostrophe aux députés, motivée par une séance du mois de juin 1843, dans laquelle la Chambre avait été saisie en langue auvergnate de la question du plus ou moins de moralité des Mystères de Paris.
L’accent de Balzac est celui d’un juste orgueil et d’une légitime indignation.
Écoutez-le :
« Si tant de stupides accusations ne se renouvelaient pas chaque jour et ne trouvaient pas de dignes et vertueux bourgeois assez peu instruits pour les porter à la tribune et à la face du pays, l’auteur se serait bien volontiers dispensé d’écrire cette préface… Il faut que les quatre cents législateurs dont jouit la France sachent que la littérature est au-dessus d’eux ; que la Terreur, que Napoléon, que Louis XIV, que les pouvoirs les plus violents comme les institutions les plus fortes disparaissent devant l’écrivain qui se fait la voix de son siècle. Ce fait-là s’appelle Tacite, s’appelle Luther, s’appelle Calvin, s’appelle Voltaire, Jean-Jacques, il s’appelle Chateaubriand, Benjamin Constant, Staël ; il s’appelle aujourd’hui JOURNAL…
Ces quelques mots sont une réponse suffisante aux législateurs qui, à propos de quelques pièces de cent sous, se sont amusés à juger du haut de la tribune des livres qu’ils ne comprenaient pas, et à passer de l’état de législateur à celui infiniment plus amusant d’académicien. »
Il a été écrit des choses bien singulières sur l’auteur de la Comédie humaine, mais il n’en a pas été écrit de plus singulières que par Lamartine dans son volume intitulé : Balzac et ses œuvres, – un de ces livres à coups de ciseaux comme le besoin lui en faisait faire sur la fin de ses jours.
Le grand poète ne comprend rien aux choses dont il parle. Il semble n’avoir pas plus connu Balzac que ses œuvres, bien qu’il se livre à un portrait minutieux de sa personne. Mais ce portrait est le comble du grotesque et de l’inexactitude. « Son nez était bien modelé, quoique un peu long. » Or, qui ne sait que Balzac avait le nez gros et carré du bout ? Cela n’est rien ; Lamartine va nous montrer encore ses dents inégales, ébréchées, noircies par la fumée de cigare. Vraiment, c’est jouer de malheur ; Balzac était aussi fier de ses dents blanches que de ses mains blanches. De plus, jamais un cigare n’avait approché de ses lèvres. Il avait le tabac en horreur.
Des œuvres de Balzac, Lamartine n’en connaît que trois : Eugénie Grandet, le Père Goriot, le Lys dans laVallée ; cela lui suffit ; il y a pratiqué de larges emprunts qui remplissent les sept huitièmes de son volume.
Buloz. – Le mari d’une étoile. – Un ami dans une armoire.
J’ai nommé tout à l’heure M. Buloz. J’y reviens.
Trois ou quatre mois après mon arrivée à Paris, M. Buloz, qui avait lu quelques-uns de mes vers dans l’Artiste et dans le feuilleton de l’Époque, me fit demander par l’imprimeur Gerdès. C’était à l’époque où les bureaux de la Revue des Deux-Mondes étaient situés dans la tranquille rue Saint-Benoît, au fond d’un petit jardin.
M. Buloz me commanda plusieurs articles qui, exécutés, ne lui plurent point. Je me lassai. Nos relations en restèrent là.
À ne pas écrire dans la Revue des Deux-Mondes, j’ai perdu sans doute quelque prestige, mais ma bonne humeur y a peut-être gagné. J’ai pu développer dans d’autres milieux des qualités de gaieté qui auraient été absolument étouffées sous l’uniforme gris qu’on faisait autrefois endosser à tout débutant dans la Revue.
M. Buloz, que j’ai souvent vu depuis, n’avait rien de séduisant au premier aspect, – ni même au second. Il était borgne et sourd. C’était un homme de haute taille, mais voûté, d’une charpente à toute épreuve ; un de ses coups de poing aurait été terrible (il en a donné quelquefois, à ce qu’on raconte dans les imprimeries). L’expression générale de sa physionomie était sombre, rude, inquiète. Sa voix était un grognement perpétuel. Il avait des hein qui faisaient rentrer sous terre les nouveaux venus et qui causaient des tressaillements à son secrétaire sensitive, M. de Mars.
Comment, avec de telles manières et avec une intelligence littéraire qui était loin de se révéler de prime abord, comment un pareil personnage parvint-il à enrégimenter les meilleurs et les plus célèbres écrivains de son époque ? C’est ce que je m’explique difficilement. Il est venu à temps ; il a été le premier et le seul. Il a eu de la ténacité et de l’esprit de suite. Mais il aurait tout aussi bien réussi dans la bonneterie ou dans la quincaillerie.
Quelques-uns de ces écrivains, il est vrai, se sont offusqués au bout de quelque temps. Balzac, le premier, a levé l’étendard de la révolte, – ainsi que je l’ai raconté, – il ne voulait pas être traité à la russe, et il gagna contre Buloz ce procès que Buloz ne devait jamais lui pardonner, car l’irascibilité était un des principaux défauts de celui qu’on appelait déjà l’autocrate de la Revue des Deux-Monde.
Plus tard, Alexandre Dumas, Philarète Chasles. Sainte-Beuve, Pontmartin se sont dérobés tour à tour à ce despotisme sans élévation.
Voici l’opinion de l’auteur des Odeurs de Paris sur François Buloz :
« M. Buloz inspire, dirige, corrige, rature, modifie les matadors de l’esprit contemporain ; et les plus fiers ne sont ou n’ont été que les truchements de sa pensée. Or, M. Buloz n’a pas de pensée ! Et voilà quarante ans tout à l’heure que cela dure. »
On s’est quelquefois moqué de ce Croquemitaine.
Écoutez Théodore de Banville, – qui n’a jamais écrit à la Revue des Deux-Mondes, écoutez-le fredonner la Villanelle de Buloz dans un coin des Odes funambulesques :
Limayrac était le plus petit des rédacteurs de Buloz. Tant qu’on se contentait de le chansonner, Buloz laissait faire ; mais il n’entendait pas raillerie dès qu’on allait plus loin.
Il fit condamner Barbey d’Aurevilly pour deux articles, qui d’ailleurs ne laissaient rien à désirer sous le rapport de l’empoignement. C’était radieux d’impertinence. On sait avec quelle désinvolture l’auteur des Diaboliques, dès qu’il a retroussé ses manchettes, s’entend à administrer une raclée à ses adversaires. Buloz se frotta longtemps les épaules.
Si affairé et si homme du Danube qu’il fût, M. Buloz avait un salon ; il recevait, il donnait des dîners quelquefois. Ces jours-là, il s’essayait à faire le beau.
« J’étais à souper chez Buloz le jour des Rois, – écrivait Alfred de Musset à son frère en 1843 ; – toute la Revue s’y trouvait, plus Rachel. C’était un peu froid ; on aurait dit un dîner diplomatique. Le hasard facétieux a donné la fève à Henri Heine, qui a fait semblant de ne pas savoir ce qu’on lui voulait, de sorte que le gâteau, sur lequel la maîtresse de la maison devait compter pour égayer la soirée, a été pour le roi de Prusse. Heureusement, Chaudes-Aigues s’est grisé, ce qui a rompu la glace. »
Musset était le Benjamin de Buloz, qui lui passait bien des choses.
Théophile Gautier avait aussi le pouvoir de le dérider par ses propos de haute graisse. Ce qui n’empêcha pas Buloz de lui réclamer par voie judiciaire le Capitaine Fracasse, – que l’indolent Théo lui avait promis depuis dix ans et sur lequel il avait touché trois mille francs.
– Rendez l’argent, au moins ! lui criait l’implacable Savoisien.
De Marseille, où il se trouvait alors, le banquier Mirès entendit cette grosse voix, et il écrivit immédiatement à son caissier de Paris ce billet, pour lequel il lui sera beaucoup pardonné, et qui mérite de transmettre son nom aux âges les plus lointains :
« Tirez Gautier des griffes de Buloz ! »
Ce qui fut fait.
Lors de mes premières années de séjour à Paris, un ami m’emmena dîner dans une table d’hôte d’une maison meublée de l’ancienne rue Copeau, aujourd’hui rue Lacépède. Un quartier lointain et pétrifié, où l’herbe poussait, où le roulement d’une voiture était un évènement, où les maisons avaient de lourdes portes cochères et pas de magasins, où l’on voyait aux fenêtres de petites vitres d’un ton verdâtre et des rideaux trop courts, – la province au fond de Paris.
La clientèle de cette table d’hôte était souverainement triste et composée de vieilles gens des deux sexes, parmi lesquels s’étaient égarés quelques étudiants en médecine. Celui qui m’avait amené me dit à l’oreille d’examiner, à un bout de la table, un monsieur d’un aspect assez froid et qui gardait le silence.
– Eh bien ! demandai-je, qui est ce personnage ?
– C’est le mari d’une femme illustre, de la première romancière du dix-neuvième siècle.
– George Sand !
– Juste. Il s’appelle le baron Dudevant et vit séparé d’elle depuis quelques années…
Pendant tout le reste du dîner, mes yeux ne quittèrent pas ce taciturne pensionnaire qui semblait être étranger à tout le monde. Depuis, je ne l’ai jamais revu ; mais cette figure soucieuse m’a toujours poursuivi.
L’étrange ménage ! Tant de rayonnement d’un côté et tant de ténèbres de l’autre ! Ce pseudonyme si glorieux et ce nom si bourgeois !
Mademoiselle Aurore Dupin avait à peine dix-huit ans lorsqu’on la maria à François-Casimir Dudevant, fils du baron Dudevant. Elle avait été élevée à la garçonnière, galopant à cheval seule par la campagne. Le mariage, ce mariage-là du moins, ne devait rien changer à ses habitudes ; son époux était un propriétaire actif, un agriculteur entendu, une nature de fermier. Bel homme, d’ailleurs ; elle dit quelque part, en parlant de son fils Maurice : « Il est leste comme son père. »
M. Dudevant parait avoir pris à tâche, pendant les premières années, de faire le bonheur de sa jeune femme, et, d’après la Correspondance de George Sand, on peut croire qu’il y a réussi. Ce ne sont que voyages luxueux, excursions dans les Pyrénées, carnaval passé à Bordeaux, etc. etc.
La vie à Nohant avait aussi son attrait et sa poésie. M. Dudevant s’y montre sous un jour qui ne lui est pas défavorable. « Casimir est très occupé de sa moisson. Il a adopté une manière de faire battre le blé qui termine en trois semaines les travaux de cinq à six mois. Aussi il sue sang et eau. Il est en blouse, le râteau à la main, dès le point du jour. »
Aurore avait donné deux enfants à son mari, deux superbes enfants, une fille et un fils, Solange et Maurice. Elle les chérissait ; M. Dudevant ne les adorait pas moins. Par quoi donc devaient être désunis les deux époux ?
Chacun d’eux a reproché à l’autre son caractère.
M’est avis, pour parler le langage des villageois, que la petite dame ne devait point être commode tous les jours, et que ses allures indépendantes étaient un peu faites pour détonner dans une zone départementale.
Pourtant ce ne fut point M. Dudevant qui parla le premier de rupture et de séparation, d’abord amiable. Les premières déclarations de guerre vinrent d’elle. On était en 1830. Elle avait supporté le joug du mariage pendant huit ans.
Elle demanda sa liberté, se réservant le droit d’habiter tantôt Paris et tantôt Nohant ; cela lui constitua une existence en partie double, et doublement désagréable pour l’époux, qui eut le tort d’y consentir.
J’ignore quels ont pu être les torts de M. Dudevant, mais il en a été terriblement puni par la réputation de sa femme, de 1831 à 1835. La petite écuyère qu’il avait épousée était devenue l’auteur excentrique d’Indiana ; tous les jours, on lui apprenait une de ses frasques nouvelles ; elle s’habillait en homme et fumait ; elle vivait dans un milieu de républicains comme Félix Pyat, de pianistes comme Liszt, de prêtres comme Lamennais. Elle partait avec Alfred de Musset pour l’Italie et y demeurait une année entière.
Puis, elle s’en revenait tranquillement à Nohant, où elle trouvait son mari faisant sa moisson. Elle se couchait quand il se levait, rentrait après minuit, en revenant de chez le Malgache.
Doit-on s’étonner outre mesure si la patience a pu quelquefois échapper à M. Dudevant ? Quel tempérament, si angélique qu’il fût, aurait résisté à pareil spectacle ?
Bientôt cette vie leur fut intolérable à tous les deux ; les tribunaux furent saisis de leur demande en séparation. Elle fut prononcée en 1836.
Si vous avez visité, en ces dernières années, l’exposition de Gustave Courbet, au palais des Beaux-Arts, vous y aurez remarqué un portrait qui revient plusieurs fois.
C’est celui d’un homme barbu offrant une vague ressemblance avec Michel-Ange. Il figure tantôt dans l’atelier du peintre, immense toile qualifiée d’Allégorie réelle sur le livret ; d’autres fois, seul, lisant un volume ou feuilletant un carton à estampes. Peu de personnes, excepté les premiers amis de Courbet, – dont je faisais partie, – pourraient mettre un nom au-dessous de cet individu.
Ce nom était aussi étrange que l’homme. Il s’appelait Marc Trapadoux et était de très haute taille. Avait-il une profession ? nous l’ignorions. Peut-être jouissait-il de quelques petits revenus ou donnait-il des leçons de quelque chose en ville. Toutefois est-il que nous le voyions assidûment le soir au café Momus, et plus tard au cabaret-restaurant de Perrin, place Saint-Sulpice, et plus tard encore à la brasserie Andler, rue Hautefeuille.
Trapadoux recherchait notre entretien ; mais il était d’un naturel sérieux et allait de préférence à Jean Wallon, notre philosophe, et à Baudelaire. Murger, qui l’avait surnommé le géant vert, lui semblait trop superficiel, et il redoutait les plaisanteries de Champfleury. Charles Barbara (le Barbemuche des Scènes de la Bohême) l’attirait par son mutisme énigmatique ; mais Barbara avait peur de lui et se contentait de l’étudier à distance.
À ces divers contacts, Marc Trapadoux avait gagné une horrible méfiance. Elle était poussée si loin que lorsque je lui demandais
– Comment vous portez-vous ?
Il me répondait en me regardant fixement :
– Pourquoi me faites-vous cette question ?
Baudelaire seul avait su capter sa confiance ; c’était à ce point qu’une nuit, comme ils se trouvaient engagés tous deux dans une conversation d’esthétique sur le boulevard Montparnasse, un orage étant survenu, Marc Trapadoux offrit à l’auteur des Fleurs du mal l’hospitalité chez lui. Or, jusqu’à ce moment, Trapadoux avait mis un soin extrême à laisser ignorer son domicile.
Si Trapadoux était mystérieux, Baudelaire était curieux. Il accepta avec empressement. Il allait donc savoir où perchait le géant vert !
On s’arrêta devant une maison isolée, sans concierge ; Trapadoux tira de sa poche une clef qui rappelait par ses dimensions les clefs de la Bastille. On monta dans les ténèbres plusieurs étages, au bout desquels on arriva dans une chambre de modeste apparence.
– Tenez, couchez-vous là, dit Trapadoux à Baudelaire en lui désignant un lit en fer.
– Eh bien ! et vous ?
– Oh ! ne vous inquiétez pas de moi… couchez-vous, vous dis-je.
Baudelaire se jeta tout habillé sur l’unique lit, mais il ne s’endormit pas tout de suite. Il guettait du coin de l’œil les mouvements de son hôte, qui allait et venait dans la chambre, tantôt fumait une pipe et tantôt jouait avec des haltères menaçants.
Une heure s’écoula ainsi.
Lorsque Trapadoux crut Baudelaire endormi, il ouvrit une grande et haute armoire, dans laquelle il entra et disparut, et dont il referma la porte sur lui.
Baudelaire était resté stupéfait. Il s’attendait à le voir reparaître d’un instant à l’autre, mais inutilement. Alors, il supposa que cette armoire n’était qu’une porte dissimulée, donnant sur un autre corps de logis.
Il dormit mal et peu. Au point du jour, voulant éclaircir ses doutes, il appela Trapadoux à haute voix.
La porte de l’armoire s’ouvrit et montra Trapadoux assis sur une chaise, grave comme à son habitude. Il avait passé la nuit dans l’attitude d’un marchand de journaux dans son kiosque.
Un mot encore sur cet excentrique :
J’ai dit que nous ignorions son état, mais nous le soupçonnions véhémentement de littérature. Nous ne nous trompions pas.
Un matin, Wallon arriva en brandissant triomphalement un volume qu’il venait de dénicher sur les quais, où il passait les trois quarts de son temps.
Ce volume avait pour titre : « Histoire de Saint-Jean-de-Dieu, par Marc Trapadoux. »
À partir de ce jour, Trapadoux ne reparut plus parmi nous.
Le baron Taylor ratant son enterrement. – Méry et le petit bossu. – Une rue de Boulogne-sur-Mer.
Le baron Taylor, je me ferais tuer pour lui ! s’écriait un obscur figurant du théâtre de la Porte-Saint-Martin.
Sa vie est des plus connues ; elle s’est toujours passée au grand jour. S’il a travaillé pour lui dans les premières années, il s’est mis bien vite à travailler pour les autres. Rédacteur des Voyages pittoresques dans l’ancienne France, il a donné de l’ouvrage à Bonnington, à Géricault, à Michalon, à Dauzats, à Ciceri, qui étaient des jeunes alors, et qui ont exécuté sous sa direction des lithographies remarquables et très recherchées aujourd’hui, celles de Bonnington particulièrement.
Commissaire royal à la Comédie française, son premier acte a été d’en ouvrir les portes à l’école romantique. De cette période aussi date sa sollicitude pour les comédiens. Il les protégeait, les encourageait et personnellement savait les défendre.
« Pour l’amour de Dieu, écrivait-il à Charles Maurice, le journaliste de théâtre, dites du bien des acteurs, c’est tout ce que je vous demande ! Ils sont déjà assez malheureux d’être jetés hors de la société par des imbéciles, sans encourir encore votre haine ; mais non, ce n’est pas votre haine, ce sont vos traits seulement, je le sais, c’est le trop plein de votre esprit. Eh bien ! oui, ami, j’entends tout cela, mais enfin ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient faire (dans la Reine d’Espagne, de Delatouche) ; soyez un peu aimable pour eux… Revenez le plus tôt que vous pourrez sur Samson, je vous en prie. Je vous le présenterai l’un de ces matins. »
C’est d’un brave homme cette lettre. Lorsqu’il n’eut plus à protéger les comédiens et les auteurs, lorsqu’il ne lui fut plus possible de fournir du travail aux dessinateurs, le baron Taylor s’occupa de les grouper. Il fonda les cinq grandes associations qui feront vivre son nom éternellement.
Une idée bien simple, pourtant !
J’ai connu Taylor dans son appartement de la rue de Bondy. La maison, haute, sévère, solennelle, était digne de lui ; l’escalier rempli de statues, de bustes, de fragments antiques, annonçait le voyageur et l’archéologue. On sonnait. Un domestique vous introduisait dans une antichambre donnant sur une immense bibliothèque, rangée avec un ordre parfait, tenue avec un soin minutieux. Cette bibliothèque, une des plus belles au point de vue de l’art dramatique, une des plus riches en éditions originales, était un de ses orgueils et son luxe unique. On comprend sa douleur lorsque, après la révolution de 1848, il fut forcé d’en vendre la moitié.
Dire que le baron Taylor était accessible à tous, même aux plus petits, ce n’est pas dire assez. Quelque chose qu’on eût à lui demander, on était toujours certain de sortir de chez lui satisfait. Personne n’était plus heureux de rendre un service. Et lorsqu’il y avait urgence, il bondissait de joie. – Je l’ai vu, toute affaire cessante, envoyer chercher un fiacre, y monter avec un visiteur nécessiteux, se faire conduire de ministère en ministère, et ne reprendre haleine qu’après avoir mis trois ou quatre billets de banque de cent francs dans la main de ce visiteur.
Taylor a poussé la philanthropie jusqu’à la furia. Il en a fait son idée fixe, son objectif de toutes les minutes. Vincent de Paul et M. de Montyon ont été dépassés. On n’a pas obligé son prochain avec un entrain plus persistant.
Certains esprits gouailleurs ont dit de lui : « C’est un homme qui veut avoir un bel enterrement ! » Possible. Une telle ambition, d’une étrangeté si exceptionnelle, n’est pas à la portée du premier venu. Pourtant, par une circonstance fortuite (un temps exécrable), il ne l’a pas eu, ce bel enterrement qu’il avait pu rêver, à force d’en suivre et d’en conduire.
Que de morts, en effet, plus ou moins illustres, il a accompagnés, le pauvre baron Taylor ! La savait-il assez, cette route du Père-Lachaise, et aussi cette route du cimetière Montmartre, et la route du cimetière Montparnasse ! Dès qu’une célébrité de la plume ou du pinceau, du barreau ou de la tribune prenait cette triste route-là, dès que le char funèbre s’ébranlait, le baron Taylor se trouvait tout désigné par l’opinion publique pour obtenir un des glands du cercueil. Et cette même opinion publique ne le laissait pas quitte à si bon marché ; elle exigeait davantage encore ; elle voulait qu’après avoir escorté le cercueil il prit la parole sur la fosse. Aussi, que d’oraisons funèbres il a prononcées ! On en établirait difficilement le nombre. Douloureuse spécialité, qui aurait fini par donner le vertige à de moins robustes que lui, et à laquelle il s’était plié et résigné depuis plus de cinquante ans !
Par une de ces ironies auxquelles se plaît le destin, le baron Taylor était aussi indispensable dans les banquets que dans les funérailles. Le même habit noir lui servait pour les cimetières et pour les restaurants. Les cinq associations festinaient fréquemment, et naturellement la présence de leur fondateur était obligatoire. L’excellent baron en avait pris son parti, comme des obsèques. Là aussi, il était obligé d’y « aller de son discours ». Et il y allait bravement, courageusement, ne ménageant pas sur l’étendue. Une fois lancé, il se prodiguait. Ceux qui l’ont entendu se rappellent cette éloquence familière, cette bienveillance parlée, ce flot d’anecdotes. Il lui arrivait souvent de forcer son organe, et il arrivait à de bizarres effets de voix de tête.
Une de ses péroraisons dont je me souviens fut celle-ci, prononcée à une réunion d’artistes dramatiques.
Il les avait longuement entretenus de leur profession ; puis, comme pour les rehausser à leurs propres yeux, il leur lança sur le mode aigu cette phrase triomphale ; « Et surtout, messieurs, n’oubliez pas qu’un des vôtres, Scaramouche, est enterré à Saint-Eustache ! ! ! »
L’effet fut inouï.
Les joueurs ont toujours été nombreux parmi les gens de lettres, – depuis Rotrou jusqu’à Méry.
Méry passait régulièrement tous ses étés à Bade, au temps de la Maison de Conversation.
On sait ce que conversation voulait dire dans le style allemand d’alors.
C’est là que je le connus et que nous devînmes amis.
Méry était joueur comme le Valère de Regnard, comme le Béverley de Saurin, comme le Robert le Diable de Meyerbeer.
Et c’était chez lui une passion d’autant plus malheureuse que, de mémoire de joueur, Méry n’avait jamais gagné.
Jamais !
Comme tous les joueurs il était superstitieux et croyait aux fétiches, aux talismans, aux gens qui portent bonheur ou malheur.
Or, il y avait alors à Bade un petit bossu d’une cinquantaine d’années.
C’était un banquier de Francfort qui s’appelait Meyer, autant qu’il m’en souvienne. Mais son nom importe peu. Je ne sais qui est-ce qui avait persuadé à Méry que les bossus étaient d’excellents fétiches, – et qu’il suffisait de toucher leur bosse pour se trouver immédiatement en relations avec la fortune.
Cette idée s’empara tellement de son esprit qu’il se mit à tourner sans relâche auprès du bossu. Il commença par se faire présenter à lui ; mais celui-ci, méfiant comme tous les bossus, le reçut très froidement.
Méry ne se rebuta pas ; il le guettait tous les jours dans les salons de jeu ; il essayait de se frotter à lui sous le moindre prétexte ; il le heurtait en s’excusant ; – et, dans ses excuses gesticulées, sa main essayait toujours de s’aventurer sur la bosse aux œufs d’or.
Le petit banquier de Francfort ne tarda pas à s’apercevoir de ce manège, dont la cause lui échappait ; – et dès lors il s’appliqua à éviter Méry avec le même soin que Méry mettait à le rencontrer.
Il n’y réussissait pas toujours, car Méry avait la ténacité et la ruse du chasseur. Rien n’était plus comique pour les initiés que ces deux hommes courant de salon en salon…
Ceux qui se rappellent combien l’auteur d’Héva était myope comprendront qu’il n’apportât aucune discrétion dans sa poursuite.
Un jour que Méry avait perdu au trente-et-quarante une somme plus forte que d’habitude, il vint à moi d’un air abattu, et me dit :
– C’est singulier ! J’ai pourtant touché deux fois ce matin la bosse du banquier.
– Vous en êtes bien sûr ?
– Parbleu !
– Peut-être ne suffit-il pas de la toucher comme vous faites, ajoutai-je.
– Que voulez-vous dire ?
– Il faut sans doute la toucher à nu.
Méry me regarda avec stupeur. J’avais toutes les peines du monde à garder mon sérieux.
– Vous croyez ? dit-il.
– Assurément. Le vêtement est un mauvais conducteur de chance.
– Vous avez peut-être raison, reprit-il en devenant rêveur ; mais comment arriver à ce but que vous m’indiquez ? Cela me paraît assez difficile.
– J’en conviens.
– Et très délicat.
– Oh ! fort délicat, en effet.
– Si ce bossu était un pauvre diable, nul doute qu’il ne consentit… Mais un banquier ! murmura Méry.
– Et un banquier de Francfort !
– Il y aurait lieu de s’attendre à un refus.
– Je le crains.
– Il faudrait procéder par surprise, continua Méry, comme en se parlant à lui-même ; oui, j’y réfléchirai… Merci de m’avoir éclairé… Évidemment, le talisman doit être touché à nu pour opérer.
Et il s’éloigna, en proie à une grande préoccupation.
Je ne le revis pas de vingt-quatre heures.
Le surlendemain, à la chute du jour, je me promenais solitairement au bord de l’Oos, – ce Mançanarès badois, – lorsque mes yeux furent attirés par un groupe de gens animés à quelques pas de moi. On venait de retirer de l’eau un individu qui s’y était laissé choir par mégarde, – disait-on, – et qui d’ailleurs ne s’était fait aucun mal. À peine avait-il éprouvé un étourdissement de quelques minutes.
On l’avait déposé fort proprement sur le gazon ; et, pour le faire sécher, on l’avait dépouillé de son habit et de son gilet, comme cela se pratique en pareil cas.
Je jetai un coup d’œil sur ce maladroit ; quelle fut ma surprise en reconnaissant le petit bossu de Francfort !
Revenu à lui, il se débattait au milieu des gens qui lui prodiguaient leurs soins…
Car, parmi ceux-là, auprès de lui, et le plus empressé de tous, était Méry, criant, s’agitant, – Méry, qui lui avait déchiré sa chemise à la hauteur des omoplates, et qui lui frottait énergiquement sa bosse à nu, pour le ranimer, disait-il.
Le lendemain matin, le petit bossu quittait Bade par le premier train du chemin de fer.
Et Méry continua de perdre au jeu, comme par le passé.
La ville de Boulogne-sur-Mer a fait une bonne et juste action : elle a donné à l’une de ses rues le nom de Jules Lecomte, un de ses enfants. Jules Lecomte n’est certainement pas un écrivain du premier ordre, mais il fut un des créateurs de la chronique parisienne, cette chose devenue indispensable aux lecteurs d’aujourd’hui. Il avait une imagination intarissable, une mémoire prodigieuse, un esprit essentiellement français. Il a donné des preuves de tous ces dons dans l’Indépendance belge et dans le Monde illustré, deux journaux à la fortune desquels il a puissamment contribué.
Lors de sa première manière (il avait commencé à écrire de très bonne heure), Jules Lecomte avait donné dans le roman maritime, qu’Eugène Sue et Édouard Corbière venaient de mettre à la mode. Il publia à vingt et un ans l’Abordage, qu’il faisait suivre bientôt de l’Île de la Tortue, de Bras de Fer, du Capitaine Sabord, de la Femme pirate, etc. etc., tous livres qui portent la marque excessivement colorée de la période romantique. Il était en train de faire son chemin parmi les romanciers, et son nom était déjà célèbre dans les cabinets de lecture, lorsqu’un incident aussi néfaste qu’imprévu vint brusquement interrompre sa carrière.
Jules Lecomte était jeune, il fut étourdi ; il le fut jusqu’à l’excès, jusqu’à la faute. Je ne suis pas ici pour rien masquer. L’heure est passée des convenances dues à un vivant, qui a d’ailleurs rudement expié une inconcevable minute d’égarement. Une affaire de billet commercial le mena en justice. Il aurait été facile et de la plus simple humanité de ne pas pousser les choses aussi loin ; les intéressés avaient été priés et suppliés avant le procès, et indemnisés, cela va sans dire. Rien n’y fit. Léon Gozlan m’a dit plus tard qu’il y « avait une femme là-dessous ». Cela ne justifie rien, mais cela explique tout. On voulait perdre Jules Lecomte, on le perdit. On le condamna à la prison, lui, le jeune homme ; lui, le littérateur déjà apprécié. On fut impitoyable, plus qu’impitoyable, on fut aveugle. La légalité, qui a d’inexplicables indulgences, a aussi d’inexplicables rigueurs. Jules Lecomte fut victime d’une de ces rigueurs-là.
Il dut s’expatrier pour purger sa contumace. Il alla vivre en Italie. Alors commença pour lui une existence difficile et romanesque dont il n’a jamais livré la clef, même à ses intimes. Il était moins que riche ; on a prétendu qu’il avait chanté l’opéra sous le nom de Volberg ; on s’est basé sur un de ses romans d’alors, devenu très rare aujourd’hui : Aventures galantes d’un ténor italien (Souverain, éditeur ; 2 vol. in-8).
Ce qui est plus certain, c’est qu’il eut des rapports avec la duchesse de Parme, veuve de Napoléon Ier, dont il a écrit l’histoire. D’autres ouvrages datent de cette époque tourmentée ; je dis tourmentée, parce qu’il bénéficia rarement de son exil. Toujours, au moment où il s’y attendait le moins, se dressait devant lui cette fatale condamnation ; tantôt c’était une gazette locale, informée par ses actifs ennemis de Paris, qui la lui jetait au visage ; tantôt même c’était d’un compatriote rencontré (Alexandre Dumas, par exemple) que lui venaient des preuves manifestes d’inimitié ou du moins d’antipathie. À cette existence pénible Jules Lecomte acquit cette fâcheuse allure cassante et nerveuse qui depuis ne le quitta jamais, même en des jours plus heureux, et qui devait ajouter de nouvelles hostilités aux anciennes.