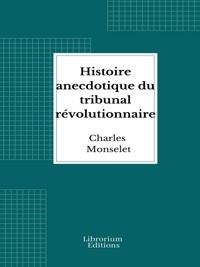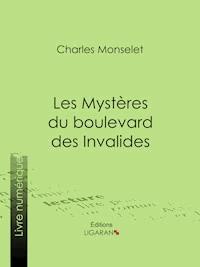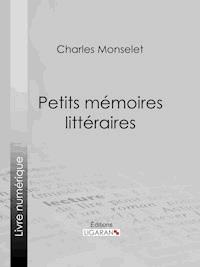Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "ABOUT (Edmond). — De l'esprit, de l'activité et du bonheur. Un type essentiellement parisien. Grâce à une polémique qui a dépassé le but, le bruit de Tolla est devenu presque un succès. Dans Les Mariages de Paris il y a un courant d'observation moderne bien suivi ; mais quelquefois aussi c'est commun, inutile, terminé à la hâte. Trop de chemisiers cités, du dilettantisme à tout prix..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335076431
©Ligaran 2015
Il y avait, l’autre soir, comme disent les gazettes, une foule nombreuse et choisie dans la salle de la rue des Bons-Enfants, ancienne maison Silvestre. Tout le Paris littéraire (autre cliché à l’usage des feuilletons) s’y était donné rendez-vous. Ce n’était point cependant de livres qu’il s’agissait. Une vente d’une nature plus originale et plus intime avait appelé là les coloristes, les réalistes, les fantaisistes et même quelques timides adeptes de l’école du bon-sens. Ces derniers portaient un coq gaulois brodé sur la manche, en signe de ralliement.
On vendait, – du libre consentement de la plupart des gens de lettres, et pour cause du décès de quelques autres, – on vendait, dis-je, un nombre assez considérable de formules littéraires, de tropes, d’aphorismes, de périphrases artistiques, le tout en très bon état. Un commissaire-priseur assistait à la vente, et l’on payait cinq centimes par franc en sus du prix de l’adjudication.
On n’avait pas distribué de catalogue ; cela explique les omissions que l’on pourra remarquer dans notre relation.
Vers huit heures, avant que la salle fût entièrement remplie, on a commencé par mettre sur table, en guise de lever de rideau, un lot de métaphores du temps du Directoire et de la Restauration, ayant appartenu tour-à-tour à François de Neufchâteau, à Ginguené, à Edmond Géraud, etc.
Il s’est présenté peu d’acquéreurs. Néanmoins « Deux globes arrondis par la main des Grâces, » provenant de la succession de M. de Jouy, ont été adjugés à M. A. de Pontmartin.
« Un site romantique, – Une magique ivresse, – Un délire amoureux, » après avoir été vivement disputés par MM. Lesguillon et Hippolyte Lucas, ont été livrés à ce dernier.
M. Rolle a acquis « Un demi-jour favorable aux doux larcins, » trouvé dans les papiers de M. Dupaty.
Enfin, M. A. de Mazade s’est rendu propriétaire d’un « Échafaudage de grands sentiments, » légué par Mme la comtesse de Genlis.
À neuf heures, grâce à l’arrivée de quelques amateurs, la vente a offert une physionomie un peu animée. « L’Écharpe d’Emma, » cédée par M. Émile Deschamps, a été achetée par MM. Des Essarts père et fils. Dès lors, on est entré à pleines voiles dans le romantisme. Les antithèses, les rimes Dante et ardente, les opulences orientales se sont succédées pendant une demi-heure environ. Mais les enchères se sont particulièrement portées sur :
M. Eugène Pelletan, M. Victor de Laprade et M. A. de la Guéronnière se sont fait remarquer par leur acharnement à se disputer ce lot, qui a fini par rester à M. Pelletan. On lui a donné, par-dessus le marché, « Un sourire indéfinissable, » et quelques « Regards semés d’étincelles. » Il était fort content.
Les beaux-arts n’avaient pas fourni un contingent énorme à cette vente d’un nouveau genre. Toutefois, Gustave Planche y a fait l’emplette d’une maxime provenant de la rédaction du vieux Globe : « La figure est le siège des passions. »
On a poussé très chaudement quatre ou cinq paradoxes, que tout fait supposer être sortis de chez M. Léon Gozlan, le meilleur faiseur. Deux d’entre eux : « Un bienfait est toujours perdu, » et « Les meilleurs pâtés d’Amiens se font à Strasbourg, » ont été couverts par M. Louis Huart et par M. Julien Lemer, à qui ils sont définitivement restés.
« Long-Champ se meurt ! Long-Champ est mort ! » Il y avait trois concurrents pour cette phrase du dernier Ermite de la Chaussée-d’Antin : M. Eugène Guinot, M. Amédée Achard et M. Edmond Texier. C’est M. Achard qui, avec sa pétulance habituelle, l’a emporté sur ses rivaux. Rien ne saurait rendre le désespoir de M. Edmond Texier ; on lui a donné, par manière de consolation : « La poésie s’en va ! » Il a paru se calmer.
À dix heures, la vente s’est sensiblement ralentie, et même plusieurs lots sont demeurés sans acquéreurs. Ce sont :
Quelques « flammes éparses et hautes » échappées du cabinet de M. Sainte-Beuve.
Une Cuisine remplie de latin, – à M. Jules Janin.
Un « Éléphant bleu, » cadeau de M. Méry.
Les auteurs dramatiques se sont montrés plus accommodants à l’endroit des expressions qui leur ont été offertes. Ainsi, il a suffi d’annoncer : « Oh ! ce signal n’arrivera donc pas ! » pour le voir enlever immédiatement par M. Raymond Deslandes, jeune débutant dans la carrière illustrée par MM. Dennery et Colliot.
Une rage véritable a signalé l’enlèvement de : « Si c’est un songe, mon Dieu ! faites que je ne m’éveille pas ! » M. Jules Barbier a proposé de diviser cette gracieuse image en deux lots : le lot en prose et le lot en vers. Sur le refus du commissaire-priseur, une cotisation s’est formée entre MM. Decourcelles, Lambert Thiboust et Delacour. À eux trois, ils sont devenus ainsi seuls possesseurs de la gracieuse image.
M. de Biéville, qui s’était contenu jusque-là dans de justes bornes, a acheté tout d’un coup et d’un seul bloc, pour les besoins de son compte-rendu hebdomadaire :
« M. un tel a brodé sur ce canevas un peu léger quelque jolis vers…
Le succès n’a pas été un seul instant douteux.
Les directeurs semblent s’être soufflé le mot pour donner le même jour leurs premières représentations. Nous, qui n’avons pas le don d’ubiquité…
Nous reviendrons sur ce drame, riche en situations émouvantes. Contentons-nous, pour aujourd’hui, de constater l’immense succès qu’il obtient sur toute la ligne des boulevards.
À bon entendeur, salut. Nous verrons bien. Francisque jeune a très heureusement tiré parti d’un petit bout de rôle… »
Etc, etc., etc.
Ces dernières acquisitions s’étant prolongées fort tard, la salle a été désertée peu à peu. À onze heures, il ne restait plus que M. de Biéville, qui achetait encore :
« C’est l’erreur d’un homme d’infiniment d’esprit, qui prendra sa revanche. »
Il existe toujours un noyau d’hommes qui se rattachent tant bien que mal à la grande tradition du XVIIe siècle. L’Université, l’Académie française, deux ou trois Revues, le clergé et quelques journaux légitimistes fournissent ces hommes dont l’influence, sinon la valeur, est encore très grande, car ils tiennent en mains l’éducation publique. Ils pèsent sur l’avenir, tout en s’appuyant sur le passé. J’ai nommé l’École classique, dont l’intolérance, pour être sourde, n’en est pas moins active, et contre laquelle nous avons le tort de ne pas nous tenir assez en garde. Je sais bien que la génération à laquelle nous appartenons a échappé en partie à son despotisme étroit ; mais si l’école classique n’a pu asservir les pères, elle tient aujourd’hui les enfants.
Les interrogez-vous quelquefois, vos fils ? vous rendez-vous bien compte de la rhétorique idiote et vieillie à laquelle on les livre ? Peut-être vous imaginez-vous que de temps à autre on prend la peine de les initier aux littératures anglaise, allemande, italienne et espagnole. Vous vous dites : – Sans doute on a fini par briser ce vieux moule dans lequel on me forçait jadis à verser ma pensée. Vous ajoutez encore : – On ne peut pas vivre perpétuellement en marge du progrès ; et nos luttes depuis vingt-cinq années, ces luttes qui durent encore et qui ont bouleversé l’Europe pensante, ces efforts qui ont reconstitué une librairie et un théâtre universels, cet ensemble de travaux, ces triomphes qui ont été la gloire, la seule gloire peut-être du règne de Louis-Philippe, tout cela a dû certainement avoir son écho dans la rue à côté, en dedans des murs du collège voisin !
Là est votre erreur. C’est avec une persistance calculée et froide que l’Université attèle à son éternel sillon la jeunesse du pays. Notez en passant que je ne suis occupé que de la seule question littéraire. Elle lui répète sans cesse : – « Redites ce que les autres ont dit, c’est le moyen de toujours bien dire. On ne peut être un grand écrivain qu’à la condition de ressembler à d’autres grands écrivains. Il y a une série d’expressions adoptées, de métaphores toutes faites, dont vous pouvez vous servir sans crainte, telles que :
Essuyer des malheurs ;
Laver sa faute,
Empoisonner ses jours ;
Étouffer un espoir ;
Éteindre son amour ;
Dévorer l’espace ;
Rallumer sa colère ;
Combattre une idée ;
Un bruit qui transpire ;
Enfanter un projet,
Se faufiler dans une société ;
Nourrir des remords ;
Enchaîner son cœur ;
Tuer le temps ;
Bouillir d’impatience, etc., etc.
Ces expressions, – c’est toujours l’école classique qui parle, – ont servi aux anciens, et les modernes s’en servent continuellement avec succès. Voilà pourquoi nous vous les imposons. Elles sont très hardies, nous n’en disconvenons pas, mais elles sont consacrées ! » C’est-à-dire que vous voudriez, usant de votre droit de poète et d’homme d’imagination, créer de nouvelles métaphores, plus belles et plus justes, que l’école classique crierait aussitôt à l’absurde et à l’impossible. Surtout n’essayez pas de vous approprier les mêmes tropes en y changeant quelque chose ; n’allez pas vous aviser de dire, par exemple : donner à manger à ses remords, au lieu de nourrir ses remords ; se battre en duel avec un dessein au lieu de combattre un dessein. La métaphore ne serait plus alors classique. À quoi tient pourtant une métaphore !
Il est permis de dire : un roc sourcilleux ; cela est même trouvé fort beau, et vous ne sauriez le répéter sans exciter l’approbation des professeurs ; mais il est défendu de dire : les sourcils d’un roc.
On trouvera que nous tombons dans des détails puérils ; c’est vrai ; mais nous voulons exposer le côté ridicule d’une école qui appelle bon goût ce qui exalte le plagiat perpétuel, et met son honneur à ne pas faire un pas en avant ; d’une école de fétichisme et d’orgueil, qui spécule, comme autrefois les gouvernements religieux, sur l’humilité de l’esprit humain. L’école classique n’est que cela.
Elle a résisté à tout, même aux avances de Châteaubriand, l’homme qui était le mieux doué pour l’amener à concession.
Quelques-uns parmi l’école classique, ceux qui sont de bonne foi, croient ingénument suivre le grand courant littéraire ; mais, comme dans les décorations d’opéra, c’est le rivage qui défile devant eux, tandis qu’ils demeurent immobiles. Niais, qui pourraient vivre chaudement dans des habits neufs et qui préfèrent grelotter sous les manteaux de Virgile et d’Ovide ! Stupides, qui veillent auprès des vieux temples au lieu d’aider à en construire de nouveaux !
Des personnes m’ont dit : – Ne publiez pas ce livre.
Tiens !
Je le publie cependant, et pour plusieurs motifs : le premier, c’est qu’il est fait.
Le deuxième, et le troisième, et le quatrième c’est que je le considère comme absolument inoffensif.
Aucun homme de lettres ne se fera sauter la cervelle à cause de ce que j’aurai dit de lui. Je n’ai pas la prétention de croire mes jugements infaillibles. Mon opinion est celle de cette année ; elle se modifiera peut-être l’année prochaine.
On ne songera certainement pas (et l’on fera sagement) à rapprocher ces pages de L’Almanach des grands hommes de Rivarol. Si cependant il arrivait qu’on s’en avisât, on ferait bien de se rappeler que le premier nom raillé dans cet Almanach est celui d’Alibert.
Une statistique semblable n’est jamais complète ; elle aurait l’importance matérielle des tables du Journal de la Librairie et de l’Imprimerie ; elle en aurait aussi l’aridité.
Les petits volumes du genre de celui-ci se recommencent tous les dix ou vingt ans ; ils n’ont et ne peuvent avoir rien de définitif.
Est-ce à dire qu’ils soient complètement inutiles ; je ne le pense pas : ils indiquent, et quelquefois même ils déterminent, en dépit de la volonté souvent très arbitraire de leur auteur, un courant d’idées et de sentiments qu’il importe d’observer.
Ces livres doivent toujours être un peu en avance sur leur temps, au risque de paraître inspirés par un juvénile esprit de coterie ; ils doivent s’arrêter sur les écrivains de demain, plutôt que sur les écrivains d’hier. Un peu de prophétie ne messied pas dans un ouvrage qui n’a que l’éphémère valeur d’un calendrier littéraire.
Aussi serait-on mal venu à chercher ici les noms de Guizot, de Michelet, d’Alexandre Dumas, de Lamartine et de quelques universitaires sur lesquels les jugements semblent épuisés. J’ai fui le point de vue élevé, j’ai ajourné l’appréciation enthousiaste ou sévère. Ce n’est qu’un recensement à vol d’oisillon.
On criera peut-être à la personnalité ; on essaiera de dire que j’ai parfois collé mon œil aux fentes de la vie privée. Bah ! mes révélations ne sont pas bien terribles.
Mais la dignité littéraire ?
Et mes doctrines ?
Ah ! oui, mes doctrines. Au fait, il est peut-être temps que je les expose.
Les voici.
À Jean Riant ! – C’est l’enseigne d’un cabaret situé au bas d’Amiens, au coin de la rue de la Barette et sur le bord de la Somme. À Jean Riant ! Et tout invite à entrer dans cette maison, dont la pierre a été peinte en vert, ainsi que cela se pratique pour la plupart des cabarets du Nord. Du reste, on adore la couleur verte à Amiens, tout le témoigne : la rue du Puits-Vert, la rue des Verts-Moines, la rue des Verts-Aulnois, l’hôtel du Vert-Soufflet.
Au milieu d’un cadre de feuilles vertes, – des feuilles de vigne, naturellement, – un peintre local a représenté le type inconnu de Jean Riant sous les traits d’un énorme compère en manches de chemise, au teint rubicond, aux lèvres entrouvertes, et dont les cheveux hardiment blonds ont cette crêpelure, indice de la passion et de la force. Il élève un verre dans sa main. Au-dessus de cette peinture, qui n’est pas plus naïve qu’il ne faut, on lit cette indication : AMÉDÉE, DÉBITANT.
Mais que m’importe Amédée et son débit ! C’est à Jean Riant seul que je viens rendre hommage.
Quand je m’arrête dans le cabaret de Jean Riant, je monte au premier étage. De la fenêtre je vois la Somme, à qui ses nombreux et hauts peupliers donnent des reflets si verts et si profonds. Ces peupliers font, avec leurs belles feuilles métalliques et luisantes, un tapage continuel : ils s’inquiètent, ils s’étonnent, ils se penchent les uns vers les autres comme pour se consulter ; puis ils éclatent, ils se tourmentent, ils sanglotent ; ils passent en une minute par toutes les gammes du bruit. L’eau les laisse dire, et coule lentement en charriant des légumes. – Garçon ! une bouteille ! Je fais comme Jean Riant ; j’élève mon verre, et je suis heureux. Je ne pense pas, je me contente de la sensation. J’envoie mes yeux se promener tout là-bas, au fond de ces épaisses masses d’arbres qui interrompent l’horizon ; et ils y vont en compagnie de ma rêverie. Comme ils se trouvent bien sous ces allées touffues ! Les nuages, oh tant de gens cherchent leurs idées, m’importent moins : d’abord ils sont si blancs qu’ils me font cligner les paupières ; j’aime mieux les regarder dans la Somme.
Le temps est superbe, mais le vent est un peu fort ; je ne m’en plains pas : cela me rafraîchit le front et disperse mes cheveux. Devant moi un jeune officier pêche à la ligne. La rivière est, par-ci, par-là, un peu abîmée par les teinturiers, qui sont en grand nombre à Amiens. – Au lointain, tout est marais et tourbières ; les cultivateurs vont de l’une à l’autre de leurs maisonnettes dans un bateau étroit et long ; chacune de ces maisonnettes a un potager où resplendissent des tournesols magnifiques, où s’étalent des nappes de cresson qui font frissonner d’aise, des choux énormes avec de larges feuilles (conçoit-on que ces choux-là recèlent un si joli et si tendre petit cœur !) Tout cela est charmant à examiner du cabaret de Jean Riant. C’est la Venise maraîchère.
Je ne parle pas de ces innombrables ponts de bois, – joie du paysage, – non plus que des grandes roues du moulin qui battent l’eau. Il n’y a rien de tel que les environs d’Amiens pour cette variété d’aspects. Quel dommage qu’il n’y vienne pas de vin, n’est-ce pas, Jean Riant ?
Voilà les peupliers d’en face qui font un vacarme prodigieux ; il va pleuvoir. Plus affermis sur leurs troncs, les petits arbres fruitiers des jardins voisins ne bougent pas, eux, et se moquent du vent. Mais, échevelés et flexibles, les acacias se donnent à tous les diables, ils se lamentent, ils se tordent par toutes leurs branches…
Adieu le soleil ! il recule devant le vent et se voile. Pour moi, je ne m’en soucie guère : j’ai le soleil dans le corps, grâce à ma bouteille. À ta santé, Jean Riant, joyeux patron de ce gîte picard, bonne face, grosse santé, belle humeur, Bacchus du peuple ! Que j’aie longtemps pied alerte et longue soif, et je te promets sonores litanies ! – Jean Riant, protégez-nous ! – Jean Riant, étoile du port (en amont), brillez sur nous ! – Éloignez de nous, Jean Riant, les trois plus épouvantables fléaux du monde : la fièvre, la guerre et l’amour ! – Je m’arrête, car il faut des rimes à cette litanie, comme il faut des clochettes d’or à une haquenée de reine ; des rimes qui aient le son et la couleur, la couleur du rubis, le son du cristal. Hélas ! pour oser tenter pareille œuvre, je ne suis encore que Jean Souriant. J’attendrai donc. On peut écrire impunément sur les frontons, sur les livres, sur les socles : aux Muses, aux Grâces, à la Patrie, à la Vertu, à la Beauté, aux Grands hommes, aux Dieux, – mais on n’écrit pas sans pâlir, en tête d’une ode matérialiste, ces trois mots qui illuminent le papier : À Jean Riant !
ABOUT (EDMOND). – De l’esprit, de l’activité et du bonheur. Un type essentiellement parisien. Grâce à une polémique qui a dépassé le but, le bruit de Tolla est devenu presque un succès. Dans Les Mariages de Paris il y a un courant d’observation moderne bien suivi ; mais quelquefois aussi c’est commun, inutile, terminé à la hâte. Trop de chemisiers cités, du dilettantisme à tout prix et de toutes mains, une lithographie d’après Charles de Bernard. Faut-il rappeler le Voyage à l’Exposition universelle des Beaux-Arts ? voilà de la critique d’écureuil ; M. About y fatigue l’attention à force de saillies.
ACHARD (AMÉDÉE). – C’était Grimm avant-hier, c’était Alceste hier ; en fait de pseudonymes on pourrait choisir plus modestement. Il est voué aux Courriers de Paris, comme M. Eugène Guinot, et l’on sent parfois qu’il ronge son frein avec tristesse. Pour se délasser, il écrit des romans où semble passer le souffle de M. Alexandre Dumas. On parle beaucoup dans le monde de ses beaux meubles en bois de boule et de ses consoles du célèbre Rocaille.
ALBY (ERNEST). – Le trompette Escoffier lui doit une heure de célébrité. Bien avant que Henri Heine publiât dans la Revue des Deux-Mondes ses Dieux en exil, M. Alby avait publié dans Le Globe les Dieux de l’Olympe en habit noir. Depuis quelques années, M. Alby est, dit-on, régisseur de la Maison-d’Or.
ALTAROCHE (A). – M. Altaroche a commencé par où les autres finissent, par des chansons. Le Charivari a gardé la mémoire d’une multitude de couplets qui ont été l’émoi, le scandale et la gaîté de leur temps. Entre tous, un chef-d’œuvre que l’on ne connaît pas assez, bien qu’on en parle toujours, c’est la fameuse Complainte sur M. Romieu, dévoré par les hannetons. M. Romieu était alors sous-préfet de Louhans ; plus tard il devint préfet de la Dordogne. Dans la complainte, M. Altaroche le représente, donnant de nouveaux soins à son roman du Mousse ; tout à coup entre précipitamment un garde-champêtre qui lui annonce une invasion de hannetons, ravageant le territoire. M. Romieu fait ses adieux à sa famille :
Je ne cite qu’un fragment ; selon moi, c’est épique. Rappelons encore, – mais n’en parlons pas trop, – son roman des Aventures de Victor Augerol. Après avoir joué un rôle politique, M. Altaroche a obtenu la direction du second Théâtre-Français ; plus récemment, il vient de fonder, avec M. Louis Huart, les Folies-Nouvelles.
ALEMBERT (ALFRED D’). – Un livre sur le Duel, un autre intitulé : Flânerie aux États-Unis, et quelques articles dans les journaux, principalement dans L’Artiste, où il a raconté d’une façon touchante les derniers moments de J. Chaudes-Aigues.
ANCRE (ALFRED D’). – Des cheveux blonds s’épanouissant en soleil autour d’une tête de vingt-cinq ans à peine, des moustaches fines, de la poésie comme s’il en fleurissait ; heureux jeune homme ! M. Alfred d’Ancre en est à son premier volume : Le Printemps de la vie humaine. Le grand mal, si ses vers et sa prose rappellent de temps en temps Alfred de Musset !
ANNE (THÉODORE). – Né en 1797. A appartenu au 16e régiment de chasseurs ; puis a été admis, en 1823, dans les gardes-du-corps du roi. Rédacteur du Drapeau Blanc, sous Martainville ; vaudevilliste ingénieux, feuilletonniste honnête.
ARAGO (ÉTIENNE). – M. E. Arago a composé beaucoup de pièces de théâtre, parmi lesquelles Les Mémoires du Diable ont toujours eu un grand succès. Une comédie en cinq actes et en vers, Les Trois Aristocraties, représentée au Théâtre-Français, a trahi ses prétentions à la haute littérature ; nous préférons ses vaudevilles. C’est un galant homme, selon l’expression favorite de M. Jules Janin.
ANCELOT (VIRGINIE). – « Au moral comme au physique, Virginie Ancelot n’a pas un mérite visible pour tout le monde, et il en faut beaucoup avoir pour sentir tout ce qu’elle en a. Cela vient d’un certain abandon répandu dans toute sa personne ; elle a l’air si désintéressé sur elle-même qu’elle n’appelle pas tout de suite l’intérêt, et, jugée par la distraction, elle ne recueille que l’indulgence. Je doute qu’on l’ait jamais trouvée ni très jolie ni très spirituelle au premier abord ; une sorte de mystère enveloppe tout son être.
Virginie a la tête admirablement bien posée, ses mouvements sont pleins de nonchalance et de grâce. Brune de cheveux, blanche de teint, elle abandonne à ses yeux tout l’honneur de sa figure et ils suffiraient à sa beauté. Modeste et timide, elle laisse quelquefois tomber sur vous ces beaux yeux, dont l’expression est sérieuse et mélancolique, d’une manière si directe et si prolongée qu’une pareille attention vous inquiète et vous charme ; elle ne se doute pas de l’effet de ces longs regards si expressifs à son insu ; ils sont, pour ainsi dire, absents de la personne qui les reçoit ; ce sont des éclairs de ce feu sacrés qu’il faut lui reconnaître, et des préoccupations de sa pensée. »
Mettez au bas de ce portrait la signature de M. A. Malitourne et la date de 1828.
AURIOL (JULES D’). – Qui est-ce qui n’a pas été un peu dans sa vie rédacteur en chef de La Patrie ? M. d’Auriol l’a été et l’est peut-être encore. Sa plume est taillée pour la polémique, et son esprit tourne facilement à l’épigramme. Trente ans et une élégante tenue.
AMPÈRE.– Académicien. Et après ?
Professeur au collège de France. Et après ?
Voyageur. Et après ?
ASSELINEAU (CHARLES). – Parisien. Il s’occupe beaucoup d’art et de bibliographie ; on a de lui des notices, qui sont de véritables découvertes, sur l’ébéniste Boulle, sur le peintre Bruandet, sur le poète Neufgermain. Il a donné une édition nouvelle du Roman bourgeois par Furetière. Ses articles de critique littéraire sont très remarqués ; esprit sain, posé, il fuit les concetti.
AUBERT (CONSTANCE). – Fille de madame la duchesse d’Abrantès. Ses articles de mode font autorité – chez les marchands.
AUBRYET (XAVIER). – La Femme de vingt-cinq ans est un roman exquis ; la petite bête y est chassée avec une ardeur et une curiosité sans égales. Quoique jeune, M. Aubryet a beaucoup vécu – par les nerfs. Il est tourmenté du beau dans l’art, du nouveau dans la poésie, du charmant dans la prose, du moral dans la vie ; ses tentatives indiquent une nature d’élite, quoique un peu tournée vers le pessimisme. Grattez le littérateur, vous trouverez un aimable garçon loyal et spirituel à outrance.
AUDEBRAND (PHILIBERT). – On couvrirait la superficie de la place du Carrousel avec le total prodigieux des écrits de cet homme de lettres. Où sont cependant ses écrits ? où sont ses mille et une nouvelles, ses anecdotes, ses comptes-rendus, tout ce pêle-mêle semé de paillettes ? Ils ont le sort des improvisations ; son auteur les oublie lui-même. M. Philibert Audebrand appartient corps et âme au journalisme quotidien, dont il est depuis quinze ans l’expression la plus vivace et la plus insouciante. On consultera beaucoup son Voyage à travers la petite presse, une des pages les plus piquantes des mémoires littéraires du dix-neuvième siècle.
AUGER (HYPPOLYTE). – Il y a des noms qui ne portent pas bonheur. On sait que l’ancien Auger, l’académicien, le commentateur, s’est noyé. Son homonyme, celui qui nous occupe, sans être réduit à une extrémité aussi fâcheuse, s’est vu quelquefois forcé de vendre ses ouvrages, non pas à des libraires, mais à des écrivains plus en renom que lui. « Je suis en effet l’auteur du roman que M. Alexandre Dumas a publié en France, sous le titre de Fernande, » dit-il dans une lettre adressée récemment à l’éditeur des Contemporains. L’aveu est triste à tous les points de vue. – « Il faut que je vive ! » ajoute avec amertume M. Auger.
AUGIER (ÉMILE). – Celui-ci est heureux autant qu’homme de France ; il est jeune, il se porte bien, il a le fauteuil de Boileau. Deux de ses dernières pièces décèlent un progrès dans sa manière jadis trop bourgeoise : Le Gendre de M. Poirier et Le Mariage d’Olympe