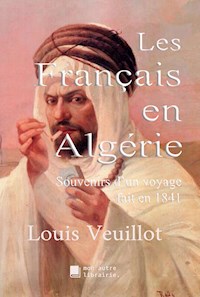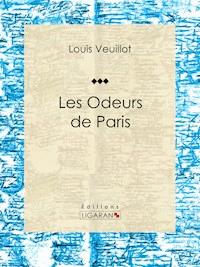
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Paris est un emplacement célèbre, sur lequel se forme une ville encore inachevée. L'on tient que cette ville sera la merveille du monde, le triomphe de la science moderne, matériellement et moralement. Il faut que les habitants y jouissent d'une liberté entière, et demeurent dans le plus grand respect."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335087543
©Ligaran 2015
Paris est un emplacement célèbre, sur lequel se forme une ville encore inachevée.
L’on tient que cette ville sera la merveille du monde, le triomphe de la science moderne, matériellement et moralement. Il faut que les habitant y jouissent d’une liberté entière, et demeurent dans le plus grand respect. Pour résoudre ce problème de toute bonne police, on a voulu d’un côté favoriser la circulation des idées, de l’autre assurer la circulation des régiments. Un système d’égouts très savant, pourvoit à ce double dessein. Les idées qui se trouveraient embarrassées dans les voies ordinaires, ont les journaux, les théâtres, les cafés, et encore d’autres moyens détournés. Quant aux régiments, si la voie était par hasard coupée, ils manœuvreraient aussi bien sous terre, ce qui assure leur avantage. Car les idées de ce temps-ci ne sont pas faites pour tenir tête aux régiments, surtout lorsqu’elles les rencontrent où elles ne les attendaient pas.
Néanmoins, comme il y a aussi beaucoup d’idées dans les égouts, où elles sont attirées par une pente naturelle, et comme rien n’est parfait en ce monde, il ne serait pas impossible, malgré l’abondance des lanternes, qu’un choc eût lieu. L’on pourra voir quelque jour la victoire toute infecte sortir d’un puisard.
Les égouts de Paris méritent qu’il s’y passe quelque chose d’illustre. Des personnes qui ont tout vu disent que ces égouts sont peut-être ce qu’il y a de plus beau dans le monde. La lumière y éclate, la fange y entretient une température douce, on s’y promène en barque, on y chasse aux rats, on y organise des entrevues, et déjà plus d’une dot y fut prise.
Les rues de Paris sont longues et larges, bordées de maisons immenses. Ces longues rues croissent tous les jours en longueur. Plus elles sont larges, moins on y peut passer. Les voitures encombrent la vaste chaussée, les piétons encombrent les vastes trottoirs. À voir une de ces rues du haut d’une de ces maisons, c’est comme un fleuve débordé qui charrierait les débris d’un monde.
Véritablement Paris est une inondation qui a submergé la civilisation française, et l’emporte toute entière en débris. Où l’emporte-t-il ainsi concassée ? Moi, je crois qu’il l’emporte à la préfecture de police, quelque victoire qui surgisse des égouts. Si de tous ces débris la préfecture de police saura faire une autre civilisation, je l’ignore. Ce que sera cette autre civilisation, qui le veut savoir, n’a qu’à lire Tacite et Pétrone.
Les constructions du nouveau Paris relèvent de tous les styles ; l’ensemble ne manque pas d’une certaine unité, parce que tous ces styles sont du genre ennuyeux, et du genre ennuyeux le plus ennuyeux, qui est l’emphatique et l’aligné. Alignement ! fixe ! Il semble que l’Amphion de cette ville soit caporal. Voilà un prodige du dix-neuvième siècle, que nul autre siècle peut-être n’a vu : on a rebâti Paris, et quasi la France, sans qu’il se soit révélé un architecte. Jusqu’à Louis XVI, on eût presque une architecture par règne.
Il pousse quantité de choses fastueuses, pompeuses, colossales : elles sont ennuyeuses ; il en pousse quantité de fort laides : elles sont ennuyeuses aussi.
Ces grandes rues, ces grands quais, ces grands édifices, ces grands égouts, leur physionomie mal copiée ou mal rêvée, garde je ne sais quoi qui sent la fortune soudaine et irrégulière. Ils exhalent l’ennui. On est là-dedans comme chez ces gens d’hier et d’ailleurs, qui vous font bien boire, bien manger, bien asseoir, qui vous chauffent bien, qui allument un luminaire à vous brûler les yeux, mais qui n’ont rien à vous dire, sitôt qu’ils ont achevé de réciter le journal de tout à l’heure. Qu’il pleuve, qu’il neige, qu’il faille rester dehors, vous voulez sortir. C’est ce qui fait le succès du vaudeville, de Thérésa et de la pipe.
Les habitants du Paris complet s’ennuieront comme on ne s’est jamais ennuyé sur la terre. Il n’est rien qu’on ne puisse craindre d’un peuple qui s’ennuie, et rien qu’on ne lui puisse imposer. Or, le peuple de Paris sera le monde, comme a été le peuple de Rome, peuplé qui s’ennuyait.
Le Paris nouveau n’aura jamais d’histoire, et il perdra l’histoire de l’ancien Paris. Toute trace en est effacée déjà pour les hommes de trente ans. Les vieux monuments même qui restent debout ne disent plus rien, parce que tout a changé autour d’eux. Notre-Dame et la Tour Saint-Jacques ne sont pas plus à leur place que l’Obélisque, et semblent aussi bien avoir été apportées d’ailleurs comme de vaines curiosités. Où seront les lieux historiques, les demeures illustres, les grands tombeaux ?
Les hommes de la Révolution ont eu la rage de faire passer des rues sur les sanctuaires qu’ils avaient démolis. Ils se sont dérangés pour accomplir cette chère besogne, ils ont sacrifié même leur bien-aimée ligne droite.
On continue. Dans le Paris nouveau il n’y aura plus de demeure, plus de tombeau, plus même de cimetière. Toute maison ne fera qu’une case de cette formidable auberge où tout le monde a passé et où personne n’a souvenir d’avoir vu personne.
Qui habitera la maison paternelle ? Qui priera dans l’église où il a été baptisé ? Qui connaîtra encore la chambre où il entendit un premier cri, où il reçut un dernier soupir ? Qui pourra poser son front sur l’appui d’une fenêtre où jeune il aura fait ces rêves éveillés qui sont la grâce de l’aurore dans le jour long et sombre de la vie ? Ô racines de joie arrachées de l’âme humaine ! Le temps a marché, la tombe s’est ouverte, et le cœur qui battait avec mon cœur s’est endormi jusqu’au réveil éternel. Pourtant quelque chose de mes félicités mortes habitait encore ces humbles lambris, chantait encore à cette fenêtre. J’ai été chassé de là, un autre est venu s’installer là : puis ma maison a été jetée par terre et la terre à tout englouti, et l’ignoble pavé a tout recouvert. Ville sans passé, pleine d’esprits sans souvenirs, de cœurs sans larmes, d’âmes sans amour ! Ville des multitudes déracinées, mobile amas de poussière humaine, tu pourras t’agrandir et devenir la capitale du monde ; tu n’auras jamais de citoyens !
Rousseau avait trouvé ce beau mot de « désert d’hommes » pour peindre Paris, quand Paris, peuplé seulement de six à sept cent mille âmes, n’était qu’une ville de province divisée en une quantité de paroisses où tout le monde se connaissait, où chacun faisait partie d’une corporation, vivait dans son quartier, avait des amis, des patrons, des parents. Et bientôt, qui donc, dans Paris, aura seulement un voisin ? Quel homme y pourra compter sur un autre homme pour une assistance quelconque, pour une résistance à quoi que ce soit d’injuste et d’odieux ? Il y a le sergent de ville, et voilà tout. Le sergent de ville connaît tout le monde, protège tout le monde, ramasse tout le monde. Mais que cet unique protecteur a de droits sur tout le monde, et que ses pupilles ont à observer de règlements !
La vile multitude, ce vieux et hideux personnage historique, n’était à vrai dire, dans la civilisation chrétienne, qu’un fantôme ; une figure de rhétorique comme les Dieux, les Grâces, les Muses et autres legs du grec et du latin. À présent elle existe, Paris l’a créée, et nous en sommes, et il n’y a pas autre chose dans l’enceinte des fortifications. Qui se croit hors de la multitude se trompe. Il en vient, il y rentrera, il n’en est pas sorti. Il n’est que la fraction minime et fatalement obéissante de quelque multitude particulière, elle-même fatalement asservie au mouvement de la multitude générale. Or, le mouvement de la multitude, c’est le vent qui en décide. Le destin de la multitude est de se soulever au vent, de s’éparpiller, d’aveugler, de souiller, de tomber, de laisser la force aller où elle veut. Mais, où qu’elle aille, la force ne trouve jamais que de la poussière et ne peut donner à cette poussière un semblant de consistance qu’en l’arrosant de sang.
J’ai fait un livre intitulé le Parfum de Rome. Il m’a donné l’idée de ces Odeurs de Paris. Rome et Paris. Sont les deux têtes du monde, l’une spirituelle, l’autre charnelle. Paris, la tête charnelle, pense que le monde n’a plus besoin : de Rome, et que cette tête spirituelle, déjà supplantée, doit être abolie.
Il y a sans doute des contradicteurs. Mais, quand une idée de telle nature possède la majorité, ou ce qui en tient lieu, tout ce que la contradiction peut dire n’est que risible.
On jure bien aussi que ce n’est pas Paris, mais Florence qui propose d’abattre Rome Florence n’est pas une tête, pas même un bras. Est-ce que c’est le bourreau qui tue ?
Pendant que le parfum de Rome s’exhalait de mon âme embrasée d’admiration, de reconnaissance et d’amour, les odeurs de Paris me poursuivaient, me persécutaient, m’insultaient. Je voyais l’impudence de l’orgueil ignorant et triomphant, j’entendais le ricanement de la sottise, l’emportement plus stupide du blasphème, les odieux balbutiements de l’hypocrisie. Je méditais de mettre en présence la ville de l’esprit qui va périr, et la ville de la chair, qui la tue. Les circonstances m’ont décidé. L’année 1866 est solennelle pour l’Europe ! Elle a déjà apporté ce que l’on n’attendait pas ; si elle apporte encore ce qui est annoncé, elle verra une chose inouïe dans les siècles chrétiens, inouïe dans la suite recommencée des siècles après le déluge. C’est en 1866, c’est tout à l’heure que, par l’abandon, de Rome aux bêtes farouches de l’Italie, lupi rapaces, l’apostasie des nations catholiques, tacitement opérée, sera officiellement proclamée.
Un regard sur la capitale de la civilisation charnelle ne saurait être inutile en pareil moment.
Ce n’est qu’un regard. Je n’ai pas prétendu écrire un portrait de Rome, tâche au-dessus, de mes forces ; j’entreprendrais bien moins de faire une description de Paris, besogne au-dessous de ma dignité. D’ailleurs Paris à ses peintres spéciaux en grand nombre et de grande audace, que j’aurai l’occasion de citer quelquefois. Ils en diront assez. Si je laisse un voile sur la plaie, on en sentira l’odeur âcre ou fade, toujours morbide.
Un jour, à Rome, allant du Pincio, où le hâtif printemps entrouvrait les fleurs, au Vatican, où l’encens brûlait sur l’autel, je lisais dans la Revue des Deux-Mondes que Rome « sent le mort. » Cela m’était dit par M. Taine, tout justement à l’entrée du pont Saint-Ange, devant les statues des apôtres Pierre et Paul, l’un crucifié, l’autre décapité, et qui pourtant ne sont pas morts ; ce qui me persuada que Rome non plus n’est pas morte. Être crucifié ou décapité n’est plus la même chose que mourir. Et je me souvins aussi qu’en France ; moi-même et beaucoup d’autres, nous sommes étrangement tourmentés d’une malsaine odeur de renfermé. Car malgré la libre circulation des idées, entretenue avec tant de largeur et tant de pompe, nous ne laissons pas de connaître des idées qui n’ont nullement la permission de prendre l’omnibus, et M. Taine le sait très bien. Mais M. Taine, essentiellement parisien et essentiellement de l’époque, attaché tout à la fois au recueil de M. Buloz et au char de l’État, peut se trouver dans la même condition que beaucoup de libres penseurs : ils n’ont pas la faculté de croire tout ce qu’ils disent, ni la permission de dire tout ce qu’ils croient. M. Taine croit-il bien que Rome « sent le mort ? » oserait-il avouer que Paris sent le renfermé ? La libre pensée est un renard qui sait toujours parfaitement où et quand il convient d’avoir un rhume de cerveau.
Faute de pouvoir ou de vouloir aller chercher à leur source toutes les mauvaises odeurs parisiennes, j’ai donné une grande place aux produits littéraires. Après tout, peu de choses dans Paris et dans le monde, à l’heure qu’il est, sentent plus mauvais que le papier fraîchement imprimé, et contiennent plus de miasmes mortels : Qu’on ne me dise pas, à propos de tel ou tel journal, que j’ai attaqué de minces adversaires : il n’est pas de petit garçon dans ces maisons-là, et Poivreux, et Galapias, et Galvaudin, et vingt autres sont des personnages en comparaison de qui les ducs et pairs de l’ancien régime n’étaient que populace. Ce matin même, Passepartout nous conte qu’une sorcière, sachant qu’elle avait l’honneur de travailler devant lui, fut intimidée au point qu’elle manqua ses tours. Assurément la sorcière eût parfaitement fonctionné devant une commission de députés et de sénateurs, même académiciens. La première chose que fait un ministre retraitant, c’est de donner séance à Passepartout : et comme il s’attife ! et comme il veut que Passepartout lui fasse un bon papier !
Que Passepartout subisse le destin des puissances et souffre le murmure des êtres de néant.
Ah ! je viens de faire un dur voyage !
À Rome, dans la belle clarté du jour, nous allions visiter les basiliques de marbre et d’or, toutes pleines de chefs-d’œuvre, de grands souvenirs, de reliques sacrées ; nous vénérions les tombeaux augustes et féconds, les ruines-majestueuses où l’histoire est assise et parle toujours. Quels pèlerinages et quels chemins ! Sur ces chemins nous rencontrions la science, la piété, la pénitence, et toutes avaient des ailes et des sourires, et leurs yeux baignés de lueurs divines se tournaient vers le ciel. L’amitié était là aussi ; et les fleurs dans les herbes recouvraient des débris dont la splendeur abattue n’avait fait que changer de beauté ; et le silence, roi de ces nobles espaces, nous laissait partout entendre les plus douces voix de la vie.
Dans Paris, à travers la boue jaillissante, à travers la foule morne, à travers l’infecte nuit, j’allais des fumées de la pipe aux vapeurs du gaz, des cafés aux théâtres. C’est là que le peuple s’amuse, c’est là qu’il s’instruit. J’ai vu, j’ai entendu, j’ai noté la voix des histrions et les mouvements de la foule ; j’ai senti le souffle et la main de la mort : Erant in diebus ante diluvium comedentes et bibentes et nubentes, usque ad eum diem quo intravit Noë in arcam, etnon cognoverunt donec venit diluvium, et tulit omnes…
J’ai parlé comme j’ai senti. Je ne m’accuse ni ne m’excuse de l’amertume de mon langage. Encore que je n’aime guère le temps où je vis, je reconnais en moi plus d’un trait de son caractère, et notamment celui que je condamne le plus : je méprise. La haine n’est point entrée dans mon cœur, mais le mépris n’en peut sortir. Il est cramponné et vissé là, il est vainqueur quoi que je fasse, il augmente quand je m’étudie à l’étouffer ; il désole mon âme en lui montrant, comme un effet de la perversité humaine, cette universelle conjuration contre le Christ, où l’ignorance a plus de part peut-être que la perversité. Ma raison, non moins révoltée que ma foi, accable ce que je voudrais conserver d’espérance, et me dicte des paroles acérées qu’il me semble que je ne voudrais pas écrire. J’en viens à croire que c’est ma fonction, de faire entendre aux persécuteurs de la vérité quelque chose de cet indomptable mépris par lequel se vengent la conscience et l’intelligence qu’ils écrasent, et de leur montrer dans un avenir prochain l’inexorable fouet qui tombera sur eux. Je suis cet homme qu’une force supérieure à sa volonté faisait courir sur les remparts de Jérusalem investie, mais encore orgueilleuse, criant : Malheur ! malheur ! Malheur à la ville et au temple ! Et le troisième jour il ajouta : Malheur à moi ! Et il tomba mort, atteint d’un trait de l’ennemi.
LE RENFERMÉ.
J’avais quarante-cinq ans, j’avais fait de la politique imprimée durant un quart de siècle, et, j’ignorais absolument deux choses que j’ai apprises coup sur coup en un rien de temps : la première est la facilité de se compromettre sans le vouloir, la seconde est la difficulté de se compromettre quand on le voudrait.
L’Univers venait d’être supprimé, j’étais à Rome. Je visitais les églises, je fréquentais un très petit nombre d’amis, je rencontrais un plus petit nombre de gens de connaissance, je lisais quelques livres, je prenais quelques notes, je recevais quelques lettres de ma famille : je me compromettais ! Un surveillant invisible pour moi suivait mes pas, en rendait compte à Paris, indiquait l’instant de mon retour, tenait la police en éveil à la gare. À peine rentré chez moi, ma valise à peine ouverte, trois hommes se présentent, me montrent un mandat, saisissent mes papiers : me voilà compromis.
Que contenaient ces papiers saisis ? Pas grand-chose, et on en convenait. Simplement de quoi tisser une petite accusation de manœuvres à l’étranger contre la sûreté de l’État. Ce crime ne se prescrit que par trois ans selon les uns, par dix ans selon les autres. Il est punissable de mort ; mais il ne faut pas que le tissu soit trop léger.
J’aurais aimé qu’on me fît procès. On me répondit avec une courtoisie charmante que je ne pouvais pas m’attendre à cela, que j’avais autrefois rendu trop de services. Je protestai que je n’invoquais pas ce souvenir. On protesta que rien ne le ferait oublier.
Le Pouvoir ne se contente pas de se montrer juste, il lui sied encore d’être reconnaissant. – Alors, qu’on me rende mes papiers ! – Oh ! non. Car enfin, sans aucune intention de les utiliser, à Dieu ne plaise ! il faut pourtant prévoir un cas de grande nécessité qui obligerait d’y venir.
C’était M. Billault, ministre de l’Intérieur, qui me parlait de la sorte, en paroles très douces, avec un sourire fin, peut-être légèrement ironique.
L’amusement que mon aventure donnait au public me mortifiait assez. Divers journaux racontaient plaisamment et complaisamment ce tour de police : l’on se divertissait trop de ma simplicité à me laisser prendre. Je sentis bien quelque chose de cela dans le style de M. Billault.
M. Billault était jurisconsulte fort expert. L’idée me vint de savoir de lui si je ne pourrais pas moi-même intenter un procès en restitution de ces papiers gênants. Je le priai de me donner une consultation d’avocat. – Tout de suite, me dit-il. Et sans désemparer, il m’expliqua que je devais d’abord présenter requête au Conseil d’État pour obtenir l’autorisation d’actionner M. le Préfet de police, après quoi je n’aurais qu’à plaider comme tout le monde, devant les tribunaux de tout le monde. – Mais, observai-je, Votre Excellence pense-t-elle que j’obtienne cette autorisation ? Moi, je ne le crois point. – Ni moi, dit-il avec un sourire plus fin et quelque peu plus ironique.
Telle fut la consultation que je reçus de M. Billault, en tête-à-tête, dans son cabinet de ministre de l’Intérieur. Je ne me rappelle pas sans plaisir ce trait si obligeant d’un homme qui fut depuis honoré de deux statues par souscription. Son sourire surtout me parut décisif. Il me persuada que le plus expédient pour moi, était de ne pas occuper davantage l’attention publique et de rester dans ma situation d’homme compromis. Aucune situation n’est plus simple : elle vous laisse toute la liberté d’aller et de venir. Seulement vous êtes, partout dans le cas de voir apparaître un exempt, muni d’un mandat d’amener : et alors vous n’allez ni ne venez plus ; vous suivez l’exempt où il vous mène, et vous demeurez où il vous met.
Compromis sans l’avoir voulu, je méditai de me compromettre de plein gré. Que ceux qui croiraient la chose aisée se détrompent. On peut conspirer et manœuvrer contre l’État et ne pas s’en douter, j’étais fixé sur ce point. Conspirer volontairement n’étant pas dans nos usages chrétiens, comment me compromettre ? Je pensai que la voie la plus sûre était d’écrire dans les journaux. Il y a de certains jours où il me semble que j’écrirais volontiers à raison d’un mois de prison par ligne.
Mais la première condition pour se compromettre dans un journal, c’est de trouver un journal qui consente à se compromettre avec vous. Or, le journal à qui vous proposez cette partie, vous dit : – « Monsieur, d’abord, il n’est pas sûr que vous vous compromettiez : il se peut fort bien que l’on vous dédaigne ; il est même vraisemblable que l’on vous dédaignera pour ne s’en prendre qu’à moi. Vous aurez le soulagement de dire votre pensée, je suis seul menacé d’en porter la peine. Cette peine, ce n’est pas la prison, même dure ; ce n’est pas l’amende, même forte ; on pourrait affronter cela. Je suis menacé de suppression, je suis menacé de la mort. Que je meure pour vous avoir procuré la satisfaction d’écrire un article, votre cause en sera-t-elle bien avancée ? Laissez-moi vivre et parler à ma guise, avec la prudence nécessaire en ce temps-ci. Je suis un privilège, je vaux un million. Faites des témérités qui ne compromettent que vous. »
Soit ! Voici un nouveau ministre de l’Intérieur qui se croit tout à fait disposé à étudier l’opinion, c’est-à-dire à laisser parler les gens ; je vais lui demander l’autorisation de fonder un journal. Que je puisse ensuite trouver cent cinquante ou deux cent mille francs, et je serai libre… de me compromettre.
– Monsieur le Ministre, daigne Votre Excellence me donner l’autorisation nécessaire pour établir un journal politique, afin que je tente de réunir deux cent mille livres. Ce n’est pas la moindre chose ? il me faut des prêteurs qui veuillent bien risquer de perdre le capital avec les intérêts. Moyennant cette bagatelle, j’entrerai en jouissance de mon droit de citoyen. J’aurai quelques raisons d’être sage, et je n’attaquerai rien de tout ce que la Constitution veut couvrir.
– Monsieur, vous n’êtes point repris de justice, ou du moins vous avez des lettres d’abolition, et vous passez pour expliquer clairement vos idées : je serais charmé de vous entendre. Mais (j’en ai regret) vous ne comprenez pas la politique du Gouvernement, comme il faut la comprendre pour la bien critiquer. Je vous connais ; votre journal ne serait point l’œuvre de conciliation qui convient au temps où nous sommes. Dans l’intérêt même de l’Église, il est du devoir du Gouvernement de s’opposer à tout ce qui peut amener des malentendus funestes entre l’Église et l’État. En même temps que mon refus, agréez l’assurance de ma considération distinguée.
Reste la brochure. Il paraît beaucoup de brochures de toutes sortes ; quoique les plus hardies ne soient pas les plus exposées, peut-être, il semble à première vue que l’on peut prendre ce moyen de se mettre mal avec l’État. Faisons une brochure.
Pendant que j’écris ma brochure son moment passe, les évènements se pressent, les faits prévus deviennent imminents et vont être des faits accomplis. Enfin, me voici chez l’imprimeur ! Il me reçoit sans allégresse :
– Hum ! On aura l’œil sur cet écrit. Je crains que vous ne vous compromettiez. – Ce n’est point ce qui m’inquiète. – Moi, cela m’inquiète beaucoup…
Il a parcouru de l’œil une page du manuscrit. – Tenez, voilà une phrase qui ne peut passer… Tenez, voilà un mot des plus périlleux… Tenez, voilà une comparaison impossible… Vous ne passerez pas.
Qu’importe ! essayons toujours. – Essayez, si vous vouliez. Quant à moi, il m’importe si bien, que je n’essaye pas.
– Désapprouvez-vous mes idées ? – Je n’approuve ni ne désapprouve rien, et si j’ai une opinion, elle n’entre point dans mes ateliers. La conscience de l’homme ne s’occupe plus des opérations du fabricant. Croyez-vous que je lise la centième partie des choses que j’imprime ? Mais je ne veux point prendre la responsabilité de cet écrit, et je doute que vous trouviez un imprimeur qui s’y expose.
– Comment ! l’art libéral de l’imprimerie, le véhicule de la pensée, le flambeau du monde, le marteau de toutes les oppressions…
– Ta, ta, ta ! Je connais cette vieille chanson ; je l’ai chantée comme vous, mieux que vous, car j’y avais de la sincérité. Il y a longtemps que l’on disait tout cela ; il y a des siècles ! Permettez-moi de vous faire observer que nous ne sommes plus à l’époque ou la Corporation des Imprimeurs était agrégée à l’Université royale et jouissait de ses privilèges ; ni à l’époque plus récente où l’imprimerie, moins honorée, avait vu les privilèges abolis remplacés par la licence et faisait ce qu’elle voulait. Je ne suis pas un imprimeur ; je suis le gérant d’une entreprise industrielle. Je conduis mon entreprise et je produis mes dividendes en vertu d’une patente qui peut m’être retirée pour simple contravention, par simple mesure administrative. Or, il a fallu tant de règlements pour surveiller l’exercice de cette profession dangereuse, qu’il est impossible de ne pas en enfreindre quelqu’un. Devant l’Administration, le plus sage imprimeur pèche sept fois par jour, et aucune imprimerie ne reste ouverte que par grâce. Mais s’il plaît à l’Administration d’être indulgente, il peut lui convenir de ne l’être pas. Quand un écrit lui paraît répréhensible, rien ne la force de poursuivre l’imprimeur en même temps que l’auteur, rien aussi ne l’en empêche. Les peines sont la prison pour vous et pour moi, de grosses amendes pour vous et pour moi, le retrait du brevet pour moi seul. Le retrait du brevet, Monsieur, c’est la ruine, tout simplement.
– Et qui vous dit que nous, serons poursuivis ? qui vous dit surtout que nous serons condamnés ?
– Qui vous dit que nous ne le serons point ? Je refuse d’en courir la chance. Non poursuivi, non condamné, c’est insuffisant ; le juste veut encore ne point déplaire.
Ainsi parle l’imprimeur ; et l’écrivain n’a plus qu’à traîner son innocence.
Mais c’est bien le moindre souci des dieux.
Voilà ce qui me fait penser, contrairement à l’heureux M. Taine, que notre, beau Paris sent aussi une odeur de renfermé, laquelle ne diminue en rien l’âcreté de ses autres odeurs.
Mais enfin, c’est le régime du couvent, et encore qu’il soit-difficile de s’y faire, on le subirait avec plus de patience, si l’on y gagnait du moins de n’être plus insulté. Il n’en va pas ainsi, tant s’en faut !
Après avoir fait l’expérience de la facilité de se compromettre sans le vouloir, et de la difficulté de se compromettre honnêtement et légalement lorsque on le veut, j’ai eu encore le crève-cœur d’apprendre combien ce régime est cher à la multitude des gens de journaux, et quel misérable instinct les anime en général contre toute loyale liberté. J’en savais long sur ce chapitre ; mais ce qui m’a été révélé par eux-mêmes, je ne l’aurais pas deviné, et je ne l’aurais pas cru. Il s’est d’ailleurs formé une génération de journalistes toute nouvelle dont rien de ce que j’ai vu de 1830 à 1860 ne pouvait me donner l’idée.
Pour avoir constaté, parce que je m’y voyais contraint, que je ne peux ni fonder un journal, ni au fond écrire dans les journaux, même en Belgique, j’ai reçu une tournée d’injures libérales. Les feuilles impériales veulent ignorer que je suis au secret, les feuilles républicaines trouvent que c’est bien fait, que je l’ai bien mérité. Il existe à Lyon un Progrès qui n’est pas sans importance. Il fait venir sa politique et sa littérature de Paris, pour les avoir plus fraîches et de cette qualité supérieure que la province ne fournit plus. Ce que les correspondants de ce Progrès lui écrivent sur le propos de mon bâillon me semble caractéristique :
« Qu’il n’essaie donc pas de nous apitoyer ; ce pleurard (c’est moi), qui ne sent la nécessité de la liberté que pour lui seul, et qui, demain encore, ne se servirait de sa plume que pour demander qu’on brise celle de ses adversaires. Ses larmes de Crocodile nous trouvent parfaitement insensibles, car si quelque chose pouvait nous consoler de toutes les restrictions qui nous étreignent, ce serait de voir réduit à l’impuissance l’apôtre de l’inquisition ; et si nous ne pouvons pas élever l’a voix, nous, avons au moins la consolation de ne plus avoir l’imagination troublée par les hurlements de l’apologiste de toutes les violences. »
Tels sont, peints par eux-mêmes, ces derniers défenseurs de la liberté. L’on dira qu’il y en a d’autres. Sans doute, mais pas beaucoup, et pas bien différents ! Je monte sans, transition du plus bas au plus haut. Assurément ; M. Prévost-Paradol ; de l’Académie française, ne saurait être soupçonné d’un pareil sentiment, pas plus qu’il n’est capable d’un pareil langage. Néanmoins, avec une parfaite politesse, il m’adresse des observations qui ont un peu le même sens. Le Progrès me traite en excommunié qui ne pourra jamais être absous ; M. Paradol me reçoit à miséricorde, non sans me rappeler que j’ai beaucoup péché, et parce qu’il espère que je suis pénitent. S’il me supposait moins corrigé par le malheur, peut-être qu’il ne resterait pas loin, sauf la forme, des conclusions du sévère Progrès. Le journal dans lequel il écrit me le fait entendre. Or, M. Prévost-Paradol m’oblige de lui confesser l’affreuse vérité. Je ne crois pas avoir péché autant qu’il le pense, mais je pense n’être pas converti autant qu’il le croit.
Nous nous sommes jadis assez vivement combattus. Je revendiquais pour la vérité des droits qu’il appelait des privilèges et qu’il repoussait de toute sa force ; je, contestais que l’erreur dût avoir des privilèges qu’il appelait et qu’il appelle encore des droits. Si nous nous retrouvions en présence, le même dissentiment, pour ne pas dire la même séparation, existerait entre nous ; il n’y aurait de changé que l’accent de la polémique, un peu chaud peut-être des deux parts. Seulement il commettrait une injustice dont je ne me rends pas coupable envers lui, s’il me prenait pour un ennemi de la liberté, et s’il me contestait l’usage de la liberté, il ferait à son principe un outrage que je ne fais pas au mien, ni quand j’invoque ni quand je conteste un certain exercice de la liberté. Je connais, moi, une vérité et une erreur, et je n’admets aucune espèce de parité ni d’égalité entre cette vérité et cette erreur. Ceux qui ne connaissent ni erreur ni vérité, ou qui établissent sur le même pied et dans le même droit la vérité et l’erreur, doivent en conscience, et quoi qu’il leur en coûte, livrer l’erreur à la libre discussion de la vérité. Dès qu’ils s’y refusent, que nous reprochent-ils ? Ils sont intolérants comme, ils nous accusent de l’être, mais intolérants avec hypocrisie, sans cesser de proclamer leur prétendue tolérance ; intolérants pour mettre à couvert leurs opinions, lorsque nous ne le sommes que par respect pour nos dogmes.
Cela dit, je crois que les libéraux séparés verraient plus juste, s’ils pouvaient comprendre quelle est, entre nous, la cause de la séparation.
Cette cause, au fond, n’est pas l’amour ou l’aversion de la liberté, mais une conception différente de la liberté.
Beaucoup de libéraux se rapprocheraient de la conception catholique, si l’aversion insensée qu’ils nourrissent contre l’Église ne les liait quasi indissolublement au noble système de ces messieurs qui se consolent « de toutes les restrictions qui les étreignent » par le plaisir « de voir réduit à l’impuissance l’apôtre de l’inquisition. » Et que prétend faire leur libéralisme avec ces messieurs et ces talents-là, rudiments informes de sous-inquisiteurs et de sous-chambellans ?
Je me sens parfaitement en état de démontrer à n’importe quel libéral, sans excepter M. Prévost-Paradol, que je n’ai pas moins que lui aimé la liberté, que je n’ai pas moins sincèrement, moins ardemment, moins obstinément essayé de la servir ; et que l’Univers n’a pas été supprimé pour avoir trop méconnu la cause de la liberté. Seulement, nous ne voulons donner à la liberté, ni les mêmes droits, ni les mêmes règles et les mêmes devoirs, ni peut-être le même but. Pour nous, catholiques, la liberté ne peut être qu’un moyen de rentrer ou de rester dans l’ordre et dans la paix. Et l’ordre et la paix sont avant tout le respect de la loi de Dieu.
Je ne demande pas la liberté d’écrire pour écrire et prouver autre chose. Je ne veux pas une liberté sans lois ; je ne me trouverais pas libre sous une loi qui me permettrait tout, sauf la liberté de réclamer de toutes mes forces contre la liberté qui prétend ne pas souffrir de lois, parce que cette liberté, incapable de s’imposer à elle-même aucune loi, est destinée à une fin prompte et mauvaise.
Je veux être libre contre cette liberté ou plutôt contre cette tyrannie qui prétend nous interdire la confession de la vérité, nous fermer l’histoire, nous ôter le passé, proscrire l’apologie des lois et des actes de l’Église. Je souffre plus et je suis plus lésé de ne pouvoir soutenir et défendre une encyclique pontificale que d’être privé de donner, mon avis sur l’entreprise du Mexique ou sur la publicité des conseils municipaux.
Mais ce n’est pas ainsi que le Progrès de Lyon entend la liberté, et même quand d’autres libéraux inclinent à pardonner, il faut être excommunié et injurié, du moment qu’on n’entend pas là liberté comme le Progrès de Lyon. Penser autrement que ces tolérants, c’est ce que le parti de la tolérance ne peut tolérer ; estimer qu’il faut respecter la loi de Dieu, c’est la doctrine absolument intolérable.
Hélas ! et l’on finira pourtant par tolérer bien autre chose, une chose qui ne sera pas du tout la loi de Dieu et qu’il faudra tolérer et adorer ; et le grand peuple de la libre-pensée fournira une rude et abondante Sainte-Hermandad pour y tenir la main !…
VUE GÉNÉRALE.
Le progrès de l’imprimerie, en universalisant l’habitude de lire ; n’a pas également répandu la connaissance du vrai, le goût du beau, l’amour du bien ; il ne tourne pas à l’honneur de la presse, et moins encore au profit de la liberté. Le sentiment de la liberté, s’il a paru s’étendre, a néanmoins singulièrement perdu de sa force. Toute discipline est plus haie, toute violence est plus docilement supportée. L’histoire nous montre en toutes ses pages les peuples à la fois plus fidèles et plus fiers qu’en ce temps. Ils aimaient quelque chose qu’on ne leur était qu’avec la vie ; ils haïssaient quelque chose qu’ils repoussaient tant qu’ils avaient la vie. Maintenant ils n’aiment rien et ils haïssent tout, mais d’une haine molle et lâche, prompte à céder, constante à trahir, d’où résulte la facilité de les dominer et l’impossibilité de les gouverner. La presse quotidienne a été le principal instrument de cette décomposition ; elle a changé le tempérament moral de l’humanité, elle y a fait régner l’indifférence. L’indifférence pèse aussi sur elle.
La presse subit le sort ordinaire des agents d’anarchie, elle est devenue un instrument de règne. Après avoir longtemps maîtrisé l’opinion et rendu les lois impuissantes, elle a vu l’opinion se retirer d’elle et les lois l’abandonner aux duretés des règlements. Elle a été empoignée comme une danseuse de mardi-gras, emmenée à la préfecture, immatriculée, soumise à l’autorisation et aux inspections de salubrité. Tout a été permis contre cette déchue qui naguère pouvait tout se permettre ; elle a tout accepté. Nous avons vu le hautain personnel des écrivains d’opposition se former promptement en escouades ministérielles. Hommes et caporaux, ils ont su tout de suite leur nouveau métier ; ils ont manié l’encensoir, ils ont dénoncé l’indépendance, ils ont pris la liberté au collet avec un style consommé et une allégresse entière. À peine s’est-il manifesté en quelques-uns quelque gêne de visage. Ce peu de vergogne a peu duré. Mais rendons leur justice ! La plupart n’ont guère à se reprocher que d’avoir longtemps ignoré leur vocation. Ils étaient nés pour le service qu’ils font. Dans cette situation nouvelle, plus changée qu’ils ne l’avouent, ils demeurent eux-mêmes plus qu’ils ne croient.
En 1851, sous la République, plusieurs d’entre eux étaient déjà florissants – fleurs rouges ! – Ils juraient de maintenir la liberté, surtout la liberté de la presse, ou de mourir pour elle. Un journal catholique leur prédit ce qui arriverait bientôt à la presse et à eux-mêmes :
« … Fatiguée de la liberté de la presse, la France y cherche un remède ; gare la censure ! Elle essaiera ceci, puis cela, puis un bon bâillon…
Écrivains, orateurs, nous y pousserons tous, nous y passerons tous. Nous serons solidaires des excès, des sottises que nous n’avons pas su empêcher. Pour avoir souffert que la tribune et la presse devinssent ce qu’elles sont devenues, nous porterons le bâillon que nous aurions dû tout les premiers appliquer sur tant de lèvres folles et d’encriers pestilentiels. Sera-ce grand profit ou grand dommage ?
Ce qui est certain, c’est que le temps où nous sommes averti de s’attendre à tout. Il se peut que l’horreur du mensonge aille jusqu’à vouloir bâillonner aussi la vérité. Ce serait d’ailleurs un marché qui conviendrait fort à nos apôtres de l’esprit humain et de la liberté de tout dire. Combien d’entre eux s’arrangeraient de ne jamais parler, si seulement on les établissait avec de bons ciseaux et de bons gendarmes à leurs ordres, censeurs de l’Église ! »
Nos bons apôtres de la liberté de tout dire ont dépassé la prédiction. L’on n’avait pas deviné que les uns, non contents de censurer, se permettraient encore d’écrire ; que les autres, au lieu de déposer la plume et de disparaître pudiquement dans un bureau, s’établiraient délateurs de la pensée muette, vilipenderaient des adversaires désarmés et se déclareraient ennemis si frénétiques de cette liberté pour laquelle ils avaient juré qu’ils sauraient mourir. Quoi de plus naturel cependant ? Avaient-ils jamais donné lieu de croire qu’ils frisent capables de comprendre et d’aimer la liberté ? Ils haïssaient la règle, c’est bien autre chose ; et quiconque liait la règle est fait pour le frein.
En même temps qu’ils ont haï la règle, ils ont redouté le combat.
Sans amour, sans doctrine, sans fierté, orgueilleux et incapables, investis du pouvoir d’écrire sans autre vocation que la brutalité de l’envie, sans autre force que la brutalité de l’ignorance, par tous les chemins ils devaient arriver où ils sont venus ; tout les appelait, tout les poussait au servage. C’est là cette belle égalité démocratique, le rêve des temps nouveaux. Il faut que tout serve ou soit asservi. L’égalité, l’égalité ! tous les fronts sous le niveau qu’ont pris les leurs, et plus de liberté qui puisse passer au-delà, ni de rayon qui puisse descendre dans cette ombre ! Ils auraient, la plupart, été monarchistes, aristocrates, n’importe quoi. Plusieurs ont fait l’essai d’être catholiques, et le vent qui parut un moment tourner de ce côté les a trouvés dociles. Mais ils sont ce qu’il leur convient d’être : révolutionnaires et appointés, égalitaires et décorés, libres de se lâcher sur les supériorités sociales sans s’attirer d’affaires, libres d’attaquer et d’outrager la religion, libres de frapper des adversaires qui ne peuvent plus se défendre… et du pain assuré pour leurs vieux jours !
La presse n’avait perdu que la liberté ; l’attitude et le langage des journalistes embrigadés lui ôtent l’honneur. Comme cette fille que Circé avait maudite, la liberté de la presse a enfanté des chiens qui dévorent leur mère.
Malheureusement, la déconsidération ou là presse est abîmée ne l’empêche pas de nuire. L’ordre public en souffre comme la morale, et le Gouvernement n’en reçoit pas moins de préjudice que les particuliers.
En premier lieu, le Gouvernement ne peut subir sans dommage les continuels encensements de ces ci-devant hurleurs de démagogie et de socialisme, la plupart sans lettres, trop souvent même remarquables par leur inculture. Le spectateur du drame politique répugne à partager l’enthousiasme de pareils claqueurs. Mais si l’on juge que cela est assez bon pour la démocratie et que cette claque grossière enlève pourtant le parterre, encore faudrait-il leur interdire de montrer le poing à la partie sérieuse et silencieuse du public, qui veut entendre la pièce afin de la juger.
C’est un grief très amer dans beaucoup d’esprits de voir et de sentir combien de choses, combien de personnes, combien de classes sont livrées sans défense aux venimeuses atteintes de ces plumés révolutionnaires, devenues insensiblement semi-officielles, ou auxiliaires.
Aux observations que plusieurs des feuilles tolérées ont hasardées sur ce point, il a été répondu d’un ton cassant qu’il n’y a pas de presse semi-officielle et que, quant aux auxiliaires, ils sont libres de leurs sympathies, sans cesser d’être passibles de répression. Il faut admettre tout ce qui porte le cachet d’une réponse d’État et ne pas argumenter trop obstinément contre le Moniteur. Mettons donc que les journaux qui reçoivent des communications ne reçoivent pas d’inspirations, et que les autres s’aventurent sans aucune connaissance des limites où ils pourraient rencontrer la répression il n’en est pas moins vrai que ces journaux, si respectueux pour le Gouvernement (sauf en matière d’éloges), si insolents envers tout le reste, exploitent leur privilège sous la surveillance et le bon plaisir de l’Administration. De là, dans l’opinion, une logique qui attribue à l’Administration une part assez grave de la responsabilité qu’elle dénie.
Non, l’Administration ne commande pas ces injures, ne dirige pas ces détestables manœuvres dont l’unique objet est de décrier le clergé et de flétrir la bienfaisance chrétienne ; l’Administration ne souffle pas ces violents appels à la légalité qui tue la parole, qui tue la pensée, qui tue la charité, qui tue la liberté ; l’Administration ne dénonce pas la prière et l’aumône, ne les accuse pas de conspirer contre l’État lorsqu’elles prononcent le nom de Jésus-Christ ; l’Administration ne s’amuse pas à provoquer ainsi la haine populaire contre le prêtre, contre la religieuse, contre les catholiques, ne prend point plaisir à désespérer ainsi tant d’inoffensifs citoyens qui portent leur part des charges sociales et ne demandent en retour que de pouvoir y ajouter la surcharge des œuvres de piété. Tous ces outrages à la foi religieuse, tous ces attentats contre la paix publique, toutes ces alarmes et toutes ces indignations jetées par surcroît dans les consciences déjà navrées, ne sont pas le fait de l’Administration, elles sont le fait des journaux. Mais enfin, il n’y a plus en France qu’un seul rédacteur en chef de tous les journaux, c’est le Ministre de l’Intérieur : et ce ministre n’aurait qu’un mot à dire ; immédiatement cet odieux travail des journaux cesserait.
Telle est la conviction du public ; il faut avouer que la raison et les faits l’appuient également. Tout le monde avoue que la presse n’a reconquis aucune estime depuis 1831, et se trouve plus que jamais sans force dans l’opinion ; tout le monde sait que l’Administration peut commander, tout le monde sait que les journaux ne peuvent ni ne veulent résister, et que si un art leur est plus connu encore que l’art de corrompre, c’est celui d’obéir.
Il y a six ans, un journal catholique, après avoir été averti pour attaque aux articles organiques, pour attaque à l’armée, pour attaque aux nations étrangères, a été enfin supprimé par cette raison qu’il nuisait à la religion catholique en ne la présentant pas sous un jour assez aimable. Comment comprendre que l’Administration qui a donné ces preuves de vigilance et remporté cette victoire, ou n’ait vu aucune nécessité, ou n’ait trouvé aucun moyen d’astreindre, à quelque décence tous ces journaux anticatholiques dont elle est d’ailleurs si aimée ? Quoi ! l’on ne saurait les empêcher d’attaquer le Concordat et les lois qui protègent l’Église, de vilipender le clergé, de diffamer ses œuvres, de rendre la religion odieuse et exécrable par toutes les perfidies que la presse peut mettre au service d’un esprit dépravé ? Ce mystère passe le sens commun.
Le Gouvernement, sans paraître se rendre compte assez exactement de la gravité de cette situation, en est visiblement importuné. Son sentiment s’est manifesté de temps en temps par des circulaires qui ont semblé promettre quelque chose, et par des notes semi-officielles qui n’ont abouti à rien. Ce que l’on y voit de plus clair, c’est que le Gouvernement, parfois, au risque de rencontrer dans la presse d’autres adversaires, y voudrait avoir d’autres amis. Rien de plus naturel qu’un tel désir. Mais le moyen de l’accomplir reste à trouver.
Une des circulaires ministérielles fit croire, l’on ne sait guère pourquoi, que la presse allait passer sous un régime presque libéral. Un fameux journaliste du soir, ancien ogre rouge, compara le ministre à Montesquieu et encore à quelque autre grand auteur ; puis le vent tourna ; et soudain le vespertin qui venait de saluer l’aurore de la liberté, cria qu’il fallait prendre bien garde, et ne pas compromettre la sûreté de l’État en déchaînant les plumes anarchiques. Cela fit rire, – tristement !
Il y a encore une autre malédiction sur la presse. Le seul changement qui soit survenu dans sa condition, depuis 1851, n’a été avantageux ni pour elle ni pour le public.
Aux termes du décret de 1851, un journal pouvait être supprimé après deux avertissements ; il était supprimé de droit après deux condamnations. Par une loi postérieure les avertissements sont prescrits au bout de deux ans, et deux condamnations encourues n’emportent plus la suppression.
Les avertissements étant facultatifs quant au sujet, quant aux motifs et quant à l’heure, et rien n’empêchant d’en donner deux en deux jours, et le même jour, il suit de là que le bénéfice de la prescription par deux ans est fort mince. Le journal chargé de deux avertissements, et qui a marché deux ans sous ce poids assez lourd, aurait tort de se croire trop dégagé le jour où le poids tomberait périmé. Le lendemain il peut être muni d’un avertissement tout neuf, et d’un second le surlendemain, qui le rendra circonspect encore pour deux ans ; il peut être supprimé légalement le troisième jour.
De plus, par une autre disposition du décret, tout journal peut toujours être supprimé sans aucun avertissement préalable. Il y a la légalité ordinaire et la légalité extraordinaire, très bonnes et incontestables toutes deux. La suppression après deux avertissements est la légalité ordinaire : elle a peu servi. Beaucoup de journaux ont continué de vivre sous deux avertissements ; le Siècle en a eu trois et ne s’en est pas plus mal porté. La légalité extraordinaire est là, suppression foudroyante, sans avertissement antérieur ou sans mention des avertissements déjà donnés. Le décret de suppression de l’Univers ne parla point des avertissements que ce journal avait reçus, comme pour faire entendre qu’il était supprimé en dehors de ses anciens crimes, pour un crime plus grave, l’impiété. La Bretagne, autre feuille catholique, atteinte du lasso quelques jours après, pour avoir plaint l’impie, était vierge d’avertissement. La suppression foudroyante a lieu par décret précédé, si l’on veut, d’un rapport du ministre de l’Intérieur, lequel expose comme il veut les motifs de la suppression. Et cela est sans appel, pas plus devant l’opinion que devant les tribunaux. Il faut avoir recours à la clémence, autre manière de mourir.
Cette prédisposition à la mort subite en l’absence et indépendamment de toute maladie déclarée, permet au Gouvernement de borner a deux ans la durée de cette maladie de langueur que contracte tout journal averti deux fois. La facilité de rouvrir toujours la plaie à peine cicatrisée réduit pareillement à presque rien l’avantage de ne plus risquer d’être emporté par une condamnation insignifiante en soi, motivée sur quelque inadvertance envers les règlements ou sur quelques torts commis envers les particuliers.
Quant à l’inadvertance envers les règlements, c’est une question de bonne foi que la Justice et l’Administration décident avec indulgence ; aucun journal n’a péri pour avoir transgressé les règlements. Quant aux torts envers les particuliers, les journaux honnêtes savent les réparer de bonne grâce, a première réquisition ; les autres finissent par s’exécuter lorsqu’ils voient que décidément la partie lésée veut une réparation. Donc, peu de danger de ce côté. Ce n’est point par ces dispositions que la presse est liée ; en les écartant, on ne l’a pas affranchie.
Il y a plus : cet avantage insignifiant, les véritables amis de la presse, je veux dire les amis de sa dignité, l’auraient refusé, du moins en ce qui regarde les torts faits aux particuliers. La seule sécurité de la presse est dans l’estime publique, et elle devrait souhaiter, que le public ne perdit rien des rares garanties qu’il a contre elle. En fait de garanties contre les journaux, tout est au profit de l’État, et il y a luxe ; le public, au contraire, est fort mal pourvu, pour ne pas dire à peu près entièrement dépouillé.
Les journaux qui craignent le moins d’attaquer l’honneur d’autrui sont ceux qui craignent le plus, d’accueillir les réclamations de leurs victimes, car ces réclamations démontrent trop combien ils ont eu la méchante volonté de nuire. Ils attaquent les pacifiques, des prêtres, des religieuses, toutes sortes d’honnêtes gens qui pardonnent, qui dédaignent, qui détestent le bruit. Si pourtant ces honnêtes gens, poussés à bout, réclament, on sait l’art de les fatiguer par mille lenteurs. Faut-il enfin céder ? La réclamation n’est publiée qu’à demi, tournée en ridicule, submergée de commentaires insolents, et ne produit plus qu’une aggravation de l’offense. Imaginez un maire de campagne, un pauvre vicaire, une religieuse aux prises avec ces émouchets de la presse parisienne que les notables du département eux-mêmes considèrent comme des aigles ! L’offensé craint la polémique, il fuit devant des adversaires trop forts pour lui, entourés de complices, assurés d’avoir le dernier mot.
La perspective d’un procès, c’est-à-dire, dans tous les cas de calomnie, la perspective d’une condamnation certaine, est la seule chose qui fasse à son tour reculer le journal. Il ne veut pas courir ce risque, et il se soumet.
C’est ainsi que l’illustre évêque de Perpignan, Mgr Gerbet, n’ayant pas jugé à propos de rester sous le feu particulièrement désagréable d’un très ridicule journaliste, a pu lui imposer silence et lui infliger néanmoins une correction aussi cuisante que méritée. L’Évêque était tout tranquillement accusé de provoquer au régicide, et le joli écrivain qui portait cette accusation prétendait la certifier par la citation textuelle d’un écrit du prélat. Si l’Évêque n’avait pas sérieusement fait entrevoir la policé correctionnelle, jamais son texte n’aurait été rétabli dans le journal qui l’avait sottement falsifié. Même en lui accordant la rétractation humiliante qu’il exigeait, on tâchait de la reprendre, de maintenir la calomnie, d’abuser encore le public. Il ne le souffrit point, écrivit de nouveau, envoya l’huissier, et le spectre correctionnel, à ce second coup, opéra pleinement. Ceux qui s’occupent de la presse doivent étudier cet instructif épisode. On verra comment un vénérable Évêque, un esprit et un talent que la postérité, – s’il y a encore une postérité pour la langue française, – placera sur le rang de Fénelon, a été traité par l’un de ces insignes messieurs qui ont maintenant le monopole de la presse. Et puisque cet Évêque avait lui-même été journaliste, on aura l’occasion de mesurer le progrès qui a fait tomber la presse des mains des Gerbet aux mains des Grandguillot. Notez que parmi les mignons du bureau de la presse, M. Grandguillot ne fut pas ce que l’on a vu de plus défectueux.
Le droit de réponse n’est pas, sérieux. La pratique en est difficile, coûteuse, souvent répugnante, il atteint difficilement le but, il n’est pas entré dans les mœurs. C’est une chose malséante de répondre à certains journaux, et qui peut répondre à tous ? Les journaux n’ayant plus à craindre les conséquences si graves d’une condamnation en police correctionnelle, le droit de réponse devient à peu près illusoire. Si les lenteurs ne suffisent pas pour décourager le réclamant, l’on peut risquer un procès dont l’issue la plus redoutable ne va pas au-delà d’une légère amende et d’un emprisonnement de quelques jours. On le risquera volontiers, lorsque l’emprisonnement devra être le bénéfice d’un secrétaire de rédaction chargé de famille.
La masse des lecteurs se soucie peu de ces aventures et ne s’éloignera pas d’un journal, parce qu’il aura souvent scandalisé l’insouciante probité publique et se sera souvent attiré le châtiment. Mais cette masse ne fait point la force ; et quand le moment est venu, c’est toujours comme au mardi-gras : il suffit de quelques sergents de ville pour appréhender la danseuse au milieu du public honteusement amusé, et la conduire au violon. Vainement elle invoque la « masse, » elle n’y trouve point de répondants.
Ce qui manque à la presse, c’est une certaine existence soumise aux lois et non plus totalement dépendante du pouvoir. Elle n’a aucun besoin d’aucune sorte d’immunité contre les particuliers ou contre les dogmes, tant religieux que politiques. Plus elle devra s’observer elle-même en ce qui regarde les particuliers, plus elle aura la faculté de se contenir elle-même sur le terrain des opinions, plus vite et plus sûrement elle remontera dans l’estime publique. Des droits la relèveraient ; toutes les immunités ne pourront que lui accroître le poids déjà écrasant de la colère et du mépris. En effet, les immunités la rendront de plus en plus insolente et oppressive envers les faibles, la laisseront de plus en plus servile et abaissée devant les forts, ou, pour mieux dire, devant le fort, puisqu’il n’y en a qu’un. Le Gouvernement seul est fort, tout le reste est faible. Ce qu’il protège est respecté, ce qu’il abandonne est vilipendé.
Si les journalistes de ce temps-ci, – ceux qui peuvent parler, – avaient soin de l’honneur de leur profession et de l’avenir de la liberté, s’ils étaient autre chose que des hommes de parti violents et impudents, ou des sicaires dévoués à toutes les besognes rétribuées, ou enfin des esprits perdus d’indifférence, de doute et de paresse, ils ne demanderaient pas des immunités dans la servitude, mais plutôt des responsabilités dans la liberté. Ils rougiraient d’avoir des privilèges et point de droits, des armes et point d’adversaires, d’être enfin une force de pouce contre les idées en pays conquis, plutôt que de loyaux soldats volontairement engagés pour faire légitimement une juste guerre.
Je peux me permettre ce langage. J’ai été journaliste. Durant vingt années, j’ai tenu la plume tous les jours. Quand cette plume a été brisée entre mes mains par un acte aussi facile à prévoir qu’à exécuter, je n’avais, je l’espère, jamais trahi ma profession, embrassée d’un libre choix, expérience déjà faite de tous ses labeurs et de tous ses déboires : Je ne pense pas que dans cet emploi j’aie été volontairement injuste envers personne, ni que j’aie refusé de réparer un tort, sachant l’avoir commis. Je n’ai pas décliné la charge de combattre ce qui me semblait contraire au bien public. J’ai fait de l’opposition sans jamais nier le droit du pouvoir. J’ai pris le parti du Gouvernement sans prétendre à aucune faveur, car je ne soutenais pas le Gouvernement parce qu’il était le Gouvernement, mais parce que, dans ce temps-là ; le Gouvernement était lui-même ma cause ; et en le soutenant je gardais ma liberté et j’en usais. Enfin, je n’ai voulu tromper personne, et c’est ce que j’appelle n’avoir pas trahi ma profession, que j’estime très belle et même glorieuse, lorsqu’elle est exercée assez dignement.
Et comme je ne l’ai pas trahie, je ne l’ai pas lion plus flattée.
Je connais la presse. S’il s’agissait d’en faire présent au monde, j’hésiterais sans doute, et vraisemblablement je m’abstiendrais.
Mais il ne s’agit plus d’installer au milieu de la civilisation cet engin périlleux et peut-être destructeur. Il s’agit de vivre avec lui, d’en tirer le bien qu’il peut produire, de neutraliser, d’atténuer au moins le mal qu’il petit faire.
Je n’ai jamais tu que ce mal ne put être très grand et supérieur probablement au bien ; je n’ai jamais désespéré que le bien ne pût être réel et capable de contrebalancer jusqu’il un certain point le mal.
J’ai toujours pensé que la seule manière de maintenir cette sorte d’équilibre, était de donner à la presse une assez grande somme de liberté, et de lui imposer par des lois sévères une somme égale de responsabilité.
Une liberté illimitée comme on l’a demandée souvent, et telle qu’elle a presque existé quelquefois ; une servitude illimitée telle qu’elle est imposée aujourd’hui, ce sont deux moyens différents mais également efficaces pour faire produire à la presse le mal absolu. Alors elle est véritablement et exclusivement un instrument de destruction. Dans les deux cas, au point présent de la civilisation, avec l’influence que la presse y exercé nécessairement, l’autorité, la religion, la morale, l’art, la langue, la politesse des mœurs, ne peuvent avoir un ennemi plus redoutable que la presse complètement libre ou complètement asservie.
DEUX FIGURES.
Galvaudin est homme de lettres et député. Comme homme de lettres, ses opinions sont larges ; comme député, ses votes sont décents. Comme homme de lettres et comme député ; il écrit dans le Mercure belge ; là, il concilie la décence et la largeur.
Il est si bien renseigné qu’il ne fait jamais passer que les nouvelles qu’il faut.
Pour varier ses correspondances et égayer la gravité des communications politiques, il hante les grands festins officiels. Comme député, il les mange ; comme homme de lettres, il les décrit ; comme correspondant du Mercure belge, il se les fait payer. Il faut bien qu’il mange pour décrire, il faut bien qu’on le paie puisqu’il a décrit. Heureux Galvaudin ! Chaque coup de fourchette qu’il donne, c’est vingt sous qu’il met dans sa poche, peut-être trente sous. Le Mercure ne saurait se montrer chiche envers un homme qui ne fait passer que les nouvelles qu’il faut.
L’homme qui ne fait passer que les nouvelles qu’il faut est très utile pour plaider en faveur de celui qui fait passer les nouvelles qu’il ne faut pas. L’innocent obtient la grâce du coupable.
Dernièrement Galvaudin entretenait le monde du grand dîner de Son Excellence Monsieur le…
Monsieur le… connaît les hommes. Il a deux chiens qu’il aime par-dessus tout. Ces deux chiens restent dans son antichambre lorsqu’il reçoit. En reconduisant ses visiteurs, il prend plaisir à regarder ses chiens. Un jour qu’il reconduisait Galvaudin, il lui a dit : – Voilà de nobles bêtes ! de nobles créatures de Dieu !
Après la description du dîner et des convives, le publiciste et législateur Galvaudin est venu aux chiens de Son Excellence. Il leur a consacré une quinzaine de lignes, contenant le détail de leurs grâces et traits d’esprit.
Mais Alceste se fâcherait-il si c’était son chien et non son valet de chambre qu’on eût mis dans les gazettes ? La gloire du valet de chambre est personnelle ; la gloire du chien retourne toute à son maître.
Le même flatteur de chiens, dans le même Mercure, a beaucoup vanté les bottes d’un autre ministre. C’était un ministre encore jeune, qui posait un peu pour le pied. Galvaudin a dit comme ce ministre était bien chaussé, et ses bottes bien luisantes ; il s’est étonné qu’un simple mortel pût trouver un si beau vernis.
Ne le croyez point si absolument sot. Il ignore peut-être pourquoi vous ne l’estimez pas, mais il sait bien que ce grand personnage aime ses chiens, et cet autre ses bottes, et qu’il se rend agréable en appuyant sur le mérite des chiens et en faisant reluire les bottes. Cette note pourra n’être pas superflue. Elle pourra maintenu des électeurs, elle pourra faciliter l’octroi d’une concession. Quant à la moralité, hélas ! Galvaudin n’est qu’un précurseur. Le temps vient, et c’est maintenant, où ces bassesses n’étonneront plus. Laissez mourir quelques hommes, laissez tomber quelques souvenirs, vous verrez ! Galvaudin lui-même trouvera qu’on va bien loin, il dira, et il n’aura pas tort qu’il gardait mieux la dignité qui convient au député et à l’homme de lettres.
Au commencement de la guerre d’Italie, Jubin rédigeait un journal par autorité de Justice. C’est-à-dire que les propriétaires le voulaient mettre à la portée, s’apercevant qu’il tuait l’abonné ; mais la Justice a ses idées, qui ne sont pas toujours les nôtres, et elle maintenait Jubin. Naturellement il était Italien, italianissime. Oh ! comme l’abonné tombait. Un jour, saisi d’un beau zèle, totalement résolu d’affranchir la patrie du Dante et de n’y plus souffrir un Autrichien, il conseilla aux Italiens « la guerre au couteau. » Pour le coup, il fit sensation.
Personne ne le croit méchant dans l’âme, et l’on accordait qu’il n’avait dit cela que pour dire quelque chose. – Hélas ! pensaient les propriétaires du journal, nous nous moquons bien de son couteau ! C’est sa plume qui tranche nos destinées…
Toutefois ce tour de littérature parut un peu sauvage, surtout en premier-Paris. Et comme Jubin est député, ou le pria de veiller à ne pas trop contaminer le Corps. L’affaire devenait grave ; Jubin, qui d’abord n’en avait fait que rire, se rétracta, protestant qu’il n’avait voulu parler que de tout petits couteaux, et encore par figure de rhétorique.
Mais la Justice n’en eut pas le démenti : le journal creva.
BONIFACE !
Un grand journal, bien imprimé, sérieux, vertueux même, et même religieux ; un journal qui a ce que l’on appelle de la tenue, c’est le Constitutionnel. Là écrivent Dréolle, Vitu, Grandguillot, Limayrac, tous chevaliers de la Légion d’honneur et de plusieurs ordres étrangers ; et quelquefois des dieux y prennent la plume sous le nom de Boniface.
Boniface, qu’est-ce que c’est ? Cela se murmure, on ne l’articule pas. « Autant le ciel est au-dessus de la terre, a dit un jour l’ami Guéroult, qui sait bien des choses, autant Boniface est au-dessus de Grandguillot ! » Voilà de quoi rêver, car Dréolle et Vitu sont grains de poussière devant Grandguillot, qui n’est rien devant Boniface.