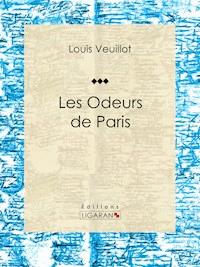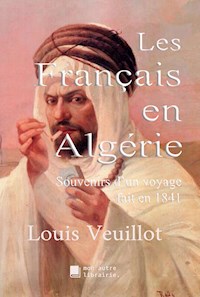
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Récit d'un voyage de découverte dans l'Algérie à peine conquise, et pas vraiment soumise. L'auteur a pu visiter différentes régions, discuter avec plusieurs acteurs de la conquête, et il nous raconte cette inconfortable rencontre avec un monde qu'il s'efforce de comprendre, mais qu'il aborde avec tous ses préjugés d'Européen chrétien sûr de ses valeurs. Naissance en direct d'un long malentendu.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 578
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fait par Mon Autre Librairie
À partir de l’édition Mame, Tours, 1845
__________
© 2020, Mon Autre Librairie
ISBN : 978-2-491445-25-6
Les Français en Algérie
Souvenirs d’un voyage fait en 1841
Louis Veuillot
Table des matières
Introduction
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Chapitre XVI
Chapitre XVII
Chapitre XVIII
Chapitre XIX
Chapitre XX
Chapitre XXI
Chapitre XXII
Chapitre XXIII
Chapitre XXIV
Chapitre XXV
Chapitre XXVI
Chapitre XXVII
Chapitre XXVIII
Chapitre XXIX
NOTES DE FIN
Introduction
Ce n’est ici le travail ni d’un militaire, ni d’un politique, ni d’un administrateur, ni d’un savant : c’est simplement un ouvrage littéraire. Je n’ai d’autre prétention que de raconter quelques faits isolés qui m’ont paru intéressants. Je crois qu’ils ne seront pas tout à fait inutiles ; j’espère qu’ils inspireront à la plupart de mes lecteurs quelques bonnes réflexions qu’ils ont souvent fait naître en moi. Instruire un peu, faire quelquefois prier, c’est l’unique but que je me sois proposé toutes les fois que je me suis vu, une plume à la main, en présence d’une feuille de papier blanc ; c’est l’unique but que je me propose aujourd’hui. Je laisse à d’autres des travaux plus complets et plus sérieux sur le même sujet. Le temps d’écrire une histoire de la conquête d’Alger n’est pas encore venu, car l’Algérie n’est pas encore conquise ; ce pays n’est pas même encore connu : ce n’est donc pas encore le temps de le décrire. D’ailleurs le loisir, les documents, le talent, tout me manque pour entreprendre l’une ou l’autre de ces œuvres.
Mais il est toujours temps de rassembler des matériaux pour les monuments futurs. On y a amplement travaillé. Des hommes capables, des hommes dévoués ont fourni leur tribut, qui s’accroît sans cesse : j’apporte ma petite pierre. Puisse-t-elle avoir sa place dans l’édifice ! En tout cas, je fais preuve de bonne volonté.
Les derniers jours de l’islamisme sont venus [Note_I] ; notre siècle est probablement destiné à le voir quitter les rivages de l’Europe, non seulement de cette vieille Europe qu’il a jadis envahie et si longtemps menacée, mais de cette Europe nouvelle et agrandie qui est née partout où l’Europe ancienne a porté la croix. Attaqué sur tous les points, le croissant se brise et s’efface. Dieu le refoule ; il l’envoie, au temps marqué, périr dans les déserts d’où il est sorti. Des calculs établis sur l’Apocalypse de Saint Jean et sur les prophéties de Daniel assignent au règne de Mahomet une durée de treize siècles. Le treizième siècle n’est pas achevé, et voici que Byzance va retomber aux mains chrétiennes. Alger, dans vingt ans, n’aura plus d’autre Dieu que le Christ ; dans vingt ans, Alexandrie sera anglaise, et que sera l’Angleterre dans vingt ans ? Où n’ira pas la croix quand Alexandrie, Alger, Constantinople seront ses points de départ ? Il ne faut pas faire entrer en ligne de compte l’indifférence des peuples et la politique impie des princes. L’indifférence des peuples n’a qu’un temps, l’iniquité des princes n’a qu’une heure. Un quart de siècle peut changer la face du monde, et qu’importent les desseins des hommes contre les desseins de Dieu ! Les conquêtes que l’Europe ne voudrait pas faire pour la foi, elle les fera pour le commerce ; les missionnaires iront à la suite des marchands, comme ils allaient à la suite des croisés. Nous croyons nous livrer au négoce, et nous achevons les croisades. Nos marchands incrédules terminent l’œuvre des fervents chrétiens du moyen âge. Toute terre où ils s’établissent en force suffisante pour y être chez eux est une terre où l’on dit la messe, où l’on baptise les enfants, où les saints, quel qu’en soit le nombre, font retentir les louanges du vrai Dieu. Il y a là, n’importe à quel titre, une civilisation au voisinage de laquelle l’islamisme ne peut tenir. Il lui faut, comme aux bêtes des forêts, un rempart de solitude. À mesure que la lumière se fait, il s’éloigne ; il va chercher des civilisations inférieures. Son croissant est un astre de nuit : que les déserts l’accueillent jusqu’au jour où il doit s’éteindre absolument et n’être plus qu’un nom dans l’histoire ! Il fera tomber les fétiches et ne leur survivra pas. Déjà l’on peut considérer son rôle comme fini, non seulement dans l’Algérie, où règne aujourd’hui la croix avec la France, mais dans toute cette partie de l’Afrique que baignent les flots de la Méditerranée. Le sang des compagnons de saint Louis, répandu sur les plages de Tunis, est un vieux titre que nous serons contraints de faire valoir un jour ; entre notre province de Tlemcen et les rivages de l’Espagne régénérée, l’air manquera aux prétendus descendants du Calife qui font encore peser sur le Maroc leur sceptre barbare. Quel sera l’agent de ces révolutions prochaines ? Le commerce, la guerre, les discordes intérieures ? Je l’ignore ; mais je sais que les événements ne manquent jamais aux desseins de Dieu. Or il faut être aveugle pour ne pas voir que c’est le dessein de Dieu d’en finir avec l’islamisme, et dès lors tout y concourra. En ce moment même, pour ce qui concerne l’Algérie, l’œuvre divine est consommée. Si l’on peut douter encore que ce sol reste à la France, il est évident du moins que l’islamisme l’a perdu. L’Europe ne se laissera pas arracher un royaume dont elle connaît la fertilité, que nous lui avons appris à conquérir, et que la vapeur rattache à son continent comme un pont relie entre elles les deux rives d’un fleuve. Anglaise, allemande, espagnole ou française, l’Algérie est possession chrétienne, elle n’est plus musulmane, et ni Tunis ni Maroc ne sauraient l’être encore longtemps. Voilà ce que Dieu a fait : grâces lui soient rendues d’avoir bien voulu se servir de nos mains ! Quoi qu’il arrive, nous pouvons prendre le récit inachevé des croisades, et aux gesta Dei per Francos, ajouter une noble page encore écrite de notre sang.
La France, il est vrai, semble n’avoir pas eu l’intelligence du grand rôle dont elle s’est vaillamment acquittée. Elle a voulu travailler pour sa gloire, non pour la gloire de Dieu. Dans ses délibérations, lorsqu’elle prodiguait à regrets, pour une conquête jugée désastreuse par beaucoup de bons esprits, ses trésors et ses soldats, jamais elle n’a dit qu’elle voulût conquérir un royaume à l’Évangile ; ce n’a été la pensée ni de ses hommes d’État, ni de ses hommes de guerre, ni de cette foule impatiente qui, par la presse ou par la parole, se rue incessamment au milieu des délibérations publiques. Mal venue eût été la voix qui se fût élevée pour développer ces idées d’un autre âge ; et quand le pape, instituant l’évêché d’Alger, parla de rendre sa gloire ancienne au siège si longtemps outragé des Eugène et des Augustin, nul n’y prit garde. On ne vit là que les formules convenues de la chancellerie romaine. La question était de savoir si la conquête serait une bonne ou une mauvaise affaire. L’orgueil de nos armes, les profits de notre commerce offraient la matière du débat. Les uns peignaient comme une terre promise ces provinces encore inconnues ; les autres, et les plus compétents, n’en traçaient que des tableaux lamentables, additionnaient les dépenses, comptaient les morts et demandaient qu’on leur montrât le fruit de tant de sang versé, de tant d’argent englouti. Nulle réponse n’était possible, le pouvoir partageait secrètement l’avis des plus désespérés ; et néanmoins on allait de l’avant, on cédait à la force de cette opinion ignorante qui ne voulait point entendre parler de retraite, et qui jurait qu’on abandonnait des trésors. C’est ainsi que l’Algérie fut conquise, et que la croix prit possession de ce nouveau domaine. Les erreurs de l’opinion y servirent, l’ambition militaire y servit davantage, la peur et la faiblesse du gouvernement y contribuèrent plus que tout. C’est un fardeau, c’est une gloire. Il y avait deux partis : l’un qui redoutait le fardeau, l’autre qui se souciait peu de la gloire. Dieu nous a donné la gloire et le fardeau. À l’écart, dans le mystère, quelques âmes ferventes, songeant avant tout aux progrès de l’Évangile, l’avaient peut-être prié de ne songer qu’à sa cause.
J’ai vu l’Algérie à une époque où le grand résultat aujourd’hui visible était encore douteux. C’était en 1841, lorsque M. le maréchal Bugeaud fut nommé gouverneur. J’avais l’honneur d’accompagner cet homme illustre, et j’ai été son hôte, presque son secrétaire, pendant les six premiers mois de son administration. Je ne trahirai pas sa confiance en disant qu’il n’espérait pas lui-même les succès qu’il a obtenus. Après dix années d’efforts, l’œuvre de la conquête semblait moins avancée qu’aux premiers jours. Les Arabes étaient organisés, et jusqu’à un certain point ils étaient vainqueurs. Nous avions mal guerroyé, mal administré, mal gouverné. La colonisation était nulle. Nous possédions bien çà et là, sur le littoral et à quelque distance dans l’intérieur, quelques villes, ou plutôt quelques murailles ; mais nous y étions prisonniers. La guerre grondait aux portes d’Oran et de Constantine ; il fallait du canon pour aller d’Alger à Blida ; il fallait une armée pour ravitailler nos garnisons captives de Miliana et de Médéa. Cette armée en marche était bloquée par une autre armée invisible, qui ne laissait aucun Arabe de l’intérieur communiquer avec les chrétiens. Abd el-Kader nous avait joués dans les négociations, il nous jouait à la guerre. On le sentait partout, on ne le voyait nulle part. S’en remettant à la fatigue, au soleil, à la pluie, du soin de nous vaincre, jamais il n’offrait, jamais il n’acceptait le combat ; mais il avait gagné une bataille lorsque, après l’avoir longtemps poursuivi sans l’atteindre, l’armée française, dépourvue de vivres, accablée de lassitude, jalonnant le chemin de ses morts, revenait confier aux hôpitaux, qui ne les rendaient plus, la masse effrayante de ses malades et de ses éclopés. J’ai vu ces lamentables files de l’ambulance défiler, après une campagne de quelques jours, dans les ravins néfastes de Mouzaïa : j’ai vu le brave colonel d’Illens, glorieusement mort depuis, échappé, lui douzième, des douze cents hommes qui formèrent la première garnison de Miliana, et portant encore sur son visage les traces de la maladie qu’il y avait contractée. De ces douze cents hommes, le fusil des Arabes n’en avait peut-être pas tué cinquante ! Ainsi se faisait la guerre, et telles étaient les garnisons ! Embusqué dans les passages difficiles, l’ennemi nous tuait quelques soldats à coups invisibles et sûrs, son feu faisait quelques blessés à l’arrière-garde ; mais le soleil, mais la pluie, mais la nostalgie et la faim suffisaient à borner nos entreprises. Nous avions organisé avec mille peines un convoi monstrueux, fait des dépenses énormes ; nous marchions cinq à six jours sans tirer un coup de fusil ; nous remplacions des captifs mourants par d’autres captifs que décourageait déjà la vue de leurs prédécesseurs, et il nous restait à engloutir, dans des asiles infects, quelques centaines de fiévreux dont la moitié mouraient en peu de jours, et le reste plus lentement. Ce que nous appelions notre colonie d’Alger n’était qu’un hôpital dans une prison.
Les indigènes n’avaient pas cessé d’estimer et de craindre notre bravoure, mais ils connaissaient notre impuissance, habilement exploitée par Abd el-Kader et par ses lieutenants. Ils ne doutaient pas que nous n’en vinssions bientôt à nous décourager d’une lutte stérile et ruineuse. S’ils connaissaient la valeur et les talents militaires du nouveau gouverneur général, ils n’ignoraient pas qu’il avait été le négociateur de la Tafna. Abd el-Kader, politique aussi habile que courageux homme de guerre, prenait soin de leur en rafraîchir la mémoire ; il persuadait à ses crédules sujets, ce qu’il croyait peut-être lui-même, que l’arrivée du général Bugeaud était l’indice d’une nouvelle paix, plus favorable encore pour eux que la première. Cette conviction excitait au plus haut point leur ardeur. Il s’agissait de se montrer en force pour obtenir de meilleures conditions, pour nous les arracher. Le sentiment religieux venait au secours du sentiment national et lui communiquait une force merveilleuse. La guerre contre nous n’était pas seulement patriotique, elle était sainte. Elle obtenait des sacrifices qu’il faut savoir honorer. Quelques-uns de ces Arabes ont combattu en héros et sont morts en martyrs. Envahisseurs du sol, détestés à ce titre, nous étions encore et surtout haïs et méprisés comme infidèles, comme impies. On nous reprochait nos mœurs, nos blasphèmes, notre religion fausse ; on nous reprochait plus encore notre irréligion. C’était œuvre de piété de faire la guerre aux chiens qui adorent les idoles ou qui n’ont pas de Dieu. Plus d’un soldat, égaré le soir à quelques pas de la colonne, a péri de la main des Douaires, nos alliés, qui croyaient se laver ainsi du crime de nous servir. Un jour, dans une razzia que faisaient ces mêmes Douaires, sous la conduite du général Lamoricière, une femme de la tribu attaquée s’étant écriée à leur vue : Voilà les baptisés ! ce mot excita en eux une telle rage qu’ils massacrèrent tout ce qui leur tomba sous la main, et jusqu’aux enfants. Mustapha lui-même, depuis si longtemps à notre solde, partageait la fureur de ses cavaliers. Le commandant Daumas1, un de nos meilleurs et de nos plus utiles officiers, parfaitement versé dans la langue et les usages arabes, m’a dit avoir entendu souvent des cavaliers auxiliaires déplorer entre eux leur situation, envier le sort des braves morts en combattant contre nous. « Qu’ils sont heureux, disaient-ils ; Dieu les a récompensés ! » Et le lendemain on apprenait de nouvelles désertions. Cette tribu des Douaires et des Smélas, qui, sous les Turcs, tenait en respect toute la province d’Oran, s’était réduite à six ou sept cents cavaliers. Leur vieux chef Mustapha n’aurait eu qu’un mot à dire pour les emmener tous à l’ennemi, et probablement nous n’avons dû qu’à sa haine particulière contre Abd el-Kader de le voir jusqu’à la fin sous nos drapeaux.
La province de Constantine, plus tranquille en apparence, était pleine de sourds ferments ; de dangereuses intrigues s’y tramaient de toutes parts. Ben-Aïssa, rusé Kabyle, assez adroit pour avoir obtenu du vainqueur de Constantine la disgrâce du général de Négrier, conspirait, malgré nos bienfaits, avec Ahmet Bey, son ancien maître. Hamelaouy, chef arabe comblé des faveurs de la France, nouait des relations avec Abd el-Kader. Nous n’étions sûrs de personne, sauf peut-être de quelques caïds pillards, qui foulaient les tribus à l’abri de notre autorité, et qui, sans se tourner les premiers contre nous, n’auraient pas manqué cependant de se mettre du parti de la révolte à son premier succès. Un soulèvement était imminent à Constantine.
Aucune terre n’était cultivée nulle part, à moins qu’on n’accorde le nom de terre cultivée à quelques jardinets situés sous le fusil des remparts, où l’on récoltait un peu de légumes et de salades, qui se vendaient à prix d’or. La viande, les fruits, le pain, le fourrage, tous les objets de consommation venaient par la mer. Nous ne nous levions guère de table que le gouverneur général n’eût calculé avec amertume la somme que le repas que nous venions de faire avait coûtée à la France, sans compter le sang. Lorsqu’on lui parlait alors de la colonisation et des colons d’Alger, son bon sens n’y pouvait tenir ; il se répandait en railleries poignantes contre ce mensonge criant, n’épargnant personne et s’inquiétant peu de savoir qui l’écoutait. J’en gémissais comme d’une faute politique, car ces discours étaient interprétés et commentés au détriment de son patriotisme ; mais j’honorais davantage sa probité, sa franchise et son cœur, et j’admirais ce patriotisme que l’on méconnaissait tant. À peu d’exceptions près il n’y avait guère dans l’Algérie d’autres colons que les fonctionnaires, les agioteurs et les cabaretiers.
Les mœurs étaient déplorables. C’était la France sans police et sans hypocrisie. On imagine assez quel pouvait être le côté moral d’une population de militaires mêlée d’aventuriers, gouvernée par des généraux déjà si préoccupés de la guerre et des affaires. Nous faisions rougir, je ne dirai pas la vertu musulmane, je n’y crois guère, mais la pudeur et la dignité des Maures et des Arabes, qui en ont beaucoup. Ils nous reprochaient, comme je l’ai déjà dit, qu’on ne nous voyait jamais prier ; ils parlaient de nos soldats ivres dans les rues, de cette prostitution qui s’étalait au grand jour, et que les Turcs réprimaient sévèrement. Nous ne leur reprochions pas leurs débauches secrètes, et, loin de là, nous les imitions. On racontait tous les jours, en riant, des infamies qui semblaient avoir été apprises à l’école de Tibère et d’Héliogabale. C’était là le mal qu’on s’occupait le moins de réprimer, et à peine souvent y voyait-on un mal.
On continuait d’écrire en France des merveilles de l’Algérie ; mais chacun, cependant, même parmi ceux qui tenaient la plume, j’en excepte à peine quelques misérables fournisseurs de journaux, trop stupides pour rien comprendre et rien voir – chacun s’avouait que les choses ne pouvaient marcher ainsi, que c’était une tromperie infâme, que ces mensonges ne remédiaient point au péril, et qu’enfin, tout en chantant victoire, il faudrait bientôt, si l’on ne changeait de voie, lever le pied et s’en aller honteusement. Là-dessus on était d’accord. Pour éviter un tel malheur, une telle honte, que faire ?
Les systèmes les plus divers, les plus contradictoires, les plus absurdes, sur la guerre, sur l’administration, sur la colonisation, étaient proposés, proposés sérieusement, et, chose lamentable, appuyés par des hommes compétents, par des savants, par des fonctionnaires anciens dans l’Algérie, par des officiers qui avaient fait la guerre longtemps et avec succès. Les uns voulaient borner l’occupation, les autres l’étendre ; les uns ne tenir nul compte des indigènes, les autres s’occuper d’eux exclusivement. Chacun démontrait parfaitement que les autres demandaient l’inutile et l’impossible, et les autres, à leur tour, n’avaient pas de peine à lui prouver que son plan péchait par les mêmes torts. Ajoutez-y le bruit des journaux, qui ne parlaient que de la trahison du gouverneur ; les directions de deux ou trois commis qui, de leurs bureaux au ministère de la guerre, à Paris, prétendaient tout régler et tout faire, et qui envoyaient, pour raison sans réplique, la signature du ministre ; ajoutez-y les discussions des chambres, où l’avis le mieux développé, le mieux écouté n’est pas toujours le plus sage, où des orateurs se croyaient et étaient crus bien au courant des matières d’Alger pour avoir fait une courte apparition sur la côte, questionné un interprète ou un Juif, reçu quelques lettres, ceux-ci d’un enthousiaste, ceux-là d’un mécontent ; ajoutez-y cette horreur que nous inspirent en général les dépenses opportunes, et qui, dans une grande affaire, nous porte à lésiner sur un détail important, vous n’aurez encore qu’une faible idée des obstacles qui se présentaient, qui s’accumulaient de toutes part2. Certes, pour arriver si vite où nous en sommes maintenant, il a fallu déployer de rares talents, et les déployer avec une rare énergie ; mais il a fallu plus visiblement encore que Dieu l’ait voulu. Nous ne voyons pas toute la grandeur de l’œuvre, il est déjà temps de louer Dieu.
C’est durant l’époque malheureuse que je viens d’esquisser que j’ai visité une partie de l’Algérie. Un séjour de six mois au centre même des affaires, deux courses, dont une assez longue, à la suite de l’armée, des informations prises à bonne source, des notes recueillies dans les documents officiels, un désintéressement parfait, un ardent désir d’être utile, m’avaient permis de croire que je pourrais, à mon retour, publier un livre assez intéressant après tous ceux qu’on a publiés. Je ne me proposais pas de présenter un système, comme c’est assez la mode, mais de rendre devant Dieu et devant les hommes un témoignage sincère de ce que j’avais appris et de ce que j’avais vu. Les événements se pressèrent ; nos affaires, conduites par une main habile et vigoureuse, changèrent rapidement de face et firent changer l’opinion ; mon livre devint inutile avant que je l’eusse commencé. Je m’en félicitai plus que personne, et je ne songeais plus à mes notes, lorsque MM. Mame, dont l’excellente librairie est un moyen de propagande si puissant, me les demandèrent pour cette masse de lecteurs, la plupart jeunes, qu’ils ont su trouver, et en quelque sorte créer.
Je conçus alors un ouvrage tout différent de celui que j’avais compté faire, beaucoup plus modeste sans doute, mais plus agréable à lire. Laissant de côté les vues d’ensemble et des conseils qui ne sont plus nécessaires, je me borne à un choix de tableaux et de récits sur ce qui est désormais le passé, le mauvais passé de l’Algérie. On ne sera pas fâché, maintenant que les omnibus vont à Médéa, de voir comment y allait naguère une armée ; de suivre nos soldats dans ces marches toujours pénibles, mais qui ne sont plus meurtrières, dans ces garnisons qui deviennent de véritables villes, et qui n’étaient que d’infects cachots. Il me semble aussi que certains détails, certains contrastes entre la civilisation française, telle qu’elle se montre en Algérie, et la civilisation des Maures et des Arabes, n’ayant pas été saisis par des yeux chrétiens, courent risque de n’être point notés, et que c’est un document qu’il faut laisser à la philosophie et à l’histoire ; je sais des anecdotes qui, si je ne m’abuse, et si je puis les conter, offrent, indépendamment du pittoresque dont s’égaye l’esprit, quelque chose qui peut attacher la raison et toucher le cœur ; enfin, les choses religieuses de l’Algérie n’ont qu’une bien étroite place dans presque tous les livres qu’on a faits ; elles en méritent une meilleure, que je voudrais leur donner. Suis-je téméraire d’avoir pensé que ce spectacle varié ne serait pas sans intérêt pour de jeunes lecteurs, ne serait pas sans utilité pour des lecteurs plus réfléchis et plus difficiles ?
Si j’en ai de cette dernière et rare catégorie, je les prie de ne point se laisser rebuter dès les premières pages par la simplicité des sujets et par le laisser-aller de tout le livre. Qu’ils y pénètrent un peu plus loin, j’ai la confiance qu’ils trouveront dans ma déposition de quoi les intéresser, et peut-être en tireront-ils des conclusions que parfois je ne formule pas. Le meilleur architecte accepte des mains d’un manœuvre des matériaux dont celui-ci ne connaît pas toujours le prix.
Quant à mes jeunes lecteurs, ils sauront, dans la plupart des asiles où ce livre ira les trouver, des choses que je souhaite qu’ils n’oublient pas, et que la plupart des sages et des savants ignorent : c’est que l’homme ne fait rien de bon si Dieu ne l’aide, et s’il ne demande à Dieu de l’aider. Cette première condition du succès a manqué à notre établissement en Afrique et lui manque encore ; les yeux chrétiens s’en aperçoivent. Malgré tout ce que nous avons fondé, nous avons perdu là des âmes que nous pouvions sauver, nous n’avons pas fait à la croix le même honneur qu’à nos drapeaux. Dieu nous en a punis, moins qu’il ne pouvait le faire, car sa clémence est grande ; moins qu’il ne le fera peut-être, car sa justice est terrible. Qu’ils prient donc pour cette grande œuvre de l’Algérie, en bonne voie aujourd’hui mais non encore terminée ; qu’ils prient pour que la France, ayant accru son territoire, accroisse aussi le royaume de Dieu ; qu’ils prient comme chrétiens, qu’ils prient comme Français.
Un dernier mot.
M. le maréchal Bugeaud a glorieusement servi son pays ; on commence à le reconnaître, mais les passions politiques lui contestent encore cette gloire3, et comme j’aurai souvent à lui rendre justice, peut-être me reprochera-t-on de n’avoir voulu faire que l’apologie d’un homme assez puissant pour bien récompenser mes faibles services. Il faut s’attendre à tout dans un temps comme le nôtre, où la presse, instrument ordinaire des passions les plus basses et des entreprises les plus viles, fournit chaque matin mille exemples qui autorisent tous les soupçons. Ma réponse sera courte : je loue M. le maréchal Bugeaud de sa bravoure, de son bon sens, de sa probité, de son patriotisme ; il possède au plus haut degré ces qualités glorieuses. Je regrette que son gouvernement, d’ailleurs bienveillant pour la religion, ne s’inspire pas plus largement des lumières catholiques, et ne diffère que bien peu, à cet égard, de celui de nos préfets. Du reste, mon langage n’est et ne peut pas être celui d’un obligé envers un bienfaiteur, encore moins celui d’un ambitieux envers un patron. Je ne dois rien à l’illustre maréchal, que beaucoup de gratitude pour l’affection qu’il m’a longtemps témoignée. Si j’avais à le blâmer, ce souvenir pourrait me conseiller le silence. Je n’ai qu’à le louer, et ma conscience me dit que ces éloges sont légitimes. Pour m’en convaincre, il suffirait d’un regard jeté sur ma situation actuelle : c’est déjà frappé par un jugement politique, et m’exposant tous les jours à en subir un second, que je me plais à rendre justice, sur un terrain neutre, au plus zélé partisan d’un pouvoir qui devient l’irréconciliable adversaire de la cause à laquelle j’ai dévoué ma vie. Il n’est pas possible d’être placé dans une condition d’impartialité plus sûre. Je ne saurais être suspect de trop de zèle pour un homme dont la haute influence ne s’emploiera vraisemblablement jamais en faveur des catholiques, et je ne me sens pas pressé de me ménager des grâces dont je ne pourrais jouir qu’au prix d’une apostasie.
Chapitre I
De Paris à Marseille. – Un sauvage. – La religieuse d’Orgon.
C’est une grande joie de courir vers le soleil : j’avais laissé le brouillard et la boue à Paris, je trouvai le lendemain la neige en Champagne ; mais nous ôtâmes nos manteaux à Moulins, nous baissâmes les stores de la voiture sur les bords du Rhône, entre Orange et Avignon, et nous trouvâmes la poussière entre Avignon et Marseille. Du reste nulle aventure de voyage. Jusqu’à Moulins nous étions quatre dans la malle : un marchand, un commis-voyageur, et un gros homme qui vivait pour son plaisir. Le marchand était niais, le commis-voyageur était stupide ; le gros homme, à qui son costume sévère et ses moustaches rabattues donnaient l’air d’un officier, n’était qu’un viveur bel esprit. Tous trois affectaient un cynisme immonde, et par occasion une impiété de laquais, même ce nigaud de marchand, à qui je fis avouer qu’il avait une femme et des filles, et qui en rougit. Après le premier repas, qui eut lieu assez tard, la conversation vint à rouler sur le progrès. Nous avions fait la connaissance, quoique je n’eusse parlé que fort peu. J’opinai comme les autres, et je soulageai mon cœur. Je pris la liberté de dire à mes compagnons que tous les progrès ne me réjouissaient pas, et que j’en connaissais de déplorables. « Vous ne nierez pas, me dit le commis-voyageur, l’amélioration des malles postes. Nous faisons en ce moment quatre lieues à l’heure ; nous allons plus vite, et nous payons moins cher qu’autrefois. – Il en résulte, lui dis-je, que tout le monde prend les voitures, et l’on se trouve exposé à de fâcheux compagnons ; la route est encore fort longue lorsqu’il faut la faire avec des gens mal élevés. » Tout le monde en convint, surtout le commis-voyageur, et l’on se remit aux propos anacréontiques. Je me tus jusqu’à Moulins, où le commis-voyageur et le marchand nous quittèrent. Resté seul avec moi, le gros bonhomme voulut continuer ; je lui dis doucement que j’étais chrétien, et que je causerais volontiers avec lui, mais qu’il fallait parler d’autre chose. Je pensais qu’il allait me bouder ; tout au contraire, il se montra fort gracieux et chercha même à s’excuser, disant qu’il était garçon et qu’il parlait librement, mais que dans le fond il ne manquait pas de religion ; qu’il n’avait jamais cherché à vexer les prêtres, et que toutes les fois qu’il rencontrait un mort, il le saluait. Je le louai de ces bonnes dispositions, et je lui demandai s’il faisait ses prières. Il me répondit qu’il n’en savait point. « Pourquoi donc, lui dis-je, saluez-vous les morts ? – C’est, me répondit-il, une coutume d’enfance. Cela m’est resté, mais en vérité je n’en sais pas plus long. »
Cet homme, déjà sur les frontières de la cinquantaine, assez instruit, ainsi que je pus voir, et assez riche, puisqu’il voyageait uniquement en vue de se distraire, ne savait véritablement pas un mot, pas un seul mot de la religion catholique, au sein de laquelle il était né, et avait vécu un demi-siècle. Il me fit des questions qu’aurait pu me faire un sauvage, et encore un sauvage aurait-il eu son Manitou. « Quoi ! m’écriai-je, vous n’avez jamais été curieux de savoir ce que signifiaient ces églises, ce que faisaient ces prêtres, quel était ce culte qui a si souvent frappé vos yeux ? – Que voulez-vous ? dit-il ; on ne m’a jamais parlé de cela, et je me suis toujours occupé d’autre chose. »
Il était vraiment bon homme. Je poussai plus loin mes questions. Je lui demandai ce qu’il avait fait depuis qu’il était au monde. « J’ai fait mes classes, dit-il, qui m’ont ennuyé ; et ensuite j’ai cherché à m’amuser. J’y ai réussi quelquefois, pas toujours. »
En somme, il allait à Marseille pour manger des clovisses ; il comptait de là se rendre en Italie pour y passer le printemps, revenir en Suisse pour l’été, à Paris pour l’hiver. Il faisait un peu de littérature, un peu de musique, beaucoup de cuisine, et cherchait les meilleurs moyens d’être bien logé, bien couché, bien vêtu, bien nourri. Il ne voulait point se marier, par crainte des embarras de la famille ; il avait mis en rentes toute sa fortune, pour éviter les embarras de la propriété. « Je suis, me dit-il à la fin en souriant, un vrai pourceau d’Épicure. »
Je l’avais déjà pensé.
Nous étions sortis d’Avignon depuis longtemps. La nuit était venue. Un vent assez piquant soufflait du nord, et venait tracasser mon gros homme à travers les portières de la malle. Il s’enveloppa très artistement de son manteau, remarquant que c’était un bon temps pour dormir dans une chambre bien close. « Écoutez, lui dis-je, nous allons passer à Orgon. Là s’est établie, il y a vingt ans, une pauvre femme qui, sans un sou dans sa poche et sans un ami dans le monde, avait résolu d’élever à ses frais un bel hôpital pour les pauvres du pays. Elle se construisit sur le bord de la route une hutte misérable, et se mit à demander l’aumône aux passants. Depuis lors il n’a pas passé une voiture, publique ou particulière, dont elle ne se soit approchée. N’importe à quelle heure du jour ou de la nuit, dans toutes les saisons, par tous les temps, elle a toujours été là, elle y est toujours. Son hôpital est bâti, les pauvres y sont reçus et soignés par des religieuses dans la compagnie desquelles elle est entrée ; mais elle veut perfectionner son ouvrage, ajouter de nouveaux bâtiments, faire place pour de nouveaux lits, laisser des rentes à ses chers pauvres. J’espère qu’elle viendra quêter auprès de vous, et j’espère bien aussi que vous lui donnerez quelque chose. – Certainement, me dit-il avec un empressement dont je fus ravi, certainement je lui donnerai. Que je meure si je ne lui donne pas quarante sous ! » Sur cette assurance, je le laissai dormir.
J’attendais impatiemment ce relais d’Orgon. Je n’avais jamais vu la sainte fille dont je venais de parler, et je regrettais de l’avoir refusée une fois, à une autre époque, par paresse, ne sachant pas alors cette histoire, qui arrache des largesses même aux incrédules, même aux impies systématiques. Un protestant l’avait racontée tout récemment devant moi, au milieu d’une compagnie nombreuse ; et chacun, émerveillé d’une si courageuse et si persévérante vertu, avait formé le vœu de traverser Orgon pour verser son offrande à l’escarcelle de l’hospitalière. Nous arrivâmes, la malle s’arrêta, et bientôt une lanterne s’approcha de la portière, une voix douce nous demanda pour les pauvres. J’aperçus une guimpe, un visage calme et souriant. « Voici la religieuse », dis-je à mon compagnon. Il ouvrit courageusement son manteau et me remit son aumône. J’y joignis ce que je croyais pouvoir donner. La religieuse reçut le tout dans une tirelire de fer-blanc, nous remercia, me promit de prier pour nous, et rejoignit sa petite hutte. « Pauvre femme, murmura mon compagnon ; elle fait là un métier très fatigant. » et il se renveloppa dans son manteau, car la nuit continuait d’être bonne pour dormir.
Les chrétiens qui auront lu cette page n’oublieront certainement pas la religieuse d’Orgon, ni son hôpital sublime. Ils ne demanderont point ce que ce récit vient faire dans un livre sur l’Algérie. J’aurai tout à l’heure à parler du dévouement militaire, du courage de l’ambition, du génie de la guerre : au frontispice de mon livre, je place cette esquisse du dévouement, du courage et du génie de la charité.
Chapitre II
À Toulon. – Un officier d’Afrique. – Le courage.
À Eugène Veuillot
18 février 1841
Cher frère, tu lis dans les journaux qu’il y a eu de grandes tempêtes sur la Méditerranée, et je me trouve dans la ridicule nécessité de te rassurer. Nous jouissons du plus beau temps que tu puisses rêver ; aux portes de Toulon, présentement, les amandiers sont en fleurs, les orangers en fruits, les champs en herbe, et il fait très chaud sur le port. Notre traversée sera de deux jours. C’est le capitaine Laederic, un des meilleurs vaporiers (je ne sais si le mot est français, il faut qu’il le devienne) de la marine royale, qui nous mène sur son bâtiment renommé. Cette marine à vapeur est un véritable pont jeté entre Toulon et Alger. Lorsqu’on songe qu’il suffit de deux jours pour aborder de France en Afrique, il faut conclure que les derniers jours de l’islamisme sont venus, du moins sur tout le littoral de la Méditerranée, que les chrétiens appelleront à leur tour mare nostrum. Voilà comment Fulton, qui probablement ne s’en doutait guère, a plus efficacement servi l’Évangile que son compatriote Richard Cœur de Lion. Je ne sais quelle fut la croyance de cet inventeur. J’espère pour lui qu’il était bon chrétien, mais il aurait été hérétique ou athée que cela n’empêcherait pas le bon Dieu d’utiliser sa machine. Elle est au service des catholiques, et bien que ceux-ci ne se pressent pas d’en user, tu verras que ce sera là le résultat final. Rien ne me console et ne me réjouit autant que ce spectacle de toutes les entreprises et de toutes les puissances humaines, toujours forcées de contribuer à l’avancement de l’Évangile et à la gloire de Dieu. Quand notre vue sera nette ; quand, délivrés de ce corps de mort qui nous attache maintenant à la terre par tant et de si déplorables liens, nous contemplerons les plans divins dans toute leur étendue, ce que nous savons actuellement par la foi, nous le saurons par l’évidence, et nous admirerons comment le monde, en dépit de ses criminels desseins, n’a jamais pu sortir de l’ordre sans y rentrer aussitôt. Quel beau prologue aux merveilles de l’éternité !
Je nage ici dans un océan de satisfaction pure, et cependant tout m’y rappelle une époque malheureuse. Je visitai ces pays il y a trois ans, et je les parcourus ayant sur les yeux ce que l’on appelle le prisme enchanteur de la première jeunesse ; mais je ne songeais point à Dieu, et que de folies dans mon esprit ! Que de folies dans mon cœur ! Pour quelques éclairs de je ne sais quelle joie furibonde, qui bientôt me faisaient honte, combien de noirs ennuis qu’il fallait traîner toujours ! Doutes sur ma destinée en ce monde et dans l’autre, doutes sur les principes les plus sacrés de la morale, mépris des hommes, mépris de moi-même, ténèbres de toutes parts. Je combattrai toute ma vie les incrédules, mais je ne leur rendrai jamais ce qu’ils m’ont fait souffrir de dix-huit à vingt-trois ans. Ma raison, sans boussole et sans point d’appui, était le jouet des moindres accidents. Je ne connaissais plus ni le vrai, ni le faux ; ballotté en tous sens, et ne sachant à quoi me prendre, ne trouvant de repos que dans un sommeil lâche, cherchant à dessein la nuit pour m’y plonger, le suprême effort de ma sagesse était de haïr brutalement le monde et de blasphémer contre le Ciel. À présent il me semble que je vogue à pleines voiles dans la lumière, et je m’y sens bien. Tout est ouvert à mon esprit. Je connais la route, et je sais ce que je verrai quand j’aurai atteint les limites de l’horizon. Les hommes sont vraiment mes frères ; je les aime et je les plains, et il ne me viendrait jamais à la pensée d’en accuser un seul, si je n’espérais par là servir tous les autres et le servir lui-même. Les objets ont d’autres couleurs : ce qui était morne est animé ; là où je voyais le caprice du hasard, je vois un clair témoin de l’existence et de la puissance de Dieu ; il y a dans la nature une voix que j’entends ; je sens au fond de mon âme d’inépuisables flots d’amour. Ah ! Ce prisme de la jeunesse que je redoutais de voir briser, et dont je calculais avec angoisse le graduel affaiblissement, quel triste voile, quand je le compare à ce beau jour de la foi qui, d’heure en heure et d’instant en instant, éclaircit l’espace immense où il m’a conduit ! Je vois se dissiper en vaine fumée les plus ardus problèmes de mon ancienne ignorance. Les portes d’airain, partout fermées sur moi, s’ouvrent d’elles-mêmes et disparaissent. J’ai le mot magique qui renverse les murailles du monde invisible et triomphe des monstres de l’esprit. Cette mer que je regarde m’offrit la stérile peinture de mon inquiétude éternelle, aujourd’hui elle est le beau miroir, la sereine image de ma profonde paix ; mon âme peut, comme elle, porter sans efforts les pesants fardeaux de la vie, et les regarder passer avec cette indifférence qui ne s’émeut ni d’envie lorsqu’ils sont riches, ni de colère lorsqu’ils sont injurieux ; une ombre légère peut la traverser un instant, mais cette ombre ne sera jamais qu’une tache dans son immensité qui réfléchit le ciel ; elle sera troublée par l’orage, mais elle retrouvera la paix, et il ne restera nulle trace de l’orage.
Je t’avoue que depuis que je suis chrétien, je ne sais plus ce que c’est que craindre un événement quelconque, pourvu que je n’aie pas sur la conscience de trop gros péchés. Je ne me défends pas d’éprouver en quelques circonstances extraordinaires et périlleuses une certaine inquiétude, naturelle à toute créature ; mais cette inquiétude elle-même ne résiste pas à deux minutes de réflexion. Le Dieu que j’adore et qui me protège règne sur la mer aussi bien que sur la terre, parmi les champs de bataille aussi bien que dans nos rues et dans nos maisons. Il peut toujours nous laisser la vie ou nous la prendre, il est tout-puissant toujours et partout, et la mort n’est pas plus à craindre en un lieu qu’en un autre ; elle n’est inévitable qu’en vertu de ses lois, elle ne frappe pas avant qu’il l’ait voulu. Il suffit de penser à la fragilité de l’existence pour acquérir la certitude qu’on ne l’a conservée jusqu’au moment où l’on est parvenu, que grâce à une succession de miracles qui peut durer encore longtemps.
Un officier à qui je parlais ainsi prétendit que j’étais fataliste. Un mot est bientôt prononcé, et l’accusation de fatalisme est volontiers portée contre les chrétiens par des gens de bien, qui du reste, sont pleins de sympathies pour les dogmes mahométans. Je répondis à mon officier que nous ne nous soumettions pas à l’arrêt d’un stupide et irrévocable destin, mais à l’arrêt d’un Dieu souverainement bon et sage. « J’ai connu, poursuivit-il, des musulmans qui l’entendent ainsi. Eh bien ! repris-je, ces musulmans ont raison. Faut-il que nous nous abstenions de prier Dieu parce qu’ils le prient ? Vous trouverez chez eux beaucoup de choses qui sont chez nous, puisque Mahomet a pillé l’Évangile. – Cependant, continua l’officier, on vous voit tout comme d’autres prendre soin d’éviter le danger et de préserver votre vie ; pourquoi, si vous pensez que Dieu se charge d’y pourvoir ? – Nous croyons aussi, lui dis-je, que Dieu sera fidèle à sa promesse qu’il a faite de nous nourrir, et cependant tous les ans, avec beaucoup de peine, nous labourons et nous ensemençons la terre ; pourquoi ? C’est que nous avons une intelligence et des forces dont nous devons user. Dieu nous a donné la vie, donc elle est bonne ; nous l’avons reçue pour l’user aux emplois auxquels il l’a destinée ; il veut que nous la défendions, comme il veut que nous cultivions notre champ ; cependant c’est lui qui fertilise les champs et qui conserve la vie, et nous savons d’avance qu’il ne l’éteindra qu’à l’heure marquée par sa miséricorde ; sur ce point il juge souvent autrement que nous, mais toujours mieux que nous. »
Cette petite difficulté éclaircie, je demandai à mon tour à l’officier de me définir le courage. Il réfléchit un peu, prétendant que cette définition n’était pas l’affaire d’un mot ni d’une phrase, quoiqu’il eût vu dans sa vie beaucoup d’hommes courageux et beaucoup d’exemples de courage. « Le courage, me dit-il enfin, c’est la force, c’est l’ambition, c’est la colère, c’est la brutalité, c’est l’eau-de-vie, c’est la vanité, c’est le délire, c’est la peur, c’est même le courage. – Un homme, poursuivis-je, qui n’affronterait pas le danger par goût naturel, mais qui ne le fuirait pas parce qu’il aurait la confiance que Dieu saura bien le défendre, et qui n’aurait besoin d’ailleurs ni de vanité, ni d’ambition, ni de colère, ni d’eau-de-vie, le jugerez-vous courageux ? – Oui, dit-il. – Et si cet homme, qui se contentait de ne pas fuir le danger, venait à le chercher pour obéissance et pour remplir son devoir ? – Très courageux. – Et si, son devoir étant accompli, cet homme savait se consoler dans la défaite, supporter paisiblement son affront, son malheur, dire que Dieu l’a voulu ainsi, et que Dieu est juste, et par conséquent bénir Dieu ? – Courage de premier choix, courage admirable, vrai courage ! – Connaissez-vous beaucoup d’hommes, lieutenant, qui aient ce courage-là ? – Franchement non ! – Eh bien ! Mon officier, je vous affirme que sur dix chrétiens, hommes ou femmes, vous en trouverez au moins neuf capables de faire preuve de cette dernière espèce de courage ; mais il faut choisir parmi ceux qui sont exacts à dire leurs patenôtres. »
Il me déclara qu’aussitôt notre arrivée en Algérie, il me proclamerait brave sur toute la ligne, et nous allâmes nous promener du côté de la mer en causant de nos futurs exploits, c’est-à-dire des siens, car il se promet de faire mille prouesses où je ne prétends en aucune manière. Ces militaires sont en général d’excellents cœurs. Ils ne paraissent guère meilleurs chrétiens que nos bourgeois, et c’est dommage, car ils ont l’esprit plus droit, plus simple, et l’âme incomparablement plus généreuse. Ils mènent la vie rude et sobre des moines ; dévoués comme eux, ils obéissent comme eux jusqu’au mépris de la vie ; pourquoi n’ont-ils pas la même foi ? Un militaire chrétien, cela me paraît une des formes idéales de la majesté humaine ; aussi suis-je bien du goût de l’Église, qui a toujours eu une affection particulière, une sorte de tendresse maternelle pour les soldats. Ce n’est pas en vain qu’elle glorifie le Dieu des armées.
Nous partons, sois exact à m’écrire. Fais-moi de ces lettres trop longues qu’on adresse aux voyageurs et aux exilés, qui prennent intérêt à tout. Songe que mon cœur est en vedette sur le bord de la mer africaine, et que tout ce qu’il verra de vous lui fera plaisir.
Chapitre III
La première garnison de Miliana.
À Eugène Veuillot
Notre départ est retardé d’un jour ; j’en profite pour t’envoyer un petit tableau de genre africain, qui m’a été présenté à Marseille.
Tu sais que nous occupons dans l’intérieur des premiers gradins de l’Atlas une ville nommée Miliana. C’est une conquête de l’an dernier. Déjà deux garnisons, relevées l’une et l’autre dans l’espace des six ou huit premiers mois, s’y sont succédé ; une troisième y séjourne en ce moment, dont on a peu de nouvelles. Les communications sont loin d’être libres entre Miliana et Alger, ces deux possessions étant séparées par une distance de quinze à dix-huit lieues. Des bruits sinistres se sont répandus ; on n’y a pas pris garde : qu’importe à nos conquérants de France, et même à quelques-uns de nos conquérants d’Alger, la situation d’une petite troupe enfermée dans ces murailles, que d’ailleurs elle garde fort bien ? Voici, mon frère, ce que c’est que la garnison de Miliana. Je tiens ce que je vais te dire d’un homme que j’ai vu il y a trois jours, encore tout jaune et tout faible de la fièvre qu’il en a rapportée, et cet homme n’est autre que le commandant supérieur de Miliana, le lieutenant-colonel d’Illens, un vieil officier de l’armée d’Espagne, un petit homme à l’air doux et bénin, que son costume et toute sa mine m’ont fait prendre pendant un quart d’heure pour un bon négociant de Marseille, de ceux qui n’attendent que d’avoir amassé un peu de rentes et marié leur fille pour se retirer dans une bastide, et là, jardiner jusqu’au dernier soupir. Tu vas voir quel bourgeois c’était.
« Je faisais, me dit-il, partie de l’expédition qui chassa de Miliana Mohammed ben-sidi-Embarrak, khalifat (lieutenant) d’Abd el-Kader. L’armée ne savait pas si l’on occuperait cette petite ville, dont la situation est agréable, mais que les Arabes avaient saccagée avant de se retirer, et qui n’était qu’un monceau de ruines. On m’y laissa avec douze cents hommes. Je ne m’y attendais point, je n’avais pu faire aucune disposition, et l’armée, qui partit aussitôt, n’en avait pris aucune. Des vivres entassés à la hâte, quelques munitions, quelques outils, et c’était tout. J’avoue que je ne pus voir sans un certain serrement de cœur nos camarades s’éloigner et disparaître derrière les collines qui entourent Miliana. Le sentiment de ma responsabilité pesa douloureusement sur mon âme. Heureusement que je ne pus mesurer d’un coup ni toute notre faiblesse, ni tous nos dangers. Si j’avais connu le sort qui attendait mes malheureux soldats, je crois que j’aurais perdu la tête.
« Je me mis sur-le-champ à examiner notre séjour, je puis bien dire notre prison, car nous étions cernés de toutes parts, et l’armée n’était pas à quatre lieues qu’on nous tirait déjà des coups de fusil. Je voulais savoir quelles ressources le lieu pouvait offrir. Le mobilier des Arabes est léger : lorsqu’ils s’en vont, il leur est facile de tout emporter avec eux ; ils n’y avaient pas manqué. Ce qu’ils s’étaient vus forcés de laisser était brisé ; toutes les maisons offraient des traces récentes de l’incendie. Nous ne trouvâmes rien que trois petites jarres de mauvaise huile, qui furent partagées entre l’hôpital et les compagnies pour l’entretien des armes, et deux sacs contenant quelques centaines de pommes de terre. On découvrir aussi, dans un silo4, des boulets et des obus. Du reste pas un lit, pas une natte, pas une table, pas une écuelle. Abandonnés au milieu du désert, nous n’aurions pas été plus dépourvus. Chaque pas que je faisais à travers ces funestes masures, chaque instant qui s’écoulait, me révélait les périls de notre situation. Une odeur infecte régnait dans la ville ; de toutes parts elle offrait des brèches ouvertes à l’ennemi. On vint me dire que les spiritueux manquaient pour corriger la crudité de l’eau, que les vivres étaient avariés, et que l’on doutait qu’il y en eût assez pour suffire au besoin de la garnison ; mais cette dernière circonstance m’inquiétait peu. Déjà je ne pouvais que trop sûrement compter sur la mort pour diminuer le nombre des bouches. Plusieurs des soldats que l’on m’avait laissés étaient déjà souffrants. Je les voyais silencieux, tristes, promener autour d’eux un œil abattu. Je n’ignorais pas ce que m’annonçaient cette attitude et ces regards.
« On était au milieu de juin. Sous un soleil qui marquait 30 degrés Réaumur, il fallait assainir la ville, réparer la muraille, faire faction, se battre, garder le troupeau, notre unique ressource et le perpétuel objet de la convoitise des Arabes, qui tentaient sans cesse de l’enlever. La masure que nous appelions l’hôpital fut bientôt remplie de fiévreux, la plupart couchés sur la terre, les plus malades sur des matelas formés de quelques débris de laine ramassée dans les égouts, où les Arabes l’avaient noyée avant de s’enfuir, et que nous avions tant bien que mal lavée. Cependant, tout alla passablement jusqu’aux premiers jours de juillet. Le moral et la santé se soutinrent ; nous pûmes à peu près suffire aux fatigues excessives qu’exigeaient les travaux les plus urgents. Mais le mois de juillet nous amena une température de feu ; le thermomètre monta au soleil jusqu’à 58 degrés centigrades, le vent du désert souffla et dura sans relâche vingt-cinq jours, les maladies éclatèrent avec une violence formidable ; la diarrhée, la fièvre pernicieuse, la fièvre intermittente, enlevèrent beaucoup de monde et n’épargnèrent personne. Plus ou moins, chacun en ressentit quelque chose : tous les officiers, excepté un capitaine du génie5, tous les officiers de santé, tous les administrateurs et employés, tous les sous-officiers et soldats anciens et nouveaux en Afrique ont payé leur tribut. À peine aurais-je pu trouver, en certains moments, cent cinquante hommes capables d’un bon service actif. Il fallait, en les menant à leur poste, donner le bras aux hommes que l’on mettait en faction. Ces pauvres soldats, dont le visage maigre et défait s’inondait à chaque instant de sueur, pouvaient à peine se soutenir sur leurs jambes tremblantes ; n’ayant plus même la force de parler, ils disaient péniblement à leur officier, avec un regard qui demandait grâce : « Mon lieutenant, je ne peux plus aller, je ne peux plus me tenir. – Allons, mon ami, répondait tristement l’officier, qui souvent n’était guère en meilleur état, un peu de cœur ; c’est pour le salut de tous. Place-toi là, assieds-toi. – Eh bien ! oui, répondait le malheureux, content de cette permission, je vais m’asseoir. » On l’aidait à défaire son sac, il s’asseyait dessus, son fusil entre les jambes, contemplant l’espace avec ce morne regard qui déjà ne voit plus. Ses camarades s’éloignaient, la tête baissée. Bientôt le sergent arrivait, et de la voix sombre qu’ils avaient tous : « Mon lieutenant, il faut un homme. – Mais il n’y en a plus. Que le pauvre un tel reste encore une heure. – Un tel a monté sa dernière garde ! » Il fallait conduire, porter presque, un mourant à la place du mort.
– Et ils obéissaient ? dis-je au colonel, qui avait les yeux remplis de larmes.
– Je n’ai pas eu, reprit-il, à punir un acte d’indiscipline. Mais je ne pouvais pas leur ordonner de vivre. Quelques-uns devinrent fous. Ceux que la nostalgie avait attaqués, ceux dont le cœur était plus sensible, les jeunes soldats qui avaient laissé en France une fiancée qu’ils aimaient encore, furent atteints les premiers et ne guérirent pas. Après eux, je perdis tous les fumeurs. Le manque absolu de tabac était sans contredit, pour ces derniers, la plus cruelle des privations. J’avais décidé un Kabyle, qui venait rôder autour de nous, à nous en vendre, et il m’en avait même apporté trois ou quatre livres, qui, distribuées aux plus nécessiteux, prolongèrent véritablement leur vie ; mais, pris sans doute par les Arabes, cet homme ne reparut plus. Alors, profitant de quelques connaissances ou de quelques souvenirs qui me venaient je ne sais d’où, je fis faire comme je pus, avec des feuilles de vigne et d’une autre plante, une espèce de tabac qui fut reçu par ces infortunés comme un présent du ciel. Malheureusement mon invention vint trop tard.
« J’étais forcé de m’ingénier de toutes manières pour combattre mille dangers, pour tromper mille besoins impossibles à prévoir. Afin de lutter contre le désastreux effet de la nostalgie, j’avais organisée une section de chanteurs qui, deux fois par semaine, essayaient de récréer leurs camarades, en leur faisant entendre les airs et les chansons de la patrie. Les uns riaient, les autres pleuraient. Quand les chanteurs, qu’on écoutait avec un douloureux plaisir, avaient fini, beaucoup regrettaient plus amèrement la patrie absente. Ce mal du pays est terrible ! Je ne savais pas, en définitive, si cette distraction, toujours impatiemment attendue, produisait un résultat favorable ou contraire. Mais je n’eus pas à délibérer là-dessus bien longtemps ! La maladie attaqua les chanteurs ; presque tous moururent, comme ceux que leurs chants n’avaient pu sauver.
« On nous avait abandonnés si vite, et avec une si cruelle imprévoyance, que dès les premiers jours, les souliers manquèrent à un grand nombre d’hommes. Je me souvins heureusement des chaussures espagnoles. Les peaux fraîches de nos bœufs et de nos moutons, distribuées aux compagnies, leur servirent à faire des espadrilles. Beaucoup aussi manquaient de linge et d’habillements. La mort n’y pourvut que trop !... Quel lamentable spectacle offrait cette pauvre troupe, mal en ordre, déguenillée, mourante ! Parmi tant de misères, c’était encore une souffrance pour le soldat de ne pouvoir quelquefois se mettre en grande tenue.
« Je vous ai dit qu’une partie des vivres étaient avariés. La farine surtout ne produisait qu’un pain détestable, et encore vîmes-nous le moment où ce mauvais pain nous manquerait, non pas faute de farine, mais faute de boulangers. Comme nos chanteurs, comme nos jardiniers, qui n’avaient point vu germer leurs semailles, nos boulangers étaient morts ou malades, et j’eus, à plusieurs reprises, une peine infinie à me procurer le peu de pain nécessaire au peu d’hommes qui pouvaient manger. Que vous dirai-je ? Les bataillons se sont trouvés souvent presque sans officiers, l’hôpital presque sans chirurgiens et sans infirmiers. Ceux qui travaillaient le plus, ceux qui travaillaient le moins, les forts, les faibles, ceux qui avaient pu guérir déjà une ou deux fois, ceux qui semblaient devoir résister à tout, venaient successivement encombrer cet hôpital, d’où j’avais fait emporter tant de cadavres.
« Les Arabes soupçonnaient notre détresse, sans la connaître entièrement. Mes pauvres soldats faisaient bonne contenance devant l’ennemi, qui ne nous laissait point de repos. Il fallait presque tous les jours combattre, et les balles venaient mordre à ceux que la maladie n’avait point entamés. Nos fiévreux enviaient le sort de leurs frères qui mouraient d’une blessure. Ils se faisaient conter les traits de courage qui tenaient en respect les bédouins. Un jour, un brave garçon, un carabinier nommé Georgi, se précipita seul au milieu de trente Kabyles qui attaquaient un de nos avant-postes ; il en perça plusieurs de sa baïonnette, mit les autres en fuite, et les obligea d’abandonner leurs blessés, dont il se rendit maître. Ce fut une fête dans la ville et dans l’hôpital ; cette action de Georgi fit plus que tous les médicaments. Mais nous n’avions pas souvent de ces prouesses. Pour poursuivre l’ennemi, il fallait plus de jambes qu’il ne nous en restait. C’était beaucoup de n’être pas absolument bloqués dans nos murs. Au bout de trois mois, vers la fin de septembre, n’ayant que très peu d’hommes à opposer aux attaques réitérées des Arabes, le ravitaillement des postes avancés devenait très difficile. Officiers, médecins, gens d’administration, tout le monde prit le fusil ; je le pris moi-même, et je dus aller à l’ennemi, suivi d’une quarantaine d’hommes, dont quelques-uns étaient à peine convalescents.
« Tout se tournait contre nous. Les fruits que nous offraient les arbres étaient dangereux et se changeaient en poison. L’approche de l’automne n’adoucissait pas cette température qui nous avait dévorés. La mortalité allait croissant. Je remarquai que les Arables, voulant s’assurer de nos pertes, venaient la nuit compter les fosses dont nous entourions les murs de la ville, et nous en creusions de nouvelles tous les jours ! J’ordonnai qu’on les fît plus profondes et qu’on mît dans chacune plusieurs cadavres à la fois. Les soldats obéirent, mais leur force épuisée ne leur permit pas de creuser bien avant. Un matin, ceux qui devaient remplir à leur tour ce lugubre office vinrent tout effarés me dire que les morts sortaient de terre. La terre, en effet, n’avait pas gardé son dépôt. Elle était inhospitalière aux morts comme aux vivants. La fermentation de ces cadavres l’avait soulevée ; elle rendait à nos regards les restes décomposés de nos compagnons et de nos amis. Je ne puis vous dire l’effet de ce spectacle sur des imaginations déjà si frappées. Malade moi-même et me traînant à peine, j’allai présider au travail qu’il fallut faire pour enterrer nos morts une seconde fois ; et afin que mes intentions fussent à l’avenir mieux remplies, je continuai de conduire désormais ces convois chaque jour plus nombreux et plus lamentables. J’avais beau m’armer de toute ma force, je ne pouvais m’y faire. Je m’étais attaché à ces soldats si bons, si malheureux, si résignés, si braves. Des enfants n’auraient pas mieux obéi à leur père, un père n’aurait pas davantage regretté ses enfants. Je ne me suis pas un seul instant endurci à cette douleur, je sens que je ne m’endurcirai jamais à ce souvenir !...
– Colonel, lui dis-je, quel était donc le chiffre de vos morts ?
– Lorsqu’on vint, reprit-il, nous relever, le 4 octobre, nous en avions enterré huit cents.
– Huit cents ! m’écriai-je.
– Au moins huit cents, reprit-il ; les autres, ceux qu’on emmena ou qu’on emporta, étaient malades, et l’on a jalonné le chemin de leurs sépultures. Ni l’art des médecins, ni la joie de leur délivrance, ne les purent remettre. Ceux qui parvinrent jusqu’aux hôpitaux de Blida ou d’Alger y succombèrent, victimes d’un mal incurable. Au sortir de Miliana, il ne s’en était pas trouvé cent qui fussent en état de marcher durant quelques heures ; il ne s’en trouva pas un qui pût porter son sac et son fusil. Lorsque, plusieurs mois après, je quittai l’Algérie pour venir me rétablir en France, il y en avait encore, à ma connaissance, une trentaine de vivants. Qui sait s’ils vivent aujourd’hui ? Je fus un des moins maltraités, et vous me voyez… Eh bien ! nous n’avons pas cessé de travailler ; nous avons exécuté des travaux considérables ; nous avons mis la place en état de défense ; nous avons établi un bel hôpital ; tout le monde, jusqu’au dernier moment, a rempli son devoir. Toujours l’ennemi nous a respectés et nous a craints. La discipline a été jusqu’au bout parfaite ; l’union, la concorde, le dévouement n’ont pas cessé de régner entre nous. Au milieu de tant de fatigues, de tant de privations, de tant de misères que je ne puis raconter, il n’y a eu que vingt-cinq déserteurs, et ils appartenaient à la légion étrangère ; pas un n’était Français !
– Mais, dis-je, colonel, comment se fait-il que ces détails n’aient pas été connus en France ? Je n’avais pas la moindre idée de tout ce que vous m’apprenez, et cependant je me tiens au courant des nouvelles d’Alger.
– Les rapports officiels ont gardé le silence, reprit-il ; cela était trop désastreux. On s’est borné à dire que la garnison de Miliana, éprouvée par le climat, avait été relevée. Cette phrase est devenue célèbre dans notre armée d’Afrique.
– Quoi ! m’écriai-je, pas un mot d’éloge pour cette garnison intrépide ! Rien pour honorer les morts, rien pour consoler les survivants prêts à mourir !
– Rien, répondit le colonel ; ces événements ne venaient pas à l’appui du système qu’on voulait suivre, et pouvaient compromettre des réputations plus importantes que les nôtres. Ils furent passés sous silence. »
J’étais confondu.