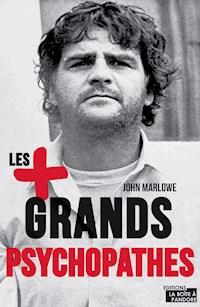
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Boîte à Pandore
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Découvrez les plus célèbres psychopathes de l'histoire...
Carl Panzram fut victime de viol collectif à l’âge de 14 ans. Pour se venger, il viola à son tour un bon millier de jeunes garçons et d’hommes adultes, et commit plus de vingt meurtres.
Ed Kemper tua sa grand-mère d’une balle dans la tête et de deux dans le dos. Il ne s’arrêta pas en si bon chemin, il assassina aussi son grand-père, sa mère, son frère et six auto-stoppeuses.
Jerry Brudos étrangla Jan Whitney chez lui et, non content, se reput, pendant plusieurs jours, du spectacle du corps de la jeune fille pendu au plafond.
Pietro Pacciani assassina le rival qui avait couché avec sa fiancée. Pacciani poignarda l’homme de 19 coups de couteau et viola aussi le corps sans vie.
John Marlowe nous propose d’étudier la vie de ces hommes, et de nombreux autres, qui figurent parmi les plus dangereux et les plus infâmes de l’histoire du crime. Sans concession aucune et sans tabou, il nous livre ici les moindres détails de ces crimes, pour une horrible mais captivante descente dans l'esprit des "plus célèbre psychopathes".
Les secrets des plus affreux crimes de l'Histoire enfin révélés.
EXTRAIT
Pages sanglantes de l'Histoire
L’Histoire connaît un nombre incroyable d’individus qui se rendirent coupables d’actes d’une atrocité sans nom. Parmi ceux-ci, il y eut certains aristocrates. Abusant de leur statut de privilégiés et de leur position de force, ils purent tuer, violer et torturer en toute impunité, mais pour un temps seulement. Certains de ces personnages historiques sont devenus des légendes dans la culture de leur pays, et ceux qui commirent des actes particulièrement horribles acquirent même une notoriété mondiale.
À PROPOS DE L'AUTEUR
John Marlowe est écrivain, journaliste et vit à Vancouver. Il collabore à plusieurs célèbres périodiques canadiens et américains et a écrit plus d’une vingtaine de documentaires pour Radio Canada International.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INTRODUCTION
Au siècle passé, un livre traitant des psychopathes aurait très certainement évoqué des affaires ô combien différentes de la plupart de celles qui figurent dans ces pages. À cette époquelà en effet, alors que les crimes de Jack l’Éventreur, de Joseph Vacher et de Thomas Neill Cream étaient encore dans toutes les mémoires, le terme « psychopathe » désignait toute forme de maladie mentale. Cependant, lorsque l’on parle de psychopathes à l’heure actuelle, il s’agit avant tout d’individus qui n’éprouvent aucun intérêt pour les sentiments d’autres êtres humains et qui sont totalement dépourvus de tout sens du devoir social.
Bien entendu, très peu de psychopathes passent à l’acte et commettent des meurtres. Les individus évoqués dans ce livre sont connus pour l’ampleur de leur cruauté, qui les éloigna complètement du reste de l’humanité. Il s’agit d’hommes et de femmes qui prirent plaisir à infliger la douleur ou à tuer. Ils peuvent tous être considérés comme des tueurs en série, même si la plupart d’entre eux commirent leurs crimes bien avant que cette appellation n’entre dans le langage commun.
Les exemples les plus anciens de cet ouvrage sont des membres de la noblesse. Aussi riches que puissants, ils commirent leurs méfaits avant la création de services de police ou de toute autre institution chargée de faire respecter la loi. Des personnages historiques tels que Gilles de Rais ou Elisabeth Báthory passèrent à l’acte avec la complicité partielle d’autres membres de l’aristocratie. C’est par le biais de documents juridiques que les récits de leurs activités macabres nous sont parvenus. Vlad III Dracula, quant à lui, est devenu un personnage légendaire par l’histoire orale et des récits tout aussi exagérés qu’extravagants. Et pourtant, malgré l’absence de toute preuve écrite, nous sommes intimement persuadés que ce prince de Valachie se rendit bel et bien coupable d’actes inhumains.
On ne peut pas en dire de même de Sweeney Todd, le barbier démoniaque de Fleet Street, dont l’existence même, sans parler de ses crimes, fut débattue pendant des générations. Selon toute vraisemblance, Sweeney Todd n’est rien de plus qu’une création de l’imagination fertile de Thomas Prest, l’un des auteurs des romans-feuilletons d’horreur du XIXe siècle.
C’est en effet dans une histoire de Thomas Prest datant de 1846, Le collier de perles, que le nom du barbier est mentionné pour la première fois. Toutefois, personne n’a encore retrouvé les dossiers du procès de Sweeney Todd, qui aurait envoyé ce tueur en série du XVIIIe siècle à la potence, ou tout autre document de ce genre.
Le seul élément qui plaide en faveur de la thèse de l’existence de Todd est que les histoires de Thomas Prest s’inspiraient souvent de faits réels.
D’ailleurs, la méthode de Thomas Prest est toujours d’actualité. L’auteur Thomas Harris était présent lors du procès de Ted Bundy pour certains de ses meurtres, en 1979, et il s’inspira des techniques utilisées par ce tueur en série pour créer le personnage de James « Buffalo Bill » Gumb dans Le Silence des agneaux. La longue histoire des meurtres commis par le Monstre de Florence inspira Harris en 1999, et il situa la suite de son roman, Hannibal, dans cette ville italienne.
Les étudiants en littérature américaine rencontreront sans doute Jeffrey Dahmer par le biais du personnage qu’il inspira, Quentin P., le protagoniste du roman Zombie de Joyce Carol Oates, récompensé en 1995. D’autres meurtriers virent leur histoire adaptée sur le petit écran. John Wayne Gacy, « le Clown tueur », vécut assez longtemps pour voir Brian Dennehy, gagnant d’un Tony Award, jouer son personnage en 1992 dans Disparitions sanglantes.
Bien évidemment, aucune histoire ne fut plus exploitée que celle de Jack l’Éventreur. Il figure dans les romans de nombreux auteurs tels que William S. Burroughs, Philip José Farmer ou Colin Wilson, pour ne citer qu’eux, et il a influencé l’imagination collective plus que tout autre. Ce « succès » peut s’expliquer en partie par le fait qu’il ne fut jamais attrapé. Il reste une ombre, pour ne pas dire un fantôme.
Dans le film de Nicolas Meyer datant de 1979, C’était demain, Jack l’Éventreur emprunte la célèbre machine à explorer le temps de H. G. Wells et est transporté dans le XXe siècle. Témoin de tant de destructions et de tant de morts, il déclare : « Il y a quatre-vingt-dix ans, j’étais un fou. Aujourd’hui, je suis un amateur ».
En effet, le début de ce siècle vit des guerres menées à un niveau de cruauté jusqu’alors inimaginable. Comme pour refléter cette inhumanité, la fréquence des meurtres commis par des psychopathes continua à augmenter. Le nombre de victimes de tueurs en série tels que Fritz Haarmann, Gary Ridgway ou Andreï Chikatilo dépasse de loin celui de Jack l’Éventreur.
Plus tard, les progrès réalisés dans le domaine des armes à feu entraînèrent une augmentation du nombre de tueurs en série. On venait d’offrir à ces derniers une vitesse et une efficacité dont ils n’avaient osé rêver. Pour perpétrer le massacre de Columbine, le 20 avril 1999, Eric Harris et Dylan Klebold utilisèrent un fusil à pompe Savage-Springfield 67H de calibre 12, un fusil semi-automatique Hi-Point 995 9mm, un pistolet semi-automatique Intratec Tec-9 9mm, et un fusil de chasse à canons juxtaposés Stevens 311 D de calibre 12. En quarante-cinq minutes, ils tuèrent un enseignant et douze étudiants, et en blessèrent vingt-quatre autres. La tuerie ne prit fin qu’avec le suicide des deux meurtriers.
Alors que j’écris ces mots, à moins de vingt kilomètres d’ici, Robert Pickton (voir le croquis de la page précédente) est jugé pour vingt-sept meurtres au premier degré. Les victimes présumées de cet éleveur de porcs étaient principalement des prostituées qui avaient jadis arpenté les rues du quartier de Downtown Eastside de Vancouver. S’il est jugé coupable, Pickton rejoindra William Burke, William Hare, Thomas Neil Cream, Fritz Haarmann, Andreï Chikatilo, Jack Unterweger, Gary Ridgway, et, bien entendu, Jack l’Éventreur, parmi les psychopathes qui préféraient s’attaquer à ces membres marginalisés et vulnérables de la société.
Les meurtriers évoqués ici choisirent rarement leurs victimes parmi leurs semblables. Edmund Kemper, deux mètres cinq, tua des femmes qu’il dominait physiquement parlant. D’autres, comme Peter Kürten ou Thomas Hamilton, comptèrent des enfants parmi leurs victimes. Même Harris et Klebold, qui tuèrent leurs camarades d’école, étaient nettement avantagés par rapport à ceux-ci puisqu’ils étaient armés.
Ainsi, les tueurs en série des temps modernes ont certains points communs avec leurs semblables de jadis issus de la noblesse : ils cherchent à pouvoir décider qui doit vivre et qui doit mourir. Pourquoi en est-il ainsi ? Peut-être ne le saurons-nous jamais.
John Marlowe Vancouver, Colombie-Britannique, 2007
PAGES SANGLANTES DE L’HISTOIRE
L’Histoire connaît un nombre incroyable d’individus qui se rendirent coupables d’actes d’une atrocité sans nom. Parmi ceux-ci, il y eut certains aristocrates. Abusant de leur statut de privilégiés et de leur position de force, ils purent tuer, violer et torturer en toute impunité, mais pour un temps seulement. Certains de ces personnages historiques sont devenus des légendes dans la culture de leur pays, et ceux qui commirent des actes particulièrement horribles acquirent même une notoriété mondiale.
Rais se débarrassant de la dépouille d’une femme, illustration tirée d’Histoire de la Prostitution et de la débauche chez tous les peuples du globe (1879)
GILLES DE RAIS
Noble et soldat, Gilles de Rais combattit aux côtés de Jeanne d’Arc durant le siège d’Orléans. En réalité, il fut l’un des plus proches compagnons d’armes de cette sainte de l’Église catholique romaine. Cependant, si l’on se souvient de Gilles de Rais, ce n’est pas pour son héroïsme ou ses victoires sur les champs de bataille. Rais est en effet l’un des premiers tueurs en série de l’histoire.
Gilles de Rais naquit en automne 1404 dans la bien nommée Tour noire du château de Champtocé. Son père, Guy de Montmorency-Laval, était l’un des hommes les plus riches de France. Intelligent et rusé, il avait acquis ce statut par de nombreuses manœuvres légales et politiques, dont notamment son mariage avec Marie de Craon, la mère de Gilles. Après la mort de ses deux parents (son père connut une mort lente et douloureuse, blessé par un ours sauvage), Gilles hérita de la baronnie dans le Duché de Rais (ou Retz).
Gilles se retrouva donc sous la tutelle de son grand-père, Jean de Craon, un homme expert dans l’art de la manipulation et du vol. Après avoir tenté à deux reprises, en vain, de marier son petit-fils à des filles de puissantes maisons de France, Jean décida que Gilles épouserait sa cousine, Catherine de Thouars. Il obtint cette union en poussant le jeune homme, alors âgé de seize ans, à enlever sa « fiancée ». On tenta de la libérer, mais les sauveurs de Catherine furent jetés dans les donjons de Champtocé et le mariage eut lieu comme prévu.
En 1427, Gilles devint commandant dans l’armée royale, soutenant Charles VII dans ses efforts pour gagner la couronne française alors très convoitée. Il combattit aux côtés de Jeanne d’Arc dans plusieurs campagnes militaires et le 17 juillet 1429, il fut honoré lors du couronnement de Charles VII à Reims.
Cette cérémonie, qu’il avait aidé à organiser puisque c’est lui qui amena l’onction de Charles depuis Paris, marqua l’apogée de la carrière de Gilles. Une série d’erreurs politiques et militaires suivirent le couronnement. Jeanne d’Arc fut capturée l’année suivante, et le 31 mai 1431, elle mourut sur le bûcher, comme tout le monde le sait. En novembre 1432, le grand-père de Gilles trépassa. Sur son lit de mort, Jean de Craon se repentit de tous ses méfaits et ce riche vieil homme dilapida sa fortune et ses biens, en les rendant à ceux qu’il avait volés et en faisant des donations à deux hôpitaux. Gilles ne reçut absolument rien.
À la mort de son ancien mentor, Rais se retrouva tout seul pour naviguer dans les eaux tumultueuses de la politique française. N’ayant pas hérité de la ruse de son père et de son grand-père, il vit ses pouvoirs et son influence disparaître rapidement. De plus, pour ne rien arranger, il traversait des difficultés financières et il avait commencé à vendre des terres de son grand-père durant les mois précédant la mort de ce dernier.
Toutes ses entreprises semblaient irréfléchies et stupides. Parmi ses plus grandes erreurs, il y eut la représentation en 1435 du Mystère du Siège d’Orléans. Censée célébrer le dixième anniversaire du triomphe qu’il avait partagé avec Jeanne d’Arc, cette mise en scène coûteuse requit plus de six-cents figurants. Finalement, ce fut cette même incompétence, cette même incapacité à agir en fonction des exigences légales et politiques complexes de la noblesse qui provoqua sa chute et ensuite sa mort.
L’une des nombreuses propriétés que Rais avait dû abandonner était un château dans le village de Saint-Étienne-de-Mer-Morte. Geoffrey le Ferron, son acquéreur, la confia à son frère, Jean, un prêtre catholique. Toutefois, Rais regrettait d’avoir pris cette décision et en 1440, deux ans après la vente, le Baron choisit de reprendre son ancien bien par la force. Le 15 mai, il conduisit un groupe de soixante-dix hommes jusqu’à Saint-Étienne. Ils firent irruption dans l’église du village, capturèrent Jean le Ferron et prirent le château. Lorsque l’Évêque de Nantes eut vent de cet enlèvement et de cette violation des biens ecclésiastiques, une enquête fut lancée. Mais ce qu’il en ressortit, c’était que ces deux crimes étaient loin d’être les pires que Rais avait commis.
Les enlèvements précédaient les meurtres pour Gilles de Rais : un jour, il sodomisa un garçon qui pendait à un crochet avant de le tuer
Comme Gilles jouissait des faveurs de Charles VII, ceux qui furent chargés de le juger durent agir lentement et prudemment. En août, des troupes de l’armée royale s’avancèrent contre l’un des châteaux de Rais, libérant le prêtre Jean le Ferron. Trois semaines plus tard, Rais et quatre de ses proches furent arrêtés pour meurtre, sodomie et hérésie, entre autres.
Le 21 octobre, Gilles avoua ses crimes. Ses déclarations lors du procès révélèrent des monstruosités qui avaient commencé sept ans plus tôt, après la mort de Jean de Craon. C’est à ce moment-là que Gilles, qui n’avait tué que sur le champ de bataille, se mit à commettre des meurtres. Sa première victime, un garçon du nom de Jean Jeudon, fut enlevé et amené jusqu’au château de Gilles à Machecoul. Là, devant les nobles qui faisaient partie de ses proches, Gilles le sodomisa à deux reprises (la deuxième fois, alors que sa victime pendait à un crochet). Ensuite, l’enfant fut tué.
D’autres enfants, généralement de jeunes garçons, furent soit enlevés soit piégés dans les nombreuses résidences de Gilles. Ils y étaient violés, torturés et mutilés. Si l’on en croit son témoignage, le Baron, avec la complicité de ses compagnons, alignait les têtes décapitées des jeunes enfants afin de déterminer quelle victime était la plus attirante. Le témoignage de Gilles de Rais aurait été si horrible que l’on ordonna que les pires passages soient effacés du compterendu du procès.
La seule manière d’expliquer les actions de Gilles fut son intérêt soudain pour les sciences occultes. Un bellâtre du nom de Francesco Prelati, qui était versé dans l’alchimie et les incantations évocatoires, lui avait promis qu’il regagnerait sa fortune de jadis en sacrifiant des enfants à un démon nommé « Baron ».
Le nombre exact des victimes de Rais reste inconnu. Les corps étaient généralement démembrés, brûlés ou enterrés. Même si l’on évoqua le sort de trente-sept malheureuses victimes lors du procès, le nombre réel doit certainement être bien plus élevé. Deux jours après les aveux du Baron, la Cour ordonna son exécution. Ensuite, il fut excommunié par le tribunal ecclésiastique. Il exprima ses profonds regrets et l’Église décida de revoir son jugement. Le 26 octobre, Gilles se rendit à l’échafaud en implorant ses amis de prier pour que leurs vies soient sauvées elles aussi. Son cadavre fut jeté dans un bûcher, mais l’évêque responsable de l’enquête qui lui avait coûté la vie le sauva des flammes et Gilles de Rais fut enterré selon les rites catholiques.
Le noble Gilles de Rais combattit aux côtés de Jeanne d’Arc durant le siège d’Orléans
Même durant le Moyen Âge, les méthodes qu’employait Vlad III pour torturer ses victimes sortaient du lot de par leur violence et leur sadisme
VLAD III
Vlad III Dracula était connu à son époque sous le nom de Vlad l’Empaleur. On doit certainement cette épithète aux Turcs qui avaient fini par l’appeler Kaziglu Bey, le prince empaleur, en référence à son mode d’exécution favori. La plupart du temps, il faisait insérer un pieu dans l’anus (ou dans d’autres orifices) de la victime pour le faire ressortir par sa bouche. Les enfants étaient empalés sur des pieux traversant la poitrine de leur mère.
Vlad III naquit à la fin de l’année 1431, probablement dans la ville-forteresse de Sighişoara en Transylvanie. Son père était Vlad II Dracul, un nom roumain signifiant « Dragon ». Ainsi, Vlad III était Dracula, « le fils du Dragon ». Cinq ans après sa naissance, Vlad III devint Prince de Valachie (une région de l’actuelle Roumanie).
Lorsque Vlad eut dix ans, son père l’envoya avec son jeune frère, Radu le Beau, comme otages au sultan ottoman Murad II. Il passa la majeure partie des six années qui suivirent en Turquie, enfermé dans un donjon souterrain, où il était fouetté et battu. Radu, lui, devint le favori du fils du sultan. Il vécut une vie confortable et se convertit à l’islam.
Le retour de Vlad en Valachie fut rendu possible par le meurtre de son frère aîné, Mircea, enterré vivant après avoir été aveuglé par des piques chauffées à blanc, et l’assassinat de son père qui suivit. Murad II fit alors de Vlad un prince fantoche. Quelques mois plus tard, Vlad fut chassé de Valachie par des troupes fidèles au Royaume de Hongrie. Il fuit en Moldavie, où il trouva refuge chez son oncle. Après le meurtre de ce dernier, Vlad décida de jurer allégeance au Royaume de Hongrie plutôt qu’à l’Empire ottoman. En 1456, il mena avec succès une campagne visant à bouter les Turcs hors de Valachie et redevint prince. Il passa les six années suivantes à consolider son pouvoir, par tous les moyens qu’il trouvait, y compris la torture et le meurtre.
Jetés aux fers
En 1462, il perdit la Valachie lorsque les troupes de l’Empire ottoman l’envahirent à nouveau. Sa femme, dont le nom n’est pas parvenu jusqu’à nous, se suicida, de peur d’être capturée. Le frère de Vlad, Radu, devint le nouveau prince. Suite à un accord passé entre le roi hongrois et le sultan Mehmed II, empereur ottoman, Vlad fut emprisonné en Hongrie. Il semble peu probable que son emprisonnement ait duré quatre ans. En 1466, il épousa une princesse hongroise et fut officiellement libéré huit ans plus tard.
En 1475, il tenta de reprendre la Valachie. Radu mort, Basarb le Vieux, devint le nouvel ennemi de Vlad. Sa victoire fut aisée, mais les troupes qui l’avaient aidé retournèrent en Transylvanie, le laissant diriger un peuple qu’il avait jadis terrorisé. Lorsque les Turcs revinrent, Vlad était à leur merci.
Il mourut en décembre 1476. Selon certaines sources, il serait mort sur le champ de bataille, entouré de ses hommes, affrontant la défaite. D’autres racontent qu’il fut accidentellement tué par l’un des siens alors que la bataille touchait à sa fin.
Après sa mort, le cadavre de Vlad fut décapité, conservé dans du miel et envoyé à Istanbul où sa tête finit, avec un certain à-propos, sur un pieu. Selon certaines sources, son corps fut enterré au monastère de Snagov, sur une île près de Bucarest. Cependant, de récentes excavations n’ont permis de découvrir que des os de chevaux. Datant de l’ère néolithique, ces os n’avaient absolument aucun lien avec la dépouille de ce prince de Valachie.
Le fait que les punitions et les tortures qu’infligeait Vlad aient été si remarquées dans cette période sombre qu’est le Moyen Âge indique bien leur degré de cruauté et de sadisme. Les traces écrites les plus anciennes détaillant ses atrocités sont un pamphlet allemand du Saint-Empire romain germanique. Imprimé en 1488, douze ans après sa mort, il décrit le prince comme un monstre sadique, terrorisant son peuple à tout instant. La tradition orale roumaine, cependant, n’est pas si unanime. Certains contes le décrivent comme étant dur mais juste, un prince qui attendait de son peuple de l’honnêteté et de la moralité. Seuls ceux qui ne répondaient pas à ses attentes étaient punis violemment. D’autres récits le décrivent comme un homme cruel dont le seul plaisir résidait dans la torture et les châtiments. Ce Vlad-là disposait d’un grand éventail de tortures pour ses victimes : il les écorchait, les ébouillantait, les scalpait, les décapitait, les aveuglait, les étranglait, les pendait, les brûlait et les faisait rôtir. On raconte qu’il adorait par-dessus tout découper certaines parties du corps (le nez, les oreilles, les parties génitales et la langue) en guise de châtiment.
Selon les traditions orales, ces techniques n’auraient pas été uniquement utilisées contre des Turcs, mais aussi contre le propre peuple de Vlad. Durant les années 1457, 1459 et 1460, il tortura et tua des marchands qui osèrent se rebeller contre ses lois. On raconte qu’en août 1459, il avait fait empaler 30 000 malheureux dans la ville de Brasov.
L’invasion ottomane de 1462 fut causée, en partie, par l’accueil qu’il avait réservé à un émissaire du sultan. Lorsque celui-ci reçut la permission de rencontrer le prince, on lui ordonna d’enlever son turban. Toutefois, l’émissaire n’obéit pas et on le lui cloua sur le front.
Elisabeth Báthory partageait complètement les pulsions sadiques et l’amour de la cruauté et de la torture de son mari
ELISABETH BÁTHORY
Issue de la noblesse, Elisabeth Báthory (Báthory Erzsébet) usa de son pouvoir et de ses privilèges pour devenir la tueuse en série la plus célèbre de l’histoire de Hongrie. Cependant, son crime le plus notoire, celui pour lequel on se souvient d’elle aujourd’hui, fut créé de toutes pièces par un moine du XVIIIe siècle.
La Comtesse Elisabeth Báthory naquit le 7 août 1569 dans la propriété familiale de Nyírbátor dans la région des grandes plaines septentrionales de Hongrie orientale. Son père, George Báthory, était immensément riche, encore plus que ne l’était le roi de Hongrie, Matthias. Sa mère, Anna Báthory, était la sœur aînée du roi de Pologne, Stephan. George était son troisième mari. Par leur mariage, les parents d’Elisabeth avaient uni deux branches d’une famille puissante et perpétué la longue tradition des mariages entre nobles.
En femme de la Renaissance, Elisabeth passa les premières années de sa vie dans le Château d’Ecsed, où elle apprit à lire et à écrire dans quatre langues. À l’âge de onze ans, elle fut fiancée à Ferencz Nádasdy, le fils d’une autre famille aristocratique hongroise, et elle s’en alla vivre dans la famille de son futur époux, dans le château de Nádasdy, situé dans la partie la plus occidentale du pays. Le statut de la famille Báthory était tellement important, que lors du mariage, le 9 mai 1575, le marié prit le nom de la mariée. Cela ne signifie pas que celui qui s’était appelé Ferencz Nádasdy ne jouissait pas d’une fortune considérable. Ainsi, il offrit à Elisabeth en guise de cadeau de mariage leur demeure, le château de Cachtice, une immense maison de campagne et dix-sept villages adjacents.
Même si Ferencz Báthory ne fut que l’un des innombrables personnages historiques à avoir été surnommé « le Chevalier noir », sa cruelle réputation était néanmoins fondée. Trois ans après leur mariage, il devint commandant en chef de l’armée hongroise contre les Turcs alors que la Longue Guerre battait son plein. Il prit un plaisir tout particulier à inventer lui-même des tortures pour ses prisonniers turcs et on raconte qu’il enseigna ces techniques à sa femme. On a même laissé entendre que la comtesse ne partageait pas seulement les pulsions sadiques de son mari, mais que sa passion pour de telles activités avait dépassé de loin celle du Chevalier noir. En fait, on a suggéré que Ferencz Báthory, qui n’était pas vraiment un gentilhomme, dut quelque peu réfréner les pulsions de sa femme et s’assurer que ses déviances restent tempérées et discrètes.
Après la mort de Ferencz en 1604 (probablement à cause d’une maladie, mais souvent avancé comme l’œuvre de prostituées), Elisabeth ne chercha plus à être discrète. Le nombre de ses victimes et le degré de cruauté de ses crimes allèrent tous deux croissants.
Ses premières victimes furent souvent des paysannes des environs, qui arrivaient au château en pensant qu’elles allaient occuper une position plutôt avantageuse en devenant des femmes de chambre. Plus tard, Elisabeth devint suffisamment téméraire pour abuser des filles de la petite noblesse qui lui étaient confiées pour qu’elle leur enseigne les convenances.
Deux ans déjà avant la mort de Ferencz Báthory, des rumeurs et des plaintes s’étaient mises à circuler quant aux activités de la comtesse et elles étaient même arrivées jusqu’à la cour de Vienne, de laquelle les Habsbourg régnaient sur la Hongrie. Dans un premier temps, elles furent écartées. Mais alors que les années passaient et qu’Elisabeth choisissait des proies dans des familles de plus en plus importantes, son comportement ne put plus être ignoré.
En mars 1610, une enquête fut lancée. Les preuves étaient si accablantes que des négociations furent engagées avec d’autres membres de la famille Báthory, dont le fils d’Elisabeth. Il fut décidé que cette dernière ne serait pas punie afin d’éviter un scandale et la disgrâce d’un nom si noble et influent. Au lieu de cela, elle fut assignée à résidence et obligée à finir le restant de ses jours au château.
Le matin du 29 décembre 1610, un groupe d’hommes menés par le palatin de Hongrie, George Thurzó, pénétra dans le château. Ils découvrirent une fille qui venait de rendre l’âme, deux autres qui étaient mortellement blessées et un grand nombre de captives. Mais ces visions d’horreur n’étaient pas les pires. Elisabeth s’était débarrassée de ses victimes sans y prêter vraiment attention. La plupart du temps, elles avaient été poussées sous des lits, et si la place venait à manquer, les servantes devaient déplacer les corps et les laisser dans les champs avoisinants. Des corps entiers ou démembrés furent retrouvés à travers tout le château.
Le 7 janvier 1611, quatre servantes, considérées comme les complices d’Elisabeth, furent jugées. Seule l’une d’entre elles échappa à l’exécution. Alors que la comtesse fut envoyée dans une tour du château pour y passer le restant de ses jours, deux de ses servantes eurent les doigts coupés et finirent sur le bûcher et la troisième fut décapitée.
En rendant leur verdict, vingt et un juges avaient considéré les témoignages collectés durant les dix derniers mois. On avança qu’Elisabeth avait torturé et tué ses victimes non seulement dans le château, mais également dans ses autres propriétés et durant des voyages à Vienne. La plupart du temps, les plaintes contre Elisabeth ne se basaient que sur des on-dit. Ses crimes, pourtant, étaient innombrables. Elle aimait placer des aiguilles sous les ongles des mains et des pieds de ses servantes et recouvrir leurs mains, leur visage et leurs parties génitales de médailles chauffées à blanc. En hiver, elle faisait jeter des jeunes filles dans la neige avant de verser de l’eau froide sur les malheureuses, et les regardait geler. Elle laissait également d’autres jeunes filles mourir de faim. On raconta aussi qu’elle prenait énormément de plaisir à mordre la chair du visage et d’autres parties du corps de ses victimes, encore vivantes.
On ignore le nombre exact des victimes d’Elisabeth. Un témoin mentionna un livre écrit par la comtesse, qui reprenait apparemment les noms de plus de 650 de ses victimes. Même si le livre ne nous est pas parvenu et que ce nombre n’est jamais mentionné par personne d’autre, cette supposition est restée, devenant partie intégrante de la légende d’Elisabeth Báthory. Cependant, ses complices estimaient le nombre de ses victimes à moins de cinquante et d’autres personnes travaillant dans le château l’estimèrent entre 100 et 200.
Après avoir appris l’étendue et la nature exacte des crimes d’Elisabeth, Mattias II, empereur de Hongrie, encouragea Thurzó à la juger. Même si ce dernier ne voulait pas rompre l’accord convenu avec la famille des Báthory, il se mit à collecter plus de preuves. On laissa penser que Thurzó cherchait à gagner du temps. Si c’était le cas, il y réussit. Elisabeth vécut en résidence surveillée pendant moins de quatre ans. Elle fut retrouvée morte dans sa chambre par une servante le soir du 21 août 1614.
Des atrocités imaginées
Comme si les crimes d’Elisabeth Báthory n’étaient pas assez ignobles, son histoire s’est enjolivée avec le temps d’atrocités inventées de toutes pièces. L’invention la plus récurrente fut l’idée selon laquelle la comtesse faisait assassiner des vierges pour se baigner dans leur sang. L’histoire veut que la comtesse espérait en agissant de la sorte retrouver sa jeunesse et sa beauté. Même si la source de cette histoire a disparu, le récit qu’en fit László Turóczi, un érudit jésuite, dans sa Tragica Historia en 1729, fut la trace écrite la plus ancienne que l’on retrouva. Depuis trois siècles cette horreur sans nom est devenue la référence ultime en matière de vanité féminine.
Des jeunes filles de la région arrivaient au château des Báthory en espérant vivre une vie de servante qui ne soit pas trop dure
William Burke, exécuté en 1829, et William Hare : les facultés de médecine avaient désespérément besoin de corps, et ces deux « déterreurs de cadavres » trouvèrent une horrible manière de les leur fournir, contre rémunération
BURKE ET HARE
Le 28 janvier 1829, le corps d’un prisonnier exécuté, William Burke, fut amené à l’Université d’Édimbourg. Il y fut étudié et disséqué sous les yeux des étudiants en médecine, des professeurs et des spectateurs intéressés. Le squelette du prisonnier fut retiré, nettoyé et préparé pour la faculté de médecine de l’université. Sa peau fut utilisée pour la réalisation de plusieurs objets, y compris la reliure d’un petit livre encore visible aujourd’hui dans le musée d’histoire de la chirurgie de l’Académie de chirurgie d’Édimbourg. Une fin on ne peut plus appropriée pour l’un des meurtriers les plus tristement célèbres de l’histoire d’Écosse.
Né en 1792, dans la commune d’Urney, dans le comté de Tyrone en Irlande, Burke avait passé sept ans dans la milice, il s’était marié et avait eu deux enfants. Vers 1817, il émigra en Écosse. Il disait écrire à sa femme régulièrement, sans qu’elle y réponde, cependant, il est plus probable qu’il ait abandonné sa famille. En Écosse, Burke eut plusieurs vies. Il travailla en effet comme boulanger, cordonnier et ouvrier agricole. Alors qu’il travaillait sur l’Union Canal, il rencontra une femme qui s’appelait Helen Mc Dougal. Toutefois, il ne s’agissait pas de son vrai nom. En effet, elle avait quitté son mari des années auparavant et avait rencontré un scieur dont elle avait adopté le nom. Ils eurent deux enfants, qu’Helen abandonna lorsque Burke et elle s’enfuirent pour arriver finalement à Édimbourg.
William Hare, lui aussi, était arrivé d’Irlande en Écosse. Tout comme Burke, il avait travaillé sur l’Union Canal et s’était lié d’amitié avec un homme du nom de Logue. En 1822, une fois son contrat terminé, Hare trouva du travail sur les canaux. Il devait charger et décharger les bateaux. Il habita dans la sordide pension de sept lits de Logue à Édimbourg, mais son séjour fut de courte durée. Les deux amis se brouillèrent, sans doute à cause de l’intérêt que Hare portait à la femme de Logue, Margaret. Lorsque Logue mourut en 1826, Hare revint à la pension et devint, après une petite compétition avec un autre pensionnaire, le compagnon de la veuve.
Dès 1827, William Burke et Helen Mc Dougal étaient devenus des pensionnaires réguliers de William Hare et de Margaret Logue. Même s’il serait incorrect de dire que les deux couples entretenaient des relations amicales, ils étaient pourtant unis par des intérêts communs : le whisky et l’argent, dont ils semblaient manquer depuis toujours. Leur situation changea en novembre 1827, lorsqu’un pensionnaire connu sous le nom d’Old Donald, un vétéran de l’armée, mourut d’une « hydropisie » alors qu’il devait quatre livres de loyer. Ennuyé par cette dette, Hare chargea Burke de l’aider en volant le corps du cercueil et en le remplaçant par l’équivalent de son poids en écorce à tanin. En homme habitué des rues moins fréquentables d’Édimbourg, Hare savait que le corps d’Old Donald avait une certaine valeur pour les facultés de médecine de la ville. Une fois la nuit tombée, ils allèrent chercher le corps là où ils l’avaient dissimulé, le mirent dans un sac et l’amenèrent au 10, Surgeons’ Square, dans une école d’anatomie. Là, ils furent reçus par trois assistants du Docteur Knox, l’un des professeurs d’anatomie des plus importants en Écosse. Pour leur dérangement, Burke et Hare reçurent un peu plus de sept livres, soit presque trois livres en dessous des prix habituels. Toutefois, il s’agissait d’une somme importante, et ils furent ravis d’avoir gagné autant d’argent en faisant si peu d’efforts.
Peu de temps après, un autre locataire, un meunier du nom de Joseph, eut un accès de fièvre et commença à délirer. Craignant que la nouvelle de la maladie de Joseph ait des conséquences sur les affaires, Hare devint de plus en plus inquiet, mais il réussit rapidement à tourner la situation à son avantage. Il appela Burke aux côtés de Joseph. Là, ils décidèrent que le meunier allait très certainement mourir de la fièvre. Ils firent boire meunier et ensuite Burke l’étouffa avec son oreiller. Ce soir-là, ils amenèrent le corps aux assistants du Docteur Knox.
L’hiver passa et l’argent que Burke et Hare avaient reçu pour le corps du meunier aussi. Dès le mois de février 1828, ils étaient à nouveau à la recherche de revenus supplémentaires par le biais des bonnes grâces du Docteur Knox. Toutefois, malgré la rigueur de l’hiver et les problèmes sérieux d’Édimbourg en matière d’hygiène, tous les locataires semblaient en bonne santé. Burke et Hare se mirent à chercher ailleurs, imaginant que les sans-abris ne manqueraient à personne. Leur prochaine victime fut Abigail Simpson, une ancienne employée appauvrie de Sir John Hope, qui avait marché jusqu’à Édimbourg pour recevoir sa retraite : dix-huit pence et un peu de bouillon. Elle rentrait chez elle lorsqu’elle rencontra Hare qui l’invita à la pension pour y prendre un verre. Il est probable que Burke et Hare aient voulu tuer Abigail ce soir-là, mais ils avaient trop bu pour mettre leur plan à exécution. Elle aussi était saoule et elle passa la nuit sur place. Au réveil, elle se remit à boire, mais Burke et Hare firent de grands efforts pour rester sobres. Dès qu’elle se rendormit, ils l’étouffèrent.
Ce soir-là, ils se rendirent pour la troisième fois au 10 Surgeons’ Square et ils rencontrèrent le Docteur Knox pour la première fois. Le professeur fut enchanté de voir qu’ils apportaient un cadavre et accepta de les payer dix livres. Comme ils en prendraient l’habitude, le gain fut divisé en trois : quatre livres pour Burke, cinq livres pour Hare et une livre pour Margaret Logue, qui, en tant que propriétaire de la pension, leur rendait un très grand service.
En six mois, le Docteur Knox eut l’occasion de revoir Burke et Hare à de nombreuses reprises, puisqu’ils commirent de plus en plus de meurtres. Ils mirent charitablement fin à la vie d’un locataire qui n’était pas en bonne santé. Ils étouffèrent une vieille femme que Margaret avait rencontrée dans la rue et ramenée à la pension. En avril, Burke ramena deux prostituées adolescentes. Les deux complices en tuèrent une des deux après que l’autre fut partie. Ensuite, ils se risquèrent à transporter sa dépouille en pleine après-midi à travers la ville. Un groupe d’écoliers les raillèrent en criant : « Ils portent un cadavre ! » Personne ne les arrêta pour vérifier.





























