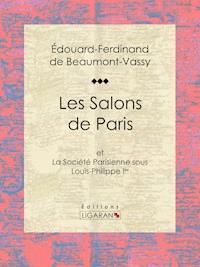
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Extrait : "On conçoit quel fut l'ébranlement produit par la Révolution de juillet 1830 sur la société parisienne. Ce coup de tonnerre devait soudainement disperser "tous ces oiseaux qui ne chantent pas pendant la tempête," comme dit le poète allemand ; et la perturbation sociale fut d'autant plus forte (il importe de le constater) qu'il y avait encore, à cette époque, des convictions politiques assez ardentes ..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335050561
©Ligaran 2015
Je ne saurais et ne voudrais, d’ailleurs, jamais jouer le rôle de contempteur systématique du temps présent au profit d’une époque sociale déjà éloignée de nous, et dont les révolutions qui nous en séparent font paraître la silhouette plus lointaine qu’elle ne l’est en réalité.
Laudator temporis acti, a dit Horace du vieillard morose qui ne trouve de beau et de bon que ce qui se disait et se faisait dans sa jeunesse. Je ne suis pas assez vieux pour jouer ce personnage, et, de plus, il ne conviendrait aucunement à ma nature impartiale.
Mais, tout en étudiant et en écrivant l’histoire contemporaine, mes yeux, se détournant quelquefois des évènements purement politiques, mes souvenirs, évoquant les faits anecdotiques, les personnages plus ou moins originaux de l’époque que je traversais, la pensée m’est venue très naturellement de reproduire avec une exactitude photographique l’image de la société parisienne durant la période comprise entre les deux révolutions de Juillet 1830 et de Février 1848.
Qu’on ne s’y trompe pas : une étude de ce genre, pour être parfois amusante, n’a, par le fait, rien de futile. Les habitudes, les goûts, les mœurs d’une époque se rattachent par le lien le plus étroit aux évènements historiques qui la composent, et, le plus souvent, les expliquent mieux que ne saurait le faire la plus consciencieuse analyse. De là vient le succès des mémoires lorsqu’ils sont réellement écrits par les contemporains.
Pour les trois quarts des faits mentionnés dans ce volume, c’est en témoin oculaire que je parle. Je tiens le reste de gens qui ont vu comme j’ai vu moi-même. Il y a là pour le lecteur une garantie d’exactitude qui a sa valeur relative.
Ce n’est point, d’ailleurs, sans une certaine émotion que je me suis reporté à l’époque sociale que je retrace. Tout en n’étant pas le vieillard d’Horace qui croit et dit que le temps passé était exclusivement le bon temps, je ne puis oublier que ce fut celui de mon adolescence et de ma jeunesse ; et il y a, pour l’homme, quelque philosophe qu’il soit devenu, un charme singulier dans le souvenir de ces premières années de la vie, où toutes les difficultés, tous les périls, toutes les douleurs qu’elle nous réserve, étaient encore inconnus, et où on s’avançait gaiement en n’apercevant que les fleurs du sentier !…
E. DE BEAUMONT-VASSY
État de la société parisienne après la Révolution de 1830. – Conséquences premières de la dispersion de la cour de Charles X.– Hiver de 1831. – Le salon de la Fayette. – Types et portraits. – La famille du général. – Ses amis et clients. – Visiteurs étrangers. – Le général Pépé et ses déceptions. – Dom Pedro et dona Maria. – Démission du général la Fayette et solitude de son salon. – Le Palais-Royal. – Fête donnée au roi de Naples, au mois de juin 1830. – Ma visite à M. de Salvandy en 1816. – Curieuse conversation avec lui à propos de cette fête.
On conçoit quel fut l’ébranlement produit par la Révolution de juillet 1830 sur la société parisienne. Ce coup de tonnerre devait soudainement disperser « tous ces oiseaux qui ne chantent pas pendant la tempête, » comme dit le poète allemand ; et la perturbation sociale fut d’autant plus forte (il importe de le constater) qu’il y avait encore, à cette époque, des convictions politiques assez ardentes pour que le temps présent ne puisse plus nous offrir, à cet égard, de point de comparaison.
Le parti que frappait la Révolution de juillet n’était pas seulement, d’ailleurs, un parti de gentilshommes et de femmes du faubourg Saint-Germain : l’antipathie produite par les sanglants excès de la première Révolution, l’attendrissement provoqué par les malheurs si étrangement répétés de la famille des Bourbons, certaines traditions de fidélité monarchique qui existaient encore et se transmettaient de père en fils, tout cela réuni faisait que l’opinion contraire au fait qui venait de s’accomplir à Paris avait alors des représentants dans le peuple, dans la bourgeoisie, et que quelques-unes de nos provinces étaient encore presque tout entières dévouées au principe que le Paris libéral venait de proscrire. Les partis avaient donc une physionomie bien nette, bien tranchée.
Lorsque, tout à coup, au milieu des eaux calmes d’un lac, tombe quelque lourd fragment des rochers qui le surplombent, l’onde, un moment bouillonnante, forme d’abord un cercle immense où s’agitent et se heurtent les vagues tumultueuses. Des cercles plus restreints succèdent au premier ; ils vont toujours se rétrécissant. L’agitation des eaux se calme enfin, et la surface du lac reprend, avec son aspect antérieur, sa primitive immobilité.
Il en est ainsi pour la société française lorsqu’elle a reçu quelque choc inattendu. Le désordre et l’agitation sont énormes d’abord ; puis les parties disjointes se rejoignent, les vides se comblent, les salons s’ouvrent de nouveau, et, si l’aspect n’en est plus absolument le même, du moins on s’y retrouve et on s’y reconnaît.
À l’exception du monde officiel, les membres de la haute société parisienne étaient presque tous dans leurs terres ou aux eaux lorsque éclata la Révolution de juillet. Ce fut sur la plage de Dieppe, aux bords du Rhin ou sous les ombrages séculaires de leurs parcs qu’ils lurent les ordonnances et apprirent les conséquences fatales de cette faute politique. Dans leur douleur ou dans leur colère, ils jurèrent (les femmes surtout) qu’ils bouderaient longtemps ce Paris qui accomplissait en trois jours des révolutions aussi radicales et renversait une dynastie imposante par les souvenirs historiques, sans daigner même se rattacher a la combinaison qui lui présentait ce jeune roi, innocent du passé, et qu’un régent, comme Louis-Philippe d’Orléans, pouvait si bien former pour l’avenir.
La cour de Charles X, sans être gaie, était extrêmement brillante ; et lorsque les dignitaires du palais, les trois cents gentilshommes de la chambre du roi, les écuyers cavalcadours, les officiers des cérémonies, de la vénerie, de l’hôtel, les pages, les gardes du corps, les officiers de la garde royale, tout ce monde couvert d’or et de broderies qui payait si largement à l’industrie cet impôt dont on ne se plaint jamais, l’impôt de la vanité, eut disparu, dispersé par la tempête, le commerce se ressentit vivement du coup que la révolution venait de lui porter. Malgré les efforts du gouvernement nouveau, les bals officiels, les fêtes données par la garde nationale, l’hiver de 1831 fut morne, et Paris, comme jadis, n’attira pas les riches étrangers.
Lorsqu’à cette époque, c’est-à-dire dans les premiers mois qui suivirent la Révolution de 1830, un curieux ou un ambitieux de province arrivait dans ce Paris si transformé, deux salons lui étaient indiqués comme renfermant toutes les influences, toutes les forces vives du jour : ces deux salons étaient celui de la Fayette et le salon du Palais-Royal ; et si, quoique l’accès en fût facile, le provincial éprouvait quelque difficulté à parvenir jusqu’au salon de Louis-Philippe, du moins était-il certain de s’introduire dans celui de la Fayette, lequel, comme le caravansérail de l’Europe révolutionnaire, était ouvert à tout le monde. Le laisser-aller du célèbre ami de Washington, sa soif inextinguible de popularité, l’extrême simplicité de ses habitudes, avaient produit ce résultat qu’il n’était pas un homme, voulant voir Paris et professant des idées politiques avancées, qui retournât dans ses foyers sans pouvoir dire qu’il avait pénétré chez le « héros des Deux-Mondes, » comme on l’appelait alors, et qu’il avait échangé une poignée de main avec lui. De là, ce public de mauvais aloi et souvent d’un aspect sordide qui se pressait alors dans le salon du général la Fayette autour des notabilités de la Révolution de juillet.
M. de la Fayette demeurait rue d’Anjou-Saint-Honoré. À partir de huit heures du soir, tous les mardis, une foule bigarrée venue à pied, en voiture de place ou en équipage, montait sans cérémonie un escalier aussi simple que l’appartement auquel il conduisait.
Dans la première pièce qui était une salle à manger, pièce d’une apparence austère et dont le mobilier attestait des mœurs républicaines, on rencontrait et on coudoyait déjà des célébrités du jour. C’était Audry de Puyraveau, d’une figure franche et modeste ; un homme convaincu celui-là ! qui, avec une simplicité tout enfantine, mais en sachant bien ce qu’il faisait, avait intrépidement joué sa vie, ou tout au moins sa liberté, pour ses opinions politiques. Près de lui, et comme repoussoir, Eusèbe de Salverte se tenait sombre et grave, écoutant la parole trop abondante de son voisin Mauguin, au teint brun, aux cheveux gris, aux yeux perçants, qui dans une interminable conversation passait toute l’Europe en revue. Non loin de là, un homme de haute taille, aux épaules carrées, maigre et bilieux, tête expressive, regard pénétrant, causait avec un petit vieillard tout courbé dont un garde-vue vert couvrait une partie du visage. Le premier de ces deux personnages était le général Lamarque dont le convoi devait, dix-huit mois plus tard, devenir le prétexte d’une émeute sanglante ; le second était aussi un homme de guerre, mais d’un tempérament différent, le général Mathieu Dumas.
De la salle à manger on pénétrait dans une seconde pièce qui était le salon, pièce non moins simplement meublée que la première ; et l’œil était tout d’abord attiré par un cercle de femmes et de jeunes filles, appartenant pour la plupart à la famille de M. de la Fayette, et dont les blonds cheveux, les fraîches toilettes sollicitaient et récréaient le regard. Presque toutes étaient la Fayette, Tracy, Lasteyrie, Corcelles. Au milieu d’elles, on distinguait une Italienne d’un genre de beauté étrange et remarquable, dont j’aurai occasion de reparler plus tard avec plus de détails, car elle a eu l’un des salons les plus curieux et les plus intéressants du Paris de cette époque. C’était la princesse Belgiojoso, née Trivulce, dont le mari, milanais, avait, à cause de ses opinions, encouru la disgrâce du gouvernement autrichien, et qui, réfugiée en France, s’y trouvait, en quelque sorte, placée sous la tutelle du général la Fayette. Près d’elle, et formant un indicible contraste, on remarquait de suite, à sa bizarre coiffure, une quakeresse, miss Opie, femme d’esprit et de cœur, qu’il n’aurait pas fallu juger sur cette apparence presque ridicule. Les enfants de M. Georges de la Fayette, Clémentine, Edmond et Oscar, circulaient au milieu de ce groupe féminin.
Enfin, dans un angle de ce salon de si simple aspect, entouré, comme un personnage antique, d’un triple rang d’amis et de clients attentifs à sa moindre parole, à son moindre geste, se tenait M. de la Fayette ; figure pâle surmontée d’une courte perruque brune, taille élevée et que l’âge avait alourdie ; visage qui cachait sous une apparence de bonhomie et d’optimisme banal, les passions politiques encore très vertes du vieillard.
Le cercle compacte qui l’entourait de sa curiosité plus ou moins respectueuse (car, je l’ai dit, tout le monde avait accès dans ce salon) empêchait le visiteur d’apercevoir immédiatement l’homme qui, depuis quarante ans, avait, pour ainsi dire, présidé à toutes nos révolutions sans avoir jamais su y jouer un rôle décisif. Autour de lui, le vieux Dupont de l’Eure, Victor de Tracy, alors commandant de l’artillerie de la garde nationale et qui depuis, sous la seconde République, a été ministre de la marine ; Cormenin, ce sphinx immobile et muet qui n’avait d’animation et d’audace que la plume à la main ; Odilon Barrot, au regard olympien, au sourire ironique, dans toute la jeunesse et la sève de son ambition politique ; Mérilhou, ministre obscur ; Cavaignac, digne de sa notoriété, et le gros Châtelain, rédacteur en chef du Courrier français, le plus jovial et le mieux nourri de tous les représentants de la presse périodique, gravitaient comme des satellites autour d’une planète de premier ordre.
Des réfugiés de tous les pays et de jeunes républicains dont les cheveux taillés à la malcontent et la barbe pointue avaient la prétention d’indiquer à tout venant une nuance politique, formaient les comparses, et, pour ainsi dire, le chœur dans ce salon singulier non moins que curieux pour l’observateur des mœurs et habitudes sociales de l’époque.
Parfois, quelque célébrité exotique y apparaissait et attirait l’attention du cénacle. Ce fut ainsi que peu de jours après la Révolution de 1830, alors que le canon de juillet devenait pour l’Europe le tocsin des révolutions, le général italien Guillaume Pépé y fut reçu à bras ouverts. Ses premières paroles furent pour demander le concours de la France dans l’entreprise qu’il méditait pour soulever l’Italie.
– De quels secours auriez-vous besoin ? lui demanda la Fayette.
– De deux mille hommes, lui répondit Pépé ; de dix mille fusils de munition et de deux frégates pour escorter l’expédition.
La Fayette, trouvant ces prétentions très modérées, demanda cinq ou six jours pour arranger, disait-il, cette affaire avec le nouveau roi des Français. En attendant, il présenta Pépé à Lamarque et Mauguin ; mais Lamarque, avec son coup d’œil militaire, murmurait entre ses dents :
– À Modène, une insurrection sera réprimée par un régiment autrichien ; à Bologne, par une brigade.
– Je vous conduirai moi-même chez le roi, dit la Fayette au général italien ; parce que, si vous m’accompagnez, votre nom ne sera pas prononcé, et les journaux ne parleront point de l’audience que vous accordera le prince, auquel il importe qu’il n’en soit pas fait mention.
Pépé fut étonné de cette précaution que la Fayette semblait ne pas trouver superflue ; toutefois il dissimula sa surprise. Mais les jours s’écoulèrent et il ne lut plus question de rien. Le mardi suivant, M. de la Fayette voyant entrer Pépé, le prit à part et lui dit :
– Lisez cette lettre.
Elle était de Louis-Philippe, et commençait ainsi :
« Mon cher général, il faut ajourner la présentation de l’étranger votre ami. »
Quelques jours plus tard, comme il entrait un matin chez le général, dont il assiégeait la porte, Pépé comprit à sa physionomie que ses espérances devaient s’évanouir.
– J’ai de mauvaises nouvelles à vous donner, lui dit M. de la Fayette ; les ministres ne veulent plus rien faire (ils ne l’avaient par le fait jamais voulu). Mais le roi semble désirer beaucoup voir le royaume des Deux-Siciles soumis à un régime constitutionnel. Seulement, dans les circonstances présentes, Louis-Philippe ne peut faire autre chose que d’envoyer à son beau-frère, le roi François Ier, un mémoire dans lequel vous exposerez de quelle façon on peut donner une constitution aux Deux-Siciles, en évitant la moindre commotion.
Guillaume Pépé écrivit le mémoire qu’on lui demandait et qui fut, en effet, envoyé à Naples par les soins du roi Louis-Philippe.
François Ier, déjà souffrant de la maladie qui devait le conduire au tombeau, fit répondre, tout en remerciant Pépé, qu’il songerait à son mémoire ; mais que les dangers qu’il signalait n’étaient pas aussi prochains qu’il semblait le supposer.
François Ier, homme politique éminent d’ailleurs, avait jugé juste : les troubles et les embarras prévus par Pépé ne devaient devenir des catastrophes pour ses successeurs qu’a la seconde génération.
Un autre personnage étranger ne tarda pas à paraître chez le général la Fayette. Ce fut dom Pedro de Bragance et Bourbon, le père de dona Maria da Gloria, l’ex-empereur du Brésil, qui rêvait une expédition en Portugal dans le but de détrôner dom Miguel au profit de sa fille.
Dom Pedro était un prince de fort bonne mine qui cherchait à se rendre le plus populaire possible à Paris, dans l’intérêt de sa cause politique. Il voulut conduire chez M. de la layette la petite reine dona Maria, eu visite de cérémonie. C’était en grand habit, comme on disait autrefois, qu’il voulait présenter sa fille au héros des deux mondes, et cette toilette, dont il avait surveillé tous les détails, ne manqua pas de faire le sujet des conversations parisiennes. La petite reine, habillée par mademoiselle Victorine, célèbre faiseuse d’alors, devait porter une robe de tulle noir brodé en lames d’or, appliquée sur un transparent de satin cramoisi, le tout recouvert d’une sorte de manteau de cour, en étoffe de Lyon, brochée noir et cramoisi sur un fond d’or, dans la bordure duquel on voyait des médaillons peints sur ivoire avec les armes du Portugal et des Algarves. On comprend que cette toilette de cour produisit un grand effet dans le salon de l’ami de Washington, qui, pour cette circonstance particulière, sut retrouver ses anciennes habitudes de Versailles, qu’en vrai gentilhomme il n’avait jamais complètement perdues.
L’influence du général la Fayette ne semblait pas encore assez détruite à cette époque pour qu’on négligeât de se présenter chez lui. Ainsi le prince de Talleyrand, nommé ambassadeur à Londres, venait, comme pour se purifier de ses anciens péchés contre la politique libérale, se montrer dans le salon de la rue d’Anjou, et la Fayette, surpris, mais, au fond, satisfait de la démarche, répétait à tout le monde : « Il y avait trente ans que Talleyrand n’avait mis les pieds chez moi. »
M. le duc d’Orléans, dans toute la sève de sa brillante jeunesse, y vint plusieurs fois sans cérémonie et frappa même son auditoire par l’élégance et la savante variété de sa conversation facile. Évidemment il avait voulu briller et séduire.
Mais un jour vint où l’attitude du général la Fayette souleva l’opinion modérée, l’élément conservateur, contre ce que l’on nommait son autorité irresponsable. Il avait rendu des services ; honnête homme, il s’indignait à l’idée du sang versé, et sa conduite durant les dernières heures du procès des ministres de Charles X avait du moins prouvé ses bonnes intentions. Mais ce n’était pas sans arrière-pensée que M. de la Fayette avait agi de la sorte ; il voulait, tout en constatant clairement l’espèce de dictature que lui conférait sa situation de commandant général des gardes nationales du royaume, faire servir au développement de ses idées politiques l’influence que les derniers évènements lui avaient donnée. Son ordre du jour du 24 novembre 1850 se terminait donc par ces phrases significatives : « La capitale, dont la sécurité a été garantie avec une sage fermeté, est contente de nous. Il en sera de même dans toute la France. Les affaires comme notre service reprennent leur cours ordinaire ; la confiance va se rétablir ; l’industrie va se ranimer ; tout a été fait pour l’ordre public ; notre récompense est d’espérer que tout va être fait pour ta liberté. »
Jalouse de ses prérogatives, ennemie (comme cela se disait alors) de toutes les dictatures, qu’elles procédassent du peuple ou du droit divin, la Chambre des députés parut s’émouvoir tout à coup de la situation exceptionnelle qui créait un pouvoir sans contrôle, presque sans limites, en dehors des pouvoirs constitutionnels et réguliers. On a dit qu’il n’y a rien de plus hypocrite que les assemblées parlementaires, et c’est une grande, une incontestable vérité : tandis que la chambre prodiguait au « héros des deux mondes » les qualifications les plus louangeuses, elle ne songeait déjà plus qu’à détruire, qu’à renverser cette puissance rivale qui la troublait et l’offusquait.
Elle l’attaqua avec une merveilleuse adresse, mais aussi avec une rare duplicité : le ministère avait présenté un projet de loi sur la garde nationale, et ce projet renfermait l’article suivant : « Dans les communes ou cantons où la garde nationale formera plusieurs légions, le roi pourra nommer un commandant supérieur, mais il ne pourra être nommé de commandant supérieur des gardes nationales de tout un département, ou même d’un arrondissement de sous-préfecture. » La discussion de cet article, en se généralisant, fit surgir tout à coup le nom de M. de la Fayette ; et, en effet, si le pouvoir de nommer un commandant supérieur dans un département n’était pas laissé au chef de l’État comment serait-il jamais possible d’admettre qu’un citoyen, quelque grand qu’il fût, d’ailleurs, pût être investi du commandement en chef des gardes nationales du royaume ?
On accabla donc d’éloges M. de la Fayette ; mais, en définitive, on supprima aussi régulièrement, aussi constitutionnellement que possible, les hautes fonctions qui lui avaient été décernées en quelque sorte comme une couronne civique dont il était si glorieux et si fier ! Vivement froissé dans son amour-propre, le général, averti du vote de la Chambre, envoya sa démission au roi.
Et le roi lui répondit :
« Je reçois à l’instant, mon cher général, votre lettre qui m’a peiné autant que surpris par la décision que vous prenez ; je n’ai pas encore eu le temps de lire les journaux. Le conseil des ministres s’assemble à une heure ; après, je serai libre, c’est-à-dire qu’entre quatre et cinq j’espère vous voir et vous faire revenir sur votre détermination. »
Mais, après avoir avec amertume et franchise exposé tous ses griefs au roi, M. de la Fayette maintint la démission qu’il avait donnée, et, à dater de ce moment (ce qui ne fait pas grand honneur à la nature humaine), son salon, jadis trop rempli, ne vit plus que sa famille ou ses intimes amis.
Celui du Palais-Royal était, comme je l’ai dit, moins facilement abordable, quoique bien loin d’être inaccessible, surtout dans les premiers temps qui suivirent la Révolution de juillet. Ce ne fut qu’au bout de dix-huit mois que Louis-Philippe et sa famille allèrent s’installer aux Tuileries, salon dont je parlerai longuement plus tard.
Le Palais-Royal avait, on le sait, bien changé d’aspect depuis 1814. Les courtisanes et les jeux avaient beaucoup contribué à étendre sa célébrité dans toute l’Europe à l’époque où, lorsqu’on demandait : « Où conduit cette roule ? » on répondait : « Elle conduit au Palais-Royal. » En 1830, les courtisanes en étaient expulsées depuis quelques années. Les jeux ne devaient pas tarder à l’être. Le duc d’Orléans avait voulu moraliser les lieux qui lui servaient de demeure. Il avait également entrepris, avec l’aide de l’architecte Fontaine, de régulariser les galeries à arcades qui encadrent le jardin, et de supprimer ces étables d’Augias que l’on nommait les galeries de bois, en les remplaçant par un passage brillant, aéré, recouvert d’un dôme de verre et auquel il avait donné son nom.
Cette élégante galerie d’Orléans, ainsi que les autres embellissements du palais, était à peine terminée à l’entrée de l’hiver de 1830.
On sait que la dernière grande fête officielle donnée sous la Restauration fut offerte par le duc d’Orléans à Charles X et à ce même roi de Naples, François Ier, dont j’ai eu occasion de parler tout à l’heure. François Ier, père de madame la duchesse de Berry, venait de conduire en Espagne une autre de ses filles destinée à épouser Ferdinand VII et à devenir la mère de la reine Isabelle II, actuellement régnante. Il avait franchi les Pyrénées et traversé toute la France pour aller visiter Charles X et la mère du duc de Bordeaux. Des réceptions brillantes l’avaient accueilli partout, ainsi que la reine de Naples, durant ce voyage accompli au moment où la glorieuse expédition d’Alger paraissait devoir faire une si heureuse diversion aux querelles politiques et aux dissentiments des partis.
Ce bal célèbre donné au Palais-Royal en juin 1830 était resté dans la mémoire de tous ceux qui y avaient assisté : je me souviens qu’un jour j’eus à son sujet une très curieuse conversation avec M. de Salvandy, alors qu’il était ministres de l’instruction publique.
Cet excellent et honorable M. de Salvandy, que je vois encore avec sa haute taille, sa figure gravée par la petite vérole, son cou un peu épaissi par une dangereuse tumeur qui commençait à apparaître et qu’il s’efforçait de dissimuler sous la cravate et les cheveux, était, quand il le voulait, un des plus brillants conteurs que l’on pût rencontrer et entendre. Homme d’un mérite beaucoup plus grand que ses adversaires politiques ne voulaient l’admettre, il s’est montré en centaines circonstances excellent orateur, et si ses ennemis lui reprochaient un peu de solennité dans les formes, il a témoigné du moins, lors de son ambassade en Espagne et pendant la durée de son ministère, d’une remarquable dignité de caractère et d’une grande fermeté d’esprit.
J’allais, un matin du mois de mai 1846, causer avec lui, au point de vue littéraire, d’une mission en Suède qui m’avait été confiée, et je me trouvais (j’ai toujours eu la mémoire exacte des lieux) dans son cabinet de travail, rue Cassette, car, jusqu’à une certaine heure de la journée, il habitait encore, quoique ministre, l’appartement particulier qu’il occupait auparavant avec sa famille, composée de l’excellente madame de Salvandy ; de sa fille, qui est devenue depuis la marquise d’Aux ; de son fils, jeune alors, et de sa parente, mademoiselle Féray, dont le frère a épousé depuis la fille du maréchal Bugeaud.
Après avoir traité la question qui m’amenait et reçu les instructions du ministre, la conversation avec l’homme continua sur des sujets divers. M. de Salvandy m’honorait d’une très grande bienveillance.
Je ne sais comment j’en vins à citer un mot de lui resté célèbre et qu’il avait prononcé pendant ce bal donné par le duc d’Orléans à Charles X et au roi de Naples : « C’est bien une fête napolitaine, car nous dansons sur un volcan. » Ses souvenirs se réveillèrent alors, et voici les curieux détails qu’il me donna à propos de cette fête historique :
– Ce fut, me dit-il, au duc d’Orléans lui-même que j’adressai ces paroles dont les journaux s’emparèrent le lendemain. La fête avait été splendide. À neuf heures précises, Charles X était arrivé avec le roi et la reine de Naples, le prince de Salerne, le Dauphin, la Dauphine, et Madame, duchesse de Berry, donnant la main à Mademoiselle. Le duc de Bordeaux n’était pas présent. Accompagné de ses deux fils aînés, les ducs de Chartres et de Nemours, le duc d’Orléans avait été recevoir les deux rois à la descente de leurs voitures. Madame la duchesse d’Orléans, entourée de ses plus jeunes fils, de ses filles charmantes et de sa belle-sœur, madame Adélaïde, attendait le royal cortège au haut du grand escalier.
« Les souverains et leurs brillantes suites parcoururent les magnifiques salons dont quelques-uns étaient à peine terminés, et la galerie nouvelle dont les peintures représentaient l’histoire du Palais-Royal. Charles X, qui donnait le bras à la reine de Naples, avait l’air gai et satisfait. La duchesse de Berry paraissait également joyeuse de posséder sa famille auprès d’elle. La Dauphine, cette martyre de nos discordes, semblait, comme toujours, dépaysée au milieu des fêtes. Le roi de Naples marchait plié en deux comme un homme qui a déjà reçu une première atteinte de la mort.
« Après avoir traversé tous les salons, Charles X s’avança vers la terrasse qui donne sur le jardin, et y conduisit la reine de Naples. La nuit était superbe, une nuit de juin éclairée puissamment par la lune. Le roi montra le ciel avec la main et dit à voix assez haute :
« – Voilà un beau temps pour ma flotte d’Alger !
« Des cris de : Vive le roi ! se firent entendre dans le jardin. Charles X salua la foule, qui renouvela ses cris ; puis il rentra dans les salons, et les danses commencèrent.
« Ce fut peu de temps après que le duc d’Orléans étant debout derrière la rongée de fauteuils des souverains et des princesses, je lui adressai les paroles que vous venez de me rappeler ; et alors eut lieu cet entretien très caractéristique dont les termes, gravés dans ma mémoire, sont à peu près textuels :
« – Qu’il y ait volcan, monsieur de Salvandy, c’est possible ; je le crois comme vous, et, au moins, la faute n’en est pas à moi. Je n’aurai pas à me reprocher de n’avoir pas cherché à ouvrir les yeux au roi. Mais que voulez-vous ? On n’écoute rien. Dieu sait où tout ceci peut nous conduire !
« – Fort loin, monseigneur, d’après ma conviction, et j’éprouve au milieu de cette fête splendide un profond sentiment de tristesse. Je me demande où sera dans six mois cette société si brillante, où seront ces princes si heureux, si gais.
« Madame passait devant nous en ce moment, galopant avec le comte Rodolphe Appony.
« – Je ne sais pas ce qui arrivera, reprit le prince, je ne sais pas où ils seront dans six mois ; mais je sais bien où je serai, moi : dans tous les cas, je resterai ici avec ma famille. C’est assez d’avoir été jeté deux fois en exil par les fautes d’autrui ; je ne m’y laisserai pas reprendre. Quelque danger que je puisse courir, je ne bougerai pas d’ici : je ne séparerai pas mon sort et le sort de mes enfants de celui de mon pays ; c’est ma résolution inébranlable. Je ne laisse pas ignorer mes sentiments. Dernièrement, à Rosny, j’ai beaucoup parlé sur tout ceci, et dit ma pensée entière. Le roi de Naples, qui y était avec nous, a très bien jugé notre situation. Ce prince, que vous voyez si cassé et qui pourtant a quatre ans de moins que moi, est un homme de beaucoup de sens. Les circonstances extérieures l’obligent à être roi absolu ; mais ses inclinations ne sont point là, et il a fait des observations fort sages. Du reste, en m’affligeant autant que vous de la route où le roi s’engage, je ne m’effraye pas autant que vous des résultats possibles. Il y a en France un grand amour de l’ordre. Cette France, on ne veut pas la comprendre, mais elle est admirable. L’expérience de la Révolution est présente à tous les esprits ; on en veut les conquêtes, on en déteste les égarements. Une révolution nouvelle ne ressemblerait à rien de ce que nous avons vu, j’en suis convaincu.
« – Cela pourrait être une révolution de 1088, monseigneur. Mais lorsque l’Angleterre se plaça en dehors de la légitimité, l’aristocratie lui restait comme élément d’ordre. Dans ce pays-ci, il n’en serait pas de même ; le peu d’aristocratie qui nous reste est trop faible et ne se rallierait pas au gouvernement. On ferait très probablement table rase, et la démocratie pure est inhabile à rien fonder.
« – Le monde est changé de face depuis quarante ans ; vous ne vous rendez pas assez compte de la diffusion des lumières, conséquence du partage des fortunes. Les classes moyennes ne sont pas toute la société, mais elles en sont la force. Leur intérêt constant est le maintien de l’ordre, et elles ont assez de puissance pour combattre et réprimer les mauvaises passions. Le jacobinisme n’est plus possible quand le grand nombre possède.
« – Ce serait une erreur dangereuse, monseigneur, de comprendre parmi les garanties d’ordre la propriété tout entière. La propriété est si divisée qu’elle a sa multitude qui est profondément envieuse de toutes les supériorités et ennemie de tous les pouvoirs.
« – Songez, monsieur de Salvandy, que tout ce que veut le pays, c’est l’établissement sincère du régime constitutionnel. Il ne demande pas autre chose. Tout le mal est venu de l’impossibilité d’accepter complètement, une bonne fois, tous les résultats de la Révolution, et la Charte en particulier. Ce qui a produit les égarements de la Révolution, c’est la mauvaise éducation de l’ancien régime, non moins que la trop grande inégalité des conditions. Nous n’en sommes plus là. Ma foi politique, c’est qu’avec des sentiments vraiment constitutionnels on mènerait tout à bien. Au reste, ces principes, je les ai toujours eus. Quand je trouvai asile à la cour de Sicile, on voulait, pour me donner ma femme, m’amener à des concessions : je déclarai que mon opinion était invariable ; que j’élèverais mes enfants dans ces idées, et que je le ferais dans leur intérêt tout autant que par amour de la vérité. La principale cause de toutes les difficultés de la politique, c’est que, dans le milieu où ils se trouvent placés, les princes nourrissent d’autres idées, d’autres opinions que les peuples. Tel est le motif pour lequel j’ai donné l’éducation publique à mes fils. J’ai voulu qu’ils pussent être à la fois citoyens et princes ; qu’ils ne prissent pas l’habitude d’un entourage de flatteurs ; qu’ils n’eussent pas devant les yeux ce voile que donne l’éducation des cours ; enfin, qu’ils ne fussent pas liés par goût d’enfance à un monde faisant bande à part, intéressé à les tromper et se trompant toujours lui-même. Je crois que, quoi qu’il arrive, je m’applaudirai toujours du parti que j’ai pris.
« J’abrège beaucoup cette curieuse conversation, continua M. de Salvandy. Elle porta sur plusieurs sujets de politique pratique, entre autres sur la loi départementale et communale. Le duc d’Orléans prenait ses comparaisons en Angleterre, en Suisse, en Amérique. Ce qu’il y avait de plus singulier, c’est que cet entretien avait lieu à deux pas du roi Charles X, et pour ainsi dire derrière son fauteuil. Vers le milieu de la fête, un tumulte populaire se produisit dans le jardin, où la foule fit un feu de joie des chaises amoncelées. Mais ce n’était que de la gaieté. Les colères du lion devaient éclater plus tard. Vers une heure du matin, Charles X, le roi et la reine de Naples, le Dauphin et la Dauphine quittèrent le bal. Madame la duchesse de Berry demeura encore pour danser le cotillon avec le duc de Chartres, et le jour était venu depuis longtemps lorsqu’elle sortit, accompagnée du prince de Salerne, de ce palais qu’elle ne devait plus revoir.
« Avouez, ajouta le ministre, que cette conversation est curieuse en ce qu’elle fait connaître d’une façon tout intime le caractère du duc d’Orléans.
– À ce point de vue, répliquai-je, elle appartient vraiment à l’histoire et mériterait d’être conservée.
Puis je remerciai vivement le ministre de sa bienveillante communication, et revenu chez moi tout pensif, je transcrivis immédiatement la conversation qui venait de m’être ainsi racontée.
Les réunions bourgeoises de 1831. – Lettre d’un ami à son ami. – Une soirée rue de Provence. – Les conversations de l’époque. – Figures originales. – Jeunes filles et femmes mariées – Célibataires et maris. – Exposition de 1831. – Les tableaux de circonstances. – Les portraits. – Grande mêlée des célébrités du temps. – Réunion de chefs-d’œuvre. – Paul Delaroche. – Léopold Bobert. – Horace Vernet. – Ary Scheffer. – Le Gudin de ce temps-là. – Nestor Roqueplan. – Les sculpteurs. – Foyatier. – Dantan. – Antonin Moyne. – Visites du roi Louis-Philippe à l’Exposition.
L’hiver de 1831 ne fut donc égayé à Paris que par des réunions officielles, des bals de souscriptions donnés par la garde nationale dans la salle de l’Opéra, ou des soirées dansantes organisées bourgeoisement à tous les étages, excepté au premier, et dans tous les quartiers, excepté au faubourg Saint-Germain dont les hôtels demeurèrent fermés.
Ces soirées bourgeoises, qui servirent de transition entre une société qui s’en allait et une autre qui venait, avaient une physionomie des plus curieuses. Voici comment un très jeune danseur de cette génération parisienne les dépeignait à l’un de ses amis de province qui devait bientôt venir le rejoindre à Paris. Ce tableau, naïvement et juvénilement présenté, n’en est pas moins très complet.
« Tu sais, mon cher, que j’ai encore la faiblesse d’aimer la danse (le danseur n’avait pas encore dix-huit ans), et je t’avouerai que cet hiver je suis un peu désappointé. Ah ! ce n’est pas comme l’année dernière, à pareille époque ; il s’en faut de toute l’épaisseur d’une révolution ; et si mes examens de droit n’en souffrent pas, bien au contraire, mes plaisirs paraissent devoir en souffrir beaucoup. Quelle sottise de la part de M. de Polignac de ne pas avoir attendu le retour de l’armée d’Alger pour opérer son petit Dix-huit brumaire ! Ce n’était même pas un Dix-huit brumaire, puisqu’il n’y avait personne à faire sauter par les fenêtres, la Chambre n’étant pas encore réunie. Et qui nous dit, après tout, qu’il ne faudra pas plus tard en venir à un équivalent des fameuses ordonnances ? À l’instar de ce bon M. de Robespierre, et plus sérieusement que ce farouche personnage, M. de Polignac n’est peut-être pas encore jugé.
« Mais, Dieu me pardonne ! je crois que je me lance dans la politique. Je reprends :
« Donc, hier malin, me trouvant encore dans cet état de somnolence rempli de charme, qui n’est plus le sommeil, mais qui n’est pas absolument le réveil non plus, alors que, jetant un coup d’œil sur ma chambre en désordre, j’admirais les débris épars de ma toilette de la veille, rapidement jetés çà et là au retour d’une soirée dont les fatigues dansantes se faisaient encore légèrement sentir ; au moment où je me demandais sérieusement par quelle loi et par quelle force de l’équilibre un de mes bas de soie se soutenait sur un des flambeaux de la cheminée, tandis que mon gilet étalait son salin à fleurs au-dessus de la pendule, Ludovic, que tu connais bien, entra brusquement chez moi et me tint ce familier langage :
« – Bonjour, ami ; tu es étonné de me voir pénétrer chez toi comme un monsieur qui veut exécuter un vol au bonjour, n’est-ce pas ? Ce n’est pas tout à fait pour cela que je suis venu.
« – Je te crois, mon ami ; je te crois.





























