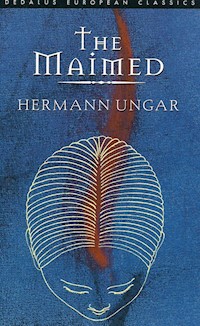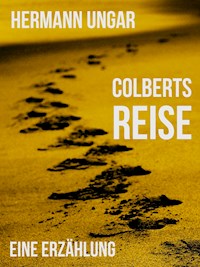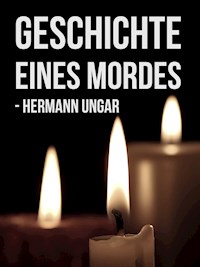Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: A verba futuroruM
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Une longue et terrifiante descente aux enfers pour un homme ordinaire confronté à la destruction de son monde professionnel et social. Cette vie déchirée par un confort moderne sans ambition, se voit soudainement propulsée dans un chaos obsessionnel où toutes les pistes ne peuvent aboutir qu'à la fin d'un monde, celui du héros, Polzer, modeste employé de banque.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Les Sous-Hommes
Hermann UNGAR
l
Depuis sa vingtième année Polzer était fonctionnaire dans une banque. Quotidiennement, à huit heures moins le quart du matin il se dirigeait vers son bureau. Jamais une minute plus tôt ou plus tard. Lorsqu’il sortait de la petite rue dans laquelle il habitait, l’horloge du clocher sonnait trois coups.
Polzer n’avait jamais changé ni d’emploi, ni de logement depuis le jour où il était entré dans sa banque. Il s’installa après avoir terminé ses études lorsqu’il débutait dans sa profession. Sa logeuse était veuve, à peu près du même âge que lui. Quand il emménagea, il n’y avait pas un an qu’elle portait le deuil de son mari.
Pendant les nombreuses années où il fut fonctionnaire, Franz Polzer ne se promena jamais. Il ne savait plus ce qu’étaient les matinées des jours de travail où les magasins sont ouverts et où les gens pressés se bousculent sur les trottoirs. Il n’avait jamais manqué un seul jour à sa banque.
Les rues à travers lesquelles il allait le matin, offraient chaque jour la même image. On levait les rideaux de fer des magasins, devant les portes, les commis attendaient leurs chefs. Chaque jour il rencontrait les mêmes gens, les écoliers et les écolières, les employées fanées, les hommes de mauvaise humeur qui se dépêchaient d’aller à leurs bureaux. Il marchait parmi les êtres qui avaient le même emploi du temps que lui, pressé, inattentif et ignoré de tous. On avait dit à Franz Polzer qu’à force de travail et de persévérance, il pourrait arriver à une situation importante dans sa profession. Pendant tout ce temps il n’avait pas réfléchi qu’en réalité les espérances qu’il formait autrefois ne se réalisaient pas. Il avait oublié cette pensée dans toutes les petites activités qui avaient absorbé son temps. Le matin il se levait, faisait sa toilette, s’habillait, jetait encore un rapide coup d’œil sur le journal pendant qu’il déjeunait, et se rendait à sa banque. Il s’asseyait à sa table sur laquelle étaient amassés des monceaux de papiers où figuraient des chiffres qu’il devait comparer avec ceux qui étaient reportés dans les livres rangés tout autour sur les rayons.
Il inscrivait l’initiale de son nom sur chaque enveloppe contrôlée et la mettait dans un dossier.
Dans la pièce tout autour de lui beaucoup d’autres hommes et femmes étaient assis à des tables identiques. Leur odeur, le bruit de leur conversation et de leur activité monotone remplissait toute la maison. Franz Polzer était tout à fait à la hauteur de son travail qui ne lui donnait pas plus l’occasion de se distinguer que d’attirer sur lui l’attention des supérieurs.
Il déjeunait dans un petit restaurant situé dans le voisinage de sa banque. L’après-midi se passait exactement comme le matin. Lorsque six heures avaient sonné il rassemblait ses papiers et ses crayons sur sa table, fermait son tiroir à clef et rentrait à la maison. La veuve lui servait un léger repas dans sa petite chambre. Il enlevait ses souliers, sa veste et son col. Après le repas pendant une heure il lisait le journal depuis la première ligne jusqu’à la dernière. Ensuite il se couchait. Il dormait mal. Il était cependant rare que son repos fût troublé par des cauchemars. Lorsque c’était le cas, il rêvait qu’il avait oublié cette initiale de son nom qu’il devait écrire plusieurs centaines de fois chaque jour, ou bien que sa main était paralysée ou que son crayon n’écrivait pas.
La matin Polzer se levait comme tous les matins et commençait sa journée qui se continuait comme toutes les autres journées. Il était morose et mécontent, cependant il ne se rendit jamais compte qu’il pouvait y avoir autre chose que d’aller s’asseoir chaque jour dans sa banque, il ne pensait pas qu’on pût se lever plus tard, se promener dans les rues, prendre deux œufs sur le plat dans un café pour son petit déjeuner, et manger à midi dans un bon rest aurant.
Parmi les quelques événements qui interrompirent cette monotonie il y en eut un qui s’imprima d’une manière particulière chez Polzer. Ce fut la mort de son père.
Franz Polzer n’eut jamais avec son père de réelle intimité. Sans doute le fait que sa mère mourut peu de temps après sa naissance y contribua beaucoup. Peut-être aurait-elle pu atténuer ces points par lesquels ils s’opposaient. Son père était un petit commerçant dans une petite ville. La chambre d’enfant de PoIzer fut de bonne heure envahie par le magasin du père. Celui-ci était un homme dur, travailleur et intransigeant. Depuis l’âge le plus tendre, PoIzer dut l’aider de sorte qu’il ne lui restait plus assez de temps pour faire ses devoirs. Malgré cela on exigeait qu’il rapportât de bonnes notes à la maison. Une fois il lui arriva d’être réprimandé, son père le priva alors de diner pendant quatre semaines. Polzer avait à ce moment seize ans.
A la maison vivait une sœur de son père, qui était venue habiter chez lui lorsqu’il était devenu veuf, pour tenir le ménage. PoIzer se représentait de manière assez obscure que sa tante avait poussé dehors sa défunte mère et dès le premier instant il l’aborda avec une franche répulsion. La tante elle non plus ne cachait pas ses sentiments à son égard. Elle le traitait de méchant garnement qui n’arriverait à rien dans la vie, le réprimandait pour sa gourmandise et sa paresse. Elle lui donnait si peu à manger qu’il fut forcé de faire exécuter une deuxième clef de son armoire afin d’aller secrètement pendant la nuit voler dans la maison de son père.
A cela vint s’ajouter une circonstance dont on ne peut parler que sous toutes réserves. Polzer avait alors quatorze ans et avait comme les jeunes garçons cette imagination facilement excitable que la haine rend féconde. Il se représentait les relations entre les hommes et femmes comme une chose horrible et répugnante en soi. L’image de la nudité d’un corps de femme le remplissait de dégoût. Une fois, il était entré dans la chambre de sa tante lorsqu’elle se lavait. L’image de son buste fané, de sa . chair pendante et fatiguée s’imprima en lui et ne s’effaça plus de sa mémoire. Une fois, il était dans l’obscur corridor bordant l’arrière magasin devant l’armoire à peine entr’ouverte, lorsque la porte de la chambre de sa tante s’ouvrit. Il se blottit contre le mur. Dans le cadre lumineux de la porte son père apparut en costume de nuit.Derrière lui se dessina pendant un instant, comme une ombre, l’image de sa tante. De l’intérieur elle verrouilla la porte.
Son père le frôla. Sa chemise était ouverte et Polzer crut malgré l’obscurité pouvoir apercevoir sa poitrine velue. Pendant un instant l’odeur du pain frais qui lui était inhérente, sans doute à cause du travail auquel il se livrait dans le magasin, caressa ses narines. Polzer retint sa respiration et demeura immobile jusqu'à ce que la porte de la chambre du maître se fût fermée derrière lui.
Cet événement suscita chez lui des impressions qui devaient avoir les suites les plus durables au cours de sa vie ultérieure. Bien qu’il n’eût vu que l’ombre de sa tante, il s’imagina fermement qu’elle était nue à ce moment. Dès lors il fut poursuivi par la représentation des scènes dissolues qui devaient se jouer la nuit entre son père et sa tante. Il n’avait pas d’autre indice que ce souvenir nocturne. Et même plus tard il n’y eut rien qui pût le confirmer nettement dans cette opinion.
Il passait ses nuits sans sommeil jusqu’au matin. Il écoutait, il croyait entendre le craquement des portes ou le bruit de pas tâtonnants et prudents, puis la vibration des planches pourries de la vieille maison. Il se réveillait en sursaut et il lui semblait avoir entendu comme un cri étouffé. Il était plein d’une répulsion amère. En outre la curiosité le poussa à se glisser la nuit devant la porte de sa tante. Il ne réussit qu’à entendre le son de sa respiration.
Son père le battait souvent et sa tante le tenait alors fortement. Lorsqu’il avait rêvé de lui la nuit, effrayé de manière illimitée dans son cauchemar par son aspect, par son vêtement, par son visage rouge et hébété, par sa tante qui était derrière lui et le poussait à le tourmenter et à le battre, le lendemain, il voulait, lorsqu’il était forcé de l’accompagner, être de nouveau battu par lui. Il lui semblait qu’il dût rendre véritables les éléments de son rêve, il lui semblait que son père dût marteler son dos de ses poings massifs pour donner corps à la haine qu’il éprouvait. C’est à ce moment qu’il la sentait grandir, mais elle était cependant bien plus faible que celle qu’il éprouvait en rêve.
Une domestique qui s’appelait Milka, servait chez des gens qui habitaient au premier étage de la maison. Elle portait une blouse flottante et venait souvent dans le magasin. Polzer vit une fois comment son père saisit sa poitrine. Ce soir-là il laissa tomber une assiette. Son père le battit et sa tante enfonça ses doigts dans son corps décharné. Il ne pleura pas et pour cette raison il fut frappé plus sauvagement et Franz Polzer voulait qu’il en fût ainsi.
Lorsqu’il le pouvait il fuyait le magasin et flânait dans les rues de la petite ville, seulement pour n’être plus à la maison. Souvent aussi il passait toute la journée chez un homme riche nommé Fanta dont le fils était son camarade de lycée. Une amitié intérieure le liait à Carl Fanta. Il avait tout d’abord fréquenté sa maison avec répulsion. Il savait que les juifs avaient assassiné le sauveur et qu’ils servaient leur Dieu en des pratiques mystérieuses et horribles. Il pensait que pour un catholique romain il y avait non seulement un grave péché à aller et venir dans la maison d’un juif mais encore un grand péril. Milka avait servi chez des juifs. Elle l’avait raconté à sa tante dans le magasin. Avant les fêtes de Pâques elle s’était sauvée car elle avait eu peur. Ce ne fut que peu à peu grâce à son amitié pour Fanta que Polzer vainquit sa propre crainte. Carl Fanta voyait qu’il se sentait malheureux et souvent les deux garçons s’étreignaient et s’embrassaient dans les larmes.
Polzer n’osait pas lui ouvrir son cœur. Il grandissait dans la maison petite et étroite, dans le magasin malpropre où pendant ses heures disponibles, il était forcé de demander à de petites gens ce qu’ils désiraient parmi les sacs de farine ou de poivre, ou les bocaux de concombres et les boîtes de sucre candi, à moins qu’il ne dût balayer le plancher.
Il avait honte de ce magasin. Il avait honte de son père, dont le vêtement était toujours taché de farine, qui s’effaçait avec modestie lorsqu’un riche bourgeois passait près de lui, de sa tante qui sortait sans chapeau et dont les cheveux grisonnant sur les tempes étaient toujours un peu hérissés par le vent. Elle ne portait pas de ruban autour de la tête et on voyait toujours la blanche ligne de séparation entre les cheveux noirs à droite et à gauche. La mère de son ami au contraire était une dame grande et distinguée qui portait des parures et des vêtements sombres. Elle avait comme son fils qui lui ressemblait beaucoup un visage pâle et bien découpé. Elle avait des cheveux noirs comme sa tante, mais ils étaient peignés en chignon. Chez elle, comme chez son fils, on pouvait remarquer de petites veines bleuâtres sur les tempes. Ce qu’elle avait de plus joli c’était comme Carl, la blancheur et la finesse des mains. Le père était un homme corpulent, qui parlait avec calme et mesure, plein de dignité et de confiance en lui. Dans cet entourage Polzer ne pouvait pas parler du petit magasin d’épicerie.
Il brossait son veston et repassait son pantalon en le pliant sous des livres. Il voulait qu’on le prît pour un lycéen de famille bourgeoise et non pas pour le fils d’un boutiquier. Devant les gens il cachait ses mains qui étaient devenues grosses et rouges à force de travailler dans le magasin ; même plus tard, il n’abandonna jamais cette habitude qui donnait une impression de grande incertitude et d’absence d’aisance. Lorsqu’un étranger, en visite chez les parents de Carl demandait à voix basse qui était Franz Polzer, celui-ci se sentait rougir de honte. On pouvait poser cette question aussi doucement que possible, Franz Polzer ne l’entendait pas, il la devinait avec son ouïe intérieure, d’une acuité sans bornes.
Il ne prétendait plus à autre chose qu’à appartenir à une bonne maison. Bien longtemps après lorsqu’on l’interrogeait sur son origine, il rougissait encore et répondait en se dérobant. Souvent il mentait et disait que son père était professeur de lycée ou juge. Un jour il prétendit même qu’il était le fils d’un industriel. L’instant suivant il sentait le regard inquisiteur de son interlocuteur glisser le long de son vêtement et il était convaincu jusqu’à en être honteux de l’indigence de sa mine.
Le père de Carl Fanta lui donna la possibilité de séjourner à l’université de la capitale. Il partit avec Carl. Il s’adonna à l’étude de la médecine, Carl à celle de la jurisprudence. Il était heureux de quitter la maison, de ne plus être forcé de subir toujours la honte du magasin, de ne plus obéir à la sévérité de son père, de ne plus voir la raie de la chevelure de sa tante et de ne plus subir ses réprimandes. Il n’emportait de chez lui qu’un seul souvenir, qui lui était devenu plus cher que tout : celui de sa mère. Il l’avait à peine connue. Il croyait cependant qu’elle l’avait fait appeler auprès du lit de mort où elle gisait les cheveux épars. Elle le pressait contre elle et ses larmes humectaient ses cheveux. Ce souvenir lui réchauffait toujours le cœur. Il fuyait de la haine de sa tante à l’amour de sa mère et ces deux sentiments s’intensifiaient mutuellement.
L’amitié qui unissait Polzer et Carl était aussi intime qu’elle peut être entre deux garçons du même âge. Polzer se réjouissait de pouvoir vivre à côté de ce bel adolescent dont il n’admirait pas moins la certitude et l’absence de crainte que la noble proportion corporelle. Carl était toujours arnical à son égard et chez Polzer c’était une sorte de besoin de deviner les désirs de son ami avant qu’il ne les eût formulés et de l’aider de quelques petits services. Il lui préparait son linge et veillait à ce qu’il n’y eut pas de taches sur ses habits.
Carl avait des cheveux noirs qui ressemblaient à de la soie. Malgré son amicale confiance il semblait souvent à Polzer que son camarade ne se livrait pas pleinement. Il avait le désir d’une petite tendresse, d’un rappel de leurs baisers d’enfants. Cependant ce désir ne fut pas comblé.
A l’université on louait le zèle de Polzer et sa compréhension. Il remettait les premières compositions avec un succès exceptionnel. Ce fut alors que Carl tomba malade et que les médecins l’envoyèrent dans le midi où il devait demeurer un an. Maintenant qu’il n’était plus le compagnon d’un riche ami il était impossible à Polzer de continuer ses études et il dut s’estimer heureux de la place que le père de Carl lui trouva dans une banque.
Là il changea rapidement. Tout contribua à dissoudre son activité. La régularité, l’exactitude, l’inévitable certitude du lendemain le détruisaient. Il se dispersait en petits actes qui rongeaient son temps. Pendant ces dix-sept ans il lui arriva rarement de se trouver avec d’autres gens. Ainsi il était devenu incertain, lorsqu’il lui arrivait par hasard d’être obligé de faire autre chose que ce qu’il avait l’habitude de faire ; s’il était obligé de parler avec des étrangers, il ne trouvait pas les mots qu’il devait dire. Il avait toujours le sentiment que ses vêtements n’étaient pas conformes à son emploi, ne lui allaient pas et le rendaient ridicule. La moindre irrégularité le troublait. Même dans sa chambre il attachait de l’importance à l’ordre le plus strict dont il avait l’habitude. Le journal devait être posé chaque jour au même endroit de la table et parallèlement aux bords. Sa méticulosité allait si loin qu’il était nerveux lorsque les cordons des rideaux n’étaient pas exactement fixés et que leur extrêmité n’était pas roulée dans l’angle de droite de la fenêtre. De mauvaise humeur il les réajustait.
Franz Polzer était environ depuis dix ans à la banque lorsque son père mourut. L’enterrement eut lieu un dimanche de sorte qu’il ne fut pas obligé de renoncer à un jour de travail. Le samedi après-midi il prit le chemin de fer pour quitter la ville.
Le jour de l’enterrement resta pour lui un souvenir désagréable. A l’aller il ne put trouver de place dans le train bondé et il dut rester debout pendant toute la route. Ses pieds qui n’étaient pas habitués à un pareil effort lui faisaient encore mal les jours suivants.
Il arriva de mauvaise humeur et fut mal accueilli par la tante qui pensait qu’il venait lui disputer le magasin du père. Malgré un froid hivernal très vif il trouva une chambre à coucher qui n’était pas chauffée et dormit tourmenté par de mauvais rêves sur son ancien lit. Le matin aucun petit déjeuner n’était préparé pour lui. Il trouva peu convenable d’aller dans une auberge et dut rester à jeun jusqu’à l’enterrement. Des gens vinrent qu’il ne connaissait pour ainsi dire pas, et lui serrèrent la main. Sa tante était au milieu, à côté du cadavre de son père tandis qu’il se tenait comme un étranger dans un coin obscur de la pièce.
Lorsque la cérémonie commença il dut s’avancer à côté de sa tante. Ce fut seulement alors qu’il vit son père. Il avait un vêtement noir qui faisait des plis sur la poitrine. Ses cheveux étaient devenus tout gris. Son visage petit et défait. La vue du cadavre ne fit aucune impression sur lui. Il n’en fut pas plus ému que s’il avait aperçu un objet étranger. Il ne sentait rien qui le liât à son père.
Au cimetière la tante prit son bras et pleura bruyamment. Polzer était debout dans la neige molle et sentait l’humidité pénétrer ses souliers. Il savait qu’il s’enrhumait très facilement et se tenait alternativement, avec inquiétude, sur chacun de ses pieds.
Les regards de tous les gens qui étaient venus à l’enterrement se posaient fixement sur lui. L’attention qu’il suscitait, le rendit incertain. Dans son abandon, il vérifia plusieurs fois les boutonnières de son pantalon pour s’assurer qu’il était bien fermé. Il avait honte de ce geste mais ne pouvait pas empêcher que quelques minutes après, le sentiment de sa nudité le poussât inévitablement à le recommencer.
Après l’enterrement Franz Polzer déclara à sa tante qu’il ne voulait rien hériter du bien de son père. Celui-ci n’avait pas laissé d’argent. La maison était endettée. Polzer ne voulait ni vêtements ni meubles. Il ne voulait pas de souvenirs.
II
Lorsque, peu après le départ de Carl Fanta pour le midi, Polzer vint habiter chez elle, la veuve était pâle et maigre. Ses vêtements de deuil étaient négligés. C’était peu de mois après la mort de son mari. La couleur de sa peau était jaunâtre comme du vieux papier. Ce fut seulement ultérieurement que ses formes s’arrondirent.
Elle s’appelait Clara Porges. Plus tard il sembla à Polzer que son nom eût contribué à tout. Il en avait été irrité dès le premier instant. Sa composition lui paraissait à la fois ridicule et agaçante.
Il vivait seul avec elle. L’une des deux chambres demeurait vide et contenait des chaises protégées par des housses de toile. N’ayant pas de domestique Madame Porges devait pourvoir à tout le travail du ménage. Polzer nettoyait seulement ses souliers. La veuve voulait lui prendre ce travail des mains, mais il ne cédait pas. Il avait toujours attaché de l’importance à faire ses souliers lui-même et n’avait jamais rencontré un être dont les chaussures eussent brillé comme les siennes, au point qu’elles semblaient presque être vernies. Chez lui aussi il lui avait fallu brosser les souliers de sa tante et de son père, mais il ne se donnait pas autant de peine. A présent il consacrait chaque matin une demi heure à leur nettoyage. Il utilisait les uns après les autres, plusieurs chiffons et brosses de différentes qualités. Madame Porges trouvait que ce travail ne convenait pas à un homme. Mais Polzer savait à quel point le matin, il était agréable et encourageant de porter des souliers bien faits ; il savait d’ailleurs que cette activité ne pouvait en aucun cas être considérée en elle-même comme peu virile, car elle était dévolue aux hommes partout où il y avait des serviteurs, par exemple dans les hôtels ou chez les gens riches. Il rappela aussi ceci à madame Porges.
Dès le premier jour, la veuve fut aux petits soins pour lui. Il se laissa décharger par elle de tout ce qui l’inquiétait. Avant tout c’étaient les événements inhabituels que le jour apporte avec lui. Le plus infime qui n’était pas quotidien, le remplissait d’une consternation angoissée. La conscience qu’il lui faudrait en un jour prochain entrer dans un magasin pour faire un achat le rendait inquiet, ses pensées revenaient sans cesse sur ce point, l’angoisse de le manquer le tourmentait, il comptait le temps qui lui serait nécessaire, et préparait les phrases qu’il avait l’intention de dire. Simultanément il lui semblait qu’il n’y eût plus de place pour quoi que ce soit d’autre, que sa vie ne pourrait plus rien atteindre. Des incidents imprévisibles pouvaient survenir. Entre autres choses, le prix demandé pouvait être supérieur à la somme d’argent qu’il portait sur lui. Des notes dont l’échéance tombait à jours fixes comme le loyer l’empêchaient de dormir pendant des semaines. Il comptait pendant la nuit l’argent qui lui serait nécessaire. Soudainement le jour, occupé par d’autres pensées, ou la nuit au cours de son sommeil il constatait avec effroi qu’il l’avait oublié à cet instant, et il se disait qu’il ne devait pas et cependant pouvait l’oublier. Mais Madame Porges était prête à prendre en main son salaire au début du mois et à pourvoir elle-même à toutes choses. Elle lui donna chaque semaine quelques couronnes avec lesquelles il pouvait payer son déjeuner au bureau et le prix du billet de tramway. Elle acheta même pour lui les nouveaux vêtements, sans qu’il eut à entrer
dans un magasin ou même à en être informé.
Tout ceci arriva, malgré la répulsion avec laquelle il accueillait sa logeuse. Le regard dont elle cherchait à l’envelopper avec une sorte de tendresse maternelle, l’angoissait par ce qu’il avait de déplaisant, d’entrant, de proche. Polzer la voyait peu, le matin lorsqu’elle lui apportait son petit déjeuner et le soir son dîner. Il se dérobait à son regard et évitait les conversations. Il habitait porte à porte avec elle, il entendait son souflle la nuit, le craquement de son lit lorsqu’elle remuait en dormant. Malgré cela durant toutes ces années, il n’était pas resté plus de quelques minutes en même temps qu’elle dans une pièce.
La présence de Clara Porges le remplit de gêne dès le premier instant. De sa chevelure émanait une odeur qui le faisait penser de manière lointaine au savon. Elle était coiffée en raie au milieu comme sa tante. A cela vint s’ajouter, que par une association incompréhensible il ne pouvait la voir sans se représenter son corps deshabillé. Cela le remplissait d’une profonde honte à son propre égard et de répulsion. C’était l’évocation d’un corps imprécis et sombre, qui s’imposait à lui avec d’autant plus d’intensité que les formes de Clara Porges devenaient plus pleines.
Depuis sa plus précoce jeunesse de semblables images le remplissaient de dégoût. Il n’aurait jamais eu de rapports avec des femmes si Carl qui ne comprenait pas ceci, ne l’avait pas entraîné et contraint à un commerce avec elles. Polzer vomissait souvent lorsqu’il quittait la maison où Carl l’avait conduit. Déjà comme jeune garçon il les fuyait. Il évitait Milka parce qu’il lui semblait que la forme de ses seins arrondis se modifiât sans cesse sous le flottement de la blouse lâche qui attirait les yeux. Il ne s’aventurait pas à les regarder. Lorsqu’il apprit par Carl que les garçons la guettaient dans les bois, il évita de toucher ses mains quand, seul avec elle dans le magasin, il était obligé d’encaisser l’ argent qu’elle lui remettait. Car les mains de Milka le faisaient frissonner. Elle remarquait bien qu’il la fuyait et souvent elle cherchait à le saisir et à l’attirer contre elle. Une fois elle le rencontra dans l’escalier obscur. Il se pressa dans la niche sombre qui abritait le crucifix. Il ne pouvait plus se dérober, Elle marcha dans sa direction et elle rit, car elle vit qu’il avait peur, ses mains s’accrochèrent à lui. Il ne remua pas. Elle dégraffa ses boutons. Il tremblait. Elle saisit son sexe ; lorsque la semence virile vint, elle rit et lui donna un coup qui le fit chanceler.
Déjà lorsque l’ombre de sa tante se découpait dans l’entrebâillement de la porte, Franz Polzer savait que la nudité de la femme était épouvantable. Il souffrait à la pensée de ce corps nu qui n’était pas fermé, de son affreuse cavité béante comme de la chair ouverte, comme les lèvres d’une blessure déchirée. Dans les musées il ne voulait jamais voir les images et les statues de femmes nues. Il ne voulait jamais toucher leurs corps. Il lui semblait qu’il n’y eût là que malpropreté et odeur répugnante. Il ne voyait Madame Porges que le jour dans ses vêtements, et malgré cela la représentation de son gros corps nu le tourmentait.
Lorsqu’elle entrait, il se courbait sur son journal et évitait de la regarder. Cependant il remarquait à quel point elle engraissait chaque année. Quelque fois il sentait son regard sur lui. Alors il n’osait pas bouger. Il ne comprit jamais comment ils arrivèrent à leur première conversation. Il avait cru qu’elle faisait à peine attention à lui. Cela arriva un soir lorsqu ‘elle lui apportait son repas. Tout commença avec ce soir-là.
Il étâit assis à sa table lorsqu’elle entra. Il parcourait son journal du regard mais il ne lisait pas. Inquiet il attendait que la porte se fermât à nouveau derrière elle. Il entendait déjà son pas s’éloigner. Soudain il sut qu’elle était immobile et le considérait. Il regarda fermement son journal. Il sentit qu’elle réclamait un mot de lui, mais il ne le dit pas. Il voulait attendre sans bouger qu’elle fût partie.
Alors il entendit le hoquet d’un sanglot. Il releva la tête. Elle cacha son visage entre ses mains et commença à pleurer avec violence.
Cela l’inquiétait qu’elle perdît la respiration en pleurant et semblât happer de l’air. Il sentit qu’il devait faire quelque chose et il se leva. Il ne savait pas comment l’aider. Désemparé il la pria de se calmer et de lui expliquer la raison de son chagrin. Mais Madame Porges ne se tranquillisait pas. Elle était tombée à terre et la respiration lui manquait d’une manière de plus en plus angoissante. Alors il marcha vers elle et chercha à lui éloigner les mains de son visage. En même temps il la releva.
Elle cessa de pleurer et commença à parler, interrompue par des sanglots spasmodiques. Elle souffrait, pauvre veuve abandonnée, parce qu’il était si indifférent à son égard : Pour lui seul elle se donnait du mal et se tourmentait. Pendant toutes ces années il ne lui avait pas adressé le plus léger mot de remerciement.
Polzer s’était de nouveau éloigné d’elle et la laissait parler.
- Vous me traitez comme votre domestique, dit-elle.
Elle se tut et parut attendre une réponse.
- Loin de moi cette pensée, madame Porges, dit-il.
- Si, dit-elle, comme on traite une domestique. Jamais vous ne m’avez demandé ce que je fais, quand j’ai fini mon travail, comment je passe mon dimanche. Vous partez et je reste seule à la maison.
- Je ne le faisais pas parce que je n’y pensais pas et que je ne savais pas que vous attachiez du prix à ma compagnie. Mais si cela vous est agréable, dimanche nous ferons une promenade ensemble, madame Porges.
Elle le considéra joyeusement. Il saisit avec effroi la portée de ses propres paroles.
- Nous irons à Kuchelbad, dit-elle, de bon matin.
- L’après-midi, madame Porges, reprit Polzer.
Cela se passait le jeudi. Il passa nerveusement le vendredi et le samedi. Il entendait Madame Porges chanter dans la cuisine en remuant les ustensiles. Il la rencontra dans l’escalier. Elle le
regarda avec une confiance souriante. Il résolut de fuir.