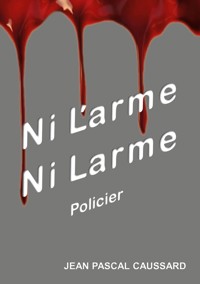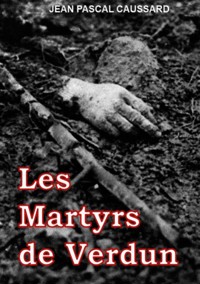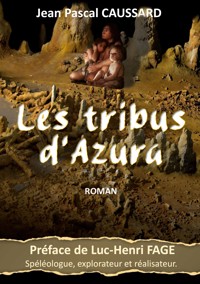
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Année 1990, des fouilles à proximité du village de Brunissac, dans le sud de la France, ont révélé d'étranges traces de présence d'hommes préhistoriques, notamment dans une grotte découverte, par hasard, par Baptiste un jeune spéléologue. Quelles sont ces étranges constructions en stalagmites qui se trouvent au fond de cette grotte ? Quelles en étaient la destination? Qui sont les hommes qui les ont édifiées ? Archéologues, préhistoriens, anthropologues, géologues... se succèdent sur place pour étudier ces vestiges de notre passé. Mais, plus ils progressent dans leurs découvertes et plus il se posent des questions ! Des questions sans réponses... Et, si ces réponses nous étaient apportées par la tribu de "ceux de la rivière" qui a vécu là, il y a plusieurs dizaines de milliers d'années... Ce roman est basé sur des découvertes récentes et des faits réels, que ce soit les résultats des fouilles ou ce qui concerne la vie de nos lointains ancètres.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Du même auteur :
15 minutes de plus – Roman – → pages
Les Martyrs de Verdun (*) - Guerre – Récit – → pages
Un été à la plage – Drame – Nouvelle – → pages
Ni larme, ni l’arme (*) – Policier – Nouvelle – → pages
Hypomnésie – Humour – Nouvelle – → pages
(*) Disponibles à la vente sur Internet
chez l'éditeur : BoD.fr
à la FNAC
sur Amazon
aux formats papier et e-book.
Remerciements
J’adresse mes plus sincères remerciements à tous ceux qui m’ont aidé pour l’écriture de ce livre :
La correctrice : Corinne
Les bêta-lectrices et bêta-lecteurs : Olivia PENDRIEZ, Bernadette COURTIN-HERREYRE, Nadine PREVOST, Éric-Pierre MOLOWA, Roger LARSONNEUR, Emilie M., Hélène L. et Bérangère B.
Ainsi que Thierry BRAYER, coach en écriture, qui m’a accompagné et conseillé tout au long de l’écriture de ce roman.
ARDÉMO formations
https://ardemo.fr
Et enfin, Luc-Henri FAGE pour ses conseils avisés sur le fond et les personnages de cette histoire, et surtout pour la très belle préface qu'il a écrite pour l'auteur inconnu que je suis.
En échange, vous trouverez en postface, une très courte biographie le concernant ; courte, car il faudrait ajouter un chapitre entier pour retracer son parcours professionnel.
Préface de Luc-Henri FAGE Les tribus d'Azura
Je garde un souvenir ému de ma première visite dans la grotte de Bruniquel. Comme chaque année, mon club de spéléologie de Caussade y organise une visite, pour les curieux et les amateurs de préhistoire. Ce club fut aussi celui du jeune garçon qui, vingt ans plus tôt, avait passé tout son temps libre à dégager un étroit passage sur une vingtaine de mètres, jusqu’à forcer une étroiture finale… Au bout de trois ans de travaux, il découvre ce qu’il appellera « la grotte de ma vie ».
Le boyau est toujours là, à peine agrandi. C’est un passage malcommode qui oblige à une humilité totale, un ramping qui meurtrit les coudes et les genoux et dont on sort comme d’une autre naissance. Dans le faisceau de nos lampes, la cavité révèle sa splendeur intacte. Depuis vingt ans, le club veille à sa sécurité, assurant un remarquable travail de protection. S’il n’y avait ces deux minces ficelles plaquées au sol de part et d’autre d’un étroit sentier où se limite la progression autorisée, on pourrait s’imaginer être « en première », être le premier spéléologue à y pénétrer.
La nécessité de la protection saute aux yeux car cette grotte est remarquable à plus d’un titre. Je suis très surpris par les dimensions de sa galerie qui fonce, plein nord, sous le Causse, présentant une section inhabituelle dans les gorges de l’Aveyron, digne d’une galerie de métro. Il y a aussi la profusion des concrétions, stalagmites, stalactites, draperies, excentriques, grandes orgues, coulées… qui surgissent ici et là, jouant une gamme de couleurs qui va du blanc étincelant à la terre de Sienne, en passant par un jaune presque citron, sans oublier les profondeurs émeraudes du lac Zen et des nombreux gours festonnés de calcite, surplombant les eaux d’une délicate dentelle.
Dès la première salle, on comprend que les lieux, scellés depuis des millénaires à la suite de l’effondrement du porche, préservent une autre richesse. Impossible de ne pas voir les dizaines de bauges à ours qui perforent le sol ni les vestiges paléontologiques qui parsèment les lieux : ici un crâne de renne encore armé d’un bois imposant, là une mâchoire de loup ou encore des ossements de bouquetins… Dans notre progression, on nous fait remarquer des griffures d’ours en haut d’une paroi, et dans l’argile quelques empreintes magnifiques de main ou de patte d’ours… Au bout de 300 mètres, la tension est à son comble.
« Nous approchons de la salle de la Structure » clame notre Cicérone, Michel Soulier, le président du Club. Une vaste salle se présente à nos éclairages, 30 mètres de circonférence au moins. Les balises en ficelle font le tour d’une discrète mais étrange construction, un muret de forme oblongue : la structure ! La colonne des visiteurs piétine sur le sentier, mais Michel me glisse : « puisque tu t’intéresses à l’archéologie, je vais te montrer l’intérieur. »
Je savoure ce privilège qui me permet de voir de près des traces de foyers indiscutables, agencés à partir de tronçons de stalagmites, qui portent encore de la suie et des parties rubéfiées, rougies par le feu.
« Le feu, c’est l’Homme ! » clame Michel qui me signale le foyer principal. « On y a prélevé un os d’ours, en partie calciné, qui a été daté en 1995 au laboratoire de Gif-sur-Yvette, comme “plus ancien” que 47 600 ans. La datation au carbone 14 fonctionne jusqu’à quarante, 45 000 ans, car au-delà, tous les radioéléments du carbone ont disparu, on ne peut plus les compter. »
Cela pourrait avoir 60 000 ans que la datation au C14 aurait donné le même résultat : « plus vieux que… 47 600 BP ». Indiscutablement, c’est l’œuvre de Néandertal, mais on n’en sait pas plus… ni l’âge exact, ni la fonction de cette structure.
« Michel, il faut faire un film !
– Les propriétaires n’ont jamais autorisé la moindre caméra, me répond Michel, mais je te promets que si un jour c’est possible, ce sera toi qui le feras. »
Cinq années plus tard, l’étude de la grotte reprend, initiée par Sophie Verheyden, paléoclimatologue, et Jacques Jaubert, préhistorien, une étude qui va révolutionner les données que l’on possède sur l’homme de Néandertal, un homme si ancien ici que les années se comptent en centaines de milliers. J’ai la chance inouïe d’être le premier cinéaste admis à filmer dans la grotte de Bruniquel et suivre l’équipe, renforcée par d’autres spécialistes, durant quatre missions, dans la grotte et leurs laboratoires.
C’est ainsi qu’est né le documentaire « Néandertal, le mystère de la grotte de Bruniquel » coproduit par ARTE. Il va faire un carton à sa première diffusion en mai 2019 et recueillir une vingtaine de prix internationaux. À ce jour, on en est à quatre séries de rediffusion sur ARTE et le total des téléspectateurs dépasse les six millions… Étonnant pour un film qui parle de cailloux…
Ce premier documentaire s’achève en laissant en friche plus de questions qu’il n’y en avait au départ, comme c’est souvent le cas pour la recherche scientifique. Et notamment, les hypothèses sur le rôle de cette structure construite à 300 mètres de l’entrée dans le noir le plus absolu : un rôle utilitaire ou symbolique ? un rituel ou un abri ?
Fait remarquable, dans le fil des commentaires à la diffusion du film sur le YouTube d’ARTE, tout comme dans le courrier que j’ai reçu, je découvre avec plaisir que le public s’est remarquablement approprié cette enquête scientifique – que Télérama qualifie de « Tintin au pays de l’homme des cavernes ». Beaucoup ont leur petite idée, leur hypothèse, plus ou moins fantaisiste, avec un luxe de détails, chacun persuadé de détenir LA solution.
Et puis voici qu’un écrivain, que je ne connais pas, m’envoie le manuscrit d’un roman « Les tribus d’Azura ». A priori, les romans sur la préhistoire ne sont pas ma tasse de thé. Mais Jean Pascal Caussard s’inspire librement de Bruniquel et je dévore le livre, où s’entrecroisent deux histoires, la très ancienne, celle d’Azura la Néandertalienne, et la période actuelle, des archéologues et des spéléologues, troussées de façon très agréable à lire. Je n’en dis pas plus, pour ne pas vous gâcher le dénouement, mais c’est une hypothèse très romanesque, que nul dans l’équipe n’a osé imaginer.
Et c’est la force de la fiction que de laisser l’imagination vagabonder librement dans les espaces les plus éloignés, voire remonter le temps par tranches de dizaines de milliers d’années… Le romancier donne vie, de chair et de sentiments, à des êtres de notre lointaine lignée humaine dont les vestiges restent, après 150 ans de science préhistorique, bien ténus.
Dans ce challenge, l’archéologue aussi peut laisser aller son intuition et n’écarter aucune piste a priori, mais il doit impérativement s’en tenir aux faits, établis, prouvés par la recherche, avant de publier son travail.
Il m’est arrivé souvent, en parcourant les paysages souterrains de cette désormais célèbre grotte des gorges de l’Aveyron, de m’imaginer à la place de l’homme de Bruniquel. Ressentir son pas glissant sur la glaise, trouant les ténèbres d’une flamme capricieuse, inquiet de croiser dans une galerie étroite un de ces terribles ours des cavernes aux griffes et aux canines acérées. Mais pour moi, le film documentaire, qu’on appelle aussi le cinéma du réel, m’oblige à respecter le travail des scientifiques, et je ne conçois pas de me lancer dans des élucubrations comme on en trouve trop souvent dans certains films qui n’hésitent pas, pour attirer le chaland, à présenter pour vraies des hypothèses farfelues. Fréquemment, les pyramides d’Égypte ou le mystère de l’Atlantide en font les frais…
Le romancier ou le poète peuvent, tout en s’abreuvant des connaissances les plus actuelles, s’affranchir de ces réserves, et joyeusement brouiller les cartes pour nous conter une histoire palpitante, qui peut-être contient une once de vérité. Allez savoir…
Paraphrasant un Alexandre Dumas, le romancier pourrait s’écrier : « on peut violer la préhistoire, à condition de lui faire de beaux enfants… »
Bonne plongée dans l’univers d’Azura et des siens…
Luc-Henri Fage
1er décembre 2023
Avant-propos
Cette histoire est librement inspirée du documentaire de Luc-Henri Fage, consacré à la découverte d’une grotte à Bruniquel (Tarn-et-Garonne). Vous trouverez des informations complémentaires dans la postface.
Précision, et elle est importante, ne le visionnez pas avant d’avoir lu ce roman, vous passeriez à côté d’une bonne partie de l’intrigue et de son intérêt !
"Le reportage nous ramène à la fin des années 80 à un jet de pierre du village médiéval de Bruniquel. Bruno Kowalczewski est alors un adolescent de quinze ans, passionné de spéléologie ; au gré de ses pérégrinations, il repère un trou de renard qui l’intrigue…"
C’est donc par le plus pur des hasards que commence cette histoire, il y a près de quarante ans. Personne ne le sait encore, mais c’est le début d’un fantastique voyage dans le passé, un bon en arrière de plusieurs dizaines de milliers d’années. Chaque élément mis au jour, dans cette grotte ou aux alentours, s’accompagne de son lot de questions, de suppositions, de réflexions et d’hypothèses. Mais, pour les scientifiques qui se succèdent sur les sites de fouilles, il est parfois impossible d’y apporter des réponses ou de confirmer leurs théories.
C’est le lot quotidien des archéologues, des paléontologues et des préhistoriens. La seule solution serait de pouvoir se mettre à la place des hommes et des femmes, nos ancêtres, qui ont vécu là ; il faudrait pouvoir penser, agir et vivre comme eux, avec eux. C’est notamment ce qui a amené certains vers l’archéologie expérimentale, discipline qui consiste à reproduire les gestes de ces hommes en n’utilisant que les moyens dont ils disposaient à cette époque.
À travers l’histoire d’une tribu qui a peut-être vécu et chassé à proximité, qui a pénétré et occupé la grotte, je vous propose d’apporter les éléments manquants du puzzle qui défie nos chercheurs.
Mais, me direz-vous, suis-je pertinent pour cela ? Ai-je le droit, moi le béotien, le profane, de donner des réponses alors que je ne me suis jamais rendu sur le site, que je ne suis ni archéologue ni préhistorien ? Y a-t-il une once de réalité, ou de possible, dans mes hypothèses ?
Oui… et non.
Non, car je ne suis ni un savant ni un sachant dans ces domaines.
Oui, si on prend en compte les recherches que j’ai effectuées sur le sujet et si on considère que la base documentaire actuelle, disponible sur cette période, est autrement plus complète et étendue que celle qui existait trente ans en arrière ; c’est-à-dire à l’époque où les spécialistes, dont on suivra les travaux, cherchaient, collectaient, mesuraient, analysaient, comparaient, testaient… et s’interrogeaient.
Oui, également (et surtout), car tout ceci n’est qu’un roman : je raconte une histoire, par l’Histoire !
Et puis, qui sait ? Peut-être que l’une des réponses que je propose est vraie et se vérifiera dans… dix, vingt ou quarante ans !
Sommaire
Chapitre 1 – La préparation de la chasse
Chapitre 2 – 1990, des silex taillés au bord l’Arriu
Chapitre 3 – La tribu de "ceux de la rivière"
Chapitre 4 – 1990, Iris et la fosse de Freyssac
Chapitre 5 – La chasse aux bisons
Chapitre 6 – 1990, Baptiste et Iris
Chapitre 7 – Azura devient mère
Chapitre 8 – Été 1991, découverte à Brunissac
Chapitre 9 – La ruse de Kahar
Chapitre 10 – Septembre 1991, Maxime
Chapitre 11 – Les ours sont morts !
Chapitre 12 – Automne 1991, la grotte se révèle
Chapitre 13 – Azura quitte la tribu
Chapitre 14 – 1992, le mystère des cercles
Chapitre 15 – La vie en exil
Chapitre 16 – 1992, confirmations et interrogations
Chapitre 17 – Le décès d’Orag
Chapitre 18 – 1993, la datation des cercles
Chapitre 19 – Le décès d’Azura
Chapitre 20 – 1993, l’avenir de la grotte
Chapitre 21 – La sépulture d’Azura
Chapitre 22 – 1er octobre 1993, la folie de Maxime
Épilogue : 4 octobre 1994, Iris et Baptiste
Chapitre 1 – La préparation de la chasse
L’attention d’Orag, le chef de la tribu de "ceux de la rivière", fut attirée par un mouvement, ses yeux perçants repérèrent rapidement Agri qui revenait en courant de son poste d’observation. Il semblait étrangement pressé. Il pouvait s’agir d’un très bon présage, ou, à l’inverse, d’un très mauvais. Soit, il avait aperçu du gibier, soit un problème était apparu avec un autre clan.
Agri se déplaçait aussi vite que ses jambes courtes et musclées le lui autorisaient, zigzaguant entre les herbes hautes et les buissons de la toundra. Il avait adopté un rythme plutôt soutenu, car la nouvelle qu’il rapportait était attendue avec une certaine impatience. Sa respiration profonde et rapide lui permettait de couvrir de longues distances en ne s’accordant que de brèves pauses pendant lesquelles il continuait de progresser en marchant. Il avait soif, sa gorge commençait à le brûler, mais il n’était pas question de baisser la cadence ; l’information était de la plus haute importance pour la tribu.
Lorsqu’il aperçut la rivière sur sa droite, il accéléra même un peu la fréquence et l’amplitude de sa foulée, le campement était tout proche. Le courant était relativement faible en cette période et il savait qu’il avait largement pied, il délaissa donc le passage offert par les rochers qui étaient venus y terminer leur course après avoir dévalé de la colline, et pénétra dans l’onde. Elle était glacée et pourtant la saison froide n’avait pas encore débuté. Sans arrêter sa progression, il en profita pour se rafraichir et se désaltérer.
De retour sur la terre ferme, il reprit son pas de course. Quelques instants plus tard, il entreverrait les premières huttes avec leurs toits en peau de bêtes et quelques membres de sa tribu : Orag le chef, Oustec la chamane et Kahar le meneur de la chasse. Tous attendaient l’arrivée d’Agri et des nouvelles dont il était porteur. Une fois de plus, celui-ci allait mériter son titre de guetteur et de messager.
Agri ne s’arrêta de courir que lorsqu’il parvint aux côtés des trois hommes. Tout en reprenant son souffle, il les salua, les deux mains ouvertes devant lui, et patienta jusqu’à ce qu’Orag s’adressa à lui.
- Qu’as-tu à dire, Agri ? 1
- Bonne nouvelle Orag, bisons2vont vers soleil levant (vers l’est).
- D’où arrivent bisons ?
- Depuis soleil couchant (l’ouest), derrière rivière.
- Bisons sont loin ?
Agri montra deux doigts en faisant un geste circulaire du bras tout en pointant l’index du côté de l’est, vers le ciel puis vers l’ouest. Cela indiquait deux jours.
- Bisons avancent lentement.
- Beaucoup bisons ?
Agri tendit légèrement le bras devant lui, ouvrit la main, la paume orientée vers le sol et décrivit deux petits cercles avec celle-ci. Les trois hommes, auxquels s’étaient joints d’autres membres de la tribu, comprirent le message : deux petits troupeaux étaient en approche. Orag se tourna vers Kahar :
- Kahar mènera chasse.
- Nous chasserons avec autre tribu, répondit Kahar
- Pas chasser quand bisons traverseront rivière ?
- Non, rivière donne eau pour boire, mais avant, rivière a emporté plusieurs hommes, eux sont morts.
Dans le passé, une battue organisée par une tribu voisine n’avait pas connu le résultat attendu. Les bisons avaient été dirigés vers la rivière, les premiers s’y étaient engagés, poursuivis par les rabatteurs, mais le reste du troupeau, excité par les mugissements des bêtes et les cris des chasseurs, avait fait volte-face. Plusieurs hommes et femmes avaient été gravement blessés ou estropiés, et s’étaient noyés.
- Toi n’as pas peur que bisons changent de direction, et partent loin ?
- Non, bisons vont manger herbe au bord du lac. Moi veux que bisons marchent vers piège.
Il décrivit ensuite les rôles de chacun dans la préparation de l’expédition : Agri préviendrait la tribu de "ceux de la forêt" 3et leur demanderait de transmettre la nouvelle à "ceux du lac". Touro, le tailleur de pierres, de son côté, irait voir "ceux du piège". Contrairement aux chasses aux daims ou aux cerfs, les femmes, en dehors de Paya et Opia, ne seraient pas de la partie, car tuer un bison nécessitait beaucoup de puissance4, lors du jet de la lance, pour en percer la peau et toucher un organe vital. Orag posa son poing sur l’épaule de Kahar.
- Toi mèneras chasse !
Même si cela était une évidence pour tous, le geste d’Orag venait conforter Kahar dans sa mission et témoignait de la confiance qui lui était accordée. Ses paroles confirmaient que Kahar avait la responsabilité d’organiser la chasse. Il définirait le jour, le lieu, le nombre d’hommes nécessaires, le rôle de chacun, les armes utilisées et la tactique à adopter. Ses choix pourraient être discutés, mais c’est à lui que reviendrait la décision finale ; même Orag devrait se plier à ses ordres.
Ils avaient deux jours pour tout mettre en place avec les autres tribus alentour :
"Ceux du piège" vivaient non loin d’une fosse naturelle à proximité du lac ; celle-ci avait été agrandie afin que les imposants ruminants ne puissent s’en échapper.
"Ceux du lac" étaient établis vers "ciel sans soleil" (nord), là où poussaient des céréales sauvages5, que l’on écrasait entre deux grosses pierres, puis avec lesquelles on préparait une bouillie épaisse que l’on faisait cuire sur un large galet chaud6.
"Ceux de la forêt" étaient installés dans la partie arborée à l’est du lac ; ils avaient conçu une arme de jet pour la traque au petit gibier. Pour être tout à fait juste, ce n’était pas eux qui étaient à l’origine de cette invention, c’est une tribu itinérante à laquelle ils avaient offert leur hospitalité qui leur avait appris à les fabriquer et à les utiliser.
"Ceux de la montagne" vivaient un peu plus vers "ciel sans soleil" (nord), mais les relations n’étaient pas très cordiales avec ceux-ci ; en effet, ses membres avaient tendance à adopter un comportement belliqueux envers les étrangers et les nomades qui traversaient leur territoire. Ils avaient la fâcheuse habitude de régler les problèmes par la force même lorsque cela n’était pas indispensable.
Si Kahar aimait diriger la chasse, il appréciait moins l’autre aspect de sa fonction. En cas de conflit avec une tribu voisine ou l’intrusion d’un groupe hostile, c’était à lui qu’était dévolue la responsabilité de conduire la bataille. Lorsque cela se produisait, une réunion était organisée avec tous les membres de "ceux de la rivière" et ne se terminait que quand une décision avait été prise. C’était Oustec, le chaman, qui menait les débats, qui posait les questions, calmait les esprits, proposait des solutions alternatives ou des arrangements. La tribu statuait sur la conduite à tenir, Orag tranchait, Kahar exécutait. Dans un premier temps, ce dernier était envoyé en émissaire et généralement les choses en restaient là. Si on se retrouvait face à un différend entre communautés, les chamans se rencontraient pour trouver un accord pacifique ; il en allait de l’intérêt de chacun. S’il s’agissait d’un groupe de nomades, Kahar devait déterminer si leurs intentions étaient de s’emparer de leur territoire, de s’y implanter provisoirement ou simplement de le traverser à la recherche d’un lieu pour installer leur bivouac. Pour eux aussi, régler un problème à l’amiable constituait toujours le choix le plus judicieux.
Agri, Orag, Oustec et Kahar se séparèrent, chacun retournant à ses occupations habituelles. Agri prit le sentier qui menait en haut de la colline qui dominait leur campement. Son rôle de guetteur et de messager n’était pas terminé. Il devait surveiller les alentours et prévenir Orag de tout événement insolite. Cela pouvait être une intrusion sur leur territoire, l’arrivée d’ours ou de loups, de nuages annonciateurs de pluie, de neige ou d’orage, un départ de feu à proximité et, bien sûr, de la progression des bisons qu’il avait repérés quelques heures auparavant. Demain, si leur rythme de marche était toujours le même, le troupeau devrait être visible depuis la colline lorsqu’il parviendrait au coude formé par la rivière en contrebas.
Kahar retourna à sa hutte pour y retrouver Azura, celle avec qui il partageait sa couche et qui allait bientôt lui donner un enfant. Il observa les grosses pierres de calage sur le sol, les branches enchevêtrées qui constituaient la charpente du dôme en demi-cercle sur lequel étaient étalées des peaux de cerf. "Moi devoir construire tente plus grande", pensa-t-il en souriant.
Azura était de "ceux du piège". Il l’avait rencontrée lors d’une chasse au cerf et quelque chose d’inexplicable s’était passé entre eux. Contrairement aux habitudes des tribus, dans lesquelles hommes et femmes appartenaient à tous, ils avaient souhaité former un couple. Kahar ne ferait pas d’enfant à d’autres femmes, Azura ne s’accouplerait pas avec d’autres hommes. Dans le respect des traditions ancestrales, chacun d’eux avait dû en faire la demande aux chefs respectifs des deux clans, puis se présenter ensemble pour rééditer leur requête. L’affaire avait été conclue, après de longues palabres et d’interminables négociations, car laisser partir une femme dans la force de l’âge, et capable de procréer, constituait une grosse perte. En règle générale, on échangeait celles en âge d’enfanter, que ce soit avec des groupes sédentaires ou nomades ; on ne s’en séparait pas sans contrepartie. Azura avait été obligée d’abandonner sa toute jeune fille, née quelques mois plus tôt, tandis que de son côté, Kahar avait dû s’engager à les aider pour la chasse chaque fois que de "ceux du piège" l’exigerait et sans pouvoir demander sa part du butin à l’issue de celle-ci.
Une fois la décision prise par les deux chefs, annonce avait été faite à tous les membres des deux tribus, puis à ceux des autres tribus environnantes. Ainsi, chacun en était informé et connaissait à l’avance les risques qu’il encourrait : si un homme tentait d’avoir une relation physique forcée avec Azura, il serait condamné au bannissement. Pour Kahar et Azura, la punition pour le non-respect de cet accord pouvait être plus sévère : la mort.
Ce jour-là, Azura fit donc son entrée sans sa nouvelle tribu. Il n’y eut pas de cérémonie à cette occasion, mais tous les membres de "ceux de la rivière" se réjouirent de son arrivée. Le compromis qui avait été trouvé leur était plutôt favorable, car en règle générale, on échangeait une femme contre une autre.
1 Les dialogues des hommes préhistoriques sont écrits avec des mots actuels, mais les tournures de phrase, la grammaire et la conjugaison ont été volontairement simplifiées. Nous savons qu’ils pouvaient parler (leur anatomie le leur permettait), mais nous n’avons, évidemment, aucune trace de la façon dont ils s’exprimaient. Le langage utilisé dans ce roman est donc un parti pris de l’auteur…
2 Les bisons d’Europe étaient très courants, ils constituaient une importante source de nourriture, de vêtements et d’outils.
3 On a retrouvé des exemplaires de cette arme de jet, cousine du boomerang. Elle n’était destinée qu’à la chasse aux oiseaux ou aux rongeurs.
4 Nombre de femmes avaient une musculature adaptée à la chasse. Elles pouvaient donc y participer, exception faite des très gros animaux.
5 On ne parle pas encore d’agriculture, car les hommes ne font pas pousser ces céréales, ils se contentent de les récolter.
6 Cette découverte a été faite grâce à l’analyse de particules de nourriture enfermées dans des plaques de tartre provenant de dents fossilisées.
Chapitre 2 – 1990, des silex taillés au bord l’Arriu
Au cours de travaux d’aménagement du lit de l’Arriu, la rivière qui longeait le joli petit village médiéval de Brunissac, les pelles mécaniques avaient mis au jour des traces d’une occupation très ancienne de la région. Par chance, Alain, le jeune conducteur d’engins était féru d’archéologie et intervenait parfois sur des chantiers de fouilles pendant ses congés.
Pendant presque une semaine, il avait déplacé des tonnes de sable, de pierres et de silex, mais ce vendredi en milieu de l’après-midi, il avait profité d’une accalmie entre deux giboulées de ce mois de mars pour faire une pause. Il avait éteint le moteur de son excavatrice, avait attrapé sa bouteille d’eau et s’était assis plus ou moins confortablement sur le bord du godet dans lequel se trouvait le contenu de sa dernière pelletée. Tout en buvant, il joua avec quelques-uns des cailloux sortis de la rivière. Une douleur aiguë en provenance de la paume de sa main lui déclencha un mouvement de recul. Une coupure bénigne de quelques centimètres laissait apparaître quelques perles de sang. Ce qui l’intriguait, c’est qu’à l’endroit où il creusait, il n’était censé se trouver que du sable et des pierres oblongues et lisses, polies par les siècles passés à rouler les unes contre les autres dans l’onde.
Il dégagea quelques galets et tomba sur un morceau de silex d’une dizaine de centimètres de long aux bords aiguisés comme une lame de rasoir. En cherchant plus profond, il en découvrit d’autres, taillés presque à l’identique et il reconnut la méthode qui lui avait été présentée par Thierry Dunand qui enseignait à l’Université de Toulouse.
C’était il y a une quinzaine d’années alors qu’il était en classe de troisième, son professeur d’histoire les avait emmenés rencontrer Thierry Dunand, un archéologue qui avait une certaine notoriété dans la région et surtout sur tout ce qui concernait la période préhistorique. Il était adepte de l’archéologie expérimentale, c’est-à-dire qu’il ne se contentait pas de tenter de décrire les techniques et moyens mis en œuvre par les hommes du passé ; il testait ses théories en les mettant lui-même en pratique et en n’utilisant que les objets existants à l’époque. Ainsi avait-il essayé, pendant plusieurs semaines, de produire des lames et des pointes comme le faisaient nos lointains ancêtres.
Le jour de leur visite, l’universitaire leur avait prodigué un cours improvisé. Cela s’était passé sur une terrasse sur laquelle donnait son bureau. Les lycéens s’étaient assis en arc de cercle autour de lui. Il s’était installé en tailleur, une large protection en cuir brut sur les jambes, un tas de pierres sur sa gauche et un éventail d’outils sur sa droite : un silex bien lisse de la grosseur d’un poing, d’autres, plus petits, un bois et des os de cerf, ainsi que des bâtons de diverses essences de bois, séchés et durcis au feu. La démonstration pouvait débuter.
Le professeur prit tout son temps pour sélectionner un des gros silex, le tournant entre ses doigts, examinant un détail invisible. Alain le regardait faire, cherchant en vain quelles différences il pouvait bien trouver entre chacun d’eux. Enfin, l’archéologue sembla satisfait de son choix et commença son travail de tailleur de pierres. À l’aide d’un galet rond, il frappa à l’une des extrémités du silex, de gros morceaux s’en détachèrent. Il s’arrêta, observa, identifia avec minutie le prochain point d’impact, puis donna de nouveau un petit coup sec qui fit sauter un autre éclat. Après plusieurs minutes de silence, uniquement ponctuées par le bruit minéral et répétitif des chocs, il contempla le résultat et s’exclama :
- Voilà, le nucléus est prêt.
- Qu’est-ce que cela signifie ?
- Le professeur fit signe aux élèves de se rapprocher.
- Eh bien, vous voyez, là, je me trouve maintenant avec deux surfaces convexes et sécantes et je vais…
- Excusez-moi monsieur, mais je ne comprends ce que veut dire "convexe et sécante", l’interrompit Alain
Un grand sourire barra le visage de l’archéologue à la question du lycéen.
- Pardon jeune homme, mais lorsque je m’attelle à ce genre de tâche je suis dans un état second et j’ai la fâcheuse tendance d’oublier que j’ai un public quand je fais mes démonstrations.
- J’ai beau participer de temps en temps à des fouilles en amateur, je ne connais pas tous ces termes.
- Ce qu’on nomme nucléus, c’est le bloc de pierre dont on va tirer les outils. Il faut parvenir à avoir deux surfaces convexes, c’est-à-dire courbées vers l’extérieur et que celles-ci soient sécantes, donc qu’elles se coupent, qu’elles se rejoignent si vous préférez.
Faisant passer le silex d’une main à l’autre, il en présenta les différentes parties aux lycéens. Alain, très intéressé, s’était avancé pour mieux observer.
- Ce côté est bombé, celui-là est presque plat, vous voyez ? Ici se trouve la jonction entre les deux faces.
- Ah oui !
- Approchez-vous encore plus près, regardez, cette face est appelée plan de frappe et celle-là, que j’ai aménagée avec des convexités plus élaborées, va servir pour le débitage.
- Le débitage ?
- C’est une technique dont on a retrouvé des traces en Afrique et qui remonte à plus de cinq cent mille ans. Le débitage est le procédé utilisé pour produire les outils dont j’ai besoin. Est-ce que l’un d’entre vous pourrait me donner une feuille et un stylo ?
Alain arracha une page de son cahier et la tendit à l’archéologue.
- Je vais vous faire un dessin, ce sera peut-être plus simple.
En quelques coups de stylo, il fit une représentation des différentes étapes qu’il venait de décrire, en la commentant au fur et à mesure.
D’un coup d’œil rapide, il vérifia que ses explications avaient bien été comprises par son auditoire. Certains élèves semblaient avoir déjà décroché par manque d’intérêt pour ces travaux pratiques.
- Les éclats que je vais en extraire seront de formes et de longueurs différentes en fonction des creux et des bosses que j’ai façonnés. C’est ce qu’on appelle la méthode Levallois. Je vais maintenant frapper là où les deux surfaces se rejoignent. Je vais tenter de produire une lame : le couteau de l’époque.
Dunand inspecta de nouveau le nucléus puis, d’un coup sec porté avec une pierre ronde, il en détacha un morceau long comme la main et de la largeur de deux doigts. Il le récupéra, donna quelques coups secs sur sa bordure à l’aide du bois de cerf, faisant voler de minuscules éclats. Par petites touches précises et habiles, il rectifia quelques détails. Il l’examina une dernière fois, entoura la partie la plus large avec un vieux chiffon puis le tendit, en direction des élèves, en arborant un air jovial.
- Tenez-le par l’extrémité protégée et vous pouvez en tester le tranchant si vous voulez, mais en faisant très attention.
Alain, qui était de toute évidence le plus intéressé de la bande, s’en empara. Il passa son pouce sur le bord le plus fin puis émit un sifflement entre ses dents.
- La vache ! Ça a l’air aussi aiguisé que mon canif.
Il coupa une feuille de son cahier avec facilité, puis se leva et fit de même sur la fine branche d’un genêt qui végétait dans un pot de grès sur la terrasse et, enfin, fit un essai sur le talon de la semelle de son soulier, l’entaillant sur un demi-centimètre de profondeur sans aucune difficulté.
- Alors, quel est votre verdict jeune homme ?
- Ça tranche aussi bien qu’un couteau moderne en acier, ce truc. Mais comment avez-vous découvert cette technique ? On n’a aucune information qui nous soit parvenue de cette époque lointaine.
- En fait, ce n’est pas moi qui en suis l’auteur, elle a été décrite à la fin du XIXe siècle par Victor Common, un géologue et préhistorien français. Puis, dans les années 60, François Bordes, également spécialiste de cette période, a précisé la méthode utilisée, en mettant l’accent sur l’importance de la préparation du nucléus pour obtenir la forme du futur éclat.
Autour d’Alain et de Dunand, le vide s’était fait. Les autres élèves, accompagnés de leur professeur d’Histoire, étaient retournés dans le bureau de l’archéologue et admiraient les représentations de scènes préhistoriques qui en ornaient les murs, ainsi que des photos de peintures rupestres prises dans des grottes en France, en Espagne et au Maroc. Lorsque les cloches d’une église sonnèrent quatre coups, il fallut mettre un terme à la discussion passionnée entre les deux hommes, il était grand temps de regagner le lycée…
Aujourd’hui encore, Alain se souvenait de chacun des détails de cette rencontre. De toute évidence, les silex qu’il avait trouvés sur son chantier au bord de l’Arriu avaient bien été taillés avec la même méthode que celle utilisée lors de cette démonstration.
Dès le lundi matin, il avait contacté l’université de Toulouse par téléphone et avait demandé à s’entretenir avec le Professeur Dunand, mais celui-ci était en déplacement pour plusieurs semaines sur un site en Pologne. Il en avait parlé à quelques habitants du village rencontrés au bar où il prenait son déjeuner. La nouvelle s’était rapidement répandue parmi les six cents âmes de la commune et le maire avait dû faire interrompre les travaux en attendant qu’un expert vienne sur place pour mesurer l’intérêt de la découverte.
Baptiste Delmas, le fils du garagiste, était présent à ce moment-là dans le bistrot, sirotant un diabolo menthe. Son attention avait été captée par quelques bribes de conversation et il avait entamé une longue discussion avec Alain, le conducteur d’engins. Baptiste était lui aussi très intéressé par cette trouvaille. Il n’était pas archéologue, mais était passionné par tout ce qui avait trait à sa région. C’était un randonneur infatigable et, s’il n’était âgé que de dix-neuf ans, peu de sentiers avaient échappé à ses pas. C’était également un spéléologue amateur reconnu ; à seize ans, il avait été le plus jeune inscrit à la Fédération Départementale du Tarn-et-Garonne et son record tenait toujours.
Ils convinrent de se retrouver sur le chantier le jour même vers quatorze heures. Baptiste devait passer chez lui pour récupérer ses gros gants en cuir, son appareil photo jetable ainsi que le caméscope de son père et une cassette VHS vierge. Il prendrait également son équipement de spéléo, car, s’il devait pénétrer dans l’eau, ce serait indispensable ; en mars, la rivière ne dépassait pas les dix degrés. Il sauta dans sa Peugeot 205 GTi, achetée d’occasion quelques mois plus tôt.
Par chance, à son arrivée, les services de la mairie n’étaient pas encore venus pour délimiter la zone interdite à la population. Baptiste salua Alain, enfila ses gants, s’approcha de la pelle mécanique et demanda à son conducteur s’il pouvait verser et étaler le contenu du godet sur le sol. Ce dernier mit son engin en marche et s’exécuta.
Baptiste se précipita vers le tapis de silex, Alain coupa le moteur, sauta en bas de la pelleteuse et le rejoignit. Tous deux scrutèrent chaque pierre, cherchant celles dont la forme n’était pas naturelle. Alain en brandit une.
- Regarde celle-là, elle ressemble bigrement à celle que le prof de fac avait fabriquée.
- Là ! une autre ! Plus petite, mais plus pointue.
- En voilà encore une qui me paraît aussi avoir été façonnée !
Ils en avaient presque terminé, lorsqu’un morceau de branche à demi couvert de terre attira soudain leur attention. Du bois dur au milieu des cailloux dans une rivière, c’était inattendu, pour ne pas dire incongru. Baptiste le tendit à Alain.
- Qu’est-ce que tu en penses ?
- Ce n’est pas du bois d’arbre.
- Comment ça, pas du bois d’arbre ?
- Non, c’est une ramure de cerf ou d’un animal du même genre.
Alain le déposa à côté des pierres taillées. Baptiste sortit son appareil photo de sa poche et fit quelques clichés de leurs découvertes.
- Il a été transporté ici par le courant, tu crois ?
- Non, ma dernière pelletée je l’ai prélevée dans la rive, pas au fond de la rivière.
- Et ça change quoi ?
- Ce n’est pas un bois apporté par le courant, il se trouvait dans la terre ; d’ailleurs, il en est encore recouvert.
- Alors c’est récent.
Alain réfléchit un instant.
- Non, je ne pense pas, car le coup de godet a été donné à deux mètres sous le niveau du sol actuel.
- Tu en conclus quoi ?
- Que ce truc est très ancien, préhistorique évidemment, mais je suis bien incapable d’en estimer l’âge ; plusieurs dizaines de milliers d’années en tout cas.
Ils reprirent leur recherche et trouvèrent un autre bois, ou plutôt ce qui ressemblait à une corne. Puis deux os de la longueur d’un avant-bras. Alain entreprit de les débarrasser de leur gangue de terre et de les examiner plus attentivement.
- Regarde, on aperçoit des traces de coupures juste avant la tête de l’os, à proximité de là où se situait l’articulation.
- Un animal blessé ?
- Plutôt un animal dépecé. Je crois que des hommes préhistoriques ont vécu ici. J’espère que les archéologues vont vite venir voir ça, j’ai hâte de savoir ce qu’ils en penseront.
Baptiste sortit le caméscope de sa sacoche et y introduisit la cassette VHS vierge. Il s’apprêtait à filmer la scène lorsqu’un bruit de moteur se fit entendre en provenance du chemin qui menait au site. Il se releva et aperçut le véhicule tout-terrain siglé "Mairie de Brunissac".
- Planque tout ça ! Ils arrivent pour interdire le coin.
Alain retira son blouson, y camoufla leur butin, puis le roula négligemment sous son bras. Heureusement, sa pelleteuse le cachait à la vue des employés municipaux qui se garaient déjà à proximité. Pour les retarder un peu, Baptiste se dirigea vers eux.
- Salut, Pierre, salut, Jean-Paul, comment allez-vous ?
- Ça va, merci. Mais on doit vous demander de quitter les lieux, directives du maire en personne. On doit délimiter la zone pour empêcher que les gens y viennent.
- Ah oui ! C’est en rapport avec la découverte des silex taillés, non ?
- On en sait fichtre rien, on fait juste ce qu’on a ordre de faire.
Le prénommé Jean-Paul sortait déjà le matériel du coffre du véhicule : des pieux en métal, une masse, du ruban en plastique rouge et blanc et des panneaux sur lesquels on pouvait lire "CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC".
- Vous allez devoir retirer votre engin de là, on doit borner le secteur dans un rayon de cinq mètres.
Alain grimpa dans sa tractopelle et s’exécuta. Pendant ce temps, Baptiste proposa aux deux hommes de leur montrer ce qu’ils avaient trouvé. Du doigt, il désigna une minuscule pierre taillée et un petit morceau de bois de cerf au milieu du tas de silex étalé devant eux.
- Vous voyez là ? Ce sont des traces d’activité humaine.
- Pour moi, ce ne sont que des cailloux et des trucs sans intérêt.
- Tout ce ramdam pour ça, on aurait pu rester tranquilles à l’atelier…
Ce n’est que deux semaines plus tard qu’une jeune femme, d’à peine plus de vingt ans, se présenta sur place. Elle se prénommait Iris, Iris Bodin, et terminait son cursus universitaire en archéologie. Elle faisait partie d’une équipe qui intervenait sur un autre site à quelques kilomètres de Brunissac. Compte tenu des maigres découvertes faites sur la rive de l’Arriu, son chef de fouilles n’avait pas jugé utile d’envoyer quelqu’un ayant plus d’expérience qu’elle.
Dès son arrivée, elle demanda à voir un certain Alain, un conducteur d’engins qui avait mis au jour ces témoignages du passé. Mais celui-ci, faute de pouvoir poursuivre son travail sur place, avait été dépêché sur un autre chantier. On lui conseilla de contacter Baptiste Delmas, le fils du garagiste, qui pourrait la renseigner. Elle s’était donc rendue à l’adresse indiquée, où elle avait été accueillie par le père du jeune homme.
- Bonjour, mademoiselle ! Que puis-je faire pour vous ?
- Bonjour, monsieur, je suis archéologue et je dois effectuer une visite sur un site au bord de la rivière, là où des traces d’occupation ancienne auraient été découvertes. On m’a conseillé de me présenter ici et de demander à voir Baptiste.
- Mon fils n’est pas là, il est parti pour la journée. Il emmène un groupe de spéléologues amateurs dans un gouffre. Il ne rentrera qu’en toute fin d’après-midi.
- Vous savez s’il serait disponible demain ?
- Je n’ai pas grand-chose à lui donner à faire au garage, je pense que ce sera possible.
La jeune fille réfléchit un instant avant de poursuivre.
- Vous pourriez lui dire que je suis passée et que je souhaiterais qu’il m’accompagne sur les lieux dans matinée. S’il peut être vers neuf heures devant la mairie, ce serait parfait.
- Compris, je lui ferai part de votre demande.
- Dites-lui que j’ai ma voiture pour me rendre sur place. Par contre, s’il ne peut pas venir, il n’aura qu’à me laisser un message au bar. Au pire, je me débrouillerai seule.
- Pas de problème, je lui transmets tout ça dès que je le vois.
Elle le remercia, tourna les talons, se dirigea vers la sortie puis s’arrêta soudain.
- J’allais oublier, s’il téléphone, qu’il demande Iris.
Alors qu’elle quittait les lieux, le garagiste la suivit des yeux. Elle était blonde, mince et élancée. Par certains côtés, elle lui rappelait sa défunte épouse à l’époque lointaine où ils s’étaient rencontrés. Elle était décédée, peu après le sixième anniversaire de Baptiste, emportée en quelques semaines par une leucémie foudroyante.
Lorsque son fils rentra, il lui fit part de la visite et de la requête faite par la jeune femme.
- Une certaine Iris est venue pour te voir pendant ton absence.
- Iris ? Connais pas !
- Eh bien, tu devrais. Non seulement elle est jeune et plutôt jolie, mais en plus elle est archéologue. Et surtout, elle souhaiterait que tu la retrouves demain à neuf heures devant la mairie pour ensuite l’accompagner sur le chantier au bord de l’Arriu.
- Mais tu as du boulot pour moi demain, non ?
- Ça ira.
- Une archéologue tu dis ?
Son père sourit.
- J’ai aussi précisé que c’était une jolie jeune femme ! Mais si ça ne t’intéresse pas, tu peux la contacter en laissant un message au bar de Tino.
Baptiste sourit à son tour.
- Tu cherches à m’aider à développer mes connaissances historiques ou à la draguer ?
- L’un n’empêche pas l’autre…
Il n’était pas tout à fait neuf heures lorsque Baptiste arriva sur le parvis de la mairie. Il avait pris son sac à dos dans lequel il avait enfoui les lames de silex, les morceaux de bois de cerf et les os entaillés, le tout enveloppé dans un vieux drap. De loin, il aperçut une jeune femme ; son père ne s’était pas trompé, elle était belle et gracieuse malgré son bleu de chantier peu seyant et taché de terre !
Lorsqu’il fut à portée de voix, il la héla.
- Bonjour, vous êtes Iris, je présume ?
- C’est bien moi. Et vous, vous êtes Baptiste, le fils du garagiste ?
- Oui. Que puis-je faire pour vous ?
- Me montrer l’endroit où vous avez trouvé des vestiges anciens.
- Pour être précis, c’est le conducteur d’engins qui travaillait au bord de l’Arriu qui les a mis au jour.
- Vous pouvez m’y accompagner ? J’ai hâte de voir ce que vous avez déterré.
Elle le guida jusqu’à sa voiture garée sur le parking sur le côté de l’Hôtel de Ville.
- Si vous voulez vous éviter le trajet, j’ai ici quelques échantillons à vous présenter.
Il posa son sac sur le sol et en sortit son contenu. Il étala le tout sur le capot de la vieille Renault 5 de la jeune femme. Elle examina chaque pièce avec attention, s’arrêtant sur des détails que Baptiste n’avait pas remarqués.
- Jolie découverte !
Elle pointa du doigt un endroit précis sur un os.
- Vous voyez cette entaille ? Elle n’est pas totalement rectiligne, elle n’a pas été faite à l’aide d’une lame droite et effilée, ce n’est donc pas récent. Plusieurs milliers d’années à coup sûr.
Elle tourna l’os entre ses mains.
- La tête de cet os de ce côté a disparu, mais elle n’a pas été séparée à l’aide d’une hache ou d’un outil équivalent, elle a été fracturée, écrasée avec une pierre.
- Pour quelle raison ?
- Pour en extraire la mœlle probablement ; un aliment plein de qualités.
Baptiste ressentit une sorte d’admiration pour ces hommes qu’on qualifiait de frustes et primaires. Ils avaient compris, instinctivement ou par nécessité, l’importance de ne pas gâcher les ressources qu’ils prélevaient dans la nature.
- Rien ne se perdait dans le passé. Par contre, l’autre extrémité est intacte ainsi, il a peut-être été utilisé comme outil.
- Quel genre d’outil ?
- Pour façonner en finesse un silex par exemple. Tenez, regardez la tête de l’os, il y manque de petits éclats. Il a probablement servi de marteau.
- Waouh ! Vous identifiez tout ça au premier coup d’œil !
Totalement absorbée par son étude détaillée de l’os ; elle n’entendit pas la remarque admirative qu’il venait de lui faire.
- On voit aussi ces traces de coupure ici !
- Qu’indiquent-elles ?
- Les muscles et les tendons ont été prélevés avec précision, pas arrachés, ni laissés en place.
- Et alors ?
- Alors ? Cela signifie qu’ils avaient une utilité pour cet homme ou pour son groupe, qu’il s’en servirait plus tard pour en faire autre chose. Je vous l’ai dit, rien ne se perdait, les ressources étaient difficiles à obtenir en ce temps-là.
Elle remit le contenu dans le drap et le tendit à Baptiste.
- Tenez, je vous les laisse, je pense qu’on trouvera d’autres vestiges sur place.
- Dans le cas contraire, je vous les rendrai.
- Surtout, n’en dites rien à personne, je serais hors-la-loi !
- Ah bon ?
- Normalement, je devrais consigner tout ça, en faire des photos puis une description détaillée. Ces objets doivent revenir officiellement à l’État. Mais, archéologiquement parlant, ils n’ont pas vraiment d’intérêt, il ne nous apporte pas d’informations nouvelles. Rien que nous ne sachions déjà, mis à part l’occupation de ce site du temps de la préhistoire.
Ils s’installèrent dans la R5 et prirent la direction du chantier qu’ils atteignirent un quart d’heure plus tard. Elle chaussa des bottes en caoutchouc qui lui montaient jusqu’aux genoux. Elle attrapa un sac à dos posé sur la banquette arrière et tous deux marchèrent vers le périmètre délimité par les bandes de plastique rouge et blanc. Baptiste lui présenta le contenu de la pelletée extrait du bord de la rivière par Alain.
L’archéologue l’examina avec attention, puis tira de son sac un petit cahier, et son appareil photo dans lequel elle installa une pellicule couleur 24x36 neuve. Elle prit plusieurs clichés, notant pour chacun des références, un descriptif et ses premières constatations. Ensuite, elle demanda à Baptiste de lui montrer l’endroit précis où le prélèvement avait été effectué.
Ce dernier la guida jusqu’à la berge, elle descendit au bord de la rivière. Baptiste comprit l’utilité des bottes de la jeune femme. Il aurait dû en apporter lui aussi… Tant pis, il l’attendrait en restant au sec.
Elle sortit un décamètre à enrouleur de son sac et métra la hauteur de terre entre l’eau et le sol. Puis elle alla chercher, dans le coffre de son véhicule, une grosse boite à outils remplie de tout un attirail hétéroclite : des pinceaux, des règles, des mini truelles comme celles dont se servent les peintres, un petit tamis, un fil à plomb, une trousse en toile contenant toute une panoplie d’ustensiles qui ressemblaient à ceux employés par les chirurgiens… Pendant de longues minutes, elle examina, fouilla, gratta, mesura, étiqueta et consigna des informations sur son cahier. Sur une grande bâche de toile de jute, qu’elle avait étalée sur le sol, elle avait déjà aligné une bonne quantité d’objets dont elle annonçait les caractéristiques physiques tout en les écrivant. Un grattoir de trois centimètres sur dix, une pointe de sept centimètres de long pour un diamètre d’un peu moins de deux centimètres, une lame de douze par trois, un biface, un racloir, un outil encoché, des percuteurs en os, un autre en bois de renne (ou de cerf), un lissoir (à vérifier/confirmer)… À côté de chacun, elle déposait une sorte d’équerre graduée puis le photographiait. Elle en était à sa troisième pellicule de trente-six poses lorsqu’elle s’arrêta net.
Un bloc de terre humide s’était détaché du bas de la paroi ravinée par le faible courant et était tombé dans l’eau, la troublant d’une couleur marron clair. Quelque chose avait immédiatement attiré son attention : un morceau de bois apparu, à demi sorti de la gangue de glaise. Avec d’infinies précautions, elle le prit dans ses mains et le porta sur les galets secs de la rive. Baptiste la regardait faire avec étonnement. Elle avait des gestes lents et mesurés, comme si elle déplaçait un bébé ou… une bombe. Elle l’examina longuement. Lorsqu’elle se redressa, son visage avait changé, elle avait une expression étrange où se mêlaient la joie, l’intérêt, l’interrogation et le sérieux.
- Venez par ici !
Baptiste se rapprocha.
- C’est quoi ?
- Un morceau de bois !
- Pardon ? Et alors ?
- C’est fantastique !
- Je ne vois pas en quoi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous nous trouvons à la lisière d’une forêt.
Ce commentaire ne fit pas retomber l’intérêt qu’elle portait à cette découverte.
- Mais il se situait sous plus de deux mètres de terre, au beau milieu des silex taillés et des outils préhistoriques que nous avons mis au jour, il est donc là depuis la même époque.
- Je ne comprends toujours pas.
Elle se tourna vers lui et le regarda, se demandant s’il se moquait d’elle.
- Pardon, j’avais oublié que vous n’avez pas de formation en archéo.
Elle s’accroupit devant sa trouvaille et d’un geste de la main indiqua à Baptiste de faire de même.
- Ce morceau de bois aurait dû pourrir et disparaître au cours des millénaires qui se sont écoulés.
- Comment se fait-il qu’il soit encore dans cet état ?
- Il a été protégé par l’argile qui a fait comme une coque étanche qui l’a isolé de l’air, des champignons et des animaux xylophages.
- Mais ce n’est quand même qu’un fragment de branche.