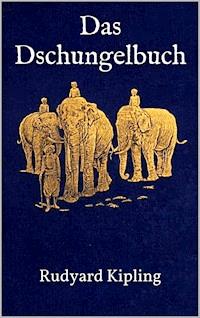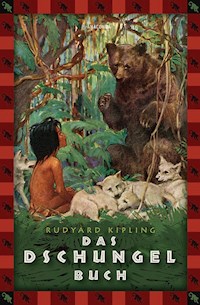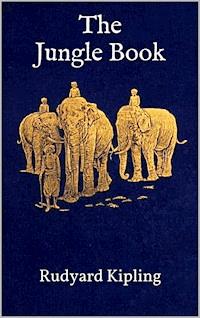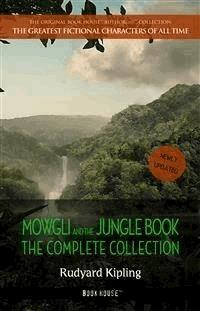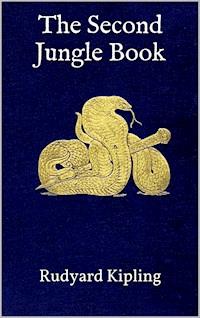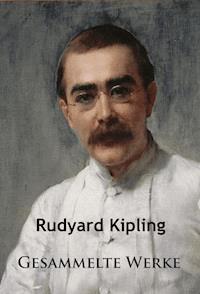Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CLAAE
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Le quotidien d'un voyageur journaliste dans un pays qui s’ouvre au monde : le Japon du XIXe siècle.
Rudyard Kipling fait escale au Japon – à la fin du XIXe siècle - entre un long séjour professionnel en Inde et l’Amérique qu'il ne connait pas encore. Cette étape est une découverte surprenante et ses écrits par ces quelque onze lettres racontent avec malice son quotidien de voyageur journaliste dans un pays qui s’ouvre au monde. Voici des lettres que M. Rudyard Kipling écrivit du Japon pour le grand journal d’Allahabad,
The Pioneer, en 1889.
"Malgré les progrès qu'a pu faire depuis quinze ans un peuple qui marche à pas de géant, j’ai cru qu'il serait d'un haut intérêt pour le public français, à l’heure où le monde a les yeux fixés sur ce peuple, d'apprendre à le connaître par un des plus puissants penseurs de notre époque, et surtout par un homme qui soumet son enthousiasme et son art au souci de l'exactitude et de l'impartialité." L. F.
Découvrez les lettres que M. Rudyard Kipling écrivit du Japon pour le grand journal d’Allahabad, The Pioneer, en 1889.
EXTRAIT
— Allons droit chez nous, en Angleterre, voir les fleurs paraître dans les parcs.
— Jouissons de ce qui est à portée de notre main, espèce de Philistin.
Et c’est ce que nous fîmes jusqu’au moment où un nuage assombrit et le vent fronça les biefs de la rivière, et où nous regagnâmes nos pousse-pousse avec un soupir de résignation.
— Combien de gens supposez-vous que le pays nourrit par kilomètre carré ? demanda le professeur à un tournant de la route, comme nous rentrions.
ll venait de lire des statistiques.
— Cinq cent cinquante, répondis-je au hasard. Il est plus fourni d’habitants que Sarun ou Behar. Disons six cents.
— Quinze cents, en chiffres ronds. Pouvez-vous le croire ?
— En regardant le paysage, oui; mais je ne pense pas que l’Inde le croira. Supposons que j’écrive mille ?
— Ils diront de même que vous exagérez. Il vaut mieux s’en tenir au vrai total. Quinze cents par kilomètre carré, et pas trace de pauvreté dans les maisons. Comment s’y prennent-ils ?
J’aimerais connaître la réponse à cette question. Le Japon, pour ce que j’en sais, est habité presque entièrement par de petits enfants dont le devoir est d’empêcher leurs aînés de devenir trop frivoles. Les bébés, à l’occasion, feront un peu de travail, mais leurs parents interviennent pour les caresser. À l’hôtel Yami, le service est dans les mains de personnages de dix ans, attendu que tout le monde est allé en pique-nique sous les cerisiers. Les petits drôles trouvent le temps de faire le travail d’un homme et de lutter, dans l’intervalle, sur l’escalier. Mon serviteur attitré, appelé l’Évêque en raison de la gravité de son aspect, de son tablier bleu et de ses guêtres, est le plus dégourdi du lot, mais son énergie même ne saurait expliquer les statistiques du professeur au regard de la population…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maquette : Atlant’Communication
Couverture : Erwan lejallé
Image de la couverture : Fleurs de prune
© CLAAE, France, 2018
Tous droits réservés. Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
EAN eBook : 9782379110733
Voici des lettres que M. Rudyard Kipling écrivit du Japon pour le grand journal d’Allahabad, The Pioneer, en 1889. Malgré les progrès qu’a pu faire depuis quinze ans un peuple qui marche à pas de géant, j’ai cru qu’il serait d’un haut intérêt pour le public français, à l’heure où le monde a les yeux fixés sur ce peuple, d’apprendre à le connaître par un des plus puissants penseurs de notre époque, et surtout par un homme qui soumet son enthousiasme et son art au souci de l’exactitude et de l’impartialité.
L. F.
Lettre 1
Dix heures de Japon, y compris une relation complète des mœurs et coutumes de son peuple, une histoire de sa constitution, de ses produits, de son art et de sa civilisation, en omettant une collation dans une maison de thé avec O-Toyo.
Ce matin, après les tristesses d’une nuit de roulis, le sabord de ma cabine me montra deux grands rochers grisâtres, cloutés et rayés de vert, et couronnés de deux pins rabougris noir bleu. Au-dessous des rochers un bateau, qui, pour la couleur et la délicatesse, pouvait avoir été découpé dans du bois de santal, secouait au vent du matin une voile plissée blanc ivoire. Un jeune garçon bleu indigo, à face de vieil ivoire, tirait sur une corde. Rocher, arbre et bateau formaient un panneau de paravent japonais, et je m’aperçus que le pays n’était pas un mensonge. Notre bonne terre brune tient en réserve maints plaisirs pour ses enfants, mais il en est peu, dans son trésor, de comparables à la joie de toucher un nouveau pays, une race complètement étrangère, et des coutumes contraires. On a pu écrire des bibliothèques, cela n’empêchera jamais tout nouveau témoin d’être à lui-même un autre Cortez. Et j’étais au Japon - le Japon des cabinets et de la menuiserie, de la gent gracieuse et des belles manières. Le Japon, d’où viennent le camphre et le laque et les sabres en peau de requin; parmi - qu’est-ce que disaient les livres ? - une nation d’artistes. Assurément, nous ne nous arrêterions à Nagasaki que douze heures avant de continuer sur Kobé, mais en douze heures on peut emballer une fort jolie collection de nouvelles connaissances.
Un homme exécrable vint à moi sur le pont, avec une brochure bleu pâle épaisse de cinquante pages.
— Avez-vous vu, dit-il, la constitution du Japon ? L’empereur vient de la faire lui-même l’autre jour. Elle suit de point en point les tracés européens.
Je pris la brochure et trouvai une complète constitution sur papier, à l’empreinte du chrysanthème impérial - un excellent petit plan de représentation, de réformes, de traitement de députés, d’évaluation de budget, et de législation. C’est une terrible chose à étudier de près, parce que c’est si pitoyablement anglais.
Il y avait sur les collines entourant Nagasaki un vert retouché de jaune, différent, ainsi mon esprit plein de bonne volonté était-il disposé à le croire, du vert des autres pays. C’était le vert d’un paravent japonais, et les pins étaient des pins de paravent. La ville elle-même émergeait à peine du port encombré. Elle reposait parmi les collines, et son côté affaires - un quai tout barbouillé – était boueux et désert. Les affaires, je me réjouis de l’apprendre, étaient bien bas à Nagasaki. Le Japonais ne devrait avoir aucun rapport avec les affaires. Tout près de l’un des tranquilles embarcadères reposait un navire appartenant au Mauvais Peuple; un steamer russe descendu de Vladivostok. Ses ponts étaient surchargés de marchandises de toutes sortes, son gréement était aussi sale et aussi mal peigné que les cheveux d’une bonne à tout faire d’hôtel garni, et ses flancs étaient ignobles.
— Cela, dit quelqu’un de chez moi, c’est un fort beau spécimen de Russe. Il vous faudrait voir leurs vaisseaux de guerre; ils sont tout aussi dégoûtants. Quelques-uns d’entre eux viennent se nettoyer dans Nagasaki.
C’était un petit bout de renseignement, peut-être inexact, mais il mit le comble à ma bonne humeur comme je posais le pied sur le quai pour m’entendre dire, en un parfait anglais, par un jeune gentleman à chrysanthème argenté sur son bonnet de police et en uniforme allemand mal adapté sur ses membres, qu’il ne comprenait pas ma langue. C’était un fonctionnaire des douanes japonais. Notre séjour eût-il été plus long que j’eusse pleuré sur lui parce que c’était un hybride - partie français, partie allemand, partie américain - un tribut à la civilisation. Tous les fonctionnaires japonais, depuis ceux de la police, semblent être habillés de vêtements européens, et jamais ces vêtements ne vont. Je crois que le mikado les a faits au même moment que la constitution. Avec le temps ils finiront par aller.
Quand le pousse-pousse, tiré par un joli garçon à figure de Basque, aux joues de pomme d’api, me jeta en plein décor du Mikado1, premier acte, je n’arrêtai ni ne me mis à jeter des cris de joie, attendu que mon maintien revêtait encore toute la dignité de l’Inde. Je me renversai sur les coussins de velours et grimaçai un voluptueux sourire à Pitti-Sing2, sa large ceinture, ses trois épingles géantes dans ses cheveux noir bleu, et ses socques hauts de trois pouces. Elle se mit à rire. Et son rire, celui d’une lady, fut ma bienvenue au Japon. Les gens y peuvent-ils s’empêcher de rire ? Je ne le crois pas. Vous comprenez, ils ont dans leurs rues tant de milliers d’enfants, qu’il faut aux aînés forcément être jeunes, de peur que les bébés ne se désolent. Nagasaki est habité entièrement par des enfants. Les grandes personnes n’y existent que par tolérance. Un enfant de quatre pieds se promène avec un enfant de trois pieds, lequel tient par la main un enfant de deux pieds, lequel porte sur son dos un enfant d’un pied, lequel – mais vous ne me croirez pas si je vous dis que l’échelle descend à de petites poupées nipponnes de six pouces, comme on en vend dans le Burlington Arcade. Ces poupées frétillent et rient. Elles sont nouées d’une chemise de nuit bleue, nouée elle-même d’une large ceinture, qui, à son tour, noue la chemise de nuit du porteur. De sorte que si vous dénouez cette ceinture, bébé et grand frère guère plus grand que lui se trouvent du coup parfaitement nus. J’ai vu une mère en agir de la sorte, et ce fut tout à fait comme l’opération qui consiste à débarrasser les œufs durs de leur coque.
Si vous cherchez des bizarreries de couleur, des devantures de boutiques flamboyantes et des lanternes éblouissantes, vous ne trouverez rien de tout cela dans les rues étroites et pavées de Nagasaki. Mais si vous désirez des détails de construction de maison, des aperçus de propreté parfaite, un goût rare, la parfaite adaptation de la chose ouvrée aux besoins de l’ouvrier, vous trouverez tout ce que vous cherchez et plus. Tous les toits, couverts de lattes ou de tuiles, sont couleur de plomb et toutes les devantures de maison, de la couleur du bois telle que Dieu l’a faite. Il n’existe ni fumée ni vapeur, et sous la franche lumière d’un ciel nuageux mes yeux pouvaient plonger jusqu’en bas de la très étroite ruelle comme dans l’intérieur d’un cabinet.
Depuis longtemps les livres vous ont raconté comment est construite une maison japonaise, surtout en paravents à coulisses et en cloisons de papier, et tout le monde connaît l’histoire de ce cambrioleur de Tokio, lequel cambriola avec une paire de ciseaux pour levier et pince-monseigneur, et vola les culottes du consul. Mais tout ce que l’on saurait imprimer ne vous fera jamais comprendre le délicieux fini d’une habitation dans laquelle entrerait un coup de pied, et que vous pourriez de vos points réduire à l’état d’allumettes. Voici la boutique d’un bunnia3. Il vend du riz, du poivre rouge, du poisson séché et des cuillers de bois faites de bambou. La devanture de sa boutique est très solide. Elle est toute en voliges d’un demi-pouce clouées côte à côte. Pas une de ces voliges n’est brisée; et chacune d’elles est parfaitement carrée. Honteux de cette barricade morose, il remplit la moitié de la façade de papier huilé tendu sur des encadrements d’un quart de pouce. Pas un seul carré de papier huilé n’a de trou, et pas un seul des cadres, qui, dans des pays plus barbares, porteraient une vitre, s’ils étaient assez solides, n’est hors de symétrie. Et le bunnia, vêtu d’une robe de chambre bleue, d’épais bas blancs aux pieds, se tient assis derrière - pas au milieu de ses marchandises - sur une natte de souple paille de riz, couleur d’or pâle, qu’une lisière noire arrête aux bords. Cette natte est épaisse de deux pouces, large de trois pieds et longue de six. Vous pourriez, en étant suffisamment un porc pour ce faire, manger votre dîner à même n’importe quel morceau de cette natte. Le bunnia repose, un bras bleu ouaté autour d’un gros brasero de cuivre martelé sur lequel est vaguement indiqué en lignes gravées un dragon d’aspect terrible. Le brasero est plein de cendre de charbon, mais il n’y a pas trace de cendre sur la natte. À portée de main du bunnia, se trouve une bourse de cuir vert nouée d’une ganse de soie rouge, et contenant du tabac coupé fin comme fil. Il remplit une longue pipe laquée rouge et noir, l’allume au charbon du brasero, en tire deux bouffées, et la pipe est vide. Encore n’y a-t-il pas la plus petite tache sur la natte. Derrière le bunnia est un store de perles et bambou. Celui-ci voile une chambre planchéiée d’or pâle et plafonnée de panneaux de cèdre au grain naturel. Il n’y a rien dans la chambre qu’une couverture rouge sang déployée de façon aussi lisse qu’une feuille de papier. Au-delà de cette chambre est un passage de bois poli, si poli qu’il renvoie les reflets du mur de papier blanc. Au bout du passage, et clairement visible pour ce bunnia comme on en voit peu, est un pin pygmée, haut de deux pieds, dans un pot enduit de vernis vert, et, à côté, une branche d’azalée, rouge sang comme la couverture, et plantée dans un pot craquelé gris pâle. Le bunnia l’a mise là pour son propre plaisir, pour les délices de son œil, parce qu’il l’aime. L’homme blanc n’a rien au monde à faire avec ses goûts, et si ce bunnia tient sa maison pure et sans tache, c’est parce qu’il aime la propreté et sait qu’elle est artistique. Que dirons-nous à un homme comme ce bunnia ?
Son frère de l’Inde septentrionale peut vivre derrière une devanture de bois à jour noircie par le temps, mais… je ne pense pas qu’il fasse croître autre chose que du tulsi dans un pot, et seulement pour plaire aux Dieux ainsi qu’à sa gent féminine.
Ne comparons point les deux hommes, et continuons à travers Nagasaki.
Sauf les horribles agents de police qui insistent pour être européens, le peuple - le menu peuple, veux-je dire - ne court après les costumes de l’Occident. Les jeunes gens, eux, portent des chapeaux de feutre rond; à l’occasion, des vestons et des pantalons, et à la demi-occasion, des bottines. Tout cela est abominable. Dans les villes plus métropolitaines, le costume occidental, dit-on, est plutôt la règle que l’exception. S’il en est ainsi, je me sens disposé à conclure que les péchés de leurs aïeux, qui consistèrent à réduire les missionnaires jésuites à l’état de biftecks, ont reçu leur punition dans les Japonais sous la forme d’un obscurcissement partiel de leurs instincts artistiques. Encore la punition semble-t-elle trop lourde pour l’offense.
Puis je me mis à admirer sur leurs joues la fraîcheur des gens, le sourire à trois fossettes des gras bébés, et l’extraordinaire quelque chose d’autre de tout ce qui était autour de moi. C’est étrange de se trouver dans un pays propre, et plus étrange de se promener au milieu de maisons de poupées. Le Japon est un pays flatteur pour un petit homme. Personne n’arrive à l’y dominer, et il regarde de haut toutes les femmes, comme il est juste et convenable. Un négociant en curiosités se plia en deux sur son propre tapis de porte, et j’entrai, sentant pour la première fois que j’étais un barbare et non point un vrai sahib. La fange des rues avait laissé des traces épaisses sur mes bottines, et lui, l’immaculé maître de céans, me demanda de traverser un plancher poli et des nattes blanches pour me rendre en une chambre intérieure. Il m’apporta un tapis de pied, lequel ne fit qu’empirer les choses, car une jolie fille étouffa de rire derrière la cloison tandis que je m’escrimais dessus. Les boutiquiers japonais ne devraient pas être si propres. J’arrivai dans un couloir planchéié, large de deux pieds, trouvai un bijou de jardin, planté d’arbres nains, dans un espace grand comme la moitié d’un tennis, me heurtai la tête à un linteau fragile, et parvins à une friandise d’ébénisterie, entourée de quatre murs, où involontairement je baissai la voix. Le marchand fit apporter du thé pâle - du thé comme vous en lisez dans les livres de voyage, - et ce thé mit le comble à mon embarras. Ce que je voulais dire, c’était : Tenez, l’homme, vous êtes beaucoup trop propre et trop raffiné pour cette vie d’ici-bas, et votre maison n’est point faite pour que les humains y habitent, à moins qu’on ne leur ait enseigné un tas de choses que je n’ai jamais apprises. En conséquence, je vous hais, attendu que je me sens votre inférieur, et vous me méprisez, moi et mes bottines, attendu que vous me prenez pour un sauvage. Laissez-moi m’en aller, ou je vais vous faire tomber sur les oreilles votre maison de bois de cèdre. Ce que je dis fut en réalité ceci : Oh, ah yes. Tout ce qu’il y a de plus joli. La plus curieuse façon de traiter les affaires.
Mon hôte se trouva être un horrible extorqueur; et j’eus chaud et me sentis mal à mon aise jusqu’à ce que je fusse dehors et redevenu bon sujet britannique ne craignant pas la crotte. Vous ne vous êtes jamais fourré par mégarde à l’intérieur d’un cabinet de trois cents dollars; aussi ne me comprendrez-vous pas.
Nous arrivâmes au pied d’une colline, comme qui eût dit la colline sur laquelle se tient le Shway Dagon, et jusqu’en haut montait une immense rampe de marches grises, noircies par le temps, laquelle était jalonnée de place en place de torii monolithiques. Tout le monde sait ce que c’est qu’un torii. On en possède dans l’Inde méridionale. Quelque grand roi prend note de l’endroit où il veut construire une arche colossale, mais, en sa qualité de roi, le fait en pierre, non point à l’encre - esquisse dans l’air deux rayons et une barre transversale, de quarante ou soixante pieds de haut sur vingt ou trente de large. Dans l’Inde méridionale, la barre transversale est bossue au milieu. Dans le fond de l’est, elle flamboie aux extrémités. Cette description s’accorde mal avec ce que disent les livres, mais celui qui se met à consulter les livres dans un nouveau pays est perdu. Au-dessus des degrés se penchaient de lourds pins vert bleu ou noir vert, chargés d’ans, noueux et bosselés. Le feuillage du versant était d’un vert plus clair, mais les pins donnaient la tonique de la couleur, à laquelle répondaient les vêtements bleus des quelques gens dispersés sur les marches. Il n’y avait pas de soleil, mais je jure que le soleil eût tout gâté. Nous grimpâmes durant cinq minutes, - moi, le professeur et l’appareil à photographie, - et, nous retournant, nous vîmes les toits de Nagasaki couchés à nos pieds - une mer de plomb et de brun terne, avec par-ci par-là un barbouillage de rose crème indiquant la floraison des cerisiers. Les collines, autour de la ville, étaient mouchetées de lieux de suprême repos, avec bouquets de pins et bambous plumeux.
— Quel pays ! dit le professeur4, en débouclant son appareil. Et avez-vous remarqué que n’importe où nous allions, se trouve toujours quelqu’un sachant porter mon attirail ? Le cocher de garri, à Moulmein, me tendait les diaphragmes; le brave garçon de Penang savait, lui aussi, tout ce qui concernait la chose; et le coolie de pousse-pousse a déjà vu des appareils à photographie. Curieux, n’est-ce pas ?
— Professeur, répondis-je, c’est dû à ce fait extraordinaire que nous ne sommes pas le seul peuple au monde. J’ai commencé à m’en apercevoir à Hong Kong. Cela s’éclaircit maintenant. Je ne serais pas surpris que nous ne finissions, après tout, par nous trouver des êtres humains ordinaires.
Nous entrâmes dans une cour où un cheval de bronze à l’air méchant fixait deux lions de pierre, et où une troupe d’enfants babillaient entre eux. Le cheval de bronze a une légende, laquelle on trouve dans les guides. Mais l’histoire vraie de vrai, c’est qu’il fut tiré, il y a longtemps, d’un ivoire fossile de Sibérie par un Prométhée japonais, qu’il prit vie et eut maints poulains dont les descendants ressemblent rigoureusement à leur père. Les longues années ont presque éliminé l’ivoire du sang, mais cet ivoire affleure encore dans la crinière et la queue de crème; et on peut retrouver même aujourd’hui la grosse panse et les pieds merveilleux du cheval de bronze parmi les poneys de charge de Nagasaki, ces poneys qui promènent des bâts adornés de velours et d’étoffe rouge, qui portent des souliers de gazon aux pieds de derrière, et qu’on rend semblables à des chevaux de pantomime.
Nous ne pûmes aller plus loin que cette cour, à cause d’un écriteau qui disait : Défense d’entrer, et tout ce que nous vîmes ainsi du temple, ce furent de hauts toits de chaume enfumé, d’un brun superbe, qui apparaissaient et réapparaissaient en vagues et en ondulations jusqu’à ce qu’ils se perdissent dans le feuillage. Les Japonais jouent avec le chaume comme on joue avec l’argile à modeler; mais comment leurs légères fondations peuvent-elles porter le poids du toit, c’est un mystère pour l’œil profane.
Nous redescendîmes les marches pour aller goûter.
— Il faut enlever vos bottines, dit Y-Tokai.
Je vous assure qu’il n’y a rien de digne à s’asseoir sur les marches d’une maison de thé pour se battre avec des chaussures boueuses. Et il est impossible de se montrer policé en pieds chaussés de bas quand le plancher, sous vous, est aussi lisse que verre et qu’une jeune fille désire savoir où vous voulez goûter. Prenez au moins une paire de belles chaussettes avec vous quand vous viendrez par ici. Ayez-les de peau de sambhur brodée, de soie si vous voulez, mais ne restez pas là debout, comme je fis, en choses brunes rayées, à bon marché, avec une reprise au talon, essayant de parler à une geisha.
Trois d’entre elles, toutes fraîches et jolies, nous conduisirent dans une chambre meublée d’une peau d’ours brun doré. Le tokonoma5 contenait un tableau pouvant se rouler et représentant des chauves-souris en train de tournoyer au crépuscule, un porte-fleurs en bambou, et des fleurs jaunes. Le plafond était de bois à panneaux, à l’exception d’une bandelette au côté le plus rapproché de la fenêtre, laquelle bandelette était faite de copeaux de bois de cèdre tressés et se trouvait séparée du reste du plafond par un bambou lie-de-vin si poli qu’on eût dit laqué. Un toucher de la main, et tout un côté de la chambre vola en arrière, pour nous laisser pénétrer dans une pièce réellement vaste, pourvue d’un autre tokonoma encadré d’un côté par des montants de huit ou dix pieds d’un bois inconnu portant le même grain qu’un bambou de Penang, et reliés en haut par une branche d’arbre dépouillée de son écorce, mise là simplement, parce qu’elle était curieusement moirée. Dans ce second tokonoma se trouvait un vase gris perle, et c’était tout. Deux côtés de la pièce étaient de papier huilé, et les joints des poutres étaient couverts de crabes en cuivre. Sauf le seuil du tokonoma, qui était de laque noir, il n’était pas dans l’endroit un pouce de bois qui n’eût son grain naturel sans défaut. Au-dehors s’étendait le jardin, bordé d’une haie de pins pygmées et décoré d’un étang minuscule, de pierres polies par l’eau enfoncées dans le sol et d’un cerisier en fleurs.
Elles nous laissèrent seuls en ce paradis de propreté et de beauté, et comme je n’étais plus autre chose qu’un Anglais sans honte et sans chaussures - un homme blanc se trouve toujours dégradé lorsqu’il est nu-pieds - j’errai autour des murs, essayant tous les paravents. Ce fut seulement quand je m’arrêtai pour examiner la fermeture presque invisible de l’un d’eux, que je m’aperçus que c’était une plaque de marqueterie représentant deux grues blanches en train de manger du poisson. Le tout avait environ trois pouces carrés, et, en temps ordinaire, n’eût point attiré l’attention. Les paravents étaient une armoire dans laquelle il semblait que toutes les lampes, tous les chandeliers, les oreillers et les sacs à dormir de la maison fussent tenus en réserve. Une nation orientale qui sait remplir proprement une armoire est une nation à saluer jusqu’à terre. Je montai par un escalier de bois naturel et de laque dans des chambres de l’invention la plus rare, pourvues de fenêtres circulaires qui ne s’ouvraient sur rien, et qu’on avait remplies d’arabesques de bambou pour les délices de l’œil. Les passages parquetés de bois sombre brillaient comme glace, et j’eus honte.
— Professeur, dis-je, ils ne crachent pas; ils ne mangent pas comme des porcs; ils ne peuvent se quereller, et un homme ivre tituberait droit à travers les différentes parties de la maison pour s’en aller rouler en bas de la colline dans Nagasaki. Il ne se peut qu’ils aient des enfants.
Ici, je m’arrêtai. En bas, c’était plein de bébés !
Les servantes entrèrent avec du thé dans de la porcelaine bleue et du gâteau dans un bol de laque rouge - du gâteau comme on en trouve dans une ou deux maisons de Simla. Nous nous prélassâmes sans aucune grâce sur des tapis rouges par-dessus les nattes, et on nous donna des baguettes pour partager le gâteau. Ce fut une longue tâche.
— Est-ce tout ? grogna le professeur. J’ai faim, et du gâteau avec du thé ne sauraient aller jusqu’à quatre heures.
Là-dessus il prit furtivement de ses mains une part de gâteau.
Les servantes revinrent au nombre de cinq, cette fois - avec des plateaux de laque noir d’un pied carré et de quatre pouces de haut. C’étaient nos tables. Les jeunes filles portaient aussi un bol de laque rouge rempli de poisson bouilli dans de la saumure, et des anémones de mer. Une serviette de papier nouée d’un fil d’or renfermait nos baguettes; et dans une petite soucoupe plate gisaient une écrevisse fumée, une tranche de quelque chose comme un compromis, qui ressemblait à du pudding du Yorkshire et avait le goût d’omelette sucrée, et un morceau tordu de je ne sais quoi de translucide qui avait dû jadis être vivant et maintenant se trouvait en conserve. Les servantes s’en allèrent, mais non pas les mains vides, attendu que toi, ô O-Toyo, tu emportais mon cœur.
Le professeur ouvrit un peu les yeux, mais ne dit mot. Les baguettes réclamaient toute son attention, et le retour des geishas absorba le reste. O-Toyo, aux cheveux d’ébène, aux joues de rose, et tout entière faite de délicate porcelaine, se moqua de moi parce que je dévorai toute la sauce à la moutarde qu’on avait servie avec mon poisson cru, et pleura abondamment jusqu’à ce qu’elle m’eût donné du saké provenant d’une altière bouteille de quatre pouces environ de haut. Prenez du vin du Rhin très léger, faites-le chauffer avec des épices, et oubliez la mixture jusqu’à ce qu’elle soit à moitié froide, vous aurez du saké. Le mien me fut donné dans une soucoupe si petite que j’eus l’audace de la faire remplir huit ou dix fois pour n’en aimer pas moins O-Toyo à la fin.
Après le poisson cru et la sauce à la moutarde vint quelque autre sorte de poisson cuit avec des radis confits, et fort peu stable sur les baguettes. Les jeunes filles s’agenouillèrent en demi-cercle et poussèrent des cris de joie devant la gaucherie du professeur, car ce n’est, à vrai dire, pas moi qui renversai presque la table du dîner, dans une vaine tentative pour prendre une attitude gracieuse. Après les rejetons de bambou arriva un bassin de haricots blancs dans une sauce sucrée - vraiment de fort bon goût. Essayez de porter des haricots à votre bouche à l’aide de deux aiguilles à tricoter, et voyez ce qui se passera. Du poulet savamment bouilli avec des navets, et un plein bol de poisson d’un blanc de neige, sans arêtes, avec un monceau de riz, conclurent le repas. J’ai oublié un ou deux services, mais quand O-Toyo me tendit la minuscule pipe japonaise laquée, pleine de tabac semblable à du foin, je comptai neuf plats dans le plateau de laque - chaque plat représentant un service. Alors, O-Toyo et moi, nous nous mîmes à fumer à tour de rôle de pleines pipes.