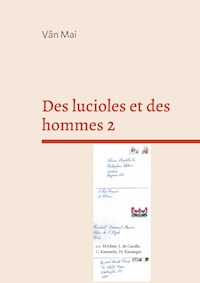Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Ne sommes-nous pas tous lucioles, condamnés d'emblée à clignoter en rase-mottes des braises qu'est la vie ? La guerre du Vietnam tire à sa fin. Au Paradis tropical, une maison close plantée sur pilotis au bord de la rivière Saigon, une poignée de destins se croisent sur les braises de l'empire américain. Un chirurgien émérite de la marine de guerre, un capitaine ninja des forces spéciales, la jeune prostituée vedette, le narcotrafiquant maison qui ne rêve que de fuir le pays en kitesurf, et le clown en résidence, archer d'élite de son état, limier à l'occasion et chef à ses heures, et dont le cirque embarqué compte un macaque danseur de dragon et une panthère acrobate. Un cocktail explosif. Né à Saigon l'année de Dien Bien Phu, Vân Mai y a passé son baccalauréat avec mention en 1972, en pleine guerre du Vietnam. Physicien formé aux USA, il a été enseignant-chercheur à la faculté de sciences de Rennes et à l'université de Californie. Avant de se mettre à écrire, SDF planétaire. Gens du saule, Lucioles et La Cage aux cerfs-volants sont les titres de sa trilogie La Guerre du Vietnam.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 570
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Manger des étoiles et rendre du caca
Cendrars
Parce que je ne vois pas comment c’est possible. De faire ce que nous avons fait. Et de simplement s’en tirer
Capote
je suis Charlie
aux races inférieures
autrefois j’étais p’tit et con
je m’emparais d’un élastique et m’amusais à me flinguer le zizi
avec
bang bang
aujourd’hui j’ai grandi et suis devenu malin
je brandis mon zizi et m’amuse à flinguer des cons avec
bang bang
(Paroles viet sur tube de Cher, c. 1966)
Sommaire
AVERTISSEMENT
PREMIERE PARTIE: L’ARCHER
1. Tirer live
2. À l’ombre du banian 1
3. Des mabuyas et des hommes
4. Scalpel d ’or et mama Ba
5. Lune de miel
6. Babar et P’tit Tronqué
7. Oncle Hai
8. À l’ombre du banian 2
DEUXIÈME PARTIE: LE FACE A FACE
9. Débusquer
10. Des jades et des perles
11. Au clair de la lune sur le fleuve
12. Joute de batelier
13. Anéantir
14. Exécuter
AVERTISSEMENT
Petit-Saigon, Californie, le 17 décembre 2005,
Madame l’Éditrice, Monsieur l’Éditeur,
Il m’est récemment échu le document ci-joint, un récit en vietnamien de plusieurs centaines de pages manuscrites accompagné, en guise d’introduction, d’une courte lettre, dans la même langue, dont je ne connais ni la destinataire ni l’auteur. Il est clair d’après ces pages que ce dernier est en train d’agoniser sur sa barque à l’ombre d’un anonyme banian dans la jungle ; s’il n’est pas déjà épave en mer, brûlé par le soleil et le sel, proie solitaire des mouettes charognards, à la fois bourreaux, croque-morts et fossoyeurs, et dont les longs cris perçants – humains à vous faire dresser les cheveux sur la tête – sont le chant funèbre même de qui elles dépècent. Quant à celle que le damné a essayé de joindre par-delà le temps et l’océan, quoique visiblement sans aucune conviction, ni les P.T.T. ni l’agent immobilier qui gère le HLM dans lequel je loue ce studio qui fut le sien, ne savent qui c’est. Trop de temps s’est écoulé. Vietnamien par hasard, j’ai ouvert le courrier. (Soit toutefois mentionné en passant, depuis maintenant des décennies, cette localité californienne au doux climat méditerranéen, à moins d’une heure de route de Los Angeles, émaillée de palmiers et relativement bon marché, encore que noyée dans le smog le plus clair du temps, continue d’attirer les migrants de mon pays, au point de se retrouver la première communauté vietnamienne en dehors du Vietnam, dûment baptisée Petit-Saigon.) Immigré relativement récent, je bredouille yes no au petit bonheur la chance. (Raison de plus pour m’accrocher à mon triste ghetto, où parler natal suffit.) Toute publication dans ma langue maternelle étant impensable, que ce soit au pays ou à l’étranger, je n’ai pu m’empêcher de traduire le document – lettre et récit – en français, mon unique langue étrangère, acquise dans les écoles françaises d’antan à Saigon. (Soit mentionné, établissements publics de qualité, uniques au monde à mon avis, mis hors la loi depuis. J’appartiens à la dernière génération de Vietnamiens francophones, n’en déplaise à certaine propagande.) Ci-joints donc, le texte original et sa traduction, pour m’en débarrasser, à l’instar du malheureux auteur.
Il va de soi : que j’aie pris le risque de livrer au monde ce récit testamentaire, cet aveu au seuil de la mort, ne signifie nécessairement que j’approuve les gesticulations des zouaves qui le peuplent – et qui à présent me hantent – ; encore moins, que je sympathise avec son ton. Le banian me soit témoin, combien nous nouveaux pauvres, confucéens de surcroît, tenons à laver notre linge sale derrière l’impénétrable haie de bambous qui, rébarbative de par son exubérance, défend chacun de nos hameaux. Vietnamien tout compte fait, je comprends que mes compatriotes, aient-ils le malheur de marcher dans ledit récit, crèveraient d’envie de lancer leurs godillots à la figure de son zigoto d’auteur. Quand bien même m’abstiendrais-je, quant à moi, de me délacer. Je crains que, pour des raisons du même ordre, d’autres aussi évitent de regarder notre damné auteur comme on le ferait un chien écrasé au milieu de la chaussée, en remontant à toute vitesse sa vitre, à défaut de risquer une esquive. Qu’en a le chien écrasé à foutre ? J’ai beau imaginer, espérer le manuscrit une blague, je n’arrive pas à le jeter, si ce n’est par vous interposé(e). Il vous faudra le mettre à la corbeille à ma place. (Corollaire incident : vous pouvez vous rassurer, l’envoi est unique.) Chaque fois et dès que le doute m’assaille sur l’authenticité de ce document que vous tenez entre vos mains, je me retrouve à me triturer la cervelle : draconienne, la censure étatique à l’envoi est censée l’avoir noyé dans l’oeuf. Qui aurait pris le risque de pointer à la poste une telle bombe kamikaze sous le bras ? Même mourant. Et juste ciel pourquoi ? À l’autre bout, incapables ni de le réexpédier ni de le déchiffrer, la plupart des gens l’auraient simplement mis à la poubelle. Quand bien même aurait-il, par extraordinaire, atterri chez un de la diaspora, autre que moi, qu’un meilleur sort ne l’y aurait attendu ; en toute probabilité, plutôt le contraire, on aurait rapporté, dans l’espoir de voir l’énergumène châtié sur son pont de mort, dans sa barque corbillard. Vu l’infime chance de percer à jour, toute tentative de canular me paraît totalement insensée. Tel mauvais plaisant n’aurait-il essayé de lever, vaille que vaille et à tout le moins, un éditeur, le moindre éditeur, plutôt qu’une garçonnière ?
Des semaines durant donc, lexilogos.com au poing derrière persiennes baissées, sept soirs sur sept après l’ingrate journée du smicard à perpétuité – job alimentaire, intérimaire et précaire s’entend, pour quinquagénaire en mal de qualifications et ne parlant pas la langue : le mal que j’ai ne soit-ce qu’avec le vanglais de la jeunesse petit-saigonaise, pige pas un traître mot de ces traîtres-nés je vous dis, cet édifiant avenir de notre diaspora valifornienne, duquel flasque sein je n’apprendrais jamais foutre rien, technicien de surface dans une grande surface dont proprios comme collègues sont tous des compatriotes, à l’instar de la plupart des clients, noyé donc dans cette foule de Jaunes tous plus Reagan que Reagan –, chaque jour après l’insipide dîner de l’apatride donc, l’amer repas du boat-people qui a perdu femme en mer, je me suis attelé à cette sacrée bombe qui de nulle part m’avait fondu dessus sans crier gare. Redoutant une fuite, n’osant montrer l’affreux manuscrit miraculé à personne, pas en mille ans en ce cher Petit-Saigon, vaméricain nid de mouchardages incestueux et autres nombrilistes récriminations, aussi patiné à la surface qu’infect dedans, seul à l’insu de tous j’ai fait avec les moyens du bord, ceux du vice-citoyen lambda, du Vietnamien amorphe, du clone d’invertébré que je suis. J’ai l’impression que la langue même de la présente, bien malgré moi, s’est déteinte du texte source, cette bouteille pactole qui, glissée dans une boîte aux lettres tel un bébé sous-x sous le porche d’un couvent, vous est parvenue de delà deux océans et trente ans, d’un monde à part et cloîtré, de l’au-delà, et que ci je vous confie, vous jette dans les jambes, comme on passe le flambeau, de nouveau sevrée cliquet, cette fois des mains de votre accoucheur de passage, sage-femme par hasard et malgré soi, ténu maillon multiplement accidentel qui, nous l’avons compris, n’ose signer.
Permettez-moi d’insister, de revenir sur un point que je viens de faire et qui me tient à cœur, souffrez que je touille un chouïa dans cette schizophrénie, ce rata de haine et d’admiration que, de tout temps et sous toute latitude, éprouve pour le maître-hôte l’immigré-traître, déjection de tout empire. Combien loin du compte, en effet, l’idée que se fait le seigneur de la fascination pétrie de dédain dont il est l’objet, et qui le fait traiter dans le même souffle par son valet de dieu et de couillon, ce prince dont le caca sent la rose et dont la maman est une chienne.
Chers lectrices, lecteurs extrême-occidentaux,
Je m’estime droit et devoir d’élaborer présentement les deux faces de ce jeton, par quelques anecdotes de mon cru, divers faits dont j’ai été tour à tour témoin de près ou de loin, ou complice, voire coupable, victime ou bourreau selon. J’insiste pour vous les faire partager, pour une simple raison, à savoir qu’elles illustrent ce phénomène universel, cette condition humaine qui sauterait aux yeux d’un martien, et qui néanmoins n’a pas l’air de faire partie de votre conscience collective. Mais n’hésitez surtout pas à me détromper. Je ne vous le dis point pour faire le malin, par pure provoc : au contraire, c’est avec vous en tête, c’est dans l’espoir de me faire rsvp à volonté, de m’en faire cribler, que je vais m’offrir une boîte aux lettres électronique, [email protected]. Je peux me permettre une adresse internautique d’abord parce qu’elle est gratuite, mais surtout, sine qua non, parce qu’elle préserve l’anonymat. C’est le seul moyen dont je dispose pour me faire adresser personnellement tout en restant dans l’ombre, tout en restant soldat de l’ombre. Autant en profiter, vous n’aurez qu’à toquer, sait-on jamais, les uns comme les autres, ce qui va nous revenir dans la tronche. (Ayant invité réplique, il n’est que de juste que je vous prévienne : je me réserve le droit de la rendre publique, anonymement de part et d’autre naturellement.) Au moins avec moi, en tout cas, vous pouvez être sûr de ne pas avoir à soigner votre grammaire, n’avez-vous en effet pas remarqué où que c’est que je me la mets ? J’espère seulement que les gens, jeunes ou vieux, ne vont pas en profiter pour me demander de leur résoudre la colle de niveau BEPC posée à un certain point dans le manuscrit, simplement parce que votre serviteur, me croit qui veut, donne sa langue au chat.
Qu’un cancre se moque de l’orthographe ou de l’arithmétique, ça se comprend. À cancre cancre et demi. Je vous invite à vous rendre au bistro
www.lapetitesourie.com
situé non loin du ghetto, dire bonjour à sa charmante rongeuse d’hôtesse. Malgré l’orthographe plutôt approximative, notre souriante Sourie se débrouille pour nous sortir la meilleure baguette de toutes les Amériques rien que ça.
Ce qui rend l’immigré, à plus forte raison l’immigré collabo, plus royaliste que le roi, n’est manifestement rien d’autre que le summum, la version cocotte-minute, de l’instinct communautaire ordinaire. Lequel ovin instinct pousse homme et bête, l’individu, à chercher refuge dans la foule, à disparaître dedans face aux prédateurs, à lui immoler son côté franc-tireur. Ce désir spontané de surpasser le maître dans ce (que l’on sent) qu’il fait de mieux, peut prendre des tournures ubuesques. Il y a quelques mois, en Floride, un Black, ado, non armé, s’est fait poursuivre et abattre à l’arme à feu par un Blanc, vigile de quartier. Le Blanc vient d’être acquitté. Beaucoup s’indignent, des manifs partout pour dénoncer l’injustice. Qu’entends-je chuchoter autour de moi dans mon cher Petit-Saigon, entre caissières à l’heure du déjeuner au boulot, dans les cafés topless le samedi après-midi, sur les courts de tennis le dimanche entre deux sets, ou sur la plage, entre cerf-volistes un jour venteux ? ‘C’est un nègre, bon débarras.’ Dans le même ordre des choses, il y a quelque temps, un journaliste local, issu de la communauté, a eu la brillante idée d’aller sur presse grand public faire l’apologie de la mère patrie, la République socialiste du Vietnam, rien que ça. Un beau soir, on a frappé (c’est au rez-de-chaussée de chez moi), il a ouvert, s’est fait abattre par balles. L’assassin n’a jamais été retrouvé.
Parlant de chien. Le bruit court dans notre immeuble, que parmi nous, quelque part à l’étage, et ce depuis déjà des années, se cacherait quelqu’un recherché par le FBI. Le fugitif en résidence ne franchirait jamais le seuil de chez lui, on lui monterait ses courses, sortirait sa poubelle, lui ferait la lessive à la laverie automatique du coin, lui livrerait pizzas, jaja, nanas. Coiffeur, médecin et dentiste lui rendraient visite à domicile. Entraîneur personnel trois fois par semaine. Tant qu’à narguer la justice, pourquoi pas faire durer le plaisir, comme pour le cul. Chaque fois que je commence à en entendre parler, je me laisse vite glisser hors de portée. Suis du genre superstitieux, crois dur comme fer que plus on est au courant, même par inadvertance, plus on s’attire des ennuis. Conviction que ne partagent nullement mes compatriotes, soit noté noir sur blanc pour la postérité. La dernière fois que j’ai eu vent dudit fugitif, je me suis retrouvé à croiser une voisine dans l’escalier. Du sac take-out à sa pogne se dégageait un fumet reconnaissable entre tous. Ayant manifestement remarqué comment mes narines se sont dilatées à son approche, la dame s’est levé l’index aux lèvres : ‘Je monte son ragoût de chien à Monsieur.’ Audio en italique sur ‘Monsieur’. Je lui ai répondu de mon sourire le plus niais, me suis effacé la laisser passer, avant de continuer mon chemin, quand bien même salivant après le fumet qui me poursuivait jusque dans la rue.
Parlant de chien. Je prête l’oreille avant de sortir dans le couloir. J’évite mes voisins comme la peste. Pour que je les affronte, il me faut l’excuse d’un banquet de tendre chien-chien, rien de moins. Mon cauchemar s’appelle le Viet du ghetto. La demi-heure du déjeuner au boulot, je me terre dans mon coin, à avaler mon sandwich et croquer ma carotte (dans une vie antérieure j’ai dû avoir les oreilles très longues), le nez dans un sudoku. Il prend un moine zen pour se concentrer au milieu des propos qui fusent. Juste un exemple vite fait : quelqu’un vient de perdre son vélo ?, c’est automatiquement un Mexicain ou un Black qui l’aurait volé, jamais un Jaune ou un Blanc. Le personnel compte d’ailleurs des hispaniques, ce qui à l’évidence n’empêche guère les préjugés de mes compatriotes. Le soir, au lieu de me mettre à l’anglais, j’apprends l’espagnol gratos sur internet, prononciation et tout, juste pour voir si mes collègues hispanos sont aussi mauvais que nous.
Il passe des jours, sinon des semaines, sans que j’ouvre la bouche. Sauf pour pousser un occasionnel juron. Avec les blattes, les exclamations sont compagnons de route du clochard : il a mal au dos, la roue du caddie s’est bloquée, il donne de la tête dans le plafond de la voiture, il sent un cafard lui chatouiller les couilles, j’en passe. À force de slalomer entre gens de son espèce, de les esquiver autant que possible, d’essayer de passer inaperçu de son frère, il vous arrive des choses pas cashers. Que quelqu’un vous adresse la parole du tout vous prend à priori au dépourvu. Surpris, on bredouille. En l’occurrence, pas comme le commun des mortels. Les neurones estrophiés n’arrivent plus à trouver les mots, que les muscles rouillés de la bouche peinent à former, ses lèvres même, il nous en coûte ne soit-ce que de les décoller l’une de l’autre, comme son doigt d’un glaçon à même le congélateur : le picotement est le même. Le cœur, quant à lui, ankylosé, bat au point mort, tapi dans l’ombre comme un rat d’égout.
Autre retombée quand on tient à jouer à l’ermite urbain. Cela fait un bout de temps que j’ai l’impression que mes feux de stop ne marchent plus. Je n’ai pas encore trouvé le moyen de vérifier.
Un mot sur la distribution ethnique de la main-d’œuvre au ghetto. Trop succulent pour passer la main. La mienne à couper si vous me montrez une personne de race noire employée par un Viet. Que ce soit au foyer, en femme de ménage par exemple, ou dans une PME. Le Viet ne descend pas plus bas que l’Hispano, point final. Au début, au bahut, il y a un Black garçon de caddie, un de ces coolies qui passent toute le journée à courir après ces chariots éparpillés d’un bout à l’autre du parking. Ou à courir après un SDF qui se barre avec. Le client-roi n’étant pas foutu de les rendre aux parcages qui leur sont réservés. Une semaine ou deux, j’ai cru que la société d’accueil, mosaïque de races, a ouvert un peu les yeux aux gérants. Jusqu’au jour où le Black m’a abordé en vietnamien pur et dur : il est un de ces enfants abandonnés au Vietnam il y a trente ans par leur père GI. J’ai lu quelque part que le gène noir est récessif. Mon œil.
Ceci dit, soyons clair, et catégorique. Il ne vient même pas à l’esprit de l’Asiatique l’idée de faire du mal à un Black ou à un homosexuel. Cette prérogative, tout comme celle de porter arme à feu en tant que civil, il la laisserait volontiers à d’autres. Des gens qui ne lui ressemblent pas, il se contente de rire sous cape. Par exemple, devant la troisième porte, marquée ‘Autres’, des latrines publiques.
Pas un jour au boulot sans une engueulade devant les caisses. Encore un qui en trente ans n’a pas appris à faire la queue. Les gens du HLM, eux, s’amusent à ouvrir au petit bonheur la chance le courrier les uns des autres. Comme si leur propre boîte n’était pas gratifiée d’assez de merde. Guettent le facteur, comme les enfants des bonbons, les oisillons la becquetée. Se jettent dessus comme hyènes sur charogne, comme ados sur vulve. Scrutent prospectus et dépliants comme un pape la Bible, alors qu’y a pas moyen de les attraper ne soit-ce qu’un tabloïde en pogne attendant le bus ou la lessive. Scotchés toute la journée aux chaînes vietnamophones petit-saigonaises. Ne s’en arrachent qu’à la venue du facteur. Heureusement que moi, je ne reçois que du courrier indésirable. Je crois l’avoir dit, c’est un véritable miracle que le présent manuscrit me soit échu.
Combien nous avons la mémoire courte. Quelques mois à peine en pays de cocagne, j’avais déjà oublié comment le courrier est traité en la mère patrie. Un jour, comme ça, sortant mon matos de voile pour aller naviguer, je n’ai pas pu trouver la laisse de mes cerfs-volants. Je vous épargne les détails techniques, suffit de savoir que cette fameuse laisse, mine de rien, est au cerf-voliste un peu comme le parachute à l’aviateur : autant on souhaite ne pas avoir à s’en servir, autant on ne part pas sans. J’ai cherché partout dans mes spartiates affaires. Après le cagibi, la poubelle, naturellement. J’ai fini par l’en récupérer, ma précieuse laisse, mais pas avant de m’être retrouvé nez à nez avec des plis décachetés qui m’avaient été adressés et que je n’avais jamais vus.
Un HLM, pour ceux qui ne sont pas au courant, a l’avantage décisif de l’anonymat. Avant de choir en la présente demeure, je me suis fait ballotter d’une chambre à louer à une autre, dans un rayon d’action de vélo du boulot. Moult ghettoites bidouillent leurs maisons pour prendre le maximum de locataires. Des smicards comme moi, bien entendu. Posent dans la cour derrière des resserres amovibles en plastique, conçues pour outillage de jardinage, dont le locataire ne ferme la porte, qu’il cadenasse de l’extérieur, que pour s’absenter, car y a pas de fenêtre. Ou pour dormir l’hiver. Du fil électrique partout dans la cour, pour les alimenter, faut se baisser pour naviguer, surfer sous la toile. Deux prises par réduit, une pour la lampe de chevet, seule source de lumière, la seconde pour le mini frigo. Faut débrancher la lampe pour recharger son portable ou allumer l’ordi. Chauffage et ventilo strictement interdits. Un lit de camp, une patère (aucun moyen d’accrocher quoi que ce soit à ces parois de plastoche), une pliante, et il ne reste plus de place pour ne soit-ce qu’une table. L’ordi et les repas, c’est toujours sur les genoux. Toutes ses affaires sous le lit-cage. Cuisine commune sous préau, gazinière quatre becs sans four, évier sans eau chaude, un four à micro-ondes. L’électricité étant beaucoup plus chère que le gaz, les réglages du micro-ondes, puissance et minuteur, sont bloqués pour réchauffer seulement, peut pas cuire avec. Les tartines se font à la poêle.
Faut bien s’y faire, aux tartines poêlées, c’est loin d’être aussi bon. L’autre chose que je regrette vivement au ghetto, c’est l’absence de fours. Les Viet ne l’ont jamais adopté, finalement, le four. Boulangers et autres pâtissiers, formés par les Français, bien sûr, eux n’ont pas le choix. Mais pas le public, pas les consommateurs, même pas les restaurateurs. Quand un resto viet vous propose du ‘poulet rôti’, rassurez-vous, elle est poêlée, sinon frite, votre volaille. Ni four ni rôtissoire. Tous les matins au ghetto je regrette les croissants du Louisiane à Nhatrang où je fus un temps garçon, les meilleurs croissants à l’est de Suez. Que le chef pâtissier, un Français, m’offrait lui-même, en plus du petit déjeuner de ramen et d’œuf sur le compte de la boîte, simplement parce que j’en commandais tous les matins, seul à le faire parmi le personnel indigène. Les boulangers viet du ghetto font les baguettes les plus croustillantes, les croissants les plus moelleux des Amériques, j’en suis persuadé, pourtant je ne mange pas leurs croissants. Le mini four est interdit au cagibi, et aucune boulangerie-pâtisserie du ghetto n’a pris la peine de s’en doter. Le boulanger de cocagne propose invariablement de vous les réchauffer aux micro-ondes, vos croissants. Pas les miens merci. Comme quoi. Dans le même ordre des choses, il y a à peine quelques mois, une boulangerie réputée du coin, dont ci je tais l’illustre nom, tenue par un Français d’origine annamite, débarqué exprès de Paris pour l’ouvrir, a remporté l’appel d’offres de Disneyland, six mille baguettes par jour 7/7. Du jour au lendemain, la meilleure baguette du ghetto est devenue carton mâché, seul le gros cochon compte. Petites couilles, petit niveau.
Ayant la mémoire courte, nous avons le bras long, en guise de compensation. Pour adopter les mauvaises habitudes d’autrui, on est fortiche. Quelques mois à peine dans les rues de cocagne, je commence à faire miennes des expressions comme ‘meilleurs croissants des Amériques’. À force de croiser tous ces panneaux qui affichent, néon clignotant toute la nuit, ‘la plus grande chaîne de pizzas au monde’, ‘les meilleures glaces de la planète’ etc. Ma radio de prédilection ? KJAZ, 88,1 FM, station de l’université de Long Beach, service public, ‘le meilleur jazz du globe’, quand ce n’est pas ‘la meilleure radio de la planète’. Mon autre favorite ? KUSC, 91,5 FM, à une quinzaine d’arrêts en aval, service public de l’université de Californie du Sud. Commentaire entendu à l’occasion d’un passage d’Un Américain à Paris de Gershwin : ‘Paris, où l’on n’aime pas entendre parler anglais.’ Quelqu’un me l’a ainsi traduit en tout cas. Dit s’appeler Jim Scratcher, l’animateur vedette de KUSC. Saute sur chaque occasion pour s’adonner au French-bashing. Je me souviens d’une autre occasion, à propos d’un morceau sur une pièce de Shakespeare, dans laquelle pièce le poète a croqué le portrait de Jeanne d’Arc d’un stylet typiquement godon. Je vous épargne les commentaires du dénommé Scratcher sur le ‘goût littéraire des Français’. Intello à la sauce ricaine, service public universitaire à l’américaine.
Avec tout ça, champion du superlatif, notre présentateur. S’agissant d’un morceau de Brahms ou d’une interprétation de Segovia, ‘parfait’ ne suffit pas, il lui faut du ‘aaabsolument parfait’. Roi de l’adverbe, en saupoudre à foison ses topos comme le culinoplouc épice, comme l’intelloplouc caquette.
Une colle que notre station universitaire semble adorer poser à son auditoire, cette frange (houp !, j’ai failli dire fange, lapsus révélateur !), cette frange donc de bobos aficionados de Mozart et autres Beethoven : quelle est la capitale européenne aux douze millions d’âmes qui a érigé dans ses rues un panneau stop, un seul ? Je parie que les amateurs de musique classique aux USA ne prennent leur fromgi que chez Trader Joe. Cette chaîne d’épiceries aussi cul-terreux que bling-bling.
Le 14 juillet, KUSC passe exprès beaucoup plus de musique française que d’habitude, de Berlioz à Poulenc en passant par Satie ou Saint-Saëns, en l’honneur de ce que la station elle-même nomme le ‘Jour de la Bastille’. Sauf l’émission vespérale, à l’heure de grande écoute, de M. Scratcher, qui leur préfère l’hymne national américain le 14 juillet. Si je ne l’avais connu, M. Scratcher, j’aurais misé sur une coïncidence. Sauf que perso je n’ai jamais entendu La Marseillaise sur RFI. Bref, pas surprenant que M. Scratcher trouve que le ‘meilleur’ orchestre philharmonique de France est celui de Montréal.
Bien que les Français soient la cible préférée dudit présentateur, il ne crache pas sur d’autres pour autant. Dès que quelqu’un s’en prend à l’anglo-saxonne race, élue de Dieu. Un obscur musicologue allemand a eu le malheur de traiter l’Angleterre de ‘terre sans musique’. M. Scratcher, lui, traite notre spécialiste de ‘sourd’. La hargne à l’antenne puritaine. C’est presque comique. D’autant plus agaçant qu’il semble étaler sa voix de tête, adore en hargner. Un présentateur pénalisé d’un fausset, le moins qu’il puisse faire est de s’aplatir.
KUSC vient de mener un sondage, Les cent sommets de la musique classique. Résultat : Chopin, 98ème, Brahms, 71ème, Mozart, 25ème, Copland, 20ème, Williams, 11ème, Bach (J.S.), 7ème, Gershwin, 2ème, Beethoven, 1er. Bartok, Berlioz, Haydn, Liszt, Schumann, tous relégués allez ouste deuxième division.
Tout Amérique qu’elle est, l’Amérique n’a pu s’amener à nier à Beethoven la médaille d’or. La neuvième symphonie. L’or concédé, l’argent, naturellement, revient impérativement à un enfant du pays. Je me demande qui d’autre, que le public américain, placerait Gershwin, Williams ou Copland devant Mozart, Brahms et Chopin. Et pas que d’un chouya, remarquez. Mais je crains de n’avoir dit rien de neuf, quelqu’un l’a déjà dit, il est simplement impossible de sous-estimer le mauvais goût du public de ce pays.
Quant à Bizet, n’en parlons même pas. Carmen la Bohémienne, à la 73ème place, à cause qu’elle est tailleuse de pipes, houp pardon, lapsus révélateur, rouleuse de pelles, houp, rouleuse de cigarettes ?
Quant à votre serviteur vadrouillard, son bonheur ? Une Danse, hongroise, gitane, polonaise ou slovène, à n’importe quel moment de la journée, devant n’importe quelle Guerre, soit-elle des étoiles, n’importe quel Printemps, soit-il des Appalaches, voire n’importe quelle Rhapsodie, de quelque couleur qu’elle soit.
Mais laissons, nous avons mieux à faire. Je vous pose la colle : qui complète le podium, qui remporte le bronze ? Indication : il n’est pas américain, mais c’est comme si, au moins en ce qui concerne Sam. Le plus américain des compositeurs du vieux continent, disons. Il y a, toujours selon notre radio KUSC, un cuirassé américain nommé en l’honneur même de notre compositeur médaillé bronze, USS xxx. Curieux quand même je trouve, je ne connais aucun autre bâtiment de guerre samien, voire samiesque, à porter le nom d’un artiste. Le plus clair du temps, soit un toponyme, soit le nom de quelque héros, homme d’État ou guerrier ou encore fictif, ou alors d’une victoire ou de quelque martiale vertu. Des porte-avions USS Eisenhower ou Charles-de-Gaulle ou USS Midway ou USS Intrepid, le cuirassé de triste renom Bismarck, le navire amiral HMS Victory de Nelson à Trafalgar. Le Yamato japonais, le plus monstrueux des cuirassés de tous les temps, 150% du Bismarck, porte un toponyme. Ainsi que le Liaoning, le premier porte-avions en service de la marine chinoise. Ex-porte-avions soviétique, le Varyag, qui signifie, si j’ai bien compris, Viking de Suède. Le sous-marin nucléaire USS Nautilus est nommé en l’honneur du héros nautique de Jules Verne. Ce n’est pas pour rien que la caraque amiral de Christophe Colomb s’appelle la Santa-Maria, c’est bien la guerre que son capitaine mène et le génocide qu’il amène. Je suis loin d’être un expert dans les arts, encore moins dans les armements, je n’ai jamais entendu parler d’un char Char ou d’un sous-marin Segovia. Encore moins d’une frégate furtive Federico Fellini capable de lancer des missiles balistiques Marlon Brando ou des missiles de croisière Miguel de Cervantes, ou d’un chasseur-bombardier Charles Bronson décollant d’un porte-avions Pouchkine pour larguer des bombes Botticelli et tirer des roquettes Rodin. Personne à ma connaissance ne s’est fait passer des menottes Mozart ou tabasser à la matraque Matisse ou envoyer au tapis par un taser Tagore ou torturer à la garrotte Gaudi ou doucher au napalm Noureev ou abattre à l’armalite Armani ou à la batte de base-ball Brigitte Bardot ou à la carabine la Callas ou à la kalachnikov Kafka ou au lance-flammes La Fontaine ou au lance-grenades Lady Gaga ou au pic à glace Picasso ou au pistolet Piaf ou au poing américain Paul Auster ou à la tronçonneuse Trenet ou au winchester Warhol. Bref, aucun autre machin dispensateur d’horreur qui soit remasterisé. Bref de chez bref, si j’avais été famille, pote voire simplement fan à xxx j’aurais poursuivi les USA en justice, pour défécation sur patronyme, pour diffamation défécatoire. Au risque de me retrouver contre-poursuivi par de légitimes descendants.
Bref, la moitié du podium est donc maison, comptant le bronze moitié américain. Et c’est à cet égard que les choses, de curieuses, deviennent cafardeuses. SDF automobiliste, je ne compte pas les heures que je passe à écouter la radio. Même si je ne comprends que dalle à ce qui s’y dit. Le plus clair du temps, de la musique pure. Celà étant, la seule fois que j’ai entendu le mot Brit prononcé sur les ondes, c’est justement sur KUSC, et justement à propos de sondages d’opinion. Heureusement que mon féal interprète, le cariste du supermarché, se trouve à mon côté. Selon lui, Brit est péjoratif de Britannique. Bref, l’équivalent américain de Godon. La radio est en train de dire : ... et c’est là que nous ne sommes pas comme les Brits. Selon KUSC donc, des sondages sur la musique classique de l’autre côté de l’Atlantique montrent que le public anglais réserve aux enfants de la patrie, aux génies maison, trois de ses quatre premières places, à commencer par l’or, évidemment, tant qu’à faire pourquoi se gêner. Tant pis donc pour ce pauvre musicologue boche pour qui l’Angleterre est terre sans musique. Et en passant tant pis pour Ludwig et autres Amadeus.
Je dirais, entre la musique savante et le jazz, c’est l’embarras du choix pour moi. Ça se joue sur un coup de tête, entre KUSC et KJAZ. Une fois campé sur l’une ou l’autre, il m’est difficile de bouger, je ne change qu’à cause de parasites. Après tout, KJAZ aime seriner à longueur de journée que le jazz est la musique classique de l’Amérique. Et l’on croise, sur l’une ou l’autre des deux stations, aussi bien Le beau Danube bleu que Gershwin. À deux exceptions près. Un, KJAZ est imbattable tôt le matin quand je me lève, une musique d’un autre monde. Le genre capable de faire broncher le suicidaire, ou l’y décider. Deux, le dimanche soir, j’évite KUSC à n’importe quel prix. L’émission, intitulée quelque chose comme ‘Du sommet’, qui donne la parole aux jeunes vedettes de la musique classique américaine, au lieu de se contenter de les laisser jouer. (Elle n’est pas animée par le dénommé Scratcher.) Non pas parce que je ne comprends rien à ce qui s’y raconte, mais parce que quelqu’un m’en a une fois traduit un bout. La marmaille qui n’arrive pas à raccrocher et qui discourt sur l’avenir de l’homme rien que ça. Désolé mon petit tu ne raccroches pas t’es d’office hors-jeu allez ouste carton rouge au piquet. La marmaille engraissée à coups de crème glacée jusqu’à obésité sur le dos des Chagossiens et autres néo-esclaves.
Les bévues particulières à la radio américaine, soit-elle universitaire, me rappellent, par contraste, cette étonnante découverte que j’ai faite en France l’été dernier, les émissions télévisées sur la littérature. Ici aux USA, ne parlant pas l’anglais, je ne regarde simplement pas la télé. Sauf la Coupe du monde. J’ai acheté un poste d’occase à dessein. J’éteins carrément le son, je le trouve tout simplement agaçant. C’est comme avec les communistes, bouchez-vous les oreilles et regardez plutôt ce qu’ils font. Une fois pourtant, j’ai fait une exception. Quelqu’un m’a fait savoir que l’épisode cette nuit-là d’une certaine émission littéraire télévisée va parler spécifiquement de Duras. Comprenez-moi, Marguerite Duras et moi sommes allés au même lycée saigonais, nous habitons, à différentes époques admettons, le même faubourg de Saigon. Je ne pouvais résister à la tentation. J’ai allumé à l’heure dite, pile poil. En passant, on m’a assuré que ladite émission, une petite demi-heure hebdomadaire, programmée tard dans la nuit sur PBS, la seule chaîne publique en terre promise, est l’unique émission qui parle de littérature dans le pays. Commençons par le commencement, le décor. Une table carrée, tapissée de vert, quatre interlocuteurs, dont l’animateur, un éditeur de quelque magazine littéraire si j’ai bien compris, et trois experts en la matière. Un verre d’eau devant chacun. Un ou deux livres sur la table. On dirait que quelqu’un les a oubliés, ces livres, ils ont l’air si paumé. On s’attendrait plutôt à voir des cartes et des jetons à la place. Le son éteint, tout un chacun parierait qu’on est en train d’assister à une partie de bridge ou de poker. Comme je n’y entends rien, je ne peux commenter sur le contenu. Mais à les regarder converser, je ne pouvais m’empêcher de tendre le cou, essayer de voir si les chaises, je ne peux m’emmener à dire les fauteuils, voir si leurs chaises ne seraient pas plantées chacune d’un balai. Au bout de la troisième fois qu’ils ont, entre eux quatre, prononcé ‘dura’ (rien que le passé simple s’il vous plaît) au lieu d’appeler l’auteure par son nom, j’ai éteint amen.
Quel contraste. En France, il n’y a pas que Bouillon de culture. On s’assoit à cinq, à sept autour d’une table basse, on débouche un Margaux, goûte aux fromages, tout en parlant du terroir aussi bien que de Radiguet ou de Cervantes, c’est génial je trouve. Même un cancre certifié comme moi pourrait en profiter, pour vous dire.
KUSC me fait penser à l’émission américaine sur Duras parce qu’aucun de sa demi-douzaine de présentateurs n’appelle Debussy par son nom. Disent tous ‘dé’. Bravo ! vous m’avez devancé, c’est Saint-Sensse, comme dans senssasse, évidemment, pour le compositeur, quoi de neuf. Comme pour se venger des érudits universitaires de la télé qui ont tenu à faire le malin, à éclairer la lanterne radiophonique, et en passant à étaler leur savoir aux yeux du monde. Dans la même veine, le présentateur de KUSC qui est venu animer le concert gratuit de l’Orchestre du Pacifique que je suis allé voir dans le parc, je n’ai pas saisi son nom, mais une fois à la radio il a présenté un morceau de Jean Françaix, joué au piano par la fille même du compositeur, Claude Françaix. Et notre animateur de s’indigner, de s’insurger : − Qu’est-ce qu’il peut être méchant, ce monsieur, d’avoir ainsi nommé sa fille ! Une autre fois, introduisant Clair de lune de Debussy, rime ‘lune’ avec ‘clown’. Parlant du loup, le voici justement qui propose un morceau intitulé Le sapin de Noël, je n’ai pas saisi de qui, absorbé comme je suis à écouter notre énonciateur appeler le pauvre arbre ‘sa - pine (comme bite) - ni (comme nichon)’. Une autre fois, présentant la chanson de Satie, dit ‘je té vous’. Ceci étant, je reconnais à notre vaillant homme un certain sens de l’humour. Énonçant un jour un concerto de Vivaldi, s’empresse de rassurer le public : − Mais ne vous inquiétez pas, ce n’est pas pour tout de suite.
Remarquez que par rapport à chaque exemple d’élocution que j’ai donné, il est hors de question d’invoquer quelconque accent comme justificatif. Quand on prononce l’unique voyelle des trois syllabes de Je te veux de trois manières différentes, il ne peut être question d’accent.
Une chose que je regrette vivement de ne pas avoir faite lors de mon pèlerinage hexagonal est d’aller à l’opéra. Je ne me souviens plus des détails, mais j’ai réussi à louper, de peu, de vraies occasions, entre les engagements et les imprévus et les horaires des trains, les grèves dans les transports aussi bien que celles des artistes. Je n’ai donc pu apprendre de première main si les représentations artistiques en France débutent obligatoirement par La Marseillaise ou non. M. Mme. Delomenède m’ont par contre emmené voir Red Star-Girondins de Bordeaux, un match de Coupe de France quand même, là au moins je sais, pour les compétitions sportives. (Qui aux USA commencent impérativement par l’hymne national.)
Avant d’atterrir dans ce HLM donc, je louais une resserre en plastique, sans fenêtre, posée dans une cour, ici et là dans le ghetto, dans des maisonnées d’une dizaine d’âmes, au bas mot, qui se croisent à peine. Pas facile de savoir exactement, car y a va-et-vient incessant, y en a qui se sont fait remercier au boulot, d’autres qui pissent par-dessus la chiotte, qui se chauffent en cachette, qui cachent un grille-pain sous son lit-cage. Ça ronfle ferme à toute heure, bon nombre d’entre nous bossant la nuit, ouvriers dans des usines qui tournent 24/7 365. Même dans le sud de la Californie les nuits d’hiver sont fraîches, surtout pour les enfants des tropiques que nous sommes, la salle de bain est loin, tout le monde pisse dans des sacs plastique et autres bouteilles la nuit. Mieux vaut s’assurer d’abord que le sac ne fuie, en soufflant dedans. Vu les parois qui nous séparent, le moindre pet s’entend, enfile les cagibis de son staccato, à la vitesse du son. Encore heureux que l’odeur ne porte aussi loin. Pour pisser la nuit, faut écraser le bulbe dans le plastique, et dès qu’il y a assez de liquide, l’immerger. La nature humaine m’a toujours sidéré, pas pour rien que j’ai opté pour le bonnet d’âne au lycée. Pourquoi continuer à pisser par-dessus bord jusqu’à se faire virer ? À l’autre bout, pourquoi mettre quelqu’un à la porte simplement parce qu’on le trouve trop feutré, parce qu’il refuse la curée ? Vive le HLM !
La dernière chambre avant le HLM fut une exception : ce n’est pas moi qui m’en suis fait chasser, j’ai plutôt filé à l’anglaise, la quéquette entre les pattes en l’occurrence. La propriétaire a à peu près mon âge. Divorcée. Son fils unique habite à Hawaï, d’où il opère un thonier qui leur appartient intégralement. La prise est livrée exclusivement au Japon. Tout ça pour vous dire que personne n’est dans le besoin. En fait, vu le cours du thon au royaume du sashimi, et le prix d’un thonier congélateur, il est évident que ce sont des gens pleins aux as. Bref, ne me demandez pas pourquoi, la mère s’est éprise de ma personne, figurez-vous. Pour vous dire qu’en échange d’un peu de partie de jambes en l’air le soir, j’aurais pu m’assurer un avenir de cocagne. Comme ma femme et moi, elle et son mari ont profité de la chute de Saigon pour prendre le large, eux y sont arrivés du premier coup. Pays de cocagne, le mari a pris juste le temps de lui faire un enfant avant d’aller voir ailleurs. Elle a élevé le fils seule, d’abord ouvrière coiffeuse, puis propriétaire du salon de coiffure, qu’elle a repris sur acompte. En parallèle elle a acheté la maison, sur acompte aussi bien entendu, comme tout le monde. Entre-temps le fils, au lycée, s’est lié un pote dont le père est pêcheur thonier, les deux copains partent chaque été dans le navire du père, leur job des grandes vacances. Après une licence en biologie marine à l’université, avec mécanique navale en sous-dominante, le fils a passé un diplôme de marine de pêche. Quant à la mère, salon de coiffure et maison enfin purgés d’hypothèque, elle a vendu le premier offrir à la prunelle de ses yeux l’acompte sur le thonier. Deux saisons de thon, et le navire est à eux deux. Chapeau, conte de fées amerloque ! Il y a trois chambres à coucher dans sa demeure, elle a fait du garage deux autres, avec une salle de bain entre, et elle a installé six cagibis en tout dans le jardin. Derrière quoi elle a aligné, contre le mur du fond (lequel mur longe un chemin de fer), une douzaine de cages dans lesquelles elle élève du chien de table. Dans l’étroit passage entre nos cages à lapins et celles des chiens, un seau marqué ‘Pour le meilleur ami de l’homme svp’, nous y vidons nos restes. Vous dites que je ne peux mieux tomber, quel pot !, mais attendez quand même que j’aie fini bon sang. Pour commencer, elle a horreur du chien, les siens, elle les livre promptement, dès l’an d’âge, quand ils ne poussent pratiquement plus, car c’est au kilo que ça se négocie, comme il se doit. Je ne lui ai d’ailleurs jamais avoué ma faiblesse culinaire, ayant vécu des années sous les cocos, j’ai quand même fini par apprendre à taire mes atouts. Allez savoir pourquoi elle fait tout ça, elle qui possède la moitié d’un bâtiment de haute mer et une maison en entier. Sans compter sa Mercedes. Attendez, je n’ai pas fini, loin de là. Vous vous demandez comment une telle multimillionnaire peut supporter toute cette racaille (dont je fais partie intégrante) dans sa maison à elle. Vous savez quoi ? Elle habite dans un de ses cagibis dans le jardin. Elle loue jusqu’à sa chambre principale, qui vaut trois ou quatre de ces réduits en plastoche. Alors, hein ? Mais bon, ce n’est pas mon problème, chacun ses priorités. Parce qu’aussitôt son dévolu jeté, elle a récupéré sa chambre, en a viré sec le locataire, parce que le crac-crac dans un cagibi, d’où le moindre pet perce, vous imaginez ? Bref, Noël dernier, le fils est venu nous rendre visite. La mère compte lui annoncer la bonne nouvelle, le surprendre. Qu’on va se marier en juin, à la belle saison. Se trouve que le fils aussi a une bonne nouvelle à lui annoncer. Plutôt une mauvaise surprise. Elle croit le surprendre. Il a amené sa fiancée. Elle est black. À maintes reprises la mère m’avait confié, comme par prémonition, que le ciel lui avait exaucé tous les vœux, mais qu’il suffirait d’une chose, d’une seule, pour tout détruire pour elle : une bru ‘charbon de bois’, qu’elle dit. Son pire cauchemar, la plus grave malédiction qui soit. Nous sommes allés les chercher à l’aéroport, dans la Mercedes qui pue le chien. La mère m’a passé le volant au retour. Elle a pleuré dans ses lunettes de soleil pendant tout le trajet, s’excusant de sa ‘grippe’. J’ai fait de mon mieux en terme de diversion, attaquant par le biais du kitesurf, ayant découvert à brûle-pourpoint que le jeune couple en est accro. Leur ai raconté le Vietnam et le narcotrafic et la prison. Ils ont particulièrement apprécié mon projet d’évasion éolienne. Pour sa part, le fils m’a dit qu’il ne manque point, chaque fois que boulot et météo le permettent, de s’adonner à la glisse nautique au beau milieu du Pacifique, un luxe que peu peuvent s’offrir ; de se lancer du pont de son navire accroché au cerf-volant, un saut vertigineux !, pour livrer la course à son propre bateau, au grand délice de l’équipage. Lequel ne se prive point de parier sur l’un ou sur l’autre, sur le mastodonte de turbines et de pistons, ou sur le franc-tireur éolien, tout aussi sophistiqué mine de rien, en dépit de son air aussi éthéréen que le vent qui le porte. Et de profiter du sillage du bâtiment, sillage qui n’en finit pas, pour faire du wakeboard combiné au kitesurf. Slalomer entre deux crêtes du sillage, dévaler à voile abattue le vertigineux sillon entre, surfer la liquide muraille de Chine, pour attaquer du tranchant de la planche le versant opposé, s’en servir, comme d’une rampe de lancement, pour sauter plus haut que son propre bateau. Profiter de l’apesanteur pour exécuter des loopings et autres figures de haute voltige en rase-mottes des tentacules géométriques de ce mur d’eau que traîne le vaisseau à travers l’océan. Peut pas dire que le jeune capitaine navigateur chef d’entreprise ne profite à fond la caisse de son thonier.
C’était quelques jours avant Noël. Nous avons dîné à trois ce soir-là, la mère ayant prétexté la grippe. Le lendemain le jeune couple est allé dès lever du jour louer une voiture faire du tourisme, le jeune homme faisant les honneurs de sa Californie natale à sa dulcinée hawaïenne. Peu après le repas de midi la mère est allée livrer les chiens pour Noël. C’est moi qui les lui attrape, qui les lui fourre dans la Mercedes. C’était un dimanche. Je l’ai embrassée sur le pas de la porte, comme d’habitude. Puis j’ai ramassé mes maigres affaires, toujours dans mon cagibi, je ne mets les pieds dans le dur que la nuit tombée, pour affronter devoir extra-conjugal. J’ai sorti le vélo, sanglé matos de voile et sac de couchage au porte-bagages, enfilé raquette de tennis et ordinateur portable, enfourché ma monture, compagne de jours heureux et d’autres qui le sont moins. Je lui ai laissé un mot. Lui demandant de ne pas trop m’en vouloir, lui disant que je ne suis pas fier de moi, mais qu’il vaut mieux ainsi, qu’elle et moi, ça a été une erreur depuis le début, que je ne suis pas fait pour elle, ni pour ce monde (l’un et l’autre combien vrais). Bref, j’ai sorti tout le répertoire que commande la situation, le patati qui couve depuis une éternité, qu’on repousse jour après jour par lâcheté, qu’on étouffe dans un orgasme volé, sous des caresses sans cœur.
Charmante pourtant, l’aspirante bru, la jeune Black, métisse en fait. Beaucoup plus caoua au lait que charbon de bois. Vive d’intelligence, sémillante, du sens de l’humour, une Grace Kelly de couleur, y a de ces convergences dans la nature, c’est ce qui m’a frappé lui parlant dans le rétroviseur. Secrétaire du fils. Un diplôme universitaire en bureautique avec législation maritime en sous-dominante. Pas pour rien qu’il a payé son thonier en deux saisons de pêche, le jeune boss. Trie ses collaborateurs sur le volet. Ira loin, le jeune homme. Comme j’aimerais mieux les connaître, qu’ils sont rares à passer au ghetto, les gens de cet acabit, combien éphémères, les rares plaisirs de l’exilé. Condamné à laisser derrière, au gré des chemins, les menues douceurs qui lui tombent dans les mains, comme le clochard fourbu ses maigres affaires.
Je crois avoir aussi dit ne pas parler anglais. L’autre jour, passant en catimini dans le couloir, je me suis fait héler d’une porte ouverte. Je déteste qu’on hèle, en plus que ça me fait toujours sursauter, même quand je n’ai rien à voir, ça me rappelle le pays natal, où tout le monde hèle, d’un trottoir à l’autre, d’un étage à l’autre, à longueur de journée, voire la nuit, tous des poissonniers, d’une vulgarité. Planté sur sa béquille au milieu de sa studette, le voisin me dit qu’il a besoin d’un coup de main. Pointant sa prothèse du pouce, il dit qu’un fil de fer a cassé et qu’il a besoin que je l’accompagne chez le prothésiste, parce que lui ne parle pas anglais. Il tombe bien le gus. Je ne le savais même pas unijambiste, ni monolingue. Je l’ai toujours vu boiter, mais en pantalon et baskets, ça ne se voit pas. D’autant plus qu’il est fortiche sur deux-roues, sitôt en selle sitôt agile comme un singe, montant de surcroît un biclou de môme trop petit pour lui. Aussitôt que je me suis rendu compte de son infirmité, j’ai pensé au cerf-voliste poliomyélitique que j’ai connu à Nhatrang, un vieux Russe. À l’un comme l’autre c’est la monture qui leur donne des ailes. Grand amateur de chien et de café topless, le voisin, tout comme votre serviteur. C’est ce jour-là que j’ai appris qu’il a perdu sa jambe au combat fantassin sud-vietnamien, et que cela fait trente ans qu’il végète en pays de cocagne. Trente ans et pas un traître mot d’anglais. Mon avenir à moi aussi ? Je ne suis pas entré chez lui, je lui ai parlé appuyé au chambranle de la porte. Il m’a fait un effet bizarre. D’une ceinture il a improvisé une lanière, au moyen de quoi il porte sa jambe en bandoulière, comme un soldat son fusil. Son pied métallique lui sort par la hanche, le col du fémur par l’épaule. Pour couronner le tout, décroche du mur le casque de fantassin dont il se coiffe religieusement pour monter à vélo. Dit que ce n’est pas la première fois que le fil casse, que c’est toujours le même, qu’il va toujours au même endroit pour le faire réparer, que l’assistance sociale paie pour tout, même le taxi. Quand je lui demande pourquoi il a besoin d’un interprète alors, il avoue n’en avoir pas vraiment besoin, puisqu’il n’a qu’à montrer l’adresse au chauffeur de taxi et la jambe au prothésiste, lequel n’a qu’à taper son nom, client récidiviste, dans son ordi pour la facture électronique envoyée via internet, en un clic, à la sécurité sociale. Dit qu’il n’a d’ailleurs jamais eu à balbutier un mot, sauf la première fois quand il a pris le soin de se faire escorter par l’assistant social bilingue qui suit son dossier. Finit par admettre qu’il a simplement peur de quitter le ghetto seul. Pourquoi qu’il n’a pas fait appel une seconde fois à l’assistant social, qui par ailleurs habite à deux pas ? Faut lui payer une tournée de chien après coup, entre consommations et couilles rôties l’addition risque d’être lourde.
Ne me dites pas que vous n’êtes pas scandalisé, qu’un assistant social profite ainsi du système. Cacahouète. De mes jours de coolie de quai à Cholon, j’ai hérité un mal chronique du dos que les mois de bat-flanc en taule, puis les années de lit-cage au cagibi, et enfin les mois de banquette dans une voiture, n’ont rien fait pour arranger. Ni bien sûr le nombre des années. Bien au contraire. Il faut que j’aille me faire soigner. Heureusement, suis pris en charge par l’état de Californie lui-même rien que ça, un machin qui s’appelle Medi-Cal, couverture médicale californienne pour smicards et autres laissés-pour-compte. Pour voir un spécialiste, faut passer par un généraliste, assurance maladie oblige. Pas n’importe quel omnipraticien non plus, celui qui vous a été assigné par votre assurance, publique ou privée. J’ai fini par le voir, le chirurgo lumbago, mais seulement au bout de trois visites en bonne et due forme au généraliste. Lequel m’a simplement refilé un peu de pommade à chaque fois après m’avoir pris le pouls, tout en m’assurant que ces trois visites sont obligatoires. Pour qui qu’il me prend ce crétin de toubib ? Mais bon, ce n’est pas moi qui paie. Tout ça, pour me faire dire en fin de compte qu’il n’y a aucune chance que le vrai toubib dégaine au tarif de l’assureur étatique. Soit je paie la différence de ma poche, soit je ne fais rien, soit j’encours le couteau de quelque charlatan. Couverture médicale amerloque, couverture passoire.
Parce que charlatans, y en a, plein même. Cézigue généraliste, d’ailleurs, m’a dit lui-même : − Qu’avez-vous à vous plaindre ?, vous n’avez qu’à pointer trois fois, ça vous coûte que dalle, heureusement que vous ne dépendez de moi. Vous croyez qu’on se fait toubib pour guérir ? Quelle idée ! Garder le patient malade, qu’il vous revienne encore et encore.
Au lycée je me vantais de mon bonnet d’âne, je n’avais rien vu du monde. À cancre cancre et demi. Ça pousse dans les arbres pour courir dans les rues.
Nous l’avons compris, tennis, café topless ou voile, j’expédie et je file. Comme pour un besoin naturel. Entre boulot, emplettes et plaisirs, j’enregistre une centaine de bornes par semaine au compteur du vélo. Ce n’est pas qu’une estimation, puisque j’ai équipé mon deux-roues, en plus d’un porte-bagages cossu pour mon matos de voile, d’un de ces odomètres de fabrication chinoise qui coûtent deux sous et qui affichent, en temps réel s’il vous plaît, jusqu’aux calories brûlées au cours du trajet. Ces cent bornes se traduisent en deux ou trois incidents par semaine. Toujours la même histoire, un automobiliste qui sort d’un parking et qui refuse de céder la priorité. Au royaume de l’automobile, les voies cyclables sont rares. Les trottoirs sont par contre spacieux, et le rare cycliste les partage avec son frère le rare piéton. En contrepartie, l’un comme l’autre sont choyés comme des enfants par la loi. Et par moult automobiliste qui les envie peinard de derrière son volant. Quand le chauffard est un Blanc, je baisse la tête et contourne : il y a des chances qu’il soit armé. Au far-west on ne badine pas avec sa monture, encore moins son flingue. Des engueulades entre chauffards se sont déjà soldées en morts par balles en plein jour. Je n’ai aucune intention de finir dans les statistiques. Incroyable, des millions de calories de carburant dans la vessie et des centaines de chevaux-vapeur sous le capot, ils vous chicanent encore sur deux pouces de ciment municipal. À coups de 7,62 s’il le faut. L’arme à feu, argument-massue s’il en est. L’arme à feu, qui épargne au tortionnaire le choc du tomahawk sur une boîte crânienne. Je me rattrape sur les Jaunes. Je n’ai qu’une règle : ne pas donner. Au flic de s’amener choper le chauffard. Naturellement, la police n’est jamais là quand on en a besoin. Il m’est arrivé de patienter un bon quart d’heure (autant dire une éternité), le biclou campé sur sa béquille contre le museau du tacot, avant que le crétin fasse marche arrière. Plus d’une fois je me suis fait dire que je n’ai pas le droit de faire du vélo là où on se trouve. Ce n’est point ce que l’on croit, le Petit-Saigonais, plus catholique que le pape, croit dur comme fer qu’en ce pays de cocagne, aux antipodes de l’enfer dont il a réchappé, le vélo est censé ne se pratiquer que sur pistes cyclables. C’est d’un pied aussi ferme que le mien qu’il attend l’éventuelle patrouille. Perso je vois dans cette conviction d’autant plus inébranlable qu’elle est crétine la cerise qui coiffe le gâteau de qui est condamné à lécher le cul en crachant au visage dans une seule et même contorsion bucco-cérébrale. Laquelle contorsion, nous l’avons compris, est son existence même : il n’en a pas d’autre. Suis quand même bien placé pour le savoir, suis des leurs après tout, jusqu’au cou.
À le lui lécher, le ghettoite finit par choper la conviction du colonialiste, celle d’avoir été appelé à débarquer couler sa loi au même titre que son bronze. Laquelle conviction ils partagent avec le missionnaire.
Parlant de chien. Suis comme tout le monde, il me faut une certaine dose de certaines choses pour pouvoir continuer à respirer. Mon chocolat à moi est le chien. En gros, entre un et deux kilos par mois ferait l’affaire, ce n’est pas beaucoup demander à la vie. Quelques clébards par an, qui s’en apercevra ? J’ai la frugalité dans la peau. Je peux me la permettre, ma combien humble chère de prédilection, point du homard ou autre caviar, j’ai un boulot après tout, et une fois le loyer payé et le café topless et autres frais généraux réglés, je n’ai plus que l’estomac à remplir, n’ayant point de voiture, encore moins de portable. Le tennis et le kitesurf sont gratos comme vent et soleil. L’essence, l’assurance et le garagiste et autres pévés et collisions, c’est ça qui vous taille des croupières dans la bourse. Je me suis bien offert un tacot d’occase. Ça m’a guéri. Bagnole-portable rime avec caca-boudin. Pour vous donner une idée, chaque fois que j’en fais le plein, c’est un vélo d’occase et une année entière de chien que je mets dedans. M’en suis débarrassé vite fait. Je ne conduirais plus que chauffeur à gages, et il faudrait me payer pour me déposer. À peine croyable, on se tue au taf pour abreuver cet étron à explosion pour qu’il nous pompe des tas de saletés dans poumons et sang et ciboulot. Pas surprenant qu’on finisse par voter extrême droite. Refiler le cancer à ses propres enfants parce que pas foutus de marcher jusqu’au café au coin de la rue. Se retrouver esclave d’un besoin sur le dos d’autrui, c’est à cela que moi je reconnais le pleutre, c’est cela que j’appelle débilité. Quand on n’a pas les moyens de son ambition, on fait payer quelqu’un d’autre par définition. Attendant le feu au carrefour à califourchon sur la bécane, il ne m’est pas rare de voir un de ces automobilistes ne pas bouger d’une semelle au feu vert, s’en faire klaxonner dans le cul : absorbé à pianoter sur son portable au volant. Parfois, on ne klaxonne même pas : le mec derrière aussi pianote. Chaque note sur le clavier une balle dans la tête d’un enfant soldat centre-africain.
En passant, deux autres phénomènes se produisent quand un cycliste aux yeux bridés attend au feu rouge dans le ghetto. Un, il se fait aborder en vietnamien, à brûle-pourpoint. Deux, des chances que la toute première phrase qu’on lui adresse soit : votre cadenas est peu convaincant, vous avez intérêt à vous en procurer un qui soit plus solide si vous tenez à votre biclou. Rien que ça.
Naturellement, je ne peux pas compter que sur les banquets occasionnels du HLM pour remplir mon quota de bonne chère. Heureusement qu’on est bien ravitaillé au ghetto, aucun problème. Pas que des inconvénients, chaque trou ses avantages. J’en passe, ci je ne mentionne que ma gargote du cœur, que j’honore disons une fois par semaine en moyenne. Une maison comme les autres, rien de marqué. Pas loin du HLM où je crèche. Dans la cour derrière, une douzaine de cages, pour vous dire combien c’est frais. Si votre table en commande un en entier, vous n’avez qu’à pointer du doigt votre choix. Point de menu imprimé non plus. Un plat unique chaque soir de semaine qui varie selon le jour et d’une semaine à l’autre, vous découvrez à table même. Que du chien bien entendu, non amateur s’abstenir. Ouvert toute la journée samedi et dimanche, quand les sept mets de la semaine sont au menu, spécial week-end. Seules deux boissons sont servies, la bière, Michelob ou Heineken, et du Rémy Martin dans de l’eau gazeuse frappée de glaçons. Une seule table, grande et ronde, est dressée au beau milieu du séjour. On se serre quand il y a du monde, ce qui est souvent le cas, surtout les fins de semaine, ça déborde parfois sur canapé et sous véranda. Le soir d’un grand match de boxe ou de football américain, mieux vaut pointer de bonne heure. Deux grands écrans plats se font face de part et d’autre de ladite table, aboient en stéréo dans la gueule l’un de l’autre par-dessus la tête des convives. L’air épais de fumée de cigarette, de fumet de chien, de tonitruants décibels. Les finales du grand Chelem, les week-ends de JO et de Coupe du monde, il faut réserver, faire jouer son dévouement à la canine cause. Les trois enfants du couple quadragénaire servent et aident dans la cuisine. Le mari s’attable souvent avec les clients, quand il n’est pas en train de faire le bourreau : il ouvre la cage et attrape le clebs au moyen d’une raquette de tennis dont le filet a été remplacé par une ceinture faisant office de nœud coulant, se sert ensuite d’une machette serpe, avant de brûler le poil au chalumeau soudeur. On dit qu’il leur coupe la langue dès acquisition ou tôt après sevrage, pour les réduire au silence, discrétion oblige, je n’ai pas regardé, pas mes oignons. Parlant de couper la langue aux chiots, j’ai été longtemps par contre curieux de l’origine des taches au plafond des boucheries canines. Et me suis toujours demandé pourquoi les chiens qui en pendent ont toujours le museau tronqué. Je suppose qu’on les mutile pour la même raison qu’on ampute la volaille au niveau des chevilles. Ce doit être une autre paire de manche quand même pour le chien. Les coups de tranchoir qu’il faut donner je veux dire, ces gens ne sont point équipés de scie électrique. Vlan ! Vlan !
Des convives, il y en a qui restent toute la journée, à picoler et becqueter et papoter et jouer aux cartes, échecs chinois et autres dominos. Il y en a de réguliers, voire d’assidus, mais il arrive aussi de visages nouveaux, en un filet qui ne semble pas près de tarir. Y a même des jeunes, voire des mômes, nés dans le pays. J’y croise de temps en temps un voisin du HLM ou un