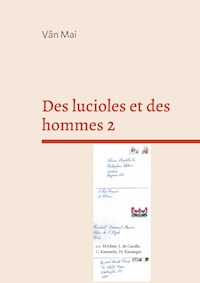Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Né à Saigon l'année de Diên-Biên-Phu, Vân Mai y passa son baccalauréat en pleine guerre du Vietnam. Bac français en poche, il s'embarqua pour l'Occident. Physicien formé aux universités Columbia et de Princeton, il a été enseignant-chercheur aux universités de Rennes et de Californie. Adulte il a vécu en terre chrétienne, dans ses temples du savoir. Expérience transformatrice, qui lui valut de troquer son premier amour la science contre une plume. La trilogie romanesque sise en guerre du Vietnam, Créchien, Des lucioles et des hommes et La Cage aux cerfs-volants en est le fruit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
à P.S.
diadème trahi
aux races inférieures
c’est leur innocence qui constitue leur crime
James Baldwin
les Blancs n’ont aucun respect pour ceux qui ne sont pas aussi méchants qu’eux
Chester Himes
ah ! Tiécoura, les Vietnamiens sont les Pygmées d’Asie, de frêles Pygmées. Ils ont chassé de leurs terres tous les grands peuples de l’univers. Peuples grands par le nombre de leurs habitants comme les Chinois ; peuples grands par les moyens techniques de leur armée comme les Américains ; peuples grands par leur culture et leur histoire comme les Français. Il est à parier que, si l’univers entier s’alliait pour occuper le sol vietnamien, les Viets vaincraient et jetteraient les soldats du monde entier à la mer
Ahmadou Kourouma
si je saisis pas l’occasion tous mes ennemis l’auront trop belle, ils me raconteront tout de travers, ils ne font déjà que ça
Céline
nolite te salopardes exterminorum
Margaret Atwood
ceci est une œuvre de fiction. La vision du monde qui y danse la gigue n’est que celle de l’auteur. La créature capable de l’en faire démordre n’est pas née ce côté-ci de l’éternité
En l’an 40 de notre ère, deux jeunes paysannes à dos d’éléphant ont chassé de leur pays l’occupant Han, le plus grand empire de l’Antiquité. En 1077, 1285, 1287, 1427 leurs descendants ont écrasé les plus puissantes armées du globe. En cette année 1965 du calendrier impérialiste, le masque a encore une fois changé d’empereur, et c’est de nouveau pris sous un rouleau compresseur que filles de dragon et fils de fée font face.
Table
I. Loriot
II. Salangane
Bibliographie sommaire
Appendice
Acronymes et sigles abscons
I. Loriot
Il jette le mégot dans l'eau dorée, se retourne, rentre dans la baraque. Il se dit qu'il ne reverra plus jamais ce soleil diffus se coucher sur ces rizières ondoyantes. Il a servi le temps requis, tiré ces onze mois réglementaires, dans une heure, à la nuit tombante, il sera dans l’hélicoptère, vingt minutes de vol, et il sera dans la capitale, il engagera les démarches nécessaires dès le lendemain matin, et dans une semaine ou deux, un mois au plus, il reviendra la chercher, ensemble ils s'en iront, loin, bien loin, vers la paix, vers le bonheur. Son havresac est prêt sur le lit de camp contre le mur du fond, les deux chaises rangées contre la table de bois accolée au rebord de la fenêtre, sa photo enveloppée du foulard bleu dans sa poche, contre son cœur : longue chevelure noire et lisse ramenée devant par-dessus une frêle épaule à l'ombre d'un chapeau de feuille conique. Officier commandant les trois vedettes de la garnison, il a eu droit à cette chambre modeste mais à part sur ses propres pilotis, où il l'a rencontrée onze mois auparavant, quelques jours après son arrivée dans cette base d’artillerie fluviale, dernier avant-poste face à l'interminable jungle aquatique. Il a eu beaucoup à faire depuis, dans cette contrée féerique où l'eau, la terre et le ciel se fondent en un immense bain de vapeur surchauffée six mois de l'année. L'eau est partout. Il n'a vu l'ombre d'un ennemi depuis son arrivée, sa guerre à lui a été réduite au difficile maintien du moral de ses hommes oisifs et de l'état de marche de ses vaisseaux vétustes, et à tenter de rester sec, au moins le temps d'en griller une après la douche quotidienne. L'eau, justement, tombait à verse cet après-midi d’il y a onze mois quand, encore furieux contre ses hommes, il pénétra en trombe dans sa baraque, les cheveux dégoulinant sur ses yeux en feu. Elle sursauta, se retrouva sur son lit qu'elle était en train de faire, les genoux repliés sur la poitrine face à ce mastodonte fougueux qui avait failli la surprendre les fesses en l'air. Lui aussi sursauta, à la vue inattendue de cette bà ba noire penchée sur sa couche, et il la fixa une seconde de ses yeux ronds, remuant fébrilement dans sa mémoire des scénarios fantastiques d'attentat ou d'espionnage. Puis sa mine d'oiseau ébouriffé acculé contre son mur le fit pouffer de rire, il se souvint d'avoir demandé à son aide de camp de faire passer sa femme de chambre chez lui aussi. Il lui tendit la main pour l'aider à se relever, se ravisa à temps, recula d'un pas, riant toujours. Vive de port comme d'esprit, elle était déjà sur ses pieds quand il eut rassemblé sa phrase :
− Seriez-vous la femme de chambre ?
Elle fit oui de la tête et, surprise de nouveau, enchaîna dans un sourire amusé :
− Parleriez-vous ma langue ?
− J’essaie d’apprendre, ce n’est pas évident. Comment vous appelez-vous ?
− Loriot. Loriot-du-Saule.
− Moi, c’est loin d’être aussi joli. Joe Key, Joe pour les amis. Enchanté, mademoiselle Loriot-du-Saule. Et merci pour le ménage.
Quelques jours plus tard il prit son courage à deux mains et lui demanda de l'aider à améliorer sa conversation.
− Vu le travail à abattre, ça va vous coûter cher.
Depuis, les mornes patrouilles sur les innombrables plans d'eau environnants, les rapports des sous-officiers, l'inspection de ses hommes et du matériel, les réunions d'état-major du bataillon, le café le matin, le cinéma au mess le soir, tout cela n'a plus été pour lui qu'attente. Attente de ses leçons, de la revoir. Ils parlaient de tout, de rien. Sous l'ampoule nue pendue au-dessus de la table, entre le tambourinage étouffé de la pluie sur le toit de feuilles de latanier et le clapotis cadencé du fleuve sous le plancher de bois noirci, naissaient, mouraient, se ravivaient pensées, souvenirs, regrets, rêves. Une cigarette entre les doigts, il regardait le picotement dru et argenté de la pluie sur le fleuve. Elle leur versait du thé, lui raccommodait une chemise ou une chaussette de ses doigts menus labourés par la terre. Elle insistait sur ces soins en dépit de ses protestations, elle lui disait que, vu l'écart d'intelligence entre l'enseignante et l'apprenti, ces leçons − elle prononçait le mot avec un sourire ironique − ces leçons bien rémunérées lui profitaient à elle bien plus qu'à lui, et que de toute façon s'il ne se laissait pas faire, elle ne reviendrait simplement plus. Les après-midi où elle devait venir, il déléguait ses fonctions plus tôt qu'à l'ordinaire, rentrait chez lui en courant une fois hors de vue. Il fouillait fébrilement dans ses maigres affaires, défaisait quelques fils ici ou là, déchirait même une poche, une manche. La fois où elle lui fit remarquer que son armée ne risquait pas de gagner vu le savoir-faire avec lequel elle habillait ses soldats, il feignit de se réfugier derrière la barrière des langues, puis ils éclatèrent de rire en même temps. Elle apprenait effectivement sa langue à lui bien plus vite que lui la sienne. Elle lui dit qu'il devait venir d'un pays feutré où ombres et sons s'estompent dans une brume féerique. Et que, chez elle, on décline dans un plumage iridescent, et chacun chante comme il l'entend. Le mendiant comme le roi marque de son sceau unique le bien de tous et de chacun. Elle pointa un coude en avant :
− Académies et recommandations de l'administration et loi Toomauvais mon coude saillant. La langue, c’est comme la guerre. C’est au ras des pâquerettes que ça se passe, pas dans les havres de vipères, les fosses d’aisances de culbénifachos qui croient faire des dicos.
Elle utilisait la langue de brume parcimonieusement, la réservait pour le sarcasme, la foudre, les coups de grâce. Lui grimaçait chaque fois qu'elle l'entamait, surtout quand elle se mettait en même temps à le vouvoyer et à l’appeler mon capitaine :
− Faut que vous cessiez de noyer mon pauvre oiseau dans votre brume mon capitaine, il est méconnaissable !
Méconnaissable, lui l’était souvent sortant de ses mains : béat, perdu, gourd, endolori. Il en redemandait.
Un jour il lui demanda pourquoi elle avait accepté de venir. Elle lui dit que le souvenir d’un tigre hirsute reculant devant un oiseau pris au piège l’avait souvent fait rigoler.
− Je sais que le marigot et le soleil m’ont tôt rabougrie mon capitaine, ce que je savais pas, c’est que j’ai une beauté à faire détaler les fauves merci ; puis, à ses protestations indignées : − C’est un peu tard pour les excuses mon capitaine, les mots sont comme les flèches, une fois décochés… ; et elle empoigna un crayon sur la table, en brisa la pointe contre sa poitrine, s’affala sur sa chaise en poussant un râle d’agonie.
− Et comment ça se fait que tu laboures seule ta rizière ?
− Ne vous inquiétez pas pour moi mon capitaine. Malgré la pénurie de mâles, et malgré ma beauté n’est-ce pas mon capitaine ?, ce ne sont pas les offres qui manquent. Je laboure ma rizière ? Ici, non seulement les femmes attellent leur buffle, elles mènent les hommes au combat, leur montrent comment prendre le tigre par les crocs. Je vous dis ça pour vous mon capitaine. Vous n’avez pas remarqué l’anneau au museau de nos buffles ? Vous voilà prévenu mon capitaine. Vous lorgnez une fille d’ici vous savez ce qui vous attend. Mais là, j’ai bien peur de n’avoir rien à craindre. Malheureux qui comme vous a croisé mon chemin. J’en ai envoyé plus d’un, et de pires que vous mon capitaine, au monastère. Vous pouvez compter sur moi mon capitaine, suis imbattable en la matière.
Au fil des mois, de mots en aiguilles, comme l’averse de mousson gonfle l’épi de paddy, comme la fleur du lotus née de la boue ne sent point la boue, l’amour naissait, grandissait, imprégnait d’une langueur onirique leurs gestes, leurs paroles, leurs regards. Il lui prêtait régulièrement livres et journaux de sa petite collection ou de la bibliothèque de la base. Elle dévorait tout. Elle lui apportait souvent à manger : salade de pousses de nénuphar aux gambas, salade de biceps de bananier à la méduse, poisson grillé au vélin de riz macéré de rosée, sanglier sauté aux champignons félins et aux cheveux de fée... Il dévorait tout.
Un jour elle lui apporta un émincé de chevreuil à l'anchois et une soupe de poulet aux feuilles de berge. Il ne pleuvait pas, ils mangeaient sur le balcon donnant sur le fleuve et les rizières au-delà. Comme une fleur du désert, le couchant sec éclatait avec vengeance, immense éventail de sang et d'or grimpant sur les gradins de strato-cumulus empourprés, embrasant l'irrégulier échiquier liquide des rizières, la bandoulière lourde du fleuve, les cimes hérissées des bosquets de bambou. Une traînée de grues s'élevait dans l'air, une file de buffles s'étirait sur une diguette, quelques barques glissaient en silence sur un miroir d'or.
− Tu n'as pas peur de venir travailler ici ? Les femmes de chambre se font régulièrement violer dans les bases.
Elle posa ses baguettes sur le rebord de son bol, fouilla dans son dos, tira un petit couteau de cuisine rouillé qu'elle posa sur la table. Elle se pencha en avant, yeux noirs dans yeux bleus, écrasa chaque syllabe entre ses mâchoires :
− Je n'attends que ça.
− Mais tu ne sortiras pas vivante d'ici !
Elle reprit ses baguettes en ricanant :
− Parce que tu penses que je compte sortir vivante d'ici ?
A la fin du repas elle pleura dans sa soupe.
Deux semaines plus tard le capitaine Joe Key et son amie Loriot-du-Saule se retrouvèrent de nouveau sur le balcon face au couchant, de nouveau devant un émincé de chevreuil à l'anchois et une soupe de poulet aux feuilles de berge.
− Ce sont nos deux mets favoris à mon frère et à moi. Je les mange au moins deux fois par an.
− Tu parles rarement de ton frère.
− Du vivant de nos parents, on allait à l'école ensemble. De quatre ans mon aîné, il me conduisait jusque dans ma salle, j'attendais un moment, puis je courais le rejoindre dans la sienne. Je me tenais accroupie sous son pupitre, m'accrochais à ses mollets, écoutais, somnolais, grignotais, pleurnichais, rigolais. Il levait fréquemment la main pour répondre à une question ou pour en poser une, j'étais fière de lui. Dans sa classe j'avais l'impression de tout comprendre : en sa présence je comprenais tout, ne craignais rien, même pas l'esprit du banian ou le démon du fleuve. Ses mollets maigrichons auxquels je m'adossais me semblaient les piliers mêmes du monde. A cause de son infirmité, on l'appelait Pirate, c'était mon pirate à moi. Il me protégerait des ogres, des fantômes, des méchants. Fin de classe, il me donnait un coup de pied aux fesses, je ramassais mes affaires par terre, rampais hors de mon trou.
Notre maître de première langue étrangère, M. Barrat pour son état et Barracuda pour nous, avait la barbe aussi rousse que le crâne chauve et une bedaine débordante de la chemise mal boutonnée, collée à la peau par la sueur dès l’heure du serpent, et ce malgré le ventilateur toujours en troisième vitesse au-dessus de sa tête. A Noël il mettait une belle chemise rouge et se scotchait du coton blanc en flocons sur la barbe, nous distribuait des bonbons, et pendant qu’il nous découpait une bûche au chocolat nous lui chantions :
mon beau Cuda
roi des gagas
que j’aime ta barbure
et tout le monde applaudissait. Une fois, en exercice de vocabulaire, il nous a demandé de citer un proverbe, dicton ou adage faisant référence à une partie du corps. Frère Pirate a levé la main : − La tête ne fait pas le moine m’sieur ; et on s’est tous mis à battre les pupitres de nos poings, certains à faire roues et jetés et entrechats au bord des tranchées, d’autres à grimper sur les échafauds de bambou ou à jouer au cheval d’arçons sur le rebord des fenêtres. M. Cuda, lui, s’est lancé dehors chercher le surgé et les pions, et sous la pluie torrentielle son crâne luisait et fumait comme une pierre d’enfer de cuisine. Accoudée à la fenêtre je le regardais fondre dans le déluge, tandis qu’étiré sur notre pupitre mon frère, dents serrées, me martelait l’arrière-train à coups d’orteils.
Après l'école on allait souvent au théâtre dans le petit temple à côté. Les ombres de personnages monstrueux dansaient sur les murs sombres aux bas-reliefs monstrueux, au battement sourd des tambours qui s’accélérait avec l'action, comme un cœur sur le point de rompre. Je ne comprenais rien au théâtre, je l'adorais, il me terrifiait. Je cherchais la main de mon frère dans le noir, la trouvais toujours qui m'apaisait. Quand les démons dansaient trop vite, quand les tambours et cymbales sonnaient trop fort, je me coulais à ses chevilles, fermais les yeux, me bouchais les oreilles contre ses mollets, et le calme revenait, je sentais de nouveau sa sueur se joindre à la mienne, réchauffer dans la coulée mes oreilles, mes joues, mes bras. Ces soirs-là nous rentrions tard, dans le noir. Un bon dâm de bruissements dans les buissons sombres, de cocotiers agitant leur noire chevelure de méduse sur fond de ciel à peine plus clair, de coassements de crapauds et de mille autres petits bruits venant du fleuve et des marais. Il tenait notre cartable d'une main, ma main de l'autre. Nous nous hâtions en silence, je n'osais hasarder un mot, de peur de réveiller quelque esprit somnolant alentour, je tremblais. De temps à autre il s'arrêtait, me prenait dans ses bras, me reniflait les joues, je fermais les yeux, ne songeais plus à trembler. Passé le dernier bosquet de bambous, il guettait le moment, lâchait d'un coup ma main, courait devant. Je m'affalais sur le chemin, hurlais de tous mes poumons à travers mes larmes. Il s'esclaffait, revenait sur ses pas, me portait dans ses bras jusqu'à la maison. Parfois, à mi-chemin alors qu’il revenait vers moi, il s'arrêtait de nouveau, tournait d’un quart de tour, feignait de reprendre sa course en tapant le sol du pied. Je guettais chaque tape de son pied pour me remettre à hurler, chaque fois de plus belle.
Un jour les yeux bleus, ceux dont la langue est aussi limpide qu'une eau de source, ceux dont le chant clair fait lever le soleil, sont venus brûler la maison, mitrailler la truie et les cochonnets, emmener nos parents embrochés l’un à l’autre par la paume des mains sur un fil de fer. Les voisines sont accourues nous plaquer le visage au sol. − Pas devant les mômes ! qu’il a crié l’officier. C’était trois mois avant Diên-Biên-Phu, j'avais huit ans.
Nos voisins nous ont recueillis, je gardais leurs canards avec Salangane ma sœur adoptive, et frère Pirate gardait les buffles du village avec des orphelins. On n'allait plus à l'école que sporadiquement. Personne n'a revu mes parents. Un soir notre mère adoptive, maman Nymphéa, nous a retenus après manger. Elle nous a dit que les yeux bleus étant rentrés chez eux voilà plus de cinq ans, et personne n'ayant eu des nouvelles de nos parents, il fallait peut-être penser à leur dresser un autel, au cas où leurs âmes erraient quelque part. C'était la veille du sixième anniversaire de leur disparition. Le lendemain mon frère est allé couper du rotin dans les bois, on a tressé un petit autel qu'on a posé contre le mur, au pied du grand bat-flanc de bambou. Maman Nymphéa nous a donné un petit encensoir en bronze, nous l'avons mis sur l'autel devant une vieille photo de nos parents dans son cadre de bambou. Comme nous ne nous souvenions pas de leurs plats préférés (les avions-nous jamais sus ?), j'ai préparé les nôtres pour la cérémonie, chevreuil et soupe de poulet. Quelques semaines plus tard mon frère est parti rejoindre nos deux frères adoptifs dans le brûlis. Il m'a reniflé les deux joues plusieurs fois à l'orée de la jungle, m'a promis de revenir me voir souvent. Avant de disparaître derrière les arbres, il est revenu de quelques pas, il a tourné d’un quart de tour, puis il a tapé le sol du pied. Je n'ai pas hurlé, mon pirate n'est pas revenu me porter dans ses bras. J'avais quatorze ans.
Le village perdait en lui plus qu'un bras fort. Gardien de buffles, sa flûte de bambou sonnait plus mélancolique que toutes, Salangane et moi la reconnaissions aisément de l'autre bout des champs. De deux ans ma cadette, ma sœur battait des mains : − Frère Pirate ramène du butin. Il nous ramenait toujours quelque chose le soir : un grillon dans une boîte d'allumettes, un brin d'herbe d'éléphant qu'il avait tressé en forme de sauterelle, un collier de douilles de cartouche, une seringue... Passé l'âge de garder les buffles, il entretenait les diguettes, le système d'irrigation et de drainage du village. C'est lui qui a proposé de construire le moulin sur le fleuve, qui est toujours en service. Il est allé en ville lire des livres d'hydraulique, il est revenu mesurer la vitesse du courant, il a choisi l'emplacement, fait les calculs, dessiné les plans... Quand il ne travaillait pas sur quelque projet ou dans les rizières, il tenait école. L'école la plus proche étant à un dâm, ses classes débordaient. L'assemblée du village lui a acheté un tableau noir, de la craie, des livres. Il tenait classe dans la baraque communale, la saison sèche il y avait du monde jusque dans la cour. Même les vieux, qui savaient déjà lire, venaient quand les leçons n'étaient pas trop élémentaires. Il leur lisait nos grandes œuvres littéraires, il racontait nos grandes batailles d’autrefois comme s'il y avait été. A la séparation de Mai et Lôc – les Juliette et Roméo de nos rivages − des vieilles se mouchaient, des jeunes rigolaient. Tout le monde l'aimait.
Il lisait tout le temps le soir, maman Nymphéa veillait à ce qu'il y eût toujours de l'huile dans sa petite lampe. Quand il ne lisait pas, il nous racontait des histoires, des histoires qu'il avait inventées, lues, entendues. Il nous disait : − Nos ennemis, ces bovidés. Ils croient pouvoir nous mater avec du fer et de l'idéologie − l'un vaut l'autre −, alors que c'est le conteur qui compte. Je ferai le brûlis un certain temps, pour l'expérience, puis j'irai en ville, je ferai toutes les bibliothèques, je commencerai par Homère, Shakespeare, Tolstoï, Kafka, Proust... Puis je porterai la guerre jusque dans leurs tours d'ivoire. Coucher l’artillerie sur le papier, truffer les lignes de Claymore, écorcher les pages avec un barbelé rouillé à l’excrément, braquer la plume sur le monde, leur fendre le cœur à travers cinq mille dâm d'océan. Sa voix faisait vaciller la lueur de la lampe. Puis il déroulait notre natte sur le grand bat-flanc de bambou − celui qu'il avait partagé avec nos deux frères la nuit, et sur lequel nous mangions, recevions ou lisions le jour −, nous couvrait ma sœur et moi avec un pan de toile de parachute, mettait en place notre moustiquaire, nous reniflait chacune sur les deux joues. Puis il déroulait sa vieille natte rafistolée par terre, s'enroulait de toile de parachute, éteignait la lampe, et se remettait à conter, jusqu'à ce que nous ronflions.
Tout petits, avant la période de l'école en ville, on se battait pourtant souvent. C'est-à-dire qu'il me battait souvent. Il me battait pour un oui, pour un non. Il me piquait mes grillons, mes geckos, mes crapauds, mes douilles de cartouche, mes élastiques, mes billes, mes éclats d'obus, je protestais, il me frappait. Je cachais mes trésors dans la maison ou le jardin, à cause du brigandage de grand chemin et pour le plaisir simple de les redécouvrir à un tournant, comme de vieux amis. Parfois je retrouvais ainsi grouillante de fourmis une vieille connaissance, qui n’avait su survivre à mon oubli.
Nous choyions particulièrement les mabouillas-chaux, ces petits geckos à robe unie, laiteuse, aux grands yeux noirs exorbités, qu'il fallait aller chercher sur les murs de chaux en ville. On les épinglait au sol par les pattes, on perforait leur peau translucide avec une seringue contenant un peu d'encre rouge, noire ou bleue. Puis on récidivait ailleurs. On variait les motifs, on fabriquait des geckos à cercles ou à arabesques, des geckos volcans ou des geckos étoiles, des geckos bagnards ou des geckos paras, puis on les relâchait, les regardait zigzaguer et tituber, ivres d'encre, se cogner la tête contre un pied de bat-flanc, tenter d'escalader les murs de latanier, puis crever, le ventre toujours incolore en l'air. Ils ne survivaient jamais à leur nouvelle robe iridescente, splendide peau neuve. On les ramassait par l'extrémité de la queue entre les bouts de deux doigts, les jetait aux poules. Il m'arrivait rarement d'en posséder un, la ville étant encore trop éloignée pour mes courtes jambes. Chacun me coûtait une demi-douzaine de grillons, avec leurs boîtes d'allumettes. Un jour j'en ai épinglé un au sol, m'apprêtais à le tatouer, frère Pirate est entré, s'est emparé du gecko, je lui ai planté la seringue dans l'œil. J'avais cinq ans.
Le vieux fripier ambulant et sa petite-fille sont venus le neuvième jour du têt suivant. Ils sillonnaient la province dans leur sampan achalandé. A leur bord on trouvait de tout : chapeaux de latanier et sandales de pneu, toile de parachute et douilles d'obus, cahiers, encre et peignes, savon et thé des hauts plateaux, boas et durions... J'ai échangé mon argent de têt contre une douille d'obus, que j'ai calée contre le pied du saule au fond de notre verger, ce même saule qui plus tard ombragerait sa roue hydraulique. J'ai rempli la douille de riz cru, j'ai placé devant le couvercle d'une canette Guigoz, mis dessus une banane, allumé un bâton d'encens. J'ai prié les yeux fermés, planté l'encens dans le riz. J'ai prié l'esprit du saule de lui faire repousser son œil, comme il a fait repousser les queues des geckos. Aujourd'hui encore je change toujours la banane à quelques jours d'intervalle, à cause des vers, des oiseaux, des singes.
Je n'ai plus jamais touché à un gecko, à un grillon, à un crapaud. Je laissais à Salangane tous les grillons que notre frère nous ramenait, en fait je lui laissais tout ce qu'il nous donnait. J'emmenais souvent Salangane prier le saule, pour mes parents, pour son père, pour l'œil de Pirate. Elle m'a dit qu'elle avait prié le tourbillon − il y a un tourbillon dans le fleuve derrière son verger, juste en amont du nôtre − on se mettait donc à prier saule et tourbillon. Elle me disait que si nous priions assez longtemps, peut-être que leur esprit nous rendrait visite en songe et nous apprendrait le nouveau plat à cuisiner pour ramener nos parents et l'œil de Pirate, comme jadis l'esprit des eaux avait montré au jeune pauvre comment envelopper l'homme de terre et ciel dans le gâteau de riz gluant. Tout ce qui me visitait en songe, c'était un gouffre sans fond, bordé de cils, griffé de sang, dans lequel je tombais, tombais...
Je pleurais souvent assise sur mes talons à l'ombre du grand saule, face au fleuve. Mon frère m'y a surprise un jour, il est venu me soulever dans ses bras, je l'ai serré dans les miens, j'ai appuyé mon œil humide contre le tissu noir recouvrant son orbite vide. Il a dégagé la tête en arrière, ramené mon visage contre son cou, caressé longuement mes cheveux. Il m'a dit : − Tu ne vas peut-être pas comprendre ce que je vais te dire, mais je t'assure que c'est vrai. On voit mieux avec un œil qu'avec deux. Tu m'as ouvert les yeux en me fermant l'œil. J'ai secoué ma tête contre son cou, éclaté en sanglots.
Plus tard, quand un garçon du village commençait à me parler noix d'arec et bétel, je lui disais les yeux dans les yeux : − Tu m'aimes, vraiment ? Prouve-le moi, crève-toi un œil.
Ils sont revenus la veille de têt, à l'heure du singe. Salangane et moi étions en train de désherber dans le potager et maman Nymphéa, assise sur ses talons dans le coin cuisine qui donnait sur le potager, découpait une grande feuille de bananier pour emballer, avant de mettre à cuire, du gâteau de riz gluant. J'ai vu la main de Salangane s'arrêter sur une touffe d'herbe, je l'ai entendue crier, elle avait déjà sauté à travers les plants de tomate, je me suis retournée. Pirate fermait la marche, un gros chevreuil sur les épaules, Salangane était déjà dans les bras de Benji, Aîné courait vers la cuisine où maman Nymphéa, qui avait trébuché sur un escabeau, puis glissé sur la feuille de bananier, était encore à quatre pattes par terre à rire et à pleurer. A peine Pirate eut-il posé le chevreuil par terre que j'ai failli le renverser en arrière. Le reste de l'après-midi, maman Nymphéa courait par-ci par-là, comme une poule sur le point de pondre, nous caquetant d'une voix incohérente des ordres contradictoires. Au pied du mangoustanier les trois frères, coupe-coupe au poing, se disputaient sur la manière d’équarrir le chevreuil, sur quels morceaux donner à quels voisins. De vieux amis allaient et venaient, qui avec un panier de pommes de rose jaspées, qui avec un jaque suant la sève à travers un vieux journal. Du chaos a émergé l'ordre : émincé de chevreuil pierre d'enfer, enroulé de chevreuil graisse pêcheur, fondue de chevreuil fée-sur-feu, et, en dessert, gélatine d’algue napée de lait de coco. Le tout copieusement arrosé d'alcool de riz aromatisé. Sur le grand bat-flanc, sous le rameau d’ochna savamment élagué pour fleurir le jour de l’an, nous mangions, buvions, causions, riions. Personne ne parlait de la guerre, sauf une brève mention de la part de Benji : Pirate est devenu le premier fusil de l'unité. Il a conclu : − Qui voit bien vise bien. Après le dîner on joua aux poètes. J'étais avec Pirate, Salangane avec Benji, maman Nymphéa avec Aîné. On énonçait un mot, à tour de rôle chaque équipe déclamait une paire de vers contenant le mot, les premiers à sécher étaient perdants ; le perdant avait pour gage de trotter deux fois autour de la maison portant la gagnante sur son dos.
Salangane-Benji : Lune,
qui veut acheter de la lune ? J'en vends
elle est là couchée sur mon tapis d'herbe sauvage. Moi-Pirate :
ici l'image de lune s'estompe dans brume et fumée
qui demande à qui : ton amour est-il vrai ?
Maman Nymphéa-Aîné :
à qui la barque arrimée au ponton de lune ?
peux-tu ramener la lune à temps ce soir ?
A l'heure de la souris, nous trottinions, titubions, riions encore autour de la maison. Au loin un barrage d'artillerie a éclaté dont l'haleine profonde rythmait le crépitement erratique des pétards alentour. Suspendues à leurs chevelures de fumée, deux lunes-parachutes, deux bombes éclairantes douchaient un pan de ciel d'une clarté électrique, dont le clignotement frénétique s'estompait à travers une épaisse vapeur d'alcool de riz. Je n'arrivais pas à dormir, tous ronflaient de bonheur. Dans le trapèze intermittent de lune électrique au sol, que fissuraient des brins d’ochna fleurissant, deux grillons s'aimaient en silence, frêle armure noire sur frêle armure noire. Une main s'est tendue vers moi à travers l'eau, doigts écartés laissant filtrer un soleil noir, j'ai tenté de l'atteindre à travers mille bulles d'air, mille yeux de verre peint, mille billes oculaires qui m'écrasaient, m'étouffaient, m'étranglaient. Je me suis réveillée encore suffoquant dans les bras de Salangane. J'ai attendu qu'elle se fût rendormie pour me lever, j'ai gagné sur la pointe des pieds la salle de bain adjacente au coin cuisine. Il y faisait encore sombre, le jour naissait dans la grande jarre d'eau, dont une moitié était hors mur pour recueillir la pluie. Sur ma peau hérissée par le choc de l'eau froide j'ai versé l'aube glacée d'une demi-noix de coco. J'ai senti la fumée dans la cuisine, j'y ai trouvé Pirate en sortant. Assis sur un escabeau face au potager, il tenait un filtre à café qu'il laissait égoutter sur des cigarettes alignées sur un tranchoir. Je me suis agenouillée derrière lui, j'ai serré son torse dans mes bras, couché ma joue sur son épaule. Je tremblais encore, son dos musclé me réchauffait, j'ai retrouvé mon pilier du monde. Une brise est entrée par le potager, j'ai frémi.
− Tu n'as pas quelque chose à me dire ? Tu es parti si longtemps.
− Tu as parlé à frère Benji ?
− Non, mais ça se voit, tu sais. C'est vrai alors ?
− Oui.
− Elle t'aime ?
− Oui. Je repartirai avec l'arec et le bétel. On ne peut pas partir tout de suite, je m'occupe de la canalisation des fumées de cuisine des bases de la région, et d'autres choses encore, mais j'aurai bientôt fini, ce sera dans l'année, sûrement pour têt prochain. Son village est à une heure de barque en amont, dans le bras de la Belle-Fée. Vingt-deux radieuses rafales, récupère les bombes dormantes, fabrique des mines, participe aux embuscades. Débrouillarde, futée. Tu l'adoreras.
− Tu l'as embrassée ?
− Comment?
− Est-ce que tu l'as embrassée, t'es sourd ou quoi ?
− Non, juste borgne. Bien sûr que je l'ai embrassée.
− Comme les yeux bleus ?
− Comme les yeux bleus.
− C'était comment ?
− Bien.
− Bien comment ?
− Bien comment comment, mais tu es bien curieuse toi, tu n'as qu'à attendre ton tour.
− C'est mieux que de renifler la joue ?
− Rien à voir... Génial d’une autre façon.
− Je le ferai jamais moi, c'est dégoûtant.
− On verra bien. De toute façon, tu ne risqueras pas d'en avoir l'occasion, vu ce que tu dis aux garçons. Tu es connue même dans le brûlis, tu sais. Au début, presque chaque semaine il y avait une noix d'arec déposée sur mon ballot, initiales et date gravées dessus. Maintenant, c'est frère Benji qui collecte tout.
− Qu'est-ce que j'en ai à cirer ?
− Tu veux devenir nonne ou quoi ? Nous brûlisards, dont faucher les hommes en rasant les murs est le métier, tomberons comme les pluies du dixième mois, comme mon épiderme eczémateux. Pas beaucoup d'entre nous verront la victoire, tu sais.
− Je veux rester avec toi et Dulcinée.
− C'est ma responsabilité de te marier.
− C'est ta responsabilité de ne rien faire alors. Presser pour l'huile, presser pour la graisse, qui a le cœur de presser pour le mariage. Me marie pas me marie pas, rien à faire.
Je me suis relevée, suis sortie par le jardin potager, me suis dirigée vers le fleuve. Sa roue hydraulique bruissait, bavait. Un rayon de soleil hâtif peignait de rouge la douille de bronze. La banane était intacte, fraîche, je l'avais remplacée la veille dans la matinée. Les pétards commençaient à crépiter dru, longues rafales régulièrement ponctuées par une grande détonation. C'était le nouvel an.
Les trois frères sont restés une semaine, sont repartis par le chemin jonché des cadavres rouges et blancs des pétards, roses et mauves des fleurs de bougainvillier. J'avais emballé l'arec et le bétel pour Pirate la veille.
Six mois plus tard, Trois-Bières, le meilleur ami de Pirate, est revenu du brûlis passer une semaine au village. Une longue lettre des trois frères et de Dulcinée. Tous étaient sains et saufs, mais la guerre s'intensifiait, de nouveaux yeux bleus étaient venus remplacer le blanchiment culturel par l'épuration idéologique, blanchir l’authentique avec le vrai. Trois-Bières et sa mère, tante Auvent, nos voisins d’amont, sont venus déjeuner chez nous le lendemain. Dans l'après-midi, maman Nymphéa et Salangane sont allées bêcher dans le potager, tante Auvent dans le sien. Sur le grand bat-flanc Trois-Bières et moi avons pris le thé.
− Entre nous, comment elle est, Dulcinée ?
− Facile à aimer. Intelligente, douce, jolie, espiègle. Elle te ressemble. Pour l'espièglerie.
− Merci, frère Pirate me l'a dit. Elle l'aime vraiment ?
− Elle l'adore.
− C'est qui le plus fort, c'est qui qui va commander ?
− Difficile à dire. Elle l'admire, mais elle a une tête bien à elle.
− Pas douce alors.
− Le plus doux des métaux est aussi le plus brillant. Pirate me l'a appris : il faut apprécier le fer à sa juste valeur. C'est l'eau, au le niveau le plus bas, qui finit par dominer. Ceux qui commandent aux hommes le savent. Le bambou, roseau enfant d'eau, résiste mieux aux chocs que le fer. C'est un matériau composite, dont la symbiose, singée dans les aéronefs canins, est reflétée dans celle de la rizière et du brûlis. Là réside la mécanique de notre victoire, non son âme. L'âme fait que dans la guerre comme dans l'amour, la victoire, qui exige l'offrande suprême, est inéluctable. Il n'est pas de victoire évitable. Il n'y a pas que le général à être figure de proue, le politique l'est tout autant.
− La politique est scatophile, son haleine cadavéreuse, ses pets contondants. Mais toi, tu veux commander ou obéir ?
− Je ne demande qu'à être commandé. Seulement, faut encore en être capable.
− Ha, vraiment ! Aucune de ces jolies brûlisardes ne serait à la hauteur ?
− J'ai bien peur que non, malheureusement. Je désespère. Mais peut-être qu'il y a espoir ailleurs ?
− Le loriot ne s'est pas aventuré dans la saulaie, comment espérer entendre le chant du moineau ?
− Mais l’ochna a su affronter le vent, et le pêcher a fleuri frais, si frais.
Je lui ai reversé du thé.
Cinq mois plus tard, pleine lune avant têt, le détachement est tombé dans une embuscade. Deux morts : Aîné et Trois-Bières, trois blessés, dont Dulcinée, deux prisonniers : Pirate et Benji. Ils les ont torturés pendant deux semaines, puis ils les ont mis dans un hélicoptère. Ils ont dit à Pirate de sauter. − Tu sautes pas, je te crève ton œil et te botte le cul dehors. Le yeux bleus a dégainé son poignard, sourire aux lèvres. Mon frère a clopiné jusqu'au bord, il a ravalé sa salive, il a sauté. Benji a réussi à s'échapper le lendemain, il nous a montré où chercher. Nous fûmes une trentaine à battre la jungle pendant quatre semaines avant de le retrouver. J'ai refermé ses phalanges blanches sur celles de sa flûte, j'ai enroulé mon pirate dans sa vieille natte rafistolée − celle qu’il déroule au sol dormir à mes pieds −, je l'ai mis en terre. A côté d'Aîné, à l'ombre du vieux saule, face à sa roue hydraulique. Par-delà les cimes des bambous il m'a encore lâché la main, il n'a pas pu taper le sol du pied, il ne reviendra plus me chercher. J’avais seize ans.
Loriot-du-Saule versa le riz, puis l'eau, dans la casserole en fer-blanc, y trempa l'index pour doser le niveau de l'eau, mit à cuire sur la plaque électrique. Studieux, le capitaine Joe Key la regarda faire avec attention.
− On dit qu'il y a autant de manières de cuire le riz qu'il y a d'hommes ou de façons de tenir une paire de baguettes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une manière de ne pas le cuire, la tienne. Il y a riz, il y a spaghetti, et ce n'est pas la même chose. Dans un grain de riz cuit comme il faut, le degré de cuisson et la teneur en eau sont uniformes. Un tel grain ne pleure pas de la surface, ni ne reste dur dans le cœur. Il est partout généreux, cède nulle part, préserve, résiste et donne. Un riz bien cuit est comme le sable en tête de plage, le minimum de tension superficielle qui favorise la communion dans l'aération, évite à la fois la coagulation de vieux époux qui se détestent et la noyade universelle des bouillons de masse. Cuire le riz comme vous le faites est une insulte à l'homme.
Elle éteignit la plaque quand le couvercle se mit à tinter en bavant sur le bord, puis alluma une spirale d’encens au vétiver.
− Récapitulons. On nous a accusés de piaillerie. Une langue à tons se chante, et se piaille si elle privilégie les consonnes sonores et les voyelles brèves. Une langue à tons, c’est quand, pour parler radio − analogie accessible à des gens de ton niveau −, on module aussi bien la fréquence que l’amplitude. La tienne de langue est atonale, caresse ses consonnes feutrées et pomponne ses voyelles longues, souvent diphtonguées, voire triphtonguées. Dans la modulation d’amplitude une marge existe qui est nécessairement étroite, et au-delà de laquelle on risque l’incompréhension. La bande passante fréquentielle, elle, couvre en entier le spectre acoustique qui est son domaine. C’est que l’oreille s’accorde, repère d’instinct, dès les premières syllabes de l’inconnu, la fréquence de base, plus exactement, les subtiles combinaisons musicales qui définissent − mais alors avec quelle complexité pour l’analyse, et quelle rédemption pour l’intelligence ! − ce que nous avons appelé, pour simplifier, le ton neutre. Forcément individuel comme chacun des cinq autres, le ton neutre se situe à peu près au milieu du registre de chaque voix. Même chez le même individu il n’est pas fixe, se déplace selon l’humeur de l’orateur (est-il en colère ?, il élève la voix), l’identité de son interlocuteur (un amant, un enfant, un ennemi...), l’effet voulu ou le sentiment insoupçonné, et j’en passe. Au centre de cet océan de contraintes nées de ses interactions avec son milieu, l’individu possède et garde, sans s’en rendre compte, ses gammes, sa voix, comme ses yeux ou son nez. C’est évidemment vrai partout, mais ici c’est aigu : la musique porte le sens, véhicule le discours. Musique est verbe.
Lotiot coupa la lime en deux, l’arome du fruit se répandit dans la chambre. Avec les doigts elle pressa les deux moitiés, l’une après l’autre, au-dessus du monticule de sucre en poudre au fond du bol. Fondant et verdissant dans le jus le sucre se tassa. La chef dosa au jugé :
− Une part de sucre, une de lime, c’est mon nuoc mam favori. C’est comme avec les tons, chacun son goût. De même que les enfants préfèrent leur nuoc mam sans piment, les vieilles gens salé épicé, les Sudistes doux, les Nordistes fadasse, de même le timbre est plus grave chez le mâle que chez la femelle, chez l’adulte que chez l’enfant, à Huê qu’au nord ou même qu’ici, dans la mélancolie que dans l’hystérie. Là sont généralités physiologiques et culturelles. L’individu, lui, dit toujours le dernier ton. Mais reprenons notre exemple de tout à l’heure. Hai, neutre, veut dire... ?
Joe Key leva la main :
− Moi madame, moi madame ! Deux !
− Bravo, chéri. Deux, comme Aîné est frère deux dans la famille. Frère un, je suppose, étant le père. Hài, un ton plus bas... ?
− Comique. Ou alors une sorte de chaussure, en toile.
− Ah, tant qu’on y est, sur le chapitre de frère et sœur, t’es anh mon grand frère, et moi je suis…
Il leva de nouveau la main :
− Em, ma petite sœur. Car chez vous, tous sont famille. A cela les racines mythologiques sont profondes. Je ne connais genèse plus mer…
Elle lui sauta au cou :
− Mon amour, comme t’es fort ! Qui t’a appris toutes ces balivernes ? Mmm... on n’a pas... fini... la... glouglou...
− Te laissé-je à ce point indifférent, pourquoi ne m'embrasses-tu jamais spontanément ? Pourquoi te raconté-je tout ça, bébé-amour, à toi qui ne m'aimes pas, à toi qu'une blonde dulcinée attend à l'horizon, comment te retenir, faut-il te retenir ? Pourquoi voudrais-tu de moi, de ma peau calcinée par le soleil, de mes doigts mangés par la terre ? La sienne doit être de nacre, les siens d'ivoire. Ses cheveux sont-ils d'or, ses lèvres de rubis, ses prunelles de jade ? Qui troquerait le jade contre du charbon ? Caresses-tu encore sa peau sur la mienne, te manque-t-elle encore dans mes bras, cherches-tu encore ses lèvres buvant les miennes ? Ah ! je comprends, tu as peur que je te passe un anneau dans le museau, c'est ça ? Mais non, ami-bonheur, c'est pour les buffles ça, tu confonds tout. C'est ma cuisine alors ? T'aimes pas mon chevreuil, avoue-le. Tu veux que je te fasse un hamburger, un chien chaud peut-être ? On s'y connaît en chien chaud ici, tu sais ? Je sais ! C'est l'esprit du marigot qui t'a atteint, comment peut-on résister avec une peau pareille, faut te mettre plus souvent nu au soleil. A moins que... mais oui, faut peut-être que je te tatoue comme un gecko tiens, tu préfères cercle ou losange, on a de l'encre et une seringue ?
− Entendons-nous bien, capitaine, je tue dans la haine. Même sans mes frères Pirate et Aîné, sans mes parents, sans les enfants du village, dont la moitié sont orphelins, et l'autre mutilés, quand ils sont encore en vie, je continuerais à me les descendre, tes compatriotes. Et le jour où tu te trouveras dans ma ligne de mire, mon amour, je n'hésiterai pas une seconde. Hésiter, dans notre métier, est fatal un jour ou l'autre, on ne sait jamais lequel. Il me faut survivre, pour tuer ma quote-part. Une simple question d'arithmétique. Porter au maximum la douleur, que les fils de chienne s'en souviennent. Par la même arithmétique, te rejoindre ne sera qu'une simple question de temps. C'est ma consolation, elle me donnera la force pour appuyer sur la gâchette le moment venu. Tu t'imagines que je vais te laisser dans les bras de ta blonde amour ?
− T'inquiète mon capitaine, ces rizières seront votre tombeau. Hachis de champion sauté, c'est la spécialité locale.
− Et si c'est mon capitaine qui saute ma spécialité locale ?
Il ferma les yeux pour prendre le crayon qu’elle lui jeta au visage, et ouvrit les bras pour la prendre dans son giron.
− Je ferai tout pour toi mon amour, sauf ne pas t’occire.
La veille du départ de son amant, Loriot-du-Saule est venue dans l'après-midi. Plus tard elle s'est levée, est allée fouiller dans le panier d'osier posé sur la chaise, ce panier rapiécé dans lequel elle apportait victuailles et ramenait livres et journaux. Sa sveltesse satinée s'est découpée net dans l'embrasure de la fenêtre, le couchant est venu dorer son dos courbé sur la chaise : mince croissant d'une lune éphémère balancée par ses mouvements. Elle est revenue le tirer maugréant du lit, elle leur a noué chacun un long foulard de toile de parachute autour du cou.
− Bleu comme tes yeux. Léger, flottant comme l'amour. Notre paire de loriots bleus. C'est pour quand tu reviendras, si jamais tu reviens pour moi. Ils danseront avec nous notre danse d'union, notre danse d'amour, notre danse de vie.
Joe Key a mis Le beau Danube bleu, lui a appris à danser. L'air embaumait de cestreau nocturne, dont les pétales blancs sur le balcon semblaient retenir les derniers reflets du crépuscule pour une dernière soirée d'amour. Longtemps dans la pénombre le couchant a voleté, tournoyé, palpité sur de longues ailes bleu violacé.
Leur dernière nuit ensemble Loriot-du-Saule a parlé dans les bras de son capitaine jusqu’à l’aube.