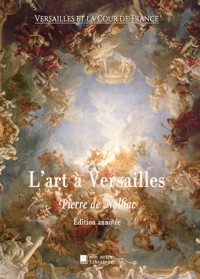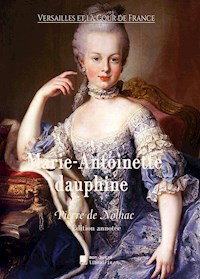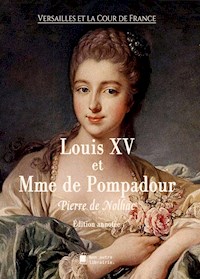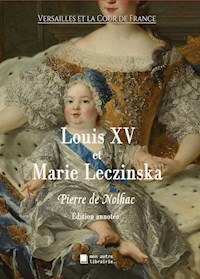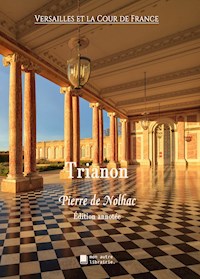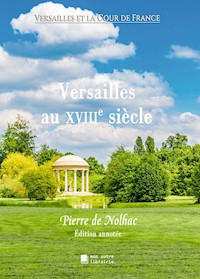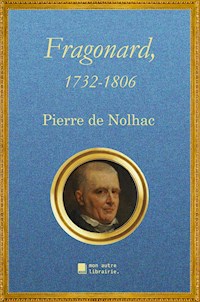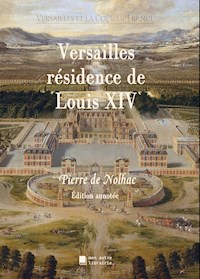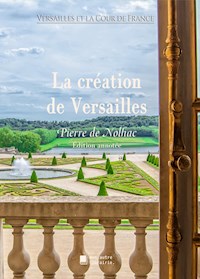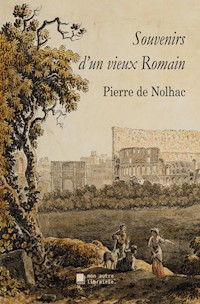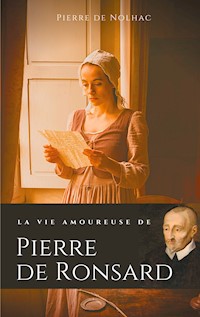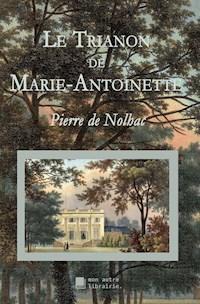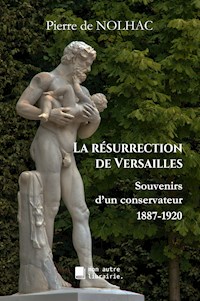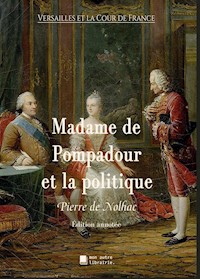
5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Mon Autre Librairie
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Outre des dépenses extravagantes, on reproche aussi à Mme de Pompadour le rôle funeste qu'elle aurait joué auprès de Louis XV dans la conduite des affaires politiques de la France. Il est certain que sa proximité avec le souverain lui laissait le loisir de faire appliquer des idées qui auraient pu servir en premier lieu les intérêts des nombreux amis qu'elle favorisait ouvertement. L'auteur nous montre ici que les illusions étaient partagées par tous les partis. (Édition annoté)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Madame de Pompadour
et la politique
Pierre de Nolhac
Édition annotée
Fait par Mon Autre Librairie
À partir de l’édition Louis Conard, Paris, 1930.
Les notes entre crochets ont été ajoutées pour la présente édition.
Couverture : Louis XV et Mme de Pompadour recevant Voltaire. Anonyme. Début XIXe siècle.
https://monautrelibrairie.com
__________
© 2023, Mon Autre Librairie
ISBN : 978-2-38371-070-7
Versailles et la Cour de France
par
Pierre de Nolhac
La création de Versailles
Versailles résidence de Louis XIV
Versailles au xviiie siècle
Trianon
Louis XV et Marie Leczinska
Louis XV et Madame de Pompadour
Marie-Antoinette dauphine
La reine Marie-Antoinette
Madame de Pompadour et la politique
L’art à Versailles
Table des matières
I. – L’initiation
II. – Les affaires d’Église
III. – La conversion de la marquise
IV. – Le renversement des alliances
V. – L’année de Damiens
VI. – Les armées du roi
VII. – La disgrâce de Bernis
VIII. – Le ministère de Choiseul
IX. – La fin
Sources
Appendice
I. – L’initiation
La Cour est en séjour à Fontainebleau dans l’automne de 1752. Un soir, chez le ministre de la Guerre, quatre personnes sont réunies : le comte d’Argenson,1 la comtesse d’Estrades,2 le docteur Quesnay,3 médecin de Mme de Pompadour, et le secrétaire qui raconta la scène. Le ministre et sa maîtresse attendent, avec une impatience qu’ils ne cachent point, l’issue d’une entrevue secrète qui a lieu à cette heure chez le Roi. C’est le dénouement d’une intrigue préparée de longue main pour le renvoi de la trop puissante marquise.
Depuis plus d’un an les deux complices, qui la haïssent également, savent que Louis XV se détache d’elle. Une jeune comtesse de Choiseul-Beaupré,4 décidée à la supplanter, manœuvre sur les conseils de gens avisés, qui comptent bien triompher avec elle, aujourd’hui même. L’incertitude va prendre fin. La porte s’ouvre, la comtesse paraît, le visage animé, les cheveux en désordre, et se jette dans les bras de Mme d’Estrades : « C’en est fait, dit-elle, je suis aimée, elle va être renvoyée ; il m’en a donné sa parole... »
Une joie bruyante remplit le salon ; Quesnay, assis dans un coin, demeure silencieux. « Monsieur, lui dit le ministre, rien ne change pour vous, et nous espérons bien que vous nous resterez. – Mais, monsieur ! répond le médecin en se levant, j’ai été attaché à Mme de Pompadour dans sa prospérité, je le serai dans sa disgrâce. » On laisse partir le philosophe : « Je le connais, assure Mme d’Estrades, il n’est pas homme à nous trahir. » Et les conspirateurs s’attardent sur les magnifiques événements que ce jour mémorable va déchaîner. De cette aventure, en effet, vont sortir des conséquences politiques, mais nullement celles qu’ils ont prévues.
Cette anecdote brutale est nécessaire pour donner le ton du monde de Cour qu’on veut peindre dans ces pages. On regrette d’y voir mêlé un ministre, par ailleurs honnête homme et qui a su servir la France. Mais les femmes surtout y sont cyniques ; elles montrent, en un temps où la morale religieuse semble se dissoudre, avec quelle âpreté se déchaînent chez elles les appétits du plaisir et du pouvoir. La jeune, qui n’a pas vingt ans, installe déjà sa vie d’épouse dans un adultère avantageux ; la corruptrice, dédaignée autrefois du caprice royal, travaille à le réveiller au profit d’une autre, avide de trahir à la fois dans Mme de Pompadour une parente, une bienfaitrice et une amie.
Ces dames ne sont rien à la Cour que par celle qu’elles veulent perdre. La comtesse d’Estrades, née Sémonville, est veuve d’un cousin de la favorite, qui l’a amenée à Versailles, introduite dans le cercle du Roi, aux soupers, aux chasses, aux voyages. Point belle de visage, le nez relevé entre deux joues rebondies, elle tire sa séduction d’un esprit endiablé mis au service d’une féroce ambition. Au reste, elle a de la lecture, de l’amabilité, et, dans les Cabinets où la naissance ne confère point de prérogatives, elle amuse le Roi plus que ne le font les duchesses. Si elle a accepté les hommages de M. d’Argenson, ce n’est pas seulement pour y gagner quelque influence dans la distribution des « grâces » et le moyen d’avoir des partisans ; c’est qu’elle voit en lui l’homme qui peut la faire passer du second rang au premier, et lui procurer ainsi les perverses joies de l’ingratitude. Mme de Pompadour commence bien à s’apercevoir « qu’elle nourrit un serpent dans son sein », mais les preuves manquent contre cette compagne inséparable, qui ne la quitte pas davantage que ses deux jolis « petits chats », Mmes d’Amblimont5 et d’Esparbès6 ; toutes sont nécessaires à ses habitudes, à celles du Roi, à la gaieté et au bon ton des petits soupers.
La marquise et la comtesse ont patronné Mme de Choiseul-Beaupré, mais c’est la première qui a fait son mariage. Intéressée par cette petite Romanet, qui lui tient aussi par les le Normant, elle a découvert, grâce à l’obligeance du duc de Gontaut, une alliance permettant de la présenter à la Cour. Elle a célébré la noce à Bellevue et obtenu du Roi, pour le mari, la place de menin ordinaire du Dauphin, pour la femme un douaire servi par avance comme pension, et chez Mesdames, le surnumérariat de dame pour accompagner. Elle l’a prise enfin dans son intimité, qui est celle du Roi ; mais la protégée abuse de tant de faveurs. Ses manières libres, son aisance effrontée ne tardent pas à inquiéter la marquise, et davantage les façons du Roi. Quoiqu’ils semblent en rester au badinage, l’ancienne châtelaine d’Étioles reconnaît sous ses yeux tous les manèges de la coquetterie et cet art de conquête qui fut le sien.
Il est, parmi les Choiseul, un homme que le mariage arrangé par la favorite n’a point flatté et à qui cette nouvelle cousine a déplu dès le premier jour. C’est le comte de Stainville, qui passe pour avoir infiniment d’esprit, mais chez qui rien ne fait prévoir la grande carrière du futur ministre de Louis XV. Il vient très rarement à la Cour, ses plaisirs étant à Paris et ses ambitions dans le militaire. Le Roi l’ignore, et Mme de Pompadour lui fait l’honneur de le détester. Il a épousé une fille de finance, Louise Crozat du Châtel, fine, spirituelle et maladive, qui l’entoure de tendresse, d’admiration et de conjugale indulgence. M. de Stainville n’a point caché à son beau-frère Gontaut qu’il blâme l’union conclue par ses soins, et s’étonne qu’on ait introduit dans la société du Roi le cousin Beaupré, lourd, grossier de tournure, et voué, suivant les usages, aux disgrâces des maris dupés ou complaisants. M. de Stainville n’a pas imaginé cependant que le monarque serait l’agresseur de cette vertu mal défendue, et rien ne lui répugnerait davantage que de voir une femme de son nom dans un tel scandale, avec les profits déshonorants qu’il comporterait pour les siens.
Il apprend seulement à Fontainebleau, où la Cour fait son voyage d’automne, que les assiduités de Louis XV compromettent Mme de Choiseul-Beaupré, et c’est le mari lui-même qui s’en déclare courroucé. Stainville l’engage à éloigner sa femme pour faire taire les médisants et supprimer, si elle existe, la tentation. Ce bon conseil ne fait point l’affaire de Mme d’Estrades, qui loge le ménage chez elle et tient d’autant plus à le retenir qu’on semble toucher au but désiré. Mécontent d’une situation équivoque, Stainville va voir sa cousine, reçoit ses aveux et la trouve fort disposée à la chute : « Elle me fit, raconte-t-il, confidence de l’amour du Roi pour elle, de l’envie qu’elle avait d’y correspondre, mais de la condition qu’elle y mettait, qui était le renvoi de Mme de Pompadour pour occuper sa place avec le même crédit. Elle continua, avec une volubilité et une étourderie inconcevables, à me dire qu’elle avait déclaré au Roi cette condition, que je l’approuverais d’autant plus volontiers que j’étais le seul du nom qu’elle portait qui fût susceptible de profiter de tous les avantages de sa faveur, qu’elle espérait que je me lierais à elle par l’amitié la plus intime et que je trouverais le moyen, de concert avec M. d’Argenson, de la débarrasser de son mari. »
Pour appuyer ses dires, la jeune folle montre à Stainville les lettres du Roi, à la vérité fort pressantes et qui promettent d’éloigner, s’il le faut, la marquise de la Cour. Devant ces preuves, Stainville éclate : « Le tableau de l’honneur d’une femme de mon nom dans cette place se présenta à moi ; je ne balançai pas à dire à Mme de Choiseul que puisqu’elle m’avait confié ses secrets, j’étais obligé de lui déclarer qu’il fallait qu’elle engageât son mari à la conduire à Paris du moment où je lui parlais à quatre jours, sans quoi je dirais à ce même mari tout ce qu’elle m’avait dit et tout ce que j’avais lu. » Laissant en colère l’ambitieuse, le comte court chez Mme d’Estrades, qui nie sa participation à l’intrigue ; il obtient qu’elle consente au départ, et, s’étant ainsi tranquillisé, croit n’avoir plus à s’occuper de cette pénible affaire. C’est à ce moment sans doute que les meneurs ont brusqué les choses et que Mme de Choiseul a cédé au Roi, croyant assurer son triomphe. Stainville l’ignore ou veut l’ignorer, mais son récit insiste sur le point où il sent nécessaire de se justifier d’une accusation fâcheuse :
Je fus par hasard chez mon beau-frère, le duc de Gontaut. Je le trouvai avec le président Ogier, s’entretenant des bruits qui couraient sur Mme de Choiseul et se reprochant d’avoir contribué à un mariage qui semait la mort dans le cœur de Mme de Pompadour. Je m’étais assis près du feu, pendant qu’il se promenait en faisant toutes ses exclamations, qui me faisaient bien rire. Il me reprocha que je me divertissais du malheur d’autrui. Je lui fis la réflexion que, comme Mme de Pompadour se piquait de ne me point aimer, il était assez simple que je ne l’aimasse point et que je m’intéressasse on ne peut moins à sa situation. M. de Gontaut recommença tous les sujets de plainte qu’il avait personnellement contre M. et Mme de Choiseul, les inquiétudes fondées de Mme de Pompadour, l’embarras où elle se trouvait et le chagrin qu’il avait de la voir dans cette situation. Je ne me mêlai point du tout de la conversation et, comme il était temps d’aller dîner, je me levai en disant que je ne pouvais pas m’empêcher de rire de sentir que, dans une intrigue qui m’était aussi étrangère, si je disais un mot, je tranquilliserais tout le monde. « Et pourquoi ne pas le dire ? s’écria M. de Gontaut. – Mon cher frère, lui répondis-je, parce que je n’ai aucune envie de tranquilliser Mme de Pompadour.7
M. de Gontaut, empressé de rassurer sa grande amie, va lui rapporter aussitôt que son beau-frère connaît certaines choses qui pourraient suffire à l’ôter de peine. Elle exige de le voir ; Stainville sent qu’il a trop parlé pour ne pas être obligé de parler encore. Il trouve la marquise en pleurs, et dans un état dont un homme sensible ne saurait supporter le spectacle. Il l’assure donc que Mme de Choiseul, qui est enceinte, va quitter Fontainebleau et ne reviendra pas à la Cour avant six mois, ses couches faites. Mais le plus important pour la favorite est de savoir jusqu’où le Roi a osé s’engager. Elle supplie le comte de dire tout ce qu’il sait, et celui-ci peu à peu s’abandonne :
Je lui confiai successivement, avouera-t-il, toutes les circonstances dont j’étais instruit ; en cela je faisais une grande faute que je me suis depuis reprochée ; mais, lorsqu’on est attendri à un certain point, la réserve réfléchie est bien difficile. Je dis donc à Mme de Pompadour que j’avais vu une lettre du Roi à Mme de Choiseul, qui prouvait la coquetterie de part et d’autre, mais qui ne me paraissait pas devoir l’inquiéter, surtout que Mme de Choiseul prenait le parti de s’éloigner ... Je lui dis même à cette occasion quelques galanteries ; mais, en même temps, je l’assurai que je regarderais comme déshonorant pour moi de tirer parti de cet événement pour profiter de son crédit, et lui ajoutai que, quoiqu’il y eût danger pour moi qu’elle instruisît le Roi de ce que je venais de lui dire, cependant je lui en laissais la liberté, si cela lui était utile. Mme de Pompadour me promit le plus grand secret. Nous attendîmes le roi qui revenait du salut. Je la quittai et abrégeai les remerciements qu’elle me faisait de bien bon cœur.
Tandis que Stainville, livré à ses réflexions, s’aperçoit qu’il a agi un peu vite et trahi des secrets qui ne sont pas tout à fait les siens, une scène agitée suit son départ. Il n’y aura pas de témoin pour les larmes qui recommencent de couler devant le Roi, les dénégations de l’amant pris en faute, les reproches que justifient les lettres échangées et l’exacte citation d’un passage de cette correspondance. Louis XV ne redoute rien davantage que les indiscrétions sur ses affaires amoureuses. Il interroge le jour même Mme de Choiseul, qui reconnaît l’aveu fait à son cousin. Dès lors, le charme est rompu ; à l’instant où elle se croit victorieuse, la maîtresse d’un jour apprend que le Roi ne veut plus d’elle. Elle part pour Paris, pleurant de rage, laissant Mme d’Estrades dissimuler sa fureur et M. d’Argenson son désappointement. Elle meurt l’année suivante, en suite de couches, sans avoir reparu à la Cour ; et cette histoire peu édifiante, où pourtant les méchants ont été déçus, semble ensevelie bientôt dans l’oubli qui en a recouvert tant d’autres.
La France y gagnera un ministre illustre, par les voies détournées qui se préparent. Mais, quand s’établira la fortune du duc de Choiseul, les indiscrets ne manqueront pas de révéler ce qu’elle eut d’équivoque à son origine. Ses ennemis diront qu’il a volé, puis livré des lettres de femme, escomptant les profits de sa délation ; on prétendra même qu’il a fait empoisonner sa cousine, afin d’assurer mieux la sécurité de sa protectrice. Cette dernière accusation faisait sourire le ministre ; la première finit par l’atteindre au vif. Elle explique son insistance à fixer les détails qui réduisent sa faute et servent à l’excuser. Ce sont les confidences d’un homme qui a de l’honneur, et dont au surplus la justification est vraisemblable ; on peut donc admettre que M. de Stainville, ayant voulu combattre honnêtement une intrigue menaçante pour sa maison, acheva son œuvre dans le cabinet d’une femme encore séduisante et qu’il fut agréable de consoler.
Mme de Pompadour, qui ne pardonnait pas les offenses, n’oubliait pas non plus les services. Elle se promettait de prouver un jour sa reconnaissance à l’ancien adversaire, qui s’était fait son chevalier pour l’aider à vaincre un des plus grands périls de sa carrière. Le Roi, de son côté, se renseignait, et ce nom de Choiseul-Stainville, autrefois indifférent, se fixait en sa mémoire à côté d’un souvenir assez humiliant pour son orgueil. Stainville vit quelquefois la marquise, l’hiver suivant, et celle-ci l’assurait qu’il n’avait pas été compromis. Mais, s’étant présenté à Compiègne pour prendre congé de Sa Majesté, avant d’aller servir en Flandre comme maréchal de camp, il s’aperçut fort bien que le maître le voyait avec déplaisir. Mme de Pompadour protesta que le Roi ne savait rien, le plaisanta sur son imagination frappée et le pria à souper pour le lendemain.
Après souper, dit-il, j’étais à causer avec elle auprès d’une table qui était tournée contre une porte, par où le Roi arriva. Dès qu’il m’aperçut, je le vis changer de visage à un point que l’on crut, dans la chambre, qu’il se trouvait mal. Mme de Pompadour fut à lui ; elle lui demanda ce qu’il avait ; il dit que son estomac n’allait pas bien et se mit au jeu. Je jouai avec lui ; le hasard fit que je lui gagnai l’impossible, ce qui ne rendit pas son visage plus favorable à mon égard, mais ce qui me consola infiniment de sa mauvaise mine. Il alla se coucher après la partie. Je pris congé de lui à son coucher. Il ne me dit pas un mot, et je remontai chez Mme de Pompadour pour lui demander si elle avait encore quelques doutes sur la connaissance qu’avait le Roi de ma conversation avec elle à Fontainebleau. Elle me dit qu’elle ne comprenait pas ce qui était arrivé, en même temps qu’elle me jurait que le Roi ne lui avait rien dit qui pût lui faire soupçonner qu’il fût éclairci.
M. de Stainville est ambitieux et ne le cache point ; mais son ambition se borne aux emplois militaires. La paix ne lui laisse guère d’espoir d’y faire valoir ses talents. Que peuvent faire pour lui ceux qui s’intéressent à sa carrière ? Voudra-t-il s’occuper de la « politique », c’est-à-dire, selon le sens du mot à cette époque, des affaires du Roi à l’étranger ? « Le maréchal de Noailles, raconte-t-il, me dit qu’en temps de paix il n’y avait point d’occupation plus noble que celle de la politique ; qu’enfin j’étais en âge de prendre de la consistance et d’acquérir quelque considération, ce qui n’arriverait pas si je restais oisif. » Mme de Pompadour y veille de son côté, et destine à son protégé l’ambassade de Rome, que le retour du duc de Nivernais va rendre vacante. Stainville s’attache à cette idée, à laquelle se prête M. de Saint-Contest, ministre des Affaires étrangères. Le ministre présente à plusieurs reprises son nom au choix du Roi, qui chaque fois le rejette. La difficulté échauffe le zèle de la marquise. Au moment où Stainville renonce à ses espérances et va s’accommoder de sa vie agréable de Paris, un billet de sa nouvelle amie l’appelle à Versailles. Il trouva chez elle le ministre, qui lui apprend sa nomination d’ambassadeur. Le succès n’a pas été facile et la marquise a dû recourir aux grands moyens :
Elle me raconta, dit Choiseul, qu’elle avait eu une explication avec le Roi, qu’elle lui avait demandé le motif de la résistance à ma nomination et qu’après beaucoup de subterfuges, qui ne signifiaient rien, il lui avait avoué qu’il me haïssait personnellement, parce que je l’avais instruite des lettres qu’il avait écrites à Mme de Choiseul ... que, si j’avais vécu intimement avec lui, il m’aurait puni de lui avoir joué un tour aussi perfide, mais que, comme il ne vivait pas avec moi, il se bornait à ne point m’aimer et à me refuser toutes les choses qui marqueraient quelque préférence. Mme de Pompadour ... lui fit sentir que c’était contre elle-même plutôt que contre moi que portaient sa colère et son aversion ; qu’elle ne pouvait pas souffrir que je fusse la victime d’une indiscrétion qu’elle avait faite et que, s’il ne me nommait pas le matin même, elle lui déclarait qu’elle prendrait son refus pour un congé pour elle et qu’elle irait à Paris pour ne plus revenir à la Cour. Elle lui rappela ... combien il était indigne de lui, après avoir exigé d’elle que tout ce qui avait rapport à cette brouillerie fût oublié, de conserver un venin dans son cœur qui devait autant la chagriner. Comme elle parla avec assez de force, elle intimida le Roi, ce qui est la façon la plus certaine de le persuader. Il fit venir M. de Saint-Contest, me nomma, redescendit chez Mme de Pompadour pour le lui dire ; mais en même temps il ajouta la condition qu’on ne le presserait pas pour me faire chevalier de l’Ordre.
Ces détails méritent d’être retenus, parce qu’ils donnent la nuance vraie des rapports de nos personnages et font assister à une de ces scènes intimes, plus intéressantes que d’autres, et sur lesquelles les témoignages sont si rares. Quant à la confiance établie entre la marquise et son protégé, nous avons pour l’attester toute la correspondance que celui-ci a gardée. Dès la première lettre, Mme de Pompadour demande son avis sur une fille de la maison de Choiseul, qu’on lui propose pour le marquis de Marigny :
On vous a dit vrai sur le dessein que j’ai eu de marier mon frère ... Je suis payée pour prendre garde à vos cousines ; malgré cela, de toutes les filles de qualité qui me sont offertes (c’est) elle qui me tente le plus par les bonnes qualités qu’elle a ... Mandez-moi ce que vous savez de cette jeune fille, dont tous s’accordent pour dire du bien ... bien entendu que je n’entendrai jamais parler du reste de la famille.
Entre Louis XV et Mme de Pompadour, il n’y avait plus alors que les tièdes orages de l’amitié. Depuis un an déjà, la triomphatrice de l’année de Fontenoy avait renoncé aux prérogatives de l’amour. Épuisée de santé, exténuée jusqu’à l’anémie par la terrible vie d’agitation que lui imposait le Roi, par les veilles, la représentation et les continuels voyages, l’estomac détruit par les soupers, le cœur usé par des inquiétudes toujours renaissantes, Mme de Pompadour abandonnait son rôle premier et adoptait celui d’amie, plus difficile à soutenir, plus sûr peut-être à la condition de s’y rendre indispensable. Le tabouret et les honneurs de duchesse, accordés précisément pendant ce séjour à Fontainebleau où fut éconduite Mme de Choiseul, avaient annoncé au public ces arrangements nouveaux. Personne, bien entendu, n’y voulait croire ; seul « l’intérieur » savait qu’ils étaient bien établis, et apparemment, pour toujours.
Romanesque à ses heures, la marquise lisait la théorie de l’amitié dans un conte de Duclos, où le romancier à la mode traçait ainsi le tableau d’un couple assagi par l’âge : « Après avoir usé les plaisirs et les peines de l’amour, ces amants se sont heureusement trouvés dignes d’être amis ; et c’est de ce moment qu’ils vivent heureux avec une confiance plus entière qu’ils ne l’auraient peut-être s’ils n’avaient pas été amants, et avec plus de douceur et de tranquillité que s’ils l’étaient encore. »
Les mœurs du moment, qui autorisent tant de choses, ont trouvé édifiante cette raisonnable métamorphose des passions, et le thème plait aux moralistes chargés d’enseigner à leurs contemporains l’art du bonheur. Mais notre bourgeoise sentimentale s’est trompée si elle a pensé rencontrer le repos dans cette sagesse et conduire en un port pacifique sa barque ramenée de Cythère. Elle a affaire à ce monde exceptionnel et périlleux de la Cour, à cet homme décevant qu’est le Roi. La marquise accepte, puisqu’il le faut, les caprices du Parc-aux-Cerfs, et son adoration fidèle pour l’ancien amant n’en est pas amoindrie. Elle ne s’offusque point d’un genre de vie, à la vérité assez bas, mais habituel aux riches libertins de l’époque et dont la morale des « philosophes » s’est toujours accommodée. Elle se borne à faire surveiller de loin toute liaison qui se prolonge et qui pourrait annoncer l’avènement d’une favorite véritable. Son rôle est d’une défense qu’elle croit légitime et qu’approuvent ses amis. Les infamies qu’on débite à ce sujet dans le public ne la préoccupent guère, et les jeunes femmes dont on lui conte l’aventure successive attendrissent quelquefois son égoïsme.
Aucune d’elles ne saurait lui enlever l’affection du Roi. « C’est à son cœur que j’en veux », dit-elle à Mme de Mirepoix. Mais celle-ci lui fait observer que le cœur compte chez Louis XV beaucoup moins que d’habitude : « C’est votre escalier qu’il aime ; il est habitué à le monter et à le descendre. S’il trouvait une autre femme à qui il parlerait de sa chasse et de ses affaires, cela lui serait égal au bout de trois jours. » L’autre femme ! Telle est la menace constante pour la marquise. L’éventail de maîtresse en titre, qu’elle a laissé tomber de ses doigts, est guetté par de grandes dames qui aspirent à le ramasser. D’où viendra le péril, parmi tant de beaux yeux qui visent le maître ? La première exigence de celle qui l’emportera sera de faire renvoyer Mme de Pompadour. L’amitié la plus tendre, le dévouement le plus éprouvé ne la défendront pas une heure d’une rivale qui l’égalerait par le rang et la dominerait par la naissance. Le complot mortel s’ébauche à tout instant et chaque menace la torture. Dans son propre cercle, elle a vu Mme d’Estrades en ligne, Mme de Choiseul presque victorieuse ; demain, ce sera Mme de Coislin, et puis d’autres, toutes préludant par une lutte sans scrupule au triomphe qui serait sans pitié.
Prête à tout risquer d’elle-même pour ce qu’elle regarde comme son bien, Mme de Pompadour songe à prendre par ailleurs ses sûretés. Elle découvre pour cela un exemple dans l’histoire, celui d’une autre marquise à qui elle prétend, bien à tort, se comparer. Mme de Maintenon a tenu, auprès d’un grand prince, le rôle de l’amie nécessaire et de bon conseil ; elle a vécu avec Louis XIV, il est vrai, en femme légitime, et le mariage secret, qu’exigea sa vertu, ne ressemble guère aux galants préliminaires de la forêt de Sénart. On veut oublier ces différences et ne voir dans cette haute aventure de l’autre règne qu’un encouragement magnifique. C’est en s’occupant du gouvernement du royaume, en participant au travail avec les ministres que Mme de Maintenon a gagné sa partie jusqu’au bout. La fille du commis Poisson, élevée par les frères Pâris, enseignée par Crébillon et par Voltaire, formée aux nobles manières par l’abbé de Bernis et M. de Gontaut, puis par une vie de Cour déjà longue, n’aurait à compléter que sur ce point son éducation de grande favorite.
Le voisinage de la maison de Saint-Cyr, que fréquentent les dames de la Cour, lui suggère des idées et des exemples. Elle s’intéressera passionnément aux Mémoires sur la vie de Mme de Maintenon que va publier La Beaumelle et s’inscrira parmi les premiers souscripteurs. Elle trouvera dans cette biographie mainte leçon précieuse à recueillir. Son projet d’École militaire pour la jeune noblesse sans fortune lui a été inspiré par Saint-Cyr ; sa prochaine « conversion » va l’être par le pieux exemple de la pénitente de l’abbé Gobelin : « Elle l’imitait depuis longtemps, écrit un bon observateur ; j’en avais été plusieurs fois témoin. » C’est d’abord par l’étude des affaires publiques qu’elle voudrait rejoindre les traces de ce modèle inattendu.
Elle y a pensé dès l’heure où, restant pour le Roi un agrément et une habitude de sa vie, elle a renoncé aux tendres prestiges et aux droits qu’assure l’amour. À y suppléer, il lui faut plus que jamais des amis sûrs et choisis, aussi fermement attachés à sa fortune qu’elle sera dévouée à la leur. Un Stainville sera du nombre, et bientôt au premier rang. Ils lui feront connaître les rouages de l’État et les vues de cabinets de l’Europe ; ils parleront devant elle le langage qu’elle emploiera à son tour auprès du Roi, étonné, charmé une fois de plus par ce renouvellement de son amie. La musicienne, la comédienne, la ballerine experte des Petits Appartements, la surintendante des plaisirs de Versailles, la protectrice des artistes et des gens de lettres, la brillante châtelaine de Bellevue et de Crécy,8 saura faire apprécier en elle des mérites imprévus. Sa politique aura seulement en vue les plus directs intérêts du Roi, reflétera toujours sa pensée, servira ses désirs secrets, ménagera les ombrages de son orgueil et ne travaillera que pour sa gloire. La marquise se montrera conseillère déférente, fidèle sujette et véritable Française, interprète des bons serviteurs, dénonciatrice des ennemis de la couronne, obtenant ainsi d’être mêlée aux décisions et jugée indispensable à toutes les heures. Elle ne redoutera aucune rivale : pour cette fonction difficile et souvent ingrate, peu de femmes auraient assez d’intelligence, aucune assez de dévouement.
Tel est le rêve ; la réalité sera souvent différente. Ces nobles espoirs n’iront pas sans défaillances, sans déceptions de plus d’une sorte. Que de difficultés déjà pour en faire accepter l’idée au Roi, et comme l’ancien rôle était plus facile !
Le « petit degré » du Roi, qui desservait les cabinets intérieurs, permettait à Louis XV d’accorder à l’insu de tous ses audiences les plus intimes. Par l’Œil-de-Bœuf passaient les « entrées », les grandes charges, les ministres, la Reine et Mesdames avec leur service, toute la vie majestueuse de Versailles ; par « les derrières » se glissaient la mante bien close d’une bonne fortune ou le portefeuille bourré de papiers des gens du « secret ». Ce « secret » politique du Roi fut si bien gardé que ceux même qui en soupçonnèrent l’existence n’en connurent jamais l’objet. Chaque jour, pendant des heures, ce souverain qu’on croyait à ses plaisirs s’asseyait à sa table de travail pour dépouiller, mettre en ordre, annoter les mémoires qu’il se faisait remettre sur les diverses parties du gouvernement ou les rapports que, de tous les coins de l’Europe, des agents inconnus adressaient sous des couverts sûrs. Il surveillait ainsi, par des hommes d’un zèle éprouvé, les points délicats de sa politique étrangère. Il se défiait de ses propres ambassadeurs, trop souvent choisis pour leur nom, leur fortune ou leur cuisinier ; il n’appréciait guère l’aide de ses ministres, ni le fumeux génie d’un marquis d’Argenson, ni la banale éloquence d’un Puisieux, ni la mémoire gonflée de gazettes d’un Saint-Contest. Ses courriers privés de Saxe, de Pologne, de Prusse ou d’Angleterre lui apportaient plus de vérités utilisables que les rapports à grandes marges des Affaires étrangères, souvent remplis de pompeux commérages. Il dirigeait ainsi deux politiques, qui soutenaient l’une et l’autre les intérêts du royaume, mais dont la secrète passionnait seule son esprit méfiant et mystérieux.
La Cour ignora tout du secret de Louis XV, et les ministres eux-mêmes s’en doutèrent à peine, jusqu’au jour où le comte de Broglie remit à Louis XVI, pour se justifier devant lui, toute la correspondance du maître qu’il avait servi. Mais, pendant bien des années au milieu du règne, certaines allées et venues du « petit degré » excitèrent la curiosité de Versailles. Le prince de Conti le montait sans être annoncé, quelquefois accompagné d’un secrétaire, et les deux cousins s’enfermaient ensemble tout au fond de l’appartement. Des courtisans, Argenson ou Luynes, jettent parfois sur leur journal des notes de ce genre : « On est toujours étonné de l’immixtion de M. le prince de Conti dans les affaires de l’État ... Ce prince porte souvent de gros portefeuilles chez le Roi, et travaille longtemps avec Sa Majesté. » – « Tout le monde demande quel est le sujet de ce travail ; il paraît que personne ne le sait ... Il y a des gens qui prétendent que M. le prince de Conti s’instruit sur différentes matières dont il vient rendre compte au Roi ... Il a plusieurs secrétaires qui paraissent fort occupés. » Mais rien ne transpire de ces entretiens répétés.
Louis-François de Bourbon, prince de Conti,9 arrière-neveu du Grand Condé et grand prieur de France, était avant tout un homme de guerre. Il avait conquis au Roi plus de places fortes que le maréchal de Saxe ne lui avait gagné de batailles, et l’armée s’attendait à être commandée par lui le jour où l’on recommencerait à se battre. Depuis la paix d’Aix-la-Chapelle il était le confident de la politique secrète de Louis XV, dont tous les ordres passaient par ses mains. Il répondait des agents et de leur silence ; il employait dans chaque Cour de l’Europe des hommes de rang très divers, dont aucun jamais ne manqua à la discrétion, et parfois c’était l’ambassadeur lui-même, jugé capable de la garder envers son ministre. Le jeune Broglie,10 nommé à l’ambassade de Varsovie le 11 mars 1752, ne fut pas peu surpris de recevoir en privé, dès le lendemain, ce billet d’une main auguste : « Le comte de Broglie ajoutera foi à ce que lui dira M. le prince de Conti et n’en parlera à âme qui vive. Louis. »
Le nœud du secret royal était en Pologne. Depuis la guerre soutenue pour les droits de son beau-père Leczinski, Louis XV s’intéressait à ce pays. Il continuait à y entretenir de ses subsides l’ardeur du parti français, et comptait parmi ses plus fidèles agents plusieurs serviteurs anciens de Stanislas. Monarchie élective, la Pologne s’offrait sans cesse comme une proie à l’avidité de ses durs voisins. Un roi né Français l’eût défendue mieux qu’un autre contre la Russie, la Prusse ou l’Autriche ; il eût ménagé en même temps à notre couronne cet appui oriental dont elle ne pouvait se passer. Le roi d’alors ne comptait point comme un ennemi, puisque c’était le père de la dauphine Marie-Josèphe, l’électeur de Saxe, Auguste III ; mais on pouvait lui préparer pour successeur un prince de la maison de France. Ce trône, que les Polonais proposaient sous Louis XIV à un prince de Conti, leurs descendants y voulaient mettre son petit-fils. Louis XV ayant autorisé son cousin à poursuivre une ambition digne de son rang, leurs démarches communes commencèrent sur ce point l’action de la diplomatie occulte. Depuis, le cadre s’en était élargi : elle appuyait toute la politique générale du Roi, qui tendait à rattacher à la France et à unir entre elles la Suède, la Pologne et la Turquie, pour les opposer à l’Autriche et à la Russie et maintenir l’équilibre créé en 1748 par le traité d’Aix-la-Chapelle. Cette paix conçue « non en marchand, mais en roi », suivant le mot de Louis XV, était son œuvre personnelle. « Quel roi, s’écriait Voltaire, a fait jamais une paix plus utile ! » Si ses alliés avaient seuls bénéficié de sa victoire, ce désintéressement devait servir, croyait-il, à détruire « dans le cœur de ses ennemis des semences de discorde et de jalousie », et à l’instituer « arbitre des nations si longtemps conjurées contre nous. »
Capable de comprendre ces vues et digne de s’y associer, Conti rachète ainsi les désordres de sa conduite privée, la forfanterie d’impiété qui s’étale aux soupers du Temple. Il n’est pas insensible à l’idée qu’il sert les intérêts français en même temps que son propre avenir. Il aime à travailler avec le Roi. Son esprit manœuvre aisément les fils de ce vaste écheveau diplomatique où se perd l’intelligence confuse du marquis de Puisieux, secrétaire d’État pour les affaires étrangères. Par instants, le « secret » fait de lui le véritable ministre. Sûr de la bonne organisation du service et de la confiance de son cousin, muni d’intentions droites et dévouées, le prince n’a oublié qu’une chose, l’existence d’une maîtresse en titre, avec qui il faudra compter.
Conti serait des ennemis de Mme de Pompadour s’il daignait s’occuper d’elle. Mais il préfère l’ignorer, car l’arrivée de cette intruse à la Cour lui a causé l’unique et cuisante humiliation de sa vie. C’est sa mère, la princesse de Conti, qui a mené la « caillette » au jour de sa présentation ; et chacun sait que le paiement des dettes de la douairière besogneuse a récompensé cette complaisance. La discorde règne depuis lors entre la mère et le fils, et celui-ci affecte de se tenir à l’écart de la puissance encensée par tant d’autres. Sa maîtresse, la fière Boufflers, « l’idole du Temple », décoche ses épigrammes à l’idole bourgeoise des Petits Appartements. La marquise espère du temps un changement dans les sentiments du prince ; elle a désarmé bien d’autres préventions, et même dans la famille royale. Pourtant, si l’on peut négliger la maîtresse, il est périlleux de l’inquiéter. Comment ne prendrait-elle pas ombrage de ce travail caché, qui lui enlève si souvent le Roi et dont il évite avec soin de lui parler ! Que contiennent ces dépêches remises à Conti en pleine chasse, et les lignes griffonnées par lui sur la selle et qu’un courrier porte au Roi ? Quelle raison si pressante le fait arriver parfois de l’Isle-Adam à cheval et bride abattue, pour s’en retourner sur-le-champ ? Pourquoi tient-on la marquise hors de toute information, alors qu’elle donne au Roi tant de preuves de discrétion et d’attachement ? Conti, interrogé par elle, s’est dérobé. Les secrétaires d’État ne savent rien, et le comte d’Argenson, un peu mieux renseigné peut-être, puisqu’il a travaillé quelquefois avec le prince, se garderait bien de satisfaire la curiosité de sa belle ennemie. Désappointée dans ses recherches, Mme de Pompadour est en proie à une jalousie singulière. Elle sent que le Roi n’accorde pas assez de confiance au sérieux de son esprit pour la mêler aux secrets de la politique. C’est alors qu’elle commence à s’instruire des choses qui jusqu’à présent ne l’intéressaient guère, et dont la connaissance peut seule lui procurer l’orgueil des suprêmes confidences.
Les rapports adressés au roi de Prusse par son envoyé à Versailles révèlent l’heure et les circonstances de ces dispositions nouvelles. Le baron Le Chambrier,11 qui connaissait bien la favorite pour l’avoir vue avant ses grandeurs, la jugeait encore sans conséquence en janvier 1751 : « La marquise de Pompadour est toute-puissante pour ce qui s’appelle grâces et bienfaits en argent, en charges, tant militaires que de la cour et de la Robe, et en général pour tout ce qui regarde l’intérieur du Royaume. Elle n’a aucune influence dans les affaires politiques, que celle de placer un ministre dans les Cours étrangères pour lesquelles elle s’intéresse, de concert avec le marquis de Puisieux ; mais pour ce qui regarde les négociations que les puissances étrangères peuvent faire avec la France, la marquise de Pompadour ne s’en mêle pas. Elle n’aime point ces sortes d’affaires ; elle ne les entend pas. Il faudrait qu’elle fût dirigée par quelqu’un, si elle voulait y influer. Si j’avais pu croire avec fondement qu’on pût tirer quelque utilité de cette femme pour les grandes affaires, je l’aurais marqué à Votre Majesté il y a longtemps. »
Deux mois plus tard, ce portrait devra subir quelques retouches. De nombreux événements se sont succédé. Le carême, le temps du Jubilé ont été pleins de tempêtes ; les prédicateurs Jésuites ont tonné devant le Roi contre les mœurs coupables de la Cour, et le pécheur le plus notoire a montré l’intention de revenir aux sacrements. La marquise a pressenti le renvoi qu’exigeront les confesseurs. Ce danger va se dissipant, il est vrai, car le Roi, trop bon chrétien pour vouloir l’absolution sans offrir en échange le ferme propos de réformer sa vie, ne l’est point assez pour se résoudre à une telle extrémité. Mais comme sa maîtresse a su l’entourer, le distraire, l’étourdir ! Gagner du temps était pour elle tout gagner. À ses armes habituelles, elle vient d’en joindre une autre, que M. de Puisieux a su lui indiquer et qui doit les défendre tous les deux : comme Mme de Maintenon, elle est appelée en tiers au travail du Roi, et voici les dessous de l’événement que Frédéric II sera le premier à connaître.
« Le marquis de Puisieux, lui écrit Le Chambrier, a commencé de travailler avec le roi de France en présence de la marquise de Pompadour, en suite de la représentation qu’il a faite à ce prince, après s’être concerté apparemment avec cette maîtresse, qu’il était du bien de son service qu’elle fût présente au travail qu’il aurait l’honneur de faire avec lui. Le marquis de Puisieux a cru sans doute qu’il fallait qu’il se liât avec la marquise de Pompadour, en la mettant pour ainsi dire de moitié dans les affaires politiques, pour faire reprendre au roi, son maître, des sentiments plus favorables pour lui, et la marquise, de son côté, en aura été charmée, vraisemblablement, pour se faire plus valoir dans l’esprit du roi de France, en lui développant des talents dont il ne l’a pas crue capable jusqu’à présent. La voilà donc à portée de prendre connaissance des plus grandes affaires ... Comme je suis sa plus ancienne connaissance parmi les ministres étrangers, elle me fit des agaceries, dans le dernier voyage à Fontainebleau,12 sur ce qu’elle ne me voyait pas souvent. Peut-être se proposait-elle déjà de tâcher de se mêler dans la politique et que, comme Votre Majesté est l’allié le plus considérable du roi de France, elle voulait se préparer une route, en me voyant, qui pût favoriser son dessein. Je ne sais pas si c’est elle qui l’a conçu ou si quelqu’un le lui a inspiré, mais elle l’avait cru au-dessus de ses forces ; et si elle paraît penser différemment aujourd’hui, c’est qu’elle aura peut-être réfléchi par elle-même, ou par d’autres, qu’il fallait qu’elle se rendît nécessaire au roi de France par ses intérêts les plus importants, pour suppléer au besoin qu’il n’avait plus si fortement de sa personne pour son aisance, et qu’en s’attachant à elle de cette manière, il lui serait plus difficile de la renvoyer quand il voudra sincèrement écouter son confesseur. »