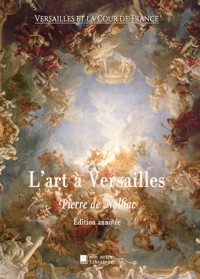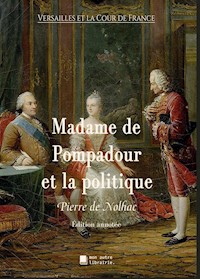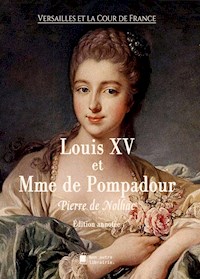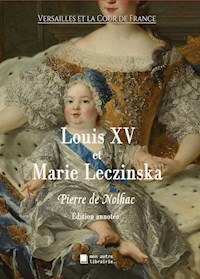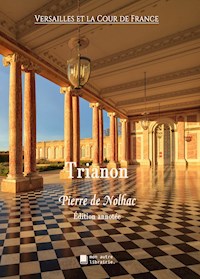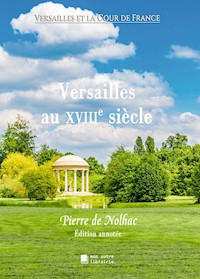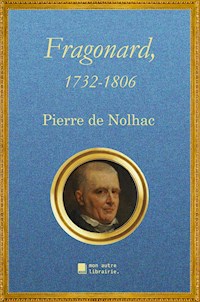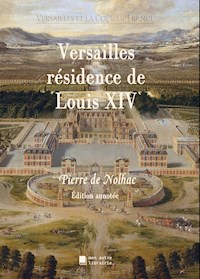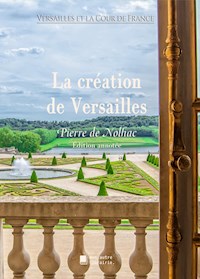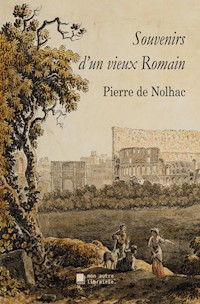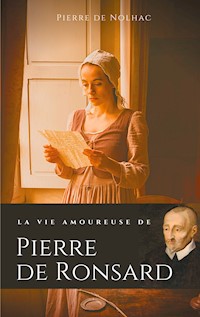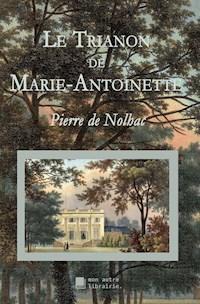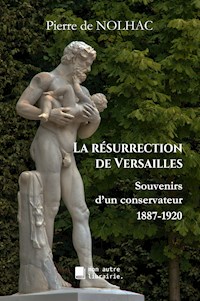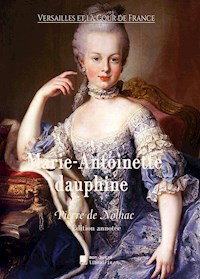
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mon Autre Librairie
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Versailles et la Cour de France
- Sprache: Französisch
Marie-Antoinette vient d'arriver en France. Mariée d'office (comme toute sa fratrie), selon des calculs stratégiques qui la dépassent, à un homme qu'elle n'a pas choisi, lui aussi marié d'office, elle a quitté pour toujours son pays, sa famille, ses amis, ses racines les plus profondes. Elle est attendue... Sur ses épaules d'adolescente pèsent d'énormes enjeux politiques dont elle n'a que vaguement conscience, immédiatement accaparée comme elle l'est par les féroces intrigues de Versailles. Il faut survivre. Son caractère bien trempé va l'aider, comme il va aussi la desservir. Déjà se dessine, derrière les combats de la dauphine, le destin de la plus tragique reine de France. (Édition annotée)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marie-Antoinette
dauphine
Pierre de Nolhac
Édition annotée
Fait par Mon Autre Librairie
À partir de l’édition Louis Conard, Paris, 1925.
Les notes entre crochets ont été ajoutées pour la présente édition.
Couverture : Marie-Antoinette par Martin van Meytens
https ://monautrelibrairie.com
__________
© 2022, Mon Autre Librairie
ISBN : 978-2-38371-055-4
Versailles et la Cour de France
par
Pierre de Nolhac
La création de Versailles
Versailles résidence de Louis XIV
Versailles au xviiie siècle
Trianon
Louis XV et Marie Leczinska
Louis XV et Madame de Pompadour
Marie-Antoinette dauphine
La reine Marie-Antoinette
Madame de Pompadour et la politique
L’art à Versailles
Table des matières
I. – La cour de Louis XV
II. – Le mariage de Marie-Antoinette
III. – La disgrâce de Choiseul
IV. – Madame du Barry
V. – La fin du règne
Sources
Appendices
L’appartement de madame du Barry
Les appartements de Mesdames
I. – La cour de Louis XV
Louis XV régnait depuis plus d’un demi-siècle quand il se décida à marier le Dauphin, son petit-fils, à l’archiduchesse Marie-Antoinette. Ce long règne avait eu des époques brillantes, qui le faisaient comparer au règne même de Louis XIV. Aux yeux de Voltaire, l’historiographe éloquent des deux périodes, les traits de Louis le Grand se retrouvaient, humanisés et ennoblis encore, en ceux de Louis le Bien-Aimé. La France l’avait cru pendant longtemps et avait prodigué au fils du duc de Bourgogne cette indulgence toujours prête que lui fournissait son inépuisable fidélité. Il avait fallu à la nation de longs scandales, de graves revers et un malaise toujours croissant pour s’apercevoir que, du caractère du Grand Roi, Louis XV développait surtout les vices. Depuis Fontenoy et les victoires mises aux pieds de Mme de Pompadour, la roue de la fortune royale avait tourné. Quels que fussent les adulations des courtisans et son aveuglement inévitable, le Roi ne songeait pas à se dissimuler qu’une décadence était venue. Lorsque finit en désastre la guerre de Sept Ans, les difficultés accumulées autour du trône pouvaient lui paraître une expiation du désordre de sa vie privée.
Le Roi avait toujours été triste, mais il l’était devenu plus encore. L’ennui, qui châtie sans les réduire des excès comme les siens, s’était fait plus étroit et plus rigoureux depuis la mort de la marquise. C’était maintenant le fond même de cette nature étrange, exigeante et molle, bienveillante et froide, où sommeillaient trop souvent les qualités réelles et sérieuses qui avaient donné tant d’espérance. Le Roi gardait l’esprit juste et la vision lucide du bon sens, mais, comme il n’avait aucune volonté à mettre au service de ses jugements, sauf dans les mesquines choses de sa passion, rien ne suffisait plus à l’intéresser ni à l’émouvoir.
Sa vie quotidienne de souverain était fort remplie. En dehors des cérémonies, des fêtes, des grandes audiences, chaque journée, de son petit lever à son coucher public, donnait une grande place à la représentation et au gouvernement ; c’était le Conseil, le travail avec les ministres, les présentations, l’interminable liste des nominations, et, lorsqu’il rentrait dans son intérieur, cette correspondance secrète qu’il entretenait, à l’aide du comte de Broglie, avec ses agents personnels à l’étranger. Les distractions n’étaient pas moins nombreuses : il avait la chasse, cette grande occupation des Bourbons, les soupers des cabinets, ses jeux de tourneur et de cuisinier, ses continuels voyages aux résidences royales ou encore, quand il était à Versailles, les nouvelles serres du jardin de Trianon et la petite maison du Parc-aux-Cerfs. Malgré tout, devenu trop détaché pour s’attarder sérieusement aux affaires, trop blasé pour goûter bien vivement les plaisirs, Louis XV s’ennuyait, et une pénible pensée l’accompagnait sans cesse, celle de ce caveau funèbre de Saint-Denis, où déjà tant des siens étaient allés l’attendre.
Il avait perdu d’abord ses filles aînées, les plus intelligentes, les préférées, mortes au moment où leur influence commençait à contrebalancer celle de Mme de Pompadour. Puis, la marquise elle-même disparue, était venue la plus récente série des deuils de famille, dont un méchant esprit de calomnie empoisonnait encore les blessures. Le Dauphin, qui promettait un règne d’honnêteté et de droiture, mais que l’on croyait trop l’ami des prêtres et des Jésuites, avait été miné par une maladie lente et inexpliquée ; la Dauphine, Marie-Josèphe de Saxe, aimée véritablement du Roi et prête à lui donner le milieu de vie honnête qui lui manquait, avait peu survécu à son mari, et les mêmes voix avaient jeté dans les esprits les mêmes soupçons. Leur fils aîné, le petit duc de Bourgogne, avait été emporté avant eux, encore enfant. La Reine enfin venait de mourir, faisant par le grand deuil qu’elle imposait à la Cour, le 24 juin 1768, plus de bruit qu’en trente années d’existence retirée et silencieuse.
Ce dernier coup frappait Louis XV au moment même où, repentant peut-être de longs torts, revenant aux affections éprouvées, il se rapprochait de Marie Leczinska, reprenait l’habitude d’aller chez elle et rendait à la vie publique de la Reine la dignité dont elle avait été injustement privée. La famille royale se décimait ainsi autour du Roi, à l’heure où les approches de la vieillesse semblaient le ramener auprès d’elle pour toujours. Que lui restait-il à présent ? Quatre filles, Mesdames de France, dont deux à peine, Mesdames Adélaïde et Louise, savaient vouloir, et dont une seule, la plus jeune, Madame Louise, savait penser ; les deux autres, Victoire et Sophie, l’une aimable et bornée, l’autre laide et quelque peu sotte, ne comptaient ni à la Cour, ni dans la vie de leur père.
Il continuait à descendre chez Mesdames chaque matin et quelquefois le soir, au retour de la chasse, et à s’intéresser à leurs petites occupations de filles mûres. Mais c’était une habitude plus qu’une joie. Mesdames n’étaient plus les brillantes princesses peintes par Nattier et qu’un pinceau flatteur rendait aisément séduisantes. L’aînée, qui leur donnait le ton, n’ayant pu trouver mari, bornait la conversation paternelle aux anecdotes de cour, aux usages et aux préséances. L’étiquette, qui apportait à Mesdames leurs plaisirs, interdisait ce qui aurait pu donner un but naturel à leur vie, l’éducation de Mesdames Clotilde et Élisabeth. Ces « petites dames », dont la seconde n’était qu’une enfant de quatre ans, restaient sous le gouvernement de Mme de Marsan, à l’autre bout du Château de Versailles, et leurs tantes, comme le Roi, les voyaient une fois le jour, en cérémonie.
Les trois jeunes princes, élevés par le duc de la Vauguyon,1 qui avait été déjà le gouverneur de feu M. le Dauphin, leur père, ne donnaient à Louis XV que des espérances incomplètes. L’aîné, l’héritier du trône, qui avait d’abord eu le titre de duc de Berri et qu’on voulait marier le plus tôt possible pour assurer la descendance, portait assez médiocrement ce brillant nom de Dauphin de France. Maigre et souffreteux, ayant trop grandi, il semblait à cet âge rappeler plutôt l’état maladif de son père que la saine fraîcheur de Marie-Josèphe ; gauche, timide, d’humeur sauvage, on devait, pour le louer, se rabattre sur des qualités de jugement et d’honnêteté qu’il n’avait guère eu du reste l’occasion de montrer publiquement. Moins déshérité de la nature, le comte de Provence annonçait de l’esprit, et le tout jeune comte d’Artois de la franchise et de la gaîté. Mais c’étaient trois frêles appuis pour la Maison de Bourbon, et Louis XV se laissait aller parfois, devant ses familiers, à des réflexions qui montraient combien l’avenir de sa race lui paraissait incertain.
Au delà des tristesses de sa famille, si le Roi regardait le royaume, le spectacle n’était ni plus joyeux ni plus rassurant. Le règne aboutissait, il fallait bien le reconnaître, à un amoindrissement de l’autorité royale. En sacrifiant les Jésuites, le Roi avait satisfait un instant son Parlement, et Mme de Pompadour, ses philosophes. Mais l’Encyclopédie et Jean-Jacques avaient pénétré les esprits de doctrines nouvelles dont les conséquences politiques devaient être redoutées. Les plus dangereuses idées jaillissaient en étincelles des inoffensifs bûchers de livres qu’allumait encore le bourreau en place de Grève. On pouvait entendre, en pleine Cour, de jeunes gentilshommes, épris de la constitution anglaise, mettre en discussion le principe de la monarchie. Le fils de Louis XV lui-même n’avait-il pas trouvé que le Contrat social valait la peine d’être discuté ?
Plus clairvoyant en philosophie, le Roi craignait de s’appesantir sur de tels sujets ; mais la question grave et urgente de son gouvernement était celle des finances. Le trésor était épuisé par des guerres qu’on avait faites interminables, par le gaspillage des favorites, par une administration nourrie d’abus, qui ne voulait pas réprimer et qui ne savait pas prévoir. Il fallait cependant remplir les coffres de l’État, et l’abbé Terray, qu’on venait d’appeler au contrôle général, interrogé sur les moyens de faire de l’argent, disait n’en connaître d’autre source que la bourse des particuliers. De là de nouveaux édits, des impôts nouveaux, le mécontentement de la nation et, de la part des Parlements, le refus de cet enregistrement des édits nécessaire pour les faire exécuter. Une telle résistance, respectueuse au début du règne, mais devenue plus âpre avec le temps, créait un conflit insoluble entre les cours souveraines et la Couronne. Le roi Louis XV allait-il mourir banqueroutier ? Le « déluge » qui devait submerger le trône, suivant le mot qu’on disait autour de lui, n’attendrait-il pas son successeur ?
Dans les provinces, le zèle des agents des fermes se heurtait à l’universelle misère, à des famines régionales, çà et là à des émeutes pour le pain, brusquement, rudement réprimées, mais dont l’écho plein de menaces arrivait jusqu’à Versailles. En ces effervescences la personne du Roi, jusque-là sacrée et inviolable entre toutes, commençait à n’être plus respectée. À Paris, nul n’ignorait ses débauches affichées ou secrètes. On les grossissait à plaisir, on y voulait voir la source première des maux de la nation, et le nom de Mme de Pompadour demeurait exécré. Quelles haines obscures, sorties du peuple, avaient armé le bras de Damiens ? Quelle influence dirigeait le poignard de cet homme, qui n’était pas fou, qui avait subi après son attentat les pires tortures et, sur la roue même, n’avait pas dit son secret ? Le Roi y songeait souvent. Il savait que la mort de son fils avait été regardée comme un malheur public, par la seule raison que ce prince faisait espérer un règne entièrement différent du sien. À ce moment même, Louis XV avait écrit en ami à M. de Choiseul une lettre de sombres pressentiments, s’effrayant de trouver dans l’enfant qui allait devenir dauphin « un bien petit secours... vis-à-vis de la tourbe républicaine » ; et le mot n’est pas sans étonner, à une telle date, sous la plume royale.
Hors des frontières surtout éclatait à tous les yeux la diminution du Roi dans l’effacement politique de la France. Qu’était devenue cette belle armée de Maurice de Saxe, de Loewendahl, de Belle-Isle, qui avait eu tant d’heures de gloire et un tel prestige de bravoure ? L’expédition de Corse préparait un médiocre dédommagement à la désastreuse guerre de Sept ans. Les armées de Louis XV n’évoquaient plus en Europe que des souvenirs de défaites ; Rosbach effaçait Lawfeldt, et les Anglais avaient pris au traité de Paris une terrible revanche de Fontenoy. La France avait perdu son rang de grande puissance maritime. Cette marine, pour laquelle on avait accepté patriotiquement tant de sacrifices, commençait à peine à se refaire ; ces colonies, héritées de l’esprit d’aventure et de l’héroïsme de la race, étaient passées au pouvoir des rivaux ; tout un empire, en Amérique et aux Indes, s’était écroulé sans qu’on eût espoir d’en relever jamais les ruines.
Sur le continent, les humiliations, les déceptions ne se comptaient plus : la diplomatie française considérée comme une annexe de la diplomatie autrichienne, le rôle de la France en Orient s’effaçant par degrés, les amis et les protégés d’autrefois, la Suède, la Pologne, la Turquie, abandonnés aux intérêts nouveaux d’une politique incertaine encore et qui n’avait donné aucun fruit. Le Roi suivait les parties liées par M. de Choiseul, non seulement au Conseil, où régnait l’optimisme intéressé de son ministre, mais aussi sur l’échiquier de sa diplomatie secrète, renseigné par ses agents particuliers, opposants presque tous et portés à ne point celer leurs inquiétudes. Comme il gardait sa rectitude de jugement à côté de sa volonté défaillante, il voyait nettement la fâcheuse marche des affaires qu’il se sentait impuissant à diriger. Il avait, en présidant le Conseil, le coup d’œil sûr, l’avis bref, le résumé précis ; il étonnait les ministres par sa clairvoyance à reconnaître un mal qu’il ne faisait rien pour empêcher.
Des diverses combinaisons diplomatiques essayées au cours du règne et payées du sang de tant de soldats, deux seulement demeuraient debout : le Pacte de Famille, qui était une ligue, dirigée contre l’Angleterre, entre tous les États gouvernés par la Maison de Bourbon, et l’Alliance, qui avait transformé en union l’antique rivalité avec la Maison d’Autriche et qu’avait resserrée étroitement le traité du 30 décembre 1758.2 Ces deux forces, qui soutenaient à cette heure les destins chancelants de la France, étaient en grande partie l’œuvre personnelle d’un ministre et formaient aussi les étais les plus solides de son incroyable puissance. Le monarque ombrageux, jaloux d’une autorité qu’il affirmait rarement, mais par à-coups d’une brutalité inattendue, après avoir promis au cardinal de Fleury et s’être juré à soi-même de n’avoir jamais plus à ses côtés de premier ministre, avait laissé fléchir ses répugnances ; il avait accepté peu à peu, par l’entraînement de son indolence et parce qu’il y voyait la garantie du Pacte de Famille et de l’alliance autrichienne, la tutelle souriante de M. de Choiseul.
Les qualités de l’homme de cour avaient fait la fortune de M. de Choiseul. Héros de toilette, diplomate de boudoir, il s’était élevé, par les échelons rapides et sûrs que dressent les femmes, aux destinées de la grande intrigue. Il avait conquis les hommes, à leur tour, par ses goûts de philosophe, son caractère serviable, sa fidélité en amitié et la bonne grâce avec laquelle il cachait à chacun le mépris qu’il avait pour tous. Créé par Mme de Pompadour, qui l’avait trouvé, à l’usage, plus docile que Bernis, il était devenu nécessaire à Louis XV par sa promptitude de labeur et sa clarté d’esprit, qui rendaient les affaires faciles et le Conseil court.
Il triomphait à ce travail à deux, dans le cabinet du Roi, auprès du grand tapis vert de la table chargée de dossiers savamment classés, prestement analysés, jetés avec art sous la signature. C’était tantôt une décision d’argent, qui engageait de gros crédits et qu’il fallait présenter comme une économie, tantôt une faveur, qui semblait un acte de justice et qui servait seulement à faire au ministre une nouvelle créature. Beaucoup de discrétion dans les demandes personnelles, forçant l’estime du Roi, l’obligeant à quelque reconnaissance ; partout le talent de suggérer la volonté en ayant l’air de la suivre, et de flatter le caprice sans paraître le deviner.
Le duc aimait le pouvoir en lui-même, non pour les vulgaires satisfactions qui le font désirer. Il était monté lentement, avec sagesse, au poste suprême où ses amis lui marquaient depuis longtemps sa place, où sa femme, fille d’un financier, comptait le voir en l’épousant, où l’ambition inquiète de sa sœur, la duchesse de Gramont, cherchait à le pousser d’un seul coup, mais qu’il avait préféré conquérir pas à pas pour s’y maintenir toujours. C’est ainsi qu’il avait réuni en ses mains le ministère des Affaires étrangères, celui de la Guerre, la Surintendance générale des Postes, et qu’il avait fait donner la Marine à son cousin le duc de Praslin, avec le gouvernement des colonies et du commerce maritime du royaume, ce qui faisait autant de grands services de l’État réunis sous son influence. Il exerçait bien, sinon les fonctions, du moins l’autorité d’un premier ministre. Le Roi, persuadé que les affaires n’iraient pas mieux avec un autre serviteur et sachant que celui-ci, malgré ses défauts, était honnête et comblé, avait abandonné peu à peu les rênes à ces mains habiles et souples. Rassuré dans sa conscience royale, satisfait dans sa paresse privée, il laissait la France à M. de Choiseul en échange de son loisir.
Cette omnipotence, mise au service d’une imagination superficielle mais vaste, donnait l’illusion d’un véritable génie politique. Aussi Choiseul, qui avait eu des rivaux, puis des adversaires, jouissait maintenant de haines solides et vigoureuses, de celles qui vont d’ordinaire aux hommes forts, et qui se trouvaient, par hasard, bien au-dessus de ses mérites d’homme d’esprit. Le parti acquis aux Jésuites, étranglés par le ministre avec un élégant cynisme, le lui rendait en calomnies. C’était lui, disait-on, qui avait empoisonné le premier Dauphin, puis la Dauphine de Saxe, pour faire disparaître toute influence contraire à la sienne et assurer la perpétuité de son règne. Des victimes moins illustres avaient subi le même sort : quand le dépositaire du « secret du Roi », le commis des Affaires étrangères Tercier, était mort d’apoplexie, on avait encore parlé du poison ministériel. La Cour et la ville répétaient couramment ces anecdotes, où quelque obscure vérité non démêlée se cachepeut-être. M. de Talleyrand défend Choiseul de ces abominables soupçons en un tour de phrase assez perfide : « Quelque persuadé que je sois qu’aucun n’ait été fondé, j’éprouve une sorte d’embarras de ne pouvoir tirer mes motifs de conviction de la moralité de sa vie, et d’être obligé d’aller les chercher dans la légèreté de son caractère. » Le duc, qui dédaignait même de se venger de ses ennemis, laissait volontiers courir ces fables ; elles donnaient plus de liberté à son jeu d’intrigue ordinaire, beaucoup moins tragique et beaucoup plus sûr.
M. de Choiseul ne détenait pas sans intention, au milieu de tant de fonctions plus sérieuses, la Surintendance des Postes. Quel facile instrument sur Louis XV que ce secret des lettres privées, dont sa curiosité était friande ! Il était d’autant plus aisé de supposer des correspondances, qu’on ne communiquait à Versailles que des copies. C’est par ce moyen que le ministre avait combattu l’influence de Marie-Josèphe sur le Roi, en lui donnant à lire des lettres de particuliers se félicitant plus que de raison de l’autorité grandissante de la princesse. Il se chargeait de faire entendre à Louis XV les « bruits de Paris ». S’il voulait arracher une mesure aux hésitations du Roi, il mettait sous ses yeux un rapport du lieutenant de police : les rumeurs qui couraient nuisaient au crédit, les porteurs de fonds publics se montraient inquiets que M. de Choiseul n’eût pas les mains libres pour réaliser son dessein. Parfois, quand il le fallait, les correspondances interceptées avouaient que les affaires allaient mal, mais que, de peur de les voir se gâter encore, il fallait conserver celui qui les faisait marcher et qu’on ne saurait par qui remplacer.
Dans les circonstances plus graves encore, lorsque le duc, comme il arrivait parfois, se sentait ébranlé dans son pouvoir et que les menées souterraines d’un duc de la Vauguyon ou les boutades enfiellées d’un maréchal de Richelieu apportaient au Roi un grief précis, une révélation fâcheuse, M. de Choiseul faisait donner les ambassadeurs. Il en avait deux à sa dévotion, Vienne et Madrid. Ils saisissaient ensemble l’occasion d’une audience pour faire entendre à Sa Majesté, avec les mérites de son incomparable ministre, la nécessité où ils se trouvaient de délivrer leurs cours respectives des inquiétudes qu’elles avaient pu concevoir sur un changement dans le ministère, toute modification risquant de desserrer les liens d’alliance et de compromettre la solidité du « système ».
Des divers moyens qu’employait Choiseul pour se faire croire l’homme nécessaire, ce dernier était toujours à sa disposition. La Cour de Vienne notamment avait un intérêt évident à le soutenir.
Le traité d’alliance négocié sous Mme de Pompadour, sans avoir été son œuvre directe, l’était devenu par la façon dont il l’avait entendu et complété. Ce n’avait pas été une idée sans grandeur que de substituer à l’antagonisme séculaire, qui finissait par épuiser les deux puissances, une entente loyale et définitive. Mais cette politique renouvelée, qui rompait avec toutes les habitudes nationales, qui exigeait des sacrifices d’argent et d’influence, avait rencontré une opposition irréconciliable. On reprochait à Choiseul de s’être montré, à l’égard de l’Impératrice Marie-Thérèse, trop fidèle sujet de la Maison de Lorraine, longtemps servie en effet par sa famille, et d’avoir sacrifié à son ambition les intérêts et les traditions de la France. Cette thèse, assez facile à soutenir devant une opinion prévenue, tirait argument des relations que Choiseul avait liées à Vienne durant son ambassade et de l’affection que lui témoignaient l’Impératrice et son chancelier, le prince de Kaunitz.3 D’autre part, si le ministre de Louis XV demeurait fier d’une combinaison politique qu’il continuait à trouver utile, il commençait à s’apercevoir lui-même qu’elle n’allait pas sans inconvénients et pouvait coûter à la France, en diminution d’autorité, plus qu’elle ne lui rapportait en sécurité du côté de l’Angleterre.
M. de Choiseul s’inquiétait aussi de la solidité de son œuvre, dont la justification devait être sa durée même. Si Marie-Thérèse était sincèrement attachée à l’alliance, Joseph II, son fils, qu’elle avait associé à l’Empire, avait trop de préventions enracinées contre les Français, trop d’admiration pour le génie du roi Frédéric et trop d’avantages peut-être à agir d’accord avec lui, pour qu’il ne fût pas tenté de sacrifier quelque jour l’allié d’Occident. Le jeune Empereur était devenu, il est vrai, le petit-fils de Louis XV, par son mariage avec l’infante Isabelle, fille de madame Infante ; mais la princesse était morte ; une fille, la petite archiduchesse Thérèse, restait le seul lien de cette parenté, qui serait comptée pour bien peu de chose au jour des complications diplomatiques. M. de Choiseul était donc aussi persuadé que Marie-Thérèse de la nécessité de fortifier l’alliance par un acte nouveau et de donner une sanction vivante et perpétuelle au traité de 1758. Cette sauvegarde de l’avenir du « système » et de l’avenir personnel du ministre, c’était le mariage du futur successeur de Louis XV avec une archiduchesse d’Autriche.
L’Impératrice, mère attentive de filles nombreuses, grande chercheuse de couronnes et diplomate à vues longues, y avait pensé sans doute dès les premiers temps du rapprochement avec la France. Plus tard, les dernières filles de l’empereur François Ier avaient paru s’accorder d’âge avec les petits-fils de Louis XV, et l’occasion s’offrait d’appliquer à nouveau la vieille devise de la Maison d’Autriche : Tu felix Austria nube,4 et sa féconde politique de mariages. Malgré les événements qui en avaient amoindri le prestige, c’était un beau trône encore que celui des fleurs de lis, et le plus beau que pût occuper alors une princesse catholique.
Dès 1765, année de ce veuvage dont Marie-Thérèse devait rester inconsolée, ses projets maternels se précisèrent en faveur de l’archiduchesse « Marie-Antoine », née le 2 novembre 1755. L’importante affaire fut traitée dans le plus grand mystère entre le duc de Choiseul et le prince de Stahremberg, ambassadeur de l’Empereur. Le prince ne voulut pas quitter Paris, où le comte de Mercy-Argenteau5 allait le remplacer, sans avoir obtenu de Louis XV la première parole que souhaitait impatiemment sa souveraine. Son attente fut longue ; enfin, à son audience de congé, le Roi se résolut à parler et le chargea expressément de prier l’Impératrice de réserver pour le Dauphin la main de l’archiduchesse Antoinette. Ce fut un grand succès pour l’ambassadeur, qui écrivit aussitôt à Marie-Thérèse, le 24 mai 1766 : « Le Roi s’est expliqué de façon que Votre Majesté peut regarder le projet comme décidé et assuré. »
Rien du dessein royal ne s’ébruitait hors des deux familles. Le mois suivant, Mme Geoffrin,6 allant en Pologne voir le roi Stanislas-Auguste, séjournait à Vienne, fort choyée de l’Impératrice et de M. de Kaunitz. On montrait, à Schönbrunn, à la vieille amie des philosophes la brillante réunion des archiducs et des archiduchesses ; elle caressait l’archiduchesse Thérèse, qui avait deux ans et qui était l’arrière-petite-fille de Louis XV, la trouvait belle comme un ange et parlait de l’emmener à Paris : « Emportez, emportez ! » répondait Marie-Thérèse, et elle recommandait à Mme Geoffrin d’écrire en France qu’elle avait vu cette petite et ce qu’elle en pensait. Quant à la jeune Antoinette, l’Impératrice ne la faisait même pas remarquer à la Française. Elle savait bien, en effet, malgré les dispositions personnelles du Roi, que le mariage n’en était encore qu’aux « assurances », et qu’il restait à la merci d’un accident de la politique.
Il s’en fallut de peu que tout manquât. Il y avait dans la famille royale deux personnes à qui ces projets déplaisaient, la mère et la tante du futur époux, Marie-Josèphe et Madame Adélaïde. La première surtout, énergique, entreprenante, capable de concevoir fortement une idée et de la suivre, avait pris sur Louis XV une influence extrême. Depuis la mort de son mari, elle habitait à Versailles tout auprès du Roi, dans un appartement qui s’enchevêtrait avec le sien et qui unissait leur vie. Elle était restée attachée avec passion à son pays d’origine, et le trône qu’elle ne devait plus occuper, elle voulait du moins le réserver à une princesse de sa famille. Elle avait justement une nièce d’âge convenable, Amélie de Saxe, et ses plans étaient partagés par son frère, le prince Xavier, administrateur de l’Électorat. Elle demanda au Roi si des engagements formels étaient échangés avec l’Autriche et si, comme mère du Dauphin, elle ne serait pas consultée. Louis XV laissa entendre qu’il tenait à son dessein, mais que cela était exposé à bien des hasards par l’âge même des deux enfants, et que c’était plutôt désir des deux parties qu’affaire conclue.
Marie-Josèphe ne se découragea pas ; elle se savait forte, écoutée, et comptait d’abord obtenir de donner la main de sa fille aînée, Madame Clotilde, au jeune électeur Frédéric-Auguste7 ; ce serait la préparation du mariage de son fils le Dauphin, qui, en fin de compte, ne se ferait pas contre son aveu. Malheureusement, la maladie la terrassait ; sur son lit de souffrance, recevant l’agent de son frère, le vicomte de Martanges, elle lui parlait encore d’un espoir qu’elle n’abandonnait pas. Le 13 mars 1767, les ambitions de la Maison de Saxe s’éteignaient avec elle. Madame Adélaïde essayait de les faire revivre, moins à cause de son préjugé contre l’Autriche que par désir de conserver son influence sur le Dauphin en lui choisissant sa femme. Mais la fille aînée de Louis XV n’était pas armée pour lutter contre M. de Choiseul, que la mort venait encore de servir avec autant d’à-propos. Seule Marie-Josèphe, vivant quelques années de plus, pouvait faire que la femme de Louis XVI fût une princesse de Saxe et que Marie-Antoinette échappât à sa destinée.
Tout y poussait maintenant l’enfant qui grandissait à la Cour de Vienne et sous les ombrages de Schönbrunn. Les obstacles disparaissaient d’eux-mêmes devant le rêve de Marie-Thérèse. L’opinion était peu à peu instruite du projet des chancelleries, et l’union de Marie-Antoinette et du Dauphin devenait dans les deux pays un sujet de conversation. C’était un de ces secrets que Choiseul avait intérêt à donner en garde à beaucoup de monde. En avril 1767, l’ambassadeur du Roi, marquis de Durfort,8 lui mandait une dépêche qui n’était point pour lui déplaire : « Le public de Vienne parle mariage autant pour le moins que le public de Paris. » Aucun ministre cependant n’y faisait encore allusion, sauf le prince de Starhemberg9 qui demanda un jour à l’ambassadeur comment il trouvait l’archiduchesse Antoinette : « Parfaitement bien, répondit Durfort. – M. le Dauphin, ajouta le prince en riant, aura là une charmante femme. – Le morceau est friand, répliqua le marquis sur le même ton, et sera en bonnes mains, si cela est. »
M. de Durfort avait pour instructions de se tenir sur une grande réserve et d’attendre les avances. Le Roi lui avait fait écrire d’assez vifs reproches pour avoir demandé avec trop d’empressement les portraits de la famille impériale. Au mois de septembre, pendant une fête à Schönbrunn à laquelle assistaient les archiduchesses, M. de Durfort et l’ambassadeur d’Espagne s’étant approchés d’une table où jouait Marie-Antoinette, l’Impératrice les rejoignit et, s’adressant à l’ambassadeur d’Espagne, parla du mariage de sa fille : « J’espère qu’elle y réussira, dit-elle. Nous pouvons en causer plus librement tous les deux, car l’ambassadeur de France n’a encore rien dit. » M. de Durfort, fort embarrassé, feignit de ne pas entendre. Quelques jours après, Mme de Lerchenfeld, gouvernante de l’archiduchesse, étant placée près de lui dans un divertissement donné à la Cour, lui faisait l’éloge de Marie-Antoinette, de son caractère, de ses grâces. L’ambassadeur s’en tirait par d’honnêtes propos, ne laissant rien percer des intentions de son maître, au moment même où la Cour de Versailles le chargeait de procurer, à tout événement, une copie du contrat récemment rédigé pour le mariage du roi de Naples et de l’archiduchesse Marie-Caroline.
Louis XV, de son côté, croyait devoir informer le roi d’Espagne, qui lui répondait en déclarant le projet admirable, « soit en politique, pour l’affermissement de l’alliance avec la Cour de Vienne, soit pour le bonheur du Dauphin, puisqu’on dit cette jeune princesse très jolie et avec une éducation parfaite ». Cependant le temps s’écoulait sans aucune démarche du Roi, qui tenait à laisser venir de Vienne les nouvelles ouvertures.
Vers la fin de 1768, les liens se resserraient à nouveau entre la Maison d’Autriche et la Maison de Bourbon ; l’archiduchesse Marie-Amélie était demandée en mariage pour l’Infant, duc de Parme. Cette union en appelait une autre. Joseph II se chargeait de l’indiquer dans une lettre intime qu’il adressait à Louis XV, lors de l’inoculation de sa fille Thérèse, et qui révèle l’intimité des relations déjà établies entre les deux Maisons. L’inoculation était alors chose très nouvelle et inquiétait encore beaucoup d’esprits ; le Roi avait tenu à être renseigné sur toutes les phases de la maladie. À la lettre du père sont jointes cinq lignes de la main de l’enfant :
« Sachant que vous m’aimez, cher grand-papa, je vous assure que je me porte à merveille, et que je n’ai eu que cinquante boutons, qui me font grand plaisir. Que ne puis-je vous les montrer et vous embrasser, vous aimant beaucoup ! »
L’Empereur à son tour réunissait, à propos de cette opération, tous les souvenirs qui pouvaient toucher le cœur du Roi :
« Vous êtes père et bon père ; je vous laisse juger des inquiétudes que cette résolution m’a données. La réussite qu’ici je vous certifie a surpassé mon attente. Ma petite n’a été incommodée qu’un seul jour... Hélas ! pourquoi cette méthode n’a-t-elle pas été connue plus tôt ! J’aurais encore une épouse qui faisait le bonheur de ma vie. En attendant, elle m’a pourtant procuré le bonheur d’oser vous appeler mon père et de joindre tous les sentiments du cœur à ceux que la raison sans cela me dicte pour le plus sûr et le plus digne ami. Vous venez de nous en donner encore tout récemment une preuve non équivoque en nous demandant une sœur pour l’Infant duc de Parme. Que n’y a-t-il encore plus de liens pour nous prouver, en les resserrant, l’avantage et le désir mutuel que nous avons d’être éternellement tendres et utiles amis ! Croyez-moi, cher grand-père, en vous embrassant pour la vie, votre tendre et affectionné petit-fils, Joseph. »
À ce débordement sentimental, dont on chercherait en vain un équivalent dans le reste de la correspondance entre l’Empereur et le Roi, celui-ci répondait, avec un compliment spécial envoyé à la petite archiduchesse (« l’Empereur vous dira combien je vous aime et les motifs que j’ai de vous aimer toujours »), une lettre tout à fait sérieuse et paternelle ; il y formulait, cette fois, expressément le projet du mariage de Marie-Antoinette :
« Je partage, mon cher fils, avec bien de la sensibilité, la satisfaction que vous avez de l’heureuse inoculation de votre fille. Cette enfant m’est chère à tous les titres et elle m’intéresse surtout par la tendresse que vous avez pour elle et par le lien intime qu’elle a formé entre nous. J’ai toujours désiré que mon petit-fils de Parme10 épousât une archiduchesse. Je ne calcule pas le bien qu’ils pourront avoir ; je suis sûr qu’ils ne manqueront pas. Mais votre fille, le mariage de mon petit-fils de Parme, celui du Dauphin, nous rendront nécessairement une même famille. »
Cette lettre de Louis XV, dont Choiseul fit garder une copie aux Affaires étrangères, est du 25 septembre 1768. Moins de six semaines après, le comte de Mercy recevait à Paris l’ordre de s’occuper du trousseau de la Dauphine, pour lequel l’Impératrice destinait quatre cent mille livres, et de faire envoyer par Choiseul un prêtre français pour achever l’éducation de l’enfant. Déjà Noverre lui donnait des leçons de danse et de maintien et lui apprenait la révérence de Versailles. On allait embellir et perfectionner à la française la princesse de treize ans sur qui reposaient maintenant tant d’espérances politiques.
À cette époque même surgissait à la Cour de France une intrigue insignifiante au début, mais qui menaçait promptement de devenir grave et d’avoir des conséquences sur la marche du gouvernement. Le courrier diplomatique à destination de Vienne, qui partait de Fontainebleau le 1er novembre 1768, en emportait les premières nouvelles. Il vaut de s’y arrêter en détail, car aucun épisode ne permet de peindre mieux au vif le milieu auquel Marie-Antoinette est destinée.
Pendant le mois de juillet, la Cour étant allée à Compiègne après la mort de Marie Leczinska, le bruit s’était répandu que le Roi avait une liaison un peu plus sérieuse que celles dont il avait coutume. La dame occupait dans la ville une maison particulière où elle restait enfermée toute la journée ; à minuit elle arrivait au château et on la voyait sortir chaque matin des cabinets du Roi, sa chaise suivie de deux domestiques en livrée. Peu de personnes surent le nom de cette femme mystérieuse, qui se faisait passer pour mariée. La plupart supposèrent que le premier valet de chambre Lebel, pourvoyeur ordinaire de Sa Majesté, avait amené quelque bourgeoise en quête d’argent, comme il en avait passé plus d’une au Parc-aux-Cerfs. C’était d’ailleurs le dernier service que rendait à son maître le fidèle personnage : il mourait assez brusquement, pendant ce voyage de Compiègne, laissant, à ce qu’il semblait, au duc de Richelieu le soin de s’occuper de la belle. Mais le vieux courtisan, si souvent le complaisant des débauches royales, se montrait cette fois assez réservé et peu porté à donner des détails sur cette aventure.
Quand M. de Choiseul arriva, huit jours après l’installation de la Cour, M. de Saint-Florentin le mit au courant des choses, ajoutant certains détails, qu’il avait eus par le lieutenant de police de Paris : « Nous déplorâmes, raconte Choiseul, la crapule à laquelle le Roi se livrait, mais d’ailleurs nous ne pensâmes point qu’une intrigue aussi basse pût avoir d’autres suites que celles de la fantaisie du moment ; nous souhaitâmes entre nous que le Roi s’en portât bien et que ce fût le dernier trait dont nous fussions témoins de son goût pour la mauvaise compagnie. » Le tout-puissant ministre s’inquiéta d’autant moins de la durée de cette passade qu’il se rappela avoir eu, quelques semaines auparavant, la personne en solliciteuse dans son cabinet et l’avoir trouvée « médiocrement jolie ».
On avait su gré à Louis XV d’avoir montré quelque discrétion extérieure pendant le deuil de la famille royale et de la Cour, et on supposa qu’il en serait de même dans le voyage suivant de Fontainebleau. D’ailleurs la lassitude, qui venait vite, pouvait avoir déjà renvoyé la dame à son mari, avec le « bon du Roi » ou « l’acquit-au-comptant » ordinaire. Mais le Roi n’avait décidément pas, en cette matière, les mêmes goûts que son ministre ; sa passion était même devenue assez forte pour qu’il ne pût la cacher davantage. M. de Mercy envoyait au prince de Kaunitz, assez curieux de ces anecdotes, toute une chronique scandaleuse, peu faite pour réjouir l’Impératrice Marie-Thérèse, sur les mœurs persistantes de l’allié royal. La dame de Compiègne, écrivait l’ambassadeur, « est logée au château, dans la cour dite des Fontaines, à côté de l’appartement qu’occupait Mme de Pompadour ; elle a un nombre de domestiques ; ses livrées sont brillantes et, les jours de fête et de dimanche, on la voit à la messe du Roi, dans une des chapelles au rez-de-chaussée, qui lui est réservée ».
C’était bien une favorite qui s’annonçait. Ses carrosses et la pimpante chaise à porteurs dont elle se servait dans l’intérieur du château portaient, tout fraîchement peint, le double écusson des femmes mariées. Elle s’était procuré un titre entre les deux voyages : c’était maintenant la comtesse du Barry, femme d’un comte Guillaume qui ne paraissait pas et qu’on avait fait venir, disait-on, de Toulouse, pour y retourner aussitôt après avoir épousé.
Ce nom, rattaché pour la circonstance aux Barry-More d’Irlande, de qui on avait pris les armes et la devise, était un nom obscur de noblesse de province, qui avait auprès de certaines gens une notoriété assez fâcheuse. Tout ce qui fréquentait les sociétés libres de Paris, les tripots de jeu et les « boucans11 », connaissait Jean du Barry, qu’on voyait même quelquefois à Versailles, dans les bureaux de la Guerre, à cause des fournitures de vivres à l’armée de Corse dans lesquelles il était intéressé. Il justifiait son nom de « Roué » par sa façon de fréquenter les boutiques où trônent les filles de modes et de s’intéresser au sort des plus jolies ; au reste, gentilhomme aussi dépourvu de scrupules que d’argent et qui, obligé de vivre de son industrie, faisait en somme un commerce qui ne dérogeait point.
L’histoire de la nouvelle venue se précisait tout à coup et le nom du Roué l’éclairait d’une parfaite lumière. Elle s’était appelée chez lui Jeanne Vaubernier12 ; depuis quatre ans elle tenait sa maison, rue de la Jussienne, et faisait les honneurs de son salon de jeu, suivant ce genre de conventions qu’on appelait alors « mariage à la détrempe ». Le Roué était un maître sans jalousie ; beaucoup de gens de la Cour, M. de Fitz-James entre bien d’autres, pouvaient témoigner qu’il suffisait de payer son écot pour souper dans le ménage. Jamais le Roi n’était aussi bas tombé ; jamais cependant les espérances qu’éveille en une cour toute apparence d’intrigue sérieuse n’avaient été plus cyniques ni plus affichées. Le véritable organisateur se découvrait, mettant au second plan Du Barry et ses complices : comme mentor et protecteur de la favorite apparaissait le maréchal duc de Richelieu.
Le héros de la galanterie du siècle, devenu vieux et laid sans cesser d’être libertin, capricieux et violent chez lui, se faisait aimable et souple auprès du Roi, à qui la conduite crapuleuse de ce compagnon septuagénaire apportait la flatterie d’une excuse. Mais il y avait en lui un ambitieux avorté qui, pour quelques campagnes heureuses et braves et une médiocre ambassade, s’était cru les talents d’un homme d’État. Dans cet emploi de premier gentilhomme de la Chambre qui le plaçait sans cesse aux côtés du maître, mais dont les plus sérieuses fonctions consistaient à gouverner l’Opéra, Richelieu souffrait de n’avoir jamais pu exercer largement cette activité brouillonne qu’il prenait pour du génie. Il accusait Choiseul de ses mécomptes : « M. de Richelieu, écrit celui-ci, m’a cru jaloux de lui, et je ne lui ai pas fait l’honneur de l’être. » Avec moins de dédain pour les petites causes, le ministre eût deviné que, sous l’affaire galante menée avec tant de zèle, se cachait l’obstinée pensée d’une revanche.
Richelieu avait senti que l’occasion était venue, et la dernière sans doute que l’âge du Roi lui permît d’espérer. Les circonstances lui donnaient une clairvoyance impossible chez ses adversaires et dont il sut profiter. Il connaissait depuis longtemps Jeanne Vaubernier, et les faiblesses de son maître, et ce qui pouvait, dans les agréments de l’une, attacher et retenir les vices de l’autre. Dès le début, il mit sur cette liaison l’enjeu de sa fortune politique. Il eut un plan et ne se donna pas la peine de le dissimuler. Ce plan était d’accord avec celui de Jean du Barry, qui ne voulait que de l’argent, mais s’était juré d’exploiter jusqu’au bout la chance extraordinaire qui avait amené un roi dans sa clientèle.
Une de leurs forces venait de ce qu’on connaissait mal au dehors les ressources dont ils se servaient. Mme du Barry n’était point la « caillette » sans manières et sans esprit que les femmes de la Cour se décrivaient malignement les unes aux autres, n’ayant pour elle, disait-on, que son effronterie. Elle avait aussi l’intelligence avisée et quelque culture ; elle s’était affinée à voir chaque jour, et pendant des années, ces gentilshommes, ces gens de lettres, ces académiciens de belle humeur qui fréquentaient chez Du Barry. Avec l’intuition juste de sa situation, elle se mit à répéter les leçons de ses deux maîtres, qui l’engageaient à payer d’audace ; elle déclara qu’elle voulait remplacer Mme de Pompadour, et se crut une puissance, ce qui est une façon de le devenir. « J’appris, écrivait M. de Mercy, qu’elle commençait à se donner de l’importance, qu’elle parlait du gouvernement, des ministres, et des grands services que rendrait à l’État une favorite à portée d’éclairer le Roi sur les vices de l’administration actuelle ; j’appris de plus que cette femme s’attendait à être présentée publiquement à la Cour et qu’une cabale en sous-ordre, étayée de quelques personnages plus relevés, favorisait ce projet. »
Le duc de Richelieu, que Mercy ne nomme pas encore, est le seul personnage à qui ait pu venir la pensée d’une présentation aussi peu décente. Quelque excès d’imagination qu’on prête à Jean du Barry, il savait l’existence et l’usage des rapports de police, et n’eût pas tout d’abord élevé aussi haut les espérances de Jeanne Vaubernier. Richelieu, au contraire, avait réalisé en sa vie les romans les plus extraordinaires, et ne croyait rien d’impossible à son étoile ; il allait, de plus, prendre son tour de service comme premier gentilhomme et avoir dès lors, pendant une année, la charge des présentations. On s’explique fort bien qu’il ait conseillé le mariage avec Guillaume du Barry.13 Après le contrat dressé le 23 juillet 1768, et surtout la cérémonie religieuse célébrée à cinq heures du matin, le 1er septembre, dans l’église Saint-Laurent de Paris, une grande sauvegarde était acquise : celle qu’aimait le Roi était à présent une femme de qualité, dont le renvoi devenait plus difficile et qui pouvait désormais servir d’appui à une coterie politique.
Il avait fallu, pour en arriver là, surmonter d’énormes obstacles et commettre une série de faux en écritures publiques comme on en a rarement réunis sur la même affaire. Les erreurs concernant l’époux ne sont que vantardise gasconne ; mais ce qui touche à l’épouse, son nom, sa naissance, sa famille, jusqu’à son âge, tout est mensonge, appuyé d’actes fabriqués de toutes pièces ou brutalement falsifiés. Jamais les complices n’auraient risqué les galères, ou même, comme il s’agissait de matières royales, la potence, si un grand et inattaquable personnage n’en eût pris la responsabilité. On peut même se demander si une autorité plus haute encore que celle du maréchal n’avait donné tout pouvoir pour agir au plus vite. Aucun papier, en effet, ne nous manque aujourd’hui sur ce scandaleux mariage ; tout a été découvert, discuté, contrôlé, sauf le point le plus intéressant et qui restera sans doute à jamais obscur.
Peut-on supposer que le Roi lui-même pensait dès cette époque à se faire « présenter » sa maîtresse ? Cela semble probable. Il devait désirer avoir sans cesse auprès de lui l’objet de sa passion ; or, sans que Mme du Barry eût été présentée, il était impossible au Roi de la faire monter dans ses carrosses, de manger avec elle en public, de la voir chez le Dauphin ou chez Mesdames, de lui donner place aux cérémonies. En outre, la tenir, sans l’avouer, à Versailles ou dans les autres châteaux, c’était humilier sa fantaisie, reconnaître des bornes à sa puissance, et Louis XV avait toujours cru, suivant le témoin qui l’a observé de plus près, « que l’éclat qu’il mettait dans ses amours était une preuve de son autorité14 ». Mais des barrières semblaient se dresser, qu’il avait rendues lui-même infranchissables.
La présentation, sollicitée par tant de dames, n’était accordée qu’à un petit nombre. Par une décision du 17 avril 1760, Louis XV avait réglé les conditions dans lesquelles cette faveur pouvait être demandée, « voulant, disait-il, à l’exemple des rois nos prédécesseurs, n’accorder qu’aux seules femmes de ceux qui sont issus d’une noblesse de race de nous être présentées ». Il exigeait la production, devant le généalogiste de ses ordres, des titres originaux ou en expédition par-devant notaire, par lesquels la filiation de l’époux serait établie clairement depuis 1400, sans robe ni anoblissement, « nous réservant au surplus, ajoutait l’édit, d’exempter de cette règle ceux qui seraient pourvus de charges de la Couronne ou dans notre maison ». Il y a, aux archives de la Maison du Roi, des listes de demandes transmises à Louis XV par les premiers gentilshommes de la Chambre ou le premier écuyer ; ce sont des femmes d’officiers de mérite, de nobles anciens ; elles sont recommandées par un ministre, un aumônier du Roi ou telle autre autorité de la Cour. Le Roi renvoie les noms à Clairambault, son généalogiste, et très souvent les raye lui-même impitoyablement d’un « Non » cruel ou d’un « Qu’on ne m’en parle plus », qui a dû jeter au désespoir bien des vanités féminines.
Si rigoureux sur le chapitre de la naissance, croyant racheter sa licence privée par une ferme observation des étiquettes, l’amant de Mme du Barry, avec son habitude de calculer à l’avance les suites lointaines de ses actions, semble avoir tout prévu, en consentant à son mariage, pour le jour où il serait tenté de la recevoir à la Cour. La famille dans laquelle elle est entrée est dans les conditions requises pour que les femmes en soient présentées ; le titre de comte reste douteux, mais les preuves de trois cents ans de noblesse ont été faites en divers cas récents, pour l’École militaire, par exemple, et les pages de la Chambre. L’incorruptible Clairambault n’aurait sur le nom des Du Barry aucune objection à faire, et nul règlement, par ailleurs, ne s’est avisé de prévoir le cas d’indignité de la femme.
Voyant son ennemi Richelieu dans cette intrigue, M. de Choiseul avait affecté de la traiter avec mépris et de n’y attacher nulle importance. Mais des esprits plus sérieux y sentaient une menace redoutable et devinaient, par derrière, le duc d’Aiguillon,15 neveu de Richelieu, désigné déjà par la cabale dévote comme le successeur nécessaire de Choiseul. Ainsi s’inquiétèrent notamment les ambassadeurs du roi d’Espagne et de l’Empereur, MM. de Fuentes et de Mercy, plus intéressés que personne à ce qu’aucun changement politique ne se produisît à la Cour de France. M. de Mercy, d’ailleurs, croyait avoir en mains un moyen de parer aux événements dans un projet de marier le Roi, dont lui avait précédemment parlé Choiseul ; celui-ci avait même prononcé le nom de l’archiduchesse Élisabeth, une des sœurs aînées de Marie-Antoinette.
Pendant la dernière maladie de Marie Leczinska, écrivait Mercy à Kaunitz, « chacun conjectura que le Roi, porté à une réforme dans ses mœurs, songerait peut-être, en cas de veuvage, à s’unir à une épouse jeune et aimable qui pût lui procurer le repos de la conscience et le bonheur du reste de ses jours. Cette idée s’établit dans le public ; le Roi en fut informé, et je sais de M. de Choiseul que ce monarque, en le questionnant un jour relativement à ce propos du public, ne donna cependant point à connaître à son ministre ce qu’il en pensait lui-même. » Louis XV avait bien mal répondu à ces honnêtes espérances ; mais on pouvait essayer de les lui présenter encore, pour peu que le ministre s’y prêtât. Mercy y travailla dès Fontainebleau, non directement, mais par Fuentes, tout dévoué à la politique autrichienne et représentant autorisé du Pacte de Famille.