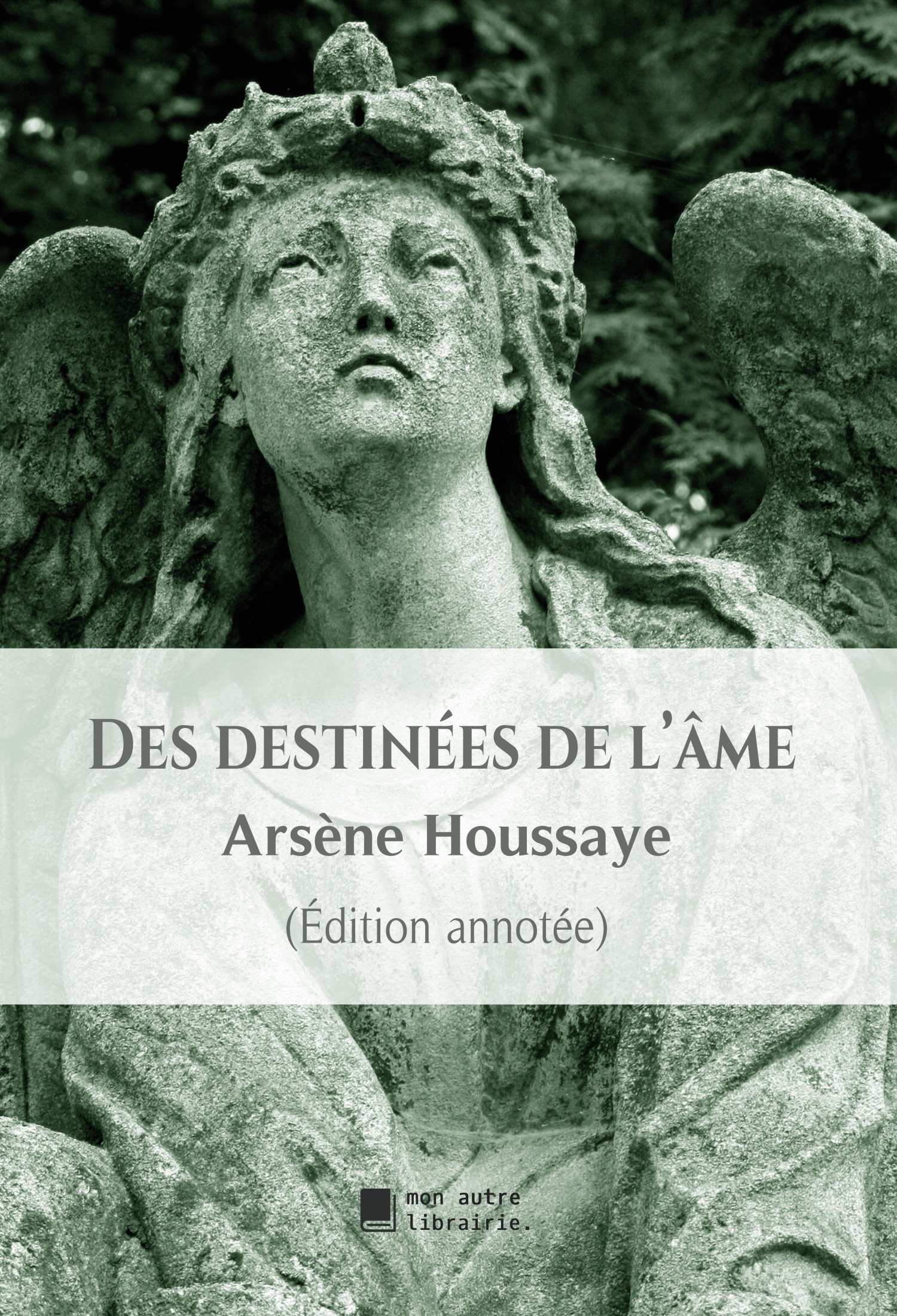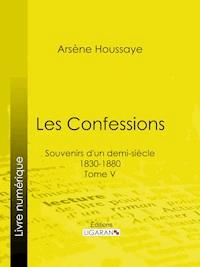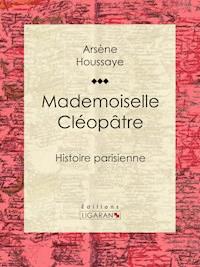
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Ce jour-là, le 5 juin 1863, mademoiselle Cléopâtre, à peine éveillée, se coucha voluptueusement dans sa victoria attelée en demi-daumont. Il était trois heures ; le soleil, contre son habitude, répandait ses gerbes d'or sur Paris ; la gaieté éclatait en mille rayons. Ceux qui n'avaient rien à faire prenaient leur part au soleil."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335040401
©Ligaran 2015
Ce jour-là, le 5 juin 1863, mademoiselle Cléopâtre, à peine éveillée, se coucha voluptueusement dans sa victoria attelée en demi-daumont. Il était trois heures ; le soleil, contre son habitude, répandait ses gerbes d’or sur Paris ; la gaieté éclatait en mille rayons. Ceux qui n’avaient rien à faire prenaient leur part de soleil.
La victoria était emportée par deux admirables chevaux, crinières aux vents, yeux de feu, fiertés de race, fronts indomptables. Et pourtant ces diables à quatre, trente-six quartiers de noblesse, étaient domptés par un écuyer de seize ans qui avait tout l’air de M. de Cupidon poudré à frimas, casaque bleu de ciel, casquette rayée d’or, bottes à la Souwaroff qui rappelaient, d’un peu loin, celles du chat botté.
– Mes beaux chevaux ! dit mademoiselle Cléopâtre ; comme ils vont désespérer mes ennemis aujourd’hui !
Elle promenait plus encore ses chevaux qu’elle-même.
Et elle se pencha à droite et à gauche pour voir les robes noires des deux merveilleuses bêtes qui dévoraient l’espace avec un entrain et une fierté dont s’émerveillaient messieurs les chevaliers du turf. Près de l’Arc de Triomphe, comme on venait d’arroser avec abondance, l’un d’eux fut éclaboussé et se retourna furieux ; mais dès qu’il reconnut l’attelage de mademoiselle Cléopâtre, il salua et s’écria avec enthousiasme :
– Ah ! Stradella et la Pluie-qui-Marche ! les plus belles bêtes de Paris !
Mademoiselle Cléopâtre était allée elle-même en Angleterre pour acheter ses chevaux. Les railleurs, tout en les estimant très haut, disaient qu’ils ne lui avaient pas coûté cher. Ils lui avaient coûté deux mille livres sterling, sans compter quelques poignées de napoléons jetées aux valets d’écurie et aux maquignons ; il est vrai que la main de Cléopâtre était si petite !
À Chantilly, aux dernières courses, on lui avait offert, au nom d’un prince – qui désirait garder l’anonyme, – cinquante mille francs de ses deux chevaux. Elle avait répondu : – Ni pour or, ni pour argent ; j’aimerais mieux me séparer de mon amant que de mes chevaux. – Je vous crois sans peine, avait dit l’ambassadeur du prince ; mais, si vous voulez, vous ne vous séparerez pas de vos chevaux. Ils seront encore à vous, seulement ils vous conduiront par un autre chemin.
Mademoiselle Cléopâtre avait refusé du même coup le prince et ses cinquante mille francs, ce que mademoiselle Chantilly et la Dame de Carreau trouvèrent outrecuidant : – les femmes ne comprenant pas les femmes qui ont un quart d’heure de vertu.
Mademoiselle Cléopâtre descendait l’avenue de l’Impératrice avec ce beau dédain qui la relevait presque de ses chutes. À peine répondait-elle par un sourire perdu à tous les saluts que les jeunes gens lui offraient au passage, pour se prouver – les fats –qu’ils étaient fort de ses amis, – illusion qui ne trompait qu’eux-mêmes.
Elle fermait à demi ses beaux yeux, jouant des paupières et des cils comme d’autres jouent de l’éventail. En descendant de sa chambre à coucher pour monter dans sa Victoria, elle n’avait fait que changer de lit. On eût dit qu’elle poursuivait un songe amoureux après un sommeil interrompu. Elle pensait peut-être tout simplement au mémoire de sa blanchisseuse. Les jeunes gens qui la voyaient ainsi enviaient tous son amant, et se demandaient par quelle force invisible M. Max Auvray régnait despotiquement sur ce cœur rebelle et cet esprit impérieux.
Cléopâtre n’était pas précisément le nom de baptême de la dame. On vous dira bientôt son histoire d’hier. – Une fille bien née, – une cantatrice, – une grande dame, – une courtisane. – On peut déjà vous dire pourquoi elle portait le nom de la reine d’Égypte, quoiqu’elle fût de Troyes en Champagne.
Elle avait une passion pour les perles, – non pas toutefois jusqu’à en faire dissoudre quelques-unes pour son déjeuner. Elle aimait les perles comme d’autres aiment les roses, – les chiffons, – les dentelles, – le vin de Chypre, – le jambon d’York et autres agaceries des yeux et des lèvres. Comme elle le disait à la Dame de Carreau, elle couchait seule, mais jamais sans son collier à trois cents perles, la merveille des deux mondes. Elle sentait vivre ses perles sur le satin de son beau cou, elle frissonnait voluptueusement sous les caresses froides de ces filles de la mer.
Les perles de Cléopâtre étaient du plus bel orient ; elles venaient du golfe Persique, comme les belles filles viennent d’Arles, de Rome ou de Venise. Elles avaient enrichi trois pêcheurs des îles d’Ormuz. Le Hollandais qui les vendit à l’amant de Cléopâtre lui dit que c’étaient des perles de reines ou des reines de perles.
Cléopâtre adorait ses perles parce qu’elles étaient incomparables et parce qu’elles étaient venues, toutes virginales, caresser son cou. Porter un collier qui a fait mille fois depuis cent ans le tour du monde et le tour des femmes, c’est peut-être le luxe des orgueilleuses, mais sentir rouler sur son cou cette rosée toute fraîche tombée du sein de Vénus, c’est le luxe des Cléopâtres.
– Et pourtant mon vrai collier de perles, disait Cléopâtre avec un sourire plus railleur que cruel, ce sont les larmes que j’ai fait répandre.
Aux premiers arbres du bois, mademoiselle Cléopâtre se croisa avec la Dame de Carreau qui avait dans sa calèche mademoiselle Chantilly, surnommée la Taciturne, un miracle de bêtise humaine.
Cléopâtre permettait à ces demoiselles de lui parler, parce qu’elles étaient fort belles et qu’à son point de vue la beauté était un brevet de noblesse.
– Ah ! voilà Cléopâtre, s’écria Chantilly.
Et d’un coup d’ombrelle elle fit signe à son cocher d’arrêter court.
Mademoiselle Cléopâtre voulait passer outre, mais la Dame de Carreau donna, d’un air décidé, l’ordre d’arrêter Stradella et la Pluie-qui-Marche.
– Pourquoi me réveilles-tu ? demanda mademoiselle Cléopâtre.
– Parce que le feu est à la maison, répondit la Dame de Carreau.
– Chut ! murmura mademoiselle Cléopâtre ; ne vas-tu pas conter nos aventures à tous les échos d’alentour ? Tu ne vois donc pas que ces coqueluchons écoutent aux portes ?
– Voilà un mot qui restera, dit la Dame de Carreau, en regardant les cavaliers qui s’étaient approchés.
– Je saute dans ton carrosse, dit la Taciturne.
– De grâce, ma chère, mon lit est si étroit ! Tu sais bien que je me couche toujours seule.
– Je ne doute pas que tu ne te couches toujours seule, mais tu te coucheras d’autant plus seule cette nuit que ton amant sera ce soir à Clichy.
– Max !
– Oui, Max. Tu croyais que tous les chercheurs d’or travaillaient pour lui, mais la Californie lui est fermée.
– Qui t’a dit cela ?
– Mon argent de change.
– Lequel ?
– Est-ce qu’elle le sait ? dit la Dame de Carreau ; tous les agents de change font des affaires avec Chantilly.
Mademoiselle Cléopâtre ne put s’empêcher de sourire, mais la Taciturne dit en se mordant les lèvres :
– Tous les agents de change ne font pas des affaires avec Max.
– À cette heure, reprit la Dame de Carreau, je n’en sais pas un seul qui voulût acheter ou vendre pour lui trente-six mille à prime, dont cinq sous. Il avait trop compté sur la baisse ; moi, je ne jouerai jamais qu’à la hausse. Songez donc qu’il avait vendu cinq mille mobiliers à mille cinquante, les uns à terme, les autres dont vingt et dont dix ; on n’est pas plus imprudent.
– Comment, dit mademoiselle Cléopâtre, Max jouait à la Bourse ?
– Tu n’en savais rien ! s’écria la Dame de Carreau. T’imaginais-tu donc qu’il remuât des millions en ciselant, comme son père, un bracelet pour moi ou un plat d’argent pour t’offrir son cœur ?
– Je n’y avais pas songé, dit Cléopâtre avec ce beau naturel des femmes qui ne s’inquiètent jamais d’où vient l’argent ni où va leur vertu.
Les courtisanes s’imaginent que l’or doit venir à elles comme le soleil aux roses, comme la lune aux amoureux, comme le fleuve à l’Océan.
– À propos, dit Chantilly, tu n’oublies pas que je donne ce soir un souper de la décadence.
– À la bonne heure, dit la Dame de Carreau, tu commences à profiter de mes vocables.
– J’irai, dit Cléopâtre.
Sur un signe au postillon, Stradella et la Pluie-qui-Marche s’envolèrent vers la rivière. Cléopâtre reprit ses airs à la fois victorieux et penchés, regardant du haut de son dédain les enthousiastes et les critiques de sa beauté.
Quand la Victoria fut au bord de la rivière, deux jeunes cavaliers, le duc Guy de Chavailles et le comte Rodolphe de Marcillac, qui revenaient de Jérusalem et qui sans doute ne voulaient pas retourner en terre sainte, aventurèrent leurs chevaux pour mieux voir Cléopâtre.
– Tu la connais ? dit le duc à son ami.
– Non, répondit le jeune homme en cachant son émotion.
– L’autre soir elle a chanté les grands airs de Verdi et de Meyerbeer.
– Oui, comme la Patti. Elle a passé trois ans à Milan et à Naples.
– C’est singulier, reprit le duc, elle est si belle qu’elle me fait peur.
– Quelle idée ! C’est mademoiselle Léonie qui te fait peur ? Depuis quand as-tu peur d’une belle femme ?
– Depuis que j’ai lu un proverbe arabe dans le Dictionnaire de M. Littré ; écoute : La beauté est un navire qui jette toutes les marchandises à la mer.
– Ce qui ne l’empêche pas de faire naufrage. Sais-tu ce qui arrivera un jour, c’est que Cléopâtre se jettera en pleine mer et que je m’y jetterai avec elle.
– Donc tu la connais ?
– Eh bien, oui, j’ai été son premier amant et je serai le dernier.
Rodolphe s’était singulièrement attristé.
– Pourquoi as-tu passé la main ?
– Parce que je ne connaissais pas mon jeu.
– Et pourquoi ne vas-tu pas à elle aujourd’hui, si tu l’as aimée hier, – si tu l’aimeras demain ?
– Parce que aujourd’hui il y a entre nous une montagne, un volcan, un océan, que sais-je !
– Pas de phrases, il y a un homme.
– S’il n’y avait que cela !
Le jeune comte exprima un dédain superbe.
– Dis-moi, est-ce que c’est vraiment une femme hors ligne ?
– Oui, comme Cléopâtre.
– Pourquoi l’a-t-on surnommée Cléopâtre ?
– Je ne sais pas. Elle se nomme Angèle. Elle ne pouvait pas se nommer Angèle dans le monde où elle vit.
– J’aime mieux Cléopâtre. Pour conserver la fraîcheur de sa maîtresse, Bolingbroke lui donnait des faisans nourris de sang de vipère. Dans la beauté de toutes ces courtisanes il y a du sang de vipère. Quand l’aspic mordit le sein de la vraie Cléopâtre… Tu ne m’écoutes pas, Rodolphe ?
– Je t’écoute, mais je suis indigné de ce mot : courtisane. C’est une cantatrice.
– Qui a perdu sa voix et qui fait chanter ceux qui l’aiment.
– Courtisane ! Va donc lui offrir ton cœur et ta bourse ! Et d’ailleurs, où commence, où finit la courtisane ? Elle commence à Sappho et à Aspasie, elle finit à Ninon de Lenclos et à Sophie Arnould. Elle va du libertinage de l’esprit à celui du cœur, en passant par le vrai libertinage, comme Marion Delorme. Mais combien qui ont eu les heures de sainte Thérèse ! Sache bien qu’on ne peut pas dire de la Cléopâtre qui va passer devant nous que c’est un carrosse de Brion qu’on loue à l’heure ou à la journée pour prendre, à La Marche ou à Longchamp, des airs de marquis. La Cléopâtre est tout une, elle se donne et ne se vend pas.
– Et qui donc lui paye ses robes et ses chevaux ? Elle a un hôtel rue du Cirque et un château je ne sais où.
– Tu t’imagines qu’elle a tout cela ! Elle est dans tout cela, mais elle n’a rien. Tu la verras tout abandonner à sa prochaine fantaisie. Pour quelques femmes, l’amour c’est l’argent ; pour quelques autres, c’est la curiosité ; pour elle l’amour, c’est l’amour.
Cléopâtre venait de dépasser les deux cavaliers.
– Elle ne t’a pas vu, dit le duc à son ami.
– Elle me croit au bout du monde. Mais je lui ai écrit aujourd’hui.
– Conte-moi donc cette histoire.
– Non. Puisque tu as cité les Arabes, je vais te dire aussi un de leurs proverbes ; « Ne parle jamais de ton voisin, mais parle encore moins de toi. » D’ailleurs, les histoires amoureuses ne sont bonnes que pour celui qui se les conte à soi-même. – Quand tu rencontreras Cléopâtre, demande-lui son histoire, son histoire c’est la mienne.
– Sais-tu, dit le duc, je trouve qu’elle ressemble prodigieusement à la marquise Vittoria Cavoni.
– Es-tu fou ! La marquise est brune et Cléopâtre est blonde.
– Oui, mais dans l’air de tête, dans la profondeur du regard, dans je ne sais quoi d’étrange et d’attractif, je reconnais la marquise.
– Tu as peut-être raison ; mais je l’ai à peine vue un soir chez ta cousine et un matin à Sainte-Clotilde.
– Crois-tu à la fatalité ?
– Oui, puisque je ne fais jamais ce que je veux faire.
– Eh bien, ces deux femmes, celle que j’aime et celle que tu aimes, voilà notre destinée. Tout ce qu’elles feront contre nous, tout ce que nous ferons pour elles, c’est écrit là-haut !
Mademoiselle Cléopâtre était belle comme la beauté. Les plus graves ne voyaient pas sans émotion ses beaux cheveux vénitiens ondés à la grecque, ses yeux bleus profonds comme le ciel et voilés par de longs cils bruns, sa bouche voluptueusement entrouverte, ses grâces de roseau penché, l’exquise distinction de son sourire, qui tempérait la sereine fierté de son regard. Vue de profil, c’était la beauté des statues ; mais vue de face, Cléopâtre se féminisait : c’était la femme trois fois vivante qui portait sur sa figure toutes les passions de son temps.
On la trouvait un peu pâle dans ses moments de repos, dans ses heures de rêverie ; mais dans ses réveils, le sang s’annonçait doucement sur ses joues comme les premières teintes de l’aurore sur le ciel froid du matin.
Ce n’était pas cependant « la beauté incomparable des héroïnes de roman. » Plus d’une chose en elle la désespérait, mais elle avait l’art de cacher ses défauts. Un grain de petite vérole volante qui avait marqué au coin des lèvres était devenu, sous son pinceau savant, un grain de beauté « d’un charme irrésistible, » selon l’expression stéréotypée d’un de ses adorateurs.
Un de ses sourcils avait été un peu brûlé ; mais elle le peignait si bien, qu’il eût fallu la regardera la loupe pour reconnaître l’art dans la nature.
Pourquoi ces critiques ? Comme disait si bien M. de Voltaire, il n’y a que les petits esprits qui constatent les imperfections des chefs-d’œuvre ; or, mademoiselle Cléopâtre était un chef-d’œuvre.
C’était plutôt une Junon qu’une Vénus, une duchesse qu’une courtisane. Elle avait les nonchalances voluptueuses, mais elle avait les fiertés indomptables. Ce qui frappait en elle au premier abord, c’était, la majesté. On disait d’elle, tout en la jugeant de haut : « Elle a du sang et de la race. » D’où cela lui venait-il ? C’est là le miracle des destinées. Dieu crée des reines où il lui plaît, sans consulter le livre héraldique. Le plus souvent, les courtisanes ne sont pas nées sur les marches d’un trône, ce qui ne les empêche pas d’être de siècle en siècle les plus rares exemplaires de la beauté humaine, de la beauté corporelle, de la beauté visible. Les femmes du monde, les femmes du peuple qui ne courent pas les hasards de l’amour ne sont pas déshéritées pour cela ; elles ont la beauté immatérielle et divine, celle qui resplendit sous les rayons de l’âme.
Il faut bien le dire, la nature ne finit pas son œuvre, elle ébauche largement, elle oublie dans sa rapidité d’exécution certaines nuances qui parachèvent. On sent le pouce du grand sculpteur, mais l’art humain ne nuit pas à l’art divin. Or, les courtisanes ont cet art inné de corriger les fautes de l’auteur : l’une en inventant pour sa chevelure des gerbes opulentes ou des coiffures de statues ; l’autre en accusant, par un crayon savant, un sourcil mal dessiné ; celle-ci en apprenant le sourire amoureux ou en jouant la malice provocante ; celle-là en retrouvant, à force de chercher des poses, les grands airs des déesses et cette grâce plus belle encore que la beauté. Et je ne parle pas du génie de s’habiller, que toutes possèdent, les unes à force d’argent, les autres par cet instinct des coquetteries qui leur vient même avant d’aimer.
Ceux qui vivent à Paris dans la région des enfants prodigues et des courtisanes, – vieux mots qui seront toujours nouveaux, – se souviendront longtemps du luxe inouï de cette Cléopâtre qui amenait à ses pieds les plus dédaigneux. Dès qu’elle se fut montrée, dès qu’elle eut levé le masque, elle régna impérieusement par sa beauté et par son esprit. Elle gouverna la mode. On ne jurait que par elle ; c’était le plus admirable scandale qui eût jamais désespéré les femmes du monde. Ce qu’il y avait de merveilleux, c’est qu’elle les désarmait par sa suprême distinction. On disait d’ailleurs, sans trop savoir son origine, que c’était une fille bien née qui se vengeait d’une trahison.
Elle avait eu l’esprit, de mettre les artistes et les gens de lettres de son parti. C’étaient d’ailleurs ses alliés naturels. Mademoiselle Cléopâtre était musicienne comme les Garcia, et elle dessinait comme madame Henriette Browne.
Voulez-vous savoir comment mademoiselle Cléopâtre était habillée ce jour-là ?
Elle régnait sur les couturières et les modistes célèbres avec le despotisme, le caprice et la fantaisie de la beauté qui a toujours raison, quoi qu’elle fasse. Cléopâtre, d’ailleurs, qui peignait au pastel avec un vrai sentiment de la ligne et de la couleur, se fût bien gardée, quand elle commandait une robe ou un chapeau, d’indiquer des formes extravagantes et de choisir des tons tapageurs.
Elle posait pour la simplicité ; seulement c’était la simplicité d’une duchesse qui a trois cent mille livres de rente ; elle dédaignait les étoffes à ramages, qui, pour beaucoup, sont le miroir aux alouettes ; elle se contentait des étoffes d’une seule teinte, mais tout le monde se demandait où elle les trouvait, tant c’étaient des merveilles par l’éclat et le velouté, par la majesté des plis, par la splendeur des effets.
On ne les trouvait pas, ces admirables étoffes ; depuis plus d’un an déjà on travaillait pour Cléopâtre seule les plus belles soies et les plus beaux velours. Plus d’une femme du meilleur monde avait beau courir les magasins, écrire à Lyon et à Londres, elle perdait son temps.
Une actrice célèbre, jalouse des robes de la courtisane, s’imagina qu’elle lui prendrait son secret en lui prenant sa femme de chambre ; mais Cléopâtre était impénétrable même pour sa femme de chambre.
Son art de s’habiller s’étendait à tout ; elle se fût trouvée fort mal mise dans une voiture de mauvais style avec des chevaux d’occasion. Il fallait toujours que le cadre fût digne du tableau. Elle avait transformé tous les carrossiers. Les turfistes les plus renommés étudiaient son regard quand ils produisaient au Bois quelque attelage hors ligne. Quand on pouvait dire : « La Cléopâtre donnerait bien vingt mille francs de mes deux chevaux, » on croyait que tout était dit.
Et avec quelle éloquence elle développait sa théorie du luxe et du style en toutes choses ! Faut-il descendre aux détails ? Ce jour-là, la Dame de Carreau était affublée d’une robe tapageuse aux larges envergures et à la queue invraisemblable, une avalanche de taffetas qui eût habillé une demi-douzaine de pauvres filles. Cléopâtre, au contraire, portait une robe aux nuances fondues rose et blanche, d’une coupe discrète, qui prouvait que, tout en s’inquiétant des accessoires, le portrait devait dominer le cadre.
– N’est-ce pas, lui dit la Dame de Carreau, que ma couturière a de belles inspirations ?
– Oui, ta robe est tout un monde, mais elle est hors de saison, puisque tu n’as pas de nègre pour porter ta queue.
Au premier aspect, les chapeaux de Cléopâtre étaient comme tous les chapeaux du monde ; mais, ainsi que pour les robes, elle avait ses couleurs. Et ses fleurs, dans quel jardin féerique les cueillait-elle ? Et ses plumes, où était l’oiseau de paradis perdu qui les lui apportait ? Qui donc avait l’art de nouer ainsi les rubans ? Et quelle fraîcheur ! Combien d’heures durait ce magique travail de quelque fée parisienne ? Tous les dimanches, la marchande à la toilette venait acheter sept chapeaux à sa fille de chambre.
Et à propos de coiffure, dirai-je avec quel goût charmant elle éparpillait en gerbes prodigues ses cheveux sur son front ? On voyait bien qu’elle avait étudié les statues antiques. Elle n’avait garde de se découvrir les tempes ; ses bandeaux ondoyaient jusqu’à ses sourcils et baignaient même le coin de ses yeux, ce qui donnait à ses regards je ne sais quoi de voilé, de voluptueux, de corrégien. Zeuxis a représenté ainsi Vénus. Baudry dit un jour à Cléopâtre : « Quelle belle Diane sous la ramée je peindrais en vous regardant, si vous vouliez dénouer un peu vôtre ceinture pour moi ! » Mais Cléopâtre lui répondit : « Je ne pose pas même devant l’Amour. »
Mademoiselle Cléopâtre fit deux fois le tour de la rivière avec son beau dédain et ses attitudes impérieuses.
Les femmes du monde la regardaient avec fureur, disant presque toutes :
– Cette créature !
La vieille madame de ***, qui était avec son cousin le hussard, lui dit ingénument :
– Voilà pourtant, mon cher Arthur, les demoiselles pour qui nos maris nous abandonnent.
Le hussard rit dans sa moustache, en pensant qu’il abandonnerait volontiers sa cousine pour mademoiselle Cléopâtre.
La femme du banquier *** fit un bleu à son mari, parce qu’il se retourna afin de voir plus longtemps la belle nonchalante.
– Si c’est pour cela que tu viens au Bois !
– Les beaux chevaux ! dit le mari prudent, qui ne voulait pas que le soir sa maîtresse pût lui demander qui l’avait tatoué ainsi.
Le dernier salon, c’est le bois de Boulogne. C’est là que les belles promeneuses de l’an de grâce 1864 se font des visites de quatre à six heures. Elles se saluent d’un sourire, elles se parlent d’un regard, et tout est dit. Et que voulez-vous dire de plus ? N’y a-t-il pas le grand et le petit journal ? Tout ce qu’on pourrait conter le soir est imprimé le matin. Ce qu’on n’imprime pas se lit sur la voiture, sur la robe, sur le chapeau, sur la physionomie des promeneuses. Si on est dans son coupé, c’est qu’on a ses raisons pour n’être pas au grand jour. Si la robe est claire, c’est que le cœur est en fête. Si le chapeau a un voile, c’est qu’on cachera quelque chose à son prochain. Si la physionomie est triste, c’est que le rendez-vous du hasard est manqué. Je n’indique que l’alphabet de la langue du Bois. C’est mieux qu’un spectacle dans un fauteuil, ce spectacle dans une victoria, dans une calèche ou dans un coupé ! on remue sans faire un mouvement. On dort à demi, on rêve et on regarde. On épie la nouvelle du jour dans le vrai monde ou dans le mauvais monde. De quel côté est le plus joli scandale ?
Une vraie grande dame qui passait en landau salua Cléopâtre d’un charmant sourire bien connu dans la franc-maçonnerie des femmes.
Je dirai plus loin comment mademoiselle Cléopâtre et la duchesse d’Armailly avaient franchi l’abîme – jonché de roses – qui séparait leur blason.
Paris est comme une bibliothèque en désordre, où les livres les plus graves côtoient les romans les plus légers. Il reste à faire toute une géographie mondaine de Paris ; mais quel est le Malte-Brun qui pourra jamais marquer les limites des divers mondes dans ce flux et ce reflux où ils se confondent tous ? Combien de contrastes et combien de nuances ? Dans le meilleur monde, il y a du plus mauvais, dans les plus mauvais il y a du meilleur. Ces dames ne reçoivent pas ces demoiselles ; les comédiennes ne daignent aller que chez les femmes déchues, car la femme déchue garde toujours quelque chose de son origine. Le faubourg Saint-Germain ne reçoit pas le faubourg Saint-Honoré, qui ne reçoit pas la Chaussée d’Antin, qui ne reçoit pas le Marais. Les Champs-Élysées forment un monde à part, où l’on ne se reconnaît jamais, tant il y a d’étrangers. La haute galanterie s’y accentue depuis quelque temps, abandonnant le pays Notre-Dame des Lorettes aux danseuses du Château des Fleurs.
C’était aux Champs-Élysées que Cléopâtre avait fondé son despotisme.
Cléopâtre descendit de sa victoria pour aller émietter du pain aux cygnes. La Taciturne la rejoignit bientôt avec des gâteaux.
Qu’est-ce que la Taciturne ? C’est une grande fille, venue je ne sais d’où et qui va au même endroit. Elle est bête à faire peur, bête au point que si, à force de remuer des mots, elle finit par trouver un mot qui soit drôle, – comme ces gens qui, à force de jouer à la loterie, finissent par prendre un bon numéro, – elle se hâte de désavouer son mot, dans la crainte d’avoir dit une bêtise. Avec cela de la figure, un estomac d’autruche pour souper, des vices d’occasion ; au demeurant, la meilleure fille du monde.
– Pourquoi ces airs penchés ; lui dit Cléopâtre ? on dirait un saule pleureur qui a reçu un coup de vent.
– Ah ! ma chère, si tu savais comme je m’ennuie ! tous mes amis sont en voyage.
– Je t’ai vue hier aux Italiens, avec le duc d’H ***.
– Oui ; mais il m’a dit que j’avais décidément trop d’esprit pour lui tout seul. Il m’a plantée là, au beau milieu de la représentation.
Cléopâtre se mit à rire.
– Que lui avais-tu dit ?
– On jouait la Gazza ladra ; je lui ai demandé si c’était Alboni qui jouait le rôle de la Gazza ladra.
– Je comprends. Écoute, ma chère, veux-tu que je te donne de l’esprit ?
– Tu vas encore te moquer de moi.
– Non, je veux que tous ces fats qui rient quand tu parles soient bientôt stupéfaits de ta métamorphose. C’est si facile d’avoir plus d’esprit qu’eux.
– Comment faire ?
– Écoute-moi bien. Ta bêtise est de trop parler.
– Quand je ne disais rien du tout, on me trouvait bien plus bête encore.
– Eh bien ! à partir d’aujourd’hui, tu ne parleras ni trop ni trop peu ; retiens bien les quatre phrases que je vais t’apprendre ; c’est toute une grammaire, c’est l’alpha et l’oméga, c’est le premier et le dernier mot de l’esprit. Tu jures de ne pas dire autre chose que ces quatre phrases ?
– Oui.
– Eh bien ! retiens-les : – J’en accepte l’augure. – Question d’argent. – Ni oui, ni non. – Je suis désarmée. Avec ces quatre mots, tu peux répondre à tout. Et pour varier, tu chanteras par-ci par-là un air nouveau.
– Tu es folle. Comment veux-tu que je réponde à tout avec : Ni oui, ni non ?
– Chut ! voilà tout justement le prince Élim qui vient à nous ; essaye ton nouveau répertoire, tu verras comme il sera émerveillé de ton esprit !
– C’est une farce que tu me fais, mais je m’en moque. Voyons un peu.
Le prince salua, regarda à la dérobée si son monde ne le voyait pas, et marcha bravement en compagnie des deux demoiselles.
– Pas une allumette, dit-il en montrant un cigare.
Et comme il aimait les phrases, il ajouta :
– Je vais allumer mon cigare à l’enfer des yeux de Chantilly.
–Question d’argent, répondit-elle gaiement.
– Souperons-nous quelque soir ensemble ?
–Ni oui, ni non.
– Je ne comprends pas, ou plutôt je comprends. Savez-vous que vous faites votre stage dans la diplomatie ?
–J’en accepte l’augure.
– C’est cela, l’esprit et la beauté. On dit que c’est l’eau et le feu ; mais vous êtes bien la preuve du contraire.
–Je suis désarmée !
– Une femme n’est jamais désarmée, car elle a le diable qui est en sentinelle à sa porte, tandis que les pauvres hommes… Voyez-vous, là-bas, Edmond qui vous salue ? En voilà un qui est désarmé depuis sa bonne fortune.
La Chantilly se mit à chanter : Fallait pas qu’il y aille.
– Bravissima ! dit Cléopâtre à l’oreille de la Taciturne. Maintenant le silence est de rigueur. Cueille une marguerite et effeuille-la, pendant que je vais continuer la conversation.
La docile Chantilly cueillit une marguerite qui, comme elle, ne savait que quatre mots.
– Savez-vous, dit le prince à Cléopâtre, que Chantilly a presque de l’esprit ? on la disait si bête !
– Pas du tout ! dit tout haut la Taciturne en jetant la marguerite.
– Voyez, reprit le prince en souriant, comme elle est pleine d’à-propos.
– Mon cher prince, dit Cléopâtre, est-ce que vous avez trouvé une femme qui eût moins d’esprit que vous ? Les femmes ne sont pas ce qu’un vain peuple pense ! Je ne vois pas une petite fille, à sa dernière tartine de confiture, qui n’en remontrerait à son maître de danse. Chantilly était timide ; mais maintenant qu’elle a jeté son bonnet par-dessus, le balcon du café Anglais, elle a autant d’esprit que la première venue.
– Mais, en vérité, elle me plaît beaucoup aujourd’hui.
Et se tournant vers la Taciturne :
– Vous voilà devenue mélancolique. Pourquoi ? demanda-t-il.
–Question d’argent, répondit-elle.
– Eh bien ! je ne veux pas qu’un seul nuage passe sur ce beau front. Vous donnez ce soir une petite fête. Tenez, voilà mille francs pour les huîtres, mille francs pour les violons et mille francs pour être le dernier convive. Adieu, car on nous regarde, et je vais vous compromettre.
Chantilly regarda Cléopâtre avec enthousiasme.
– Oh ! ma chère amie, tu m’as sauvé la vie ! c’est la première fois que trois billets de mille francs se rencontrent dans ma main.
– Tu me promets de suivre rigoureusement ma leçon de grammaire ?
– J’aimerais mieux me couper la langue que d’oublier une seule de tes phrases.
Mademoiselle Cléopâtre ne voulut pas repasser une troisième fois par ce salon au vent, où tout Paris veut régner deux heures par jour, où les plus discrètes s’imaginent qu’on ne les a pas vues quand elles ne se sont pas affichées. Cléopâtre avait trop le sentiment de la haute coquetterie pour donner dans ce travers. Elle avait toujours l’air de promener ses chevaux. Le plus souvent elle fuyait dans les avenues désertes, plus fière de l’admiration des rares dilettanti que des exclamations de la foule. Comme quelques grandes comédiennes, elle ne jouait pas pour le parterre, mais pour trois ou quatre spectateurs.
Elle se souvint tout à coup que la veille, en lui disant adieu, Max avait l’air plus sérieux que de coutume.
– Chantilly a peut-être raison, murmura-t-elle, Max est trop généreux pour me parler jamais d’argent. Et d’ailleurs j’ai dépensé si peu ! Je donnerais des leçons d’économie domestique aux mères de famille.
Comme elle remontait l’avenue de l’Impératrice un peu plus tôt que de coutume, ses chevaux quelque peu emportés épouvantèrent au passage une grave famille de province qui, pour la première fois, allait dans un méchant fiacre admirer les splendeurs du bois de Boulogne.
– Quelle poussière ! C’est la Cléopâtre, dit le cocher de fiacre en se retournant vers les gens qu’il conduisait.
La belle fille s’était retournée : elle devint pâle comme la mort.
Qu’y avait-il donc dans ce fiacre qui pût l’émouvoir ainsi ?
Il y avait un homme de cinquante ans, une jeune fille qui ressemblait à une pensionnaire et un jeune homme qui regardait beaucoup la jeune fille, – un de ces mille tableaux, en un mot, qu’on rencontre tous les jours à Paris. – Y avait-il donc là de quoi faire pâlir Cléopâtre ?
Quand elle fut à l’Arc de Triomphe, elle se retourna encore une fois pour regarder au loin la voiture qu’elle avait failli renverser.
– Et ce cocher qui a dit : la Cléopâtre !
Elle soupira et sentit deux larmes dans ses yeux.
Un jeune homme qui conduisait un tilbury s’arrêta tout à coup devant la victoria.
– Eh bien où es-tu donc ? Je te parle et tu ne m’entends pas.
– Ah ! c’est toi, Max.
– Des larmes !
– Que m’a donc conté la Chantilly ? Tu as tout perdu excepté moi.
– Et c’est pour cela que tu pleures ! Qui ne voudrait tout perdre à ce prix-là ?
– Non, je ne pleure pas pour cela, Max.
– Point de phrases. Cette folle m’a inquiétée ; dis-moi tout.
Max sauta à terre, remit les guides à son groom et monta près de sa maîtresse.
– Nous allons nous compromettre tous les deux, lui dit-elle en essayant de rire.
– Dis-moi pourquoi tu pleurais, Cléopâtre.
– Non. N’est-ce pas Max que ce n’est pas moi qui t’ai ruiné ?
Max la regarda avec quelque surprise.
– Toi ! tu ne m’as jamais demandé d’argent.
– En vérité, j’ai quelquefois abusé du superflu, mais combien de fois aussi n’ai-je mangé qu’une mandarine pour mon dîner !
– Oui, hier j’aurais peut-être mieux fait de t’envoyer un jambon d’York qu’un bouquet de violettes de Parme.
– Oh ! oui, ce magnifique bouquet signé Alphonse Karr ? N’est-ce pas qu’avec le prix d’un pareil bouquet on pourrait nourrir toute une famille pendant le carême ? Combien coûtait-il ?
– Je ne sais pas. Quand il n’y a plus de violettes que dans le jardin d’Alphonse Karr, il vend ses bouquets vingt francs à madame Prévost, qui ne les revend pas beaucoup plus de quatre-vingts francs.
– Mais, j’y pense, tu m’envoies un bouquet tous les jours. Trois cent soixante-cinq bouquets par an plus rares que ceux du paradis perdu : décidément c’est moi qui t’ai ruiné, sans compter que quand j’ai du monde tu fais monter chez moi tous les jardins de Babylone.
– Rassure-toi, je ne paye pas mes bouquets cent francs, quoique je n’aie jamais marchandé tes fleurs.
– C’est égal, ce chapitre-là coûte bien vingt-cinq mille francs, car je sais qu’avec les fleurs tombées de mes bouquets on fleurit les jardinières des autres. Cette année tu m’as acheté un château ruineux. Je ne parle pas des trois cent mille francs qu’il t’a coûtés, mais le mobilier, mais les écuries, mais le potager improvisé où j’ai voulu avoir des raisins là où il n’y avait que des pommes ? Ma couturière se plaint pourtant que je ne lui « inspire » plus de robes. Il est vrai que je n’ai pas encore porté les dix dernières qu’elle m’a faites. Huit chevaux à Paris : on ne peut cependant pas se faire traîner à moins. Mes gens sont très raisonnables, ils me volent si peu qu’ils ne tiennent pas à moi. J’ai peut-être eu tort de donner souvent à dîner, pourtant je crois que mes festins ne sont pas ruineux !
– Oh ! non, dit Max en souriant, à peu près trois mille francs par semaine.
– Pourquoi aussi me laisser aller à Bade ? Il est vrai que j’ai joué si-peu de temps.
– C’est vrai, dit Max ; seulement le temps de perdre cinquante mille francs.
– Mon cher Max, je commence à voir que je ne suis pas aussi raisonnable que je me l’étais figuré. Je vais réformer ma maison ; et pour commencer je n’allumerai pas demain le grand lustre.
– C’est cela, des économies de bouts de chandelles. Ne parlons pas de ces misères, ma chère Cléopâtre, c’est ma faute et non la tienne.
– Après tout, reprit mademoiselle Cléopâtre, je n’ai jamais vu ton argent, je ne sais pas ce que tu en as fait. Je n’ai pas de rentes sur le grand-livre. Tu m’as donné une argenterie de haut style, un chef-d’œuvre digne des maîtres florentins, mais te l’avouerai-je ? je n’ai pas beaucoup plus de chemises que madame Ève. Il est vrai que les chemises coûtent plus cher aujourd’hui que de son temps.
En devisant ainsi ils arrivaient au rond-point des Champs-Élysées. Tous les promeneurs les regardaient passer et semblaient se dire :
– Voilà donc comment on est heureux !
Et, en effet, tant de jeunesse, tant de beauté, tant de folie, ces beaux chevaux nés pour traîner des princes tout fiers d’emporter Cléopâtre et sa fortune, cet insolent jockey qui regardait du haut de Stradella les petites gens qui allaient à pied, tout cela ne chantait-il pas la chanson des joies de la terre ?
Oui, ils étaient bien heureux, lui et elle ! Lui, avait son lit fait à Clichy pour la nuit prochaine ; elle, devait trouver dans son salon la statue du commandeur.
Au rond-point, le cocher prit l’avenue Gabriel, cette belle avenue qui ferait croire aux amoureux que Paris a encore une porte ouverte sur le paradis. Mademoiselle Cléopâtre demeurait rue du Cirque, dans un hôtel dont elle avait oublié, dans son livre de dépenses, de compter le loyer. Il est vrai que cela coûtait si peu : quelque vingt-cinq mille francs par an.
Quand la victoria fut sous la porte-cochère, Max, quoiqu’à peine de la taille de mademoiselle Cléopâtre, la prit dans ses mains et la posa doucement sur le marbre du péristyle.
– Adieu, ma mie.
– Adieu, mon chien.
Max noya ses lèvres dans les cheveux ondes de Cléopâtre.
– Où vas-tu ? lui demanda-t-elle.
– Je ne sais pas, mais je viendrai ce soir.
– Tu sais que la fête de la Chantilly commence à dix heures ? Vas-y de bonne heure, si tu veux voir les grands airs de la dame de Carreau et la robe incroyable d’Olympia. Elle en aura si peu en haut, qu’à minuit il n’en restera plus du tout. Il est vrai qu’elle n’a rien à montrer.
– J’ouvrirai le bal avec elle, dit Max en s’éloignant.
Il se retourna pour voir encore dans l’escalier sa maîtresse, dont les jupes ruisselantes inondaient bruyamment les marches.
Elle ne se retourna pas ; elle monta avec plus de rapidité que de coutume comme si elle fût attendue, Max s’en alla avec inquiétude.
– Elle ne m’aime pas comme je l’aime, murmura-t-il. Et pourtant qui donc la force de rester avec moi ? Elle m’a ruiné, mais elle n’en sait rien, puisqu’elle ne m’a jamais demandé d’argent.
Max reprit l’avenue Gabriel et marcha à grands pas vers la rue Royale.
– C’est peut-être la dernière fois que je la vois, se dit-il en s’arrêtant tout à coup.
D’une main il souleva son chapeau et de l’autre il s’essuya le front. Il regrettait de ne pas être monté avec Cléopâtre.
– J’aurais dû la presser bien fort sur mon cœur. Au moins si je ne dois plus la revoir, je la sentirais plus longtemps dans mes bras. La pauvre fille ! Si je vais à Clichy, que deviendra-t-elle demain ? Elle n’a pas un sou vaillant. Ce château, dont je n’ai payé que le tiers du prix, n’est qu’une folie et pas une ressource. Et d’ailleurs, qui sait ce qu’il faudrait pour l’océan de ses dettes ? Il y a des gens qui s’imaginent qu’on peut arrêter le budget d’une maîtresse. Mais le budget d’une maîtresse, c’est l’imprévu, l’imprévu c’est le déficit, le déficit c’est la banqueroute. Qui donc va me donner un million ? car pour la sauver et me sauver moi-même il faut un million. Ce n’est pas Rothschild, je suppose, qui va soumissionner cet emprunt-là. Ah ! si l’on pouvait comme au Moyen Âge donner son âme au diable pour avoir de l’or !
Max n’était pas si loin qu’il le croyait de donner son âme au diable.
Jamais l’argent n’a parlé aussi haut qu’aujourd’hui. C’est que l’argent n’est éloquent qu’à force d’éloquence, c’est que pour mener la vie à quatre chevaux, ce n’est pas assez d’être gentilhomme et de jouer le grand jeu des dettes, il faut avoir une mine d’or sous la main, frapper monnaie à la Bourse par des créations industrielles, lancer des vaisseaux vers l’océan Pacifique, escompter des héritages, remuer l’or de la haute banque ou être le fils d’un des vingt industriels qui gagnent un million par an, qui à vendre des soieries, qui à vendre des diamants, qui à vendre des bonbons.
Le père de Max, un grand artiste sans le savoir, gagnait un million par an par son art merveilleux de centupler la valeur de l’or en le travaillant. On reconnaissait son génie à Londres, à Florence, à Pétersbourg, à Rome et à Paris. Quand il avait mis sa griffe sur un bijou, sur un crucifix, sur un bénitier, on ne demandait pas le contrôle de la Monnaie.
Max était un Parisien de la décadence, une figure pâle, fine, efféminée, où la perversité s’accusait sous la raillerie. Il n’y avait pas là un homme pour l’avenir, l’enfant gâté avait stérilisé l’enfant, ou plutôt c’était l’enfant du siècle, bruyant, orgueilleux, bravache ; tout à lui, mais plus encore à ses passions qu’à lui-même ; n’ayant ni foi ni loi ; sauvé çà et là des aspirations brutales par son vif amour pour Cléopâtre et par un vague sentiment de l’art. Son père lui avait, de bonne heure, mis la pointe à la main devant les merveilles du XVIe siècle. Max s’était imaginé qu’il serait le Benvenuto Cellini de son temps, et il avait prouvé de rares aptitudes en ciselant une aiguière pour le duc de Luynes et un saint ciboire pour l’archevêque de Bordeaux ; mais le désœuvrement l’avait envahi comme ces herbes folles qui étouffent le blé.
Jusque-là il avait passé dans la vie comme un fou, sans prendre le temps de se regarder passer.
Cet autre soi-même, qui s’appelle la conscience, ne s’était jamais levé grave et méditatif pour juger ses actions. Il allait, il allait encore, il allait toujours, comme un jeune cheval enivré par la course qui se brisera tout à l’heure la tête aux rochers des précipices. Pareil à tous ceux qui ont gaspillé leur jeunesse, ni la raison, ni le devoir n’avaient pu l’attacher au mât du navire ; raillant la famille, raillant Dieu, se raillant lui-même, il s’était jeté tout éperdu dans les folies dévorantes, dans les passions effrénées, dans les ivresses orageuses.