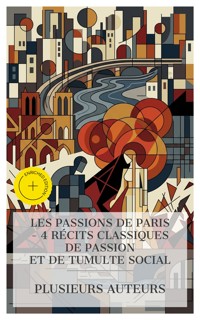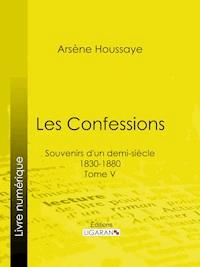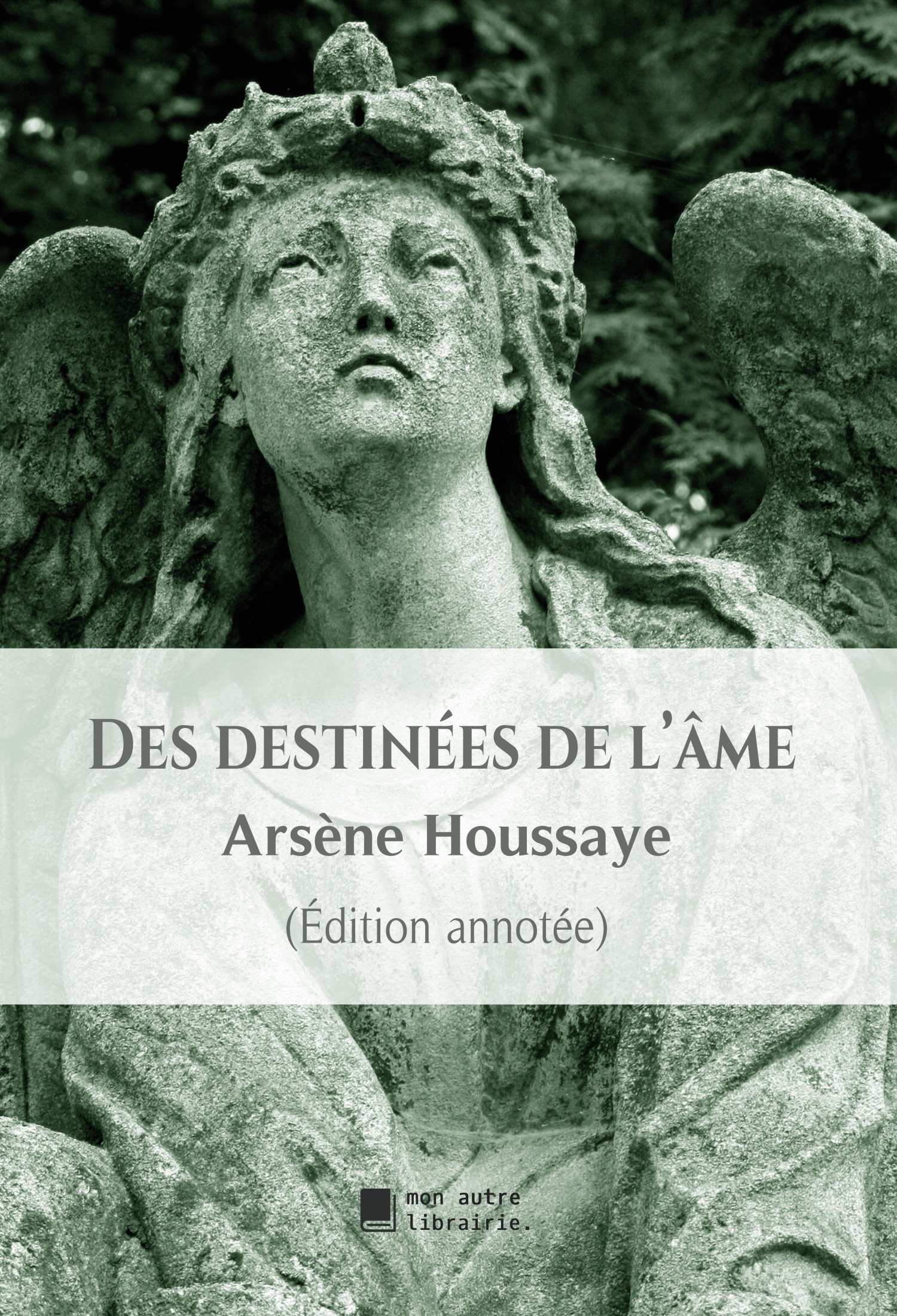
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Cruellement éprouvé lui-même par la disparition prématurée de plusieurs de ses proches, l'auteur nous propose ici une réflexion mélancolique et douce sur l'après-vie. Après avoir fait le tour des grands systèmes religieux, interrogé les philosophes, les scientifiques, voire les occultistes, avoir même discuté sincèrement avec les athées, c'est vers sa propre sensibilité qu'il se tourne, nourrie des expériences et des réflexions des autres. Ce texte profondément touchant, écrit sur de nombreuses années, reflète le parcours d'une grande âme. (Édition annotée, à partir d'une édition non cataloguée, sans date.)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Des destinées de l’âme
Arsène Houssaye
Fait par Mon Autre Librairie
À partir de l’édition Calmann Lévy, nouvelle édition, Paris, sans date.
Les notes entre crochets ont été ajoutées pour cette présente édition
__________
© 2020, Mon Autre Librairie
ISBN : 978-2-491445-33-1
Table des matières
I. – La recherche de l’inconnu
II. – Histoire de l’âme
III. – Les sciences occultes
IV. – Les hallucinés
V. – Les poètes et les philosophes
VI. – Les athées
VII. – La science
VIII. – Le tombeau
IX. – L’immortalité de l’âme
X. – Les destinées de l’âme
XI. – Horizons et nuées
L’amour déploie nos ailes pour un vol sublime, c’est la première station vers Dieu.
Michel-Ange
I. – La recherche de l’inconnu
L’esprit humain est comme le soleil, qui n’éclaire que la moitié du monde à la fois – ou comme la mer, qui perd d’un côté ce qu’elle gagne de l’autre.
Voilà pourquoi l’homme, à force de tenter l’inconnu, perd pied sur le sable mouvant des hypothèses.
Qu’est-ce que l’âme ? demandait-on à Marivaux. Il se recueillit et répondit : « Il faudra le demander à Fontenelle. » Mais se reprenant : « Il a trop d’esprit pour en savoir plus que moi. »
Est-ce là le dernier mot sur l’âme ?
Il y a plus de vingt ans que j’ai écrit les premiers chapitres de ce livre. Un philosophe couronné m’a dit un jour : « C’est un livre qu’on commence toujours et qu’on ne finit jamais. » Je veux pourtant finir ce volume avant que la mort me dise le dernier mot.
Quand je me suis posé devant les yeux ce terrible point d’interrogation, je venais de perdre un enfant, et je sentais son âme en m’élevant à Dieu. Pourquoi Dieu frapperait-il par la mort, si la mort n’était pas une renaissance radieuse ? Pourquoi Dieu permettrait-il que l’enfant qui rit à la lumière descendît dans la nuit éternelle à son premier sourire ?
Tous ceux qui ont aimé le chemin de la mort ont senti l’âme immortelle, hormis ceux qui se sont obstinés à ne voir que la mort dans la mort.
Oportet hæreses esse : « Il faut qu’il y ait des hérésies », a dit l’apôtre1 ; et les siècles amoncelés lui ont toujours donné raison. Les avocats de la foi ont continué leurs controverses avec les protestants de la conscience. Le jour où, à la tribune, un des plus vaillants soldats que l’Évangile ait comptés dans nos temps, M. de Montalembert, s’écriait : « Nous sommes les fils des croisés et nous ne reculerons pas devant les fils de Voltaire », M. de Montalembert entrait dans le vrai sens de la question éternelle ; et lui-même, en cette déclaration de résistance, il concluait, comme le disciple du Sauveur, à la fatalité de ces hérésies, dont la plus ardente et la plus vivace fut celle qui dure encore, et qui pour pape revendique Voltaire. Mais Voltaire a bien perdu de son satanisme. Combien de sages qui sont allés par delà ses audaces ! Lamennais a été plus amer que Candide quand il s’est écrié : « Voulez-vous que je vous dise ce que c’est que le monde ? Une ombre de ce qui n’est pas, un son qui ne vient de nulle part et qui n’a pas d’écho, un ricanement de Satan dans le vide. » Pourquoi Satan si Dieu n’y est pas ?
La vérité est dans un perpétuel demi-jour ; Dieu l’a voulu, lui qui confond les orgueilleux et qui protège les simples d’esprit. Les simples d’esprit sont les simples de cœur. Vivre de son cœur, c’est vivre déjà de la vie éternelle ; vivre de son orgueil, c’est se heurter à la mort. Dieu a dit à l’esprit humain comme à la mer : « Tu n’iras pas plus loin. » Le père limite le lieu où jouent ses enfants, dans la peur des précipices. Dieu a limité l’esprit humain entre deux rives. Le symbolisme de l’arbre de science est donc aussi profond que poétique ; vivre est doux, savoir est amer. Dieu n’avait-il pas tout donné à l’homme en lui donnant les poésies de la terre et les horizons rayonnants de l’infini !
Bienheureux ceux qui auront eu le mal du ciel. C’est le mal du pays. La patrie des âmes appelle toutes les âmes. Lamartine a été bien inspiré quand il a dit ce vers sublime :
L’homme est un Dieu tombé qui se souvient du ciel.2
Ce jour-là il a créé toute une philosophie spiritualiste, comme Ange de Fiesole a montré le paradis des âmes dans ce divin poème des archanges et des madones, où toutes les joies du ciel se reflètent sur les figures dans l’adorable épanouissement de la foi et de l’amour.3
Il y a des idées que l’esprit n’aborde qu’en certaines heures lumineuses. Les philosophes ont le tort de croire qu’il leur suffit de prendre la plume pour toute démonstration, comme si la lumière allait jaillir de leur écritoire. Mais pour parler de l’âme, la volonté de l’intelligence ne suffit pas. Il faut que le sentiment révèle les grands horizons ; il faut que les battements du cœur, comme des échos lointains, vous rappellent votre origine et vous marquent les symphonies de la vie future. Et encore, si vous n’avez pas le sentiment de l’infini, si l’amour du beau, qui est l’amour du bien, n’a pas hanté votre âme, si chaque jour de votre vie vous n’avez pas cultivé les fleurs sacrées du spiritualisme, si vous n’avez pas élevé en vous-même un temple à Dieu, si vous avez méconnu votre part de travail dans l’œuvre universelle, si quelque fatale blessure n’a déchiré votre cœur, vous parlerez mal de l’âme, parce qu’elle aura replié ses ailes en vous.
Pour parler bien de l’âme, il faut que l’âme parle elle-même. L’esprit peut parcourir les mondes connus et se hasarder dans les mondes inconnus, comme un éclair rapide, âme de feu et de lumière. Mais Jean-Jacques l’a dit, il est encore plus difficile de rentrer en soi pour y étudier l’homme.
Dans leur orgueil, les philosophes créent des faux dieux devant les vrais dieux, si bien que pour les esprits faibles, les folles visions cachent les grandes images ; Bossuet a dit que c’était ainsi qu’on ne reconnaissait plus la majesté de la religion dans la multitude des sectes. Voilà pourquoi tant de vraies intelligences, égarées çà et là, finissent par tomber, sinon dans l’athéisme, au moins dans l’indifférence, qui est déjà l’anémie de l’âme.
Je comprends le philosophe spiritualiste qui s’avance dans l’infini sans souci de ses guenilles corporelles. C’est l’orgueil de l’humanité. Il commence à vivre ici-bas de la vie future ; il a entrevu les radieux espaces où Dieu attend son âme immortelle ; il frappe avant l’heure aux portes d’or des paradis rêvés. Mais le philosophe qui doute et qui nie, celui-là qui ne veut pas voyager avec les ailes de la foi, qui va se brisant à toutes les hypothèses, celui-là devrait plus souvent fermer les in-folios, abandonner aux brises du soir les hiéroglyphes de son âme pour étudier, libre de toute tradition, les pages de la vie. Pour quiconque les sait lire, ces pages divines détachées de tout commentaire humain, la vérité resplendit. Mais combien qui ont des yeux et qui s’obstinent à ne pas voir ! On joue à l’esprit fort en niant l’esprit simple. On veut prouver la grandeur de la science en dépouillant l’homme de tous ses privilèges. Du soldat de Dieu destiné aux conquêtes pacifiques de l’humanité, on fait un animal perfectible dédaignant ses destinées.
Non, la science surhumaine ne s’apprend pas dans les in-folios : elle aime la solitude dans la méditation. Toutes les religions ont montré les hommes supérieurs en communion avec Dieu quand ils dépouillent comme un manteau le monde visible pour passer le seuil du monde invisible.
Pourquoi ne pas faire marcher la raison humaine dans une route parallèle à la raison divine : Socrate et Jésus ? Par ces jours nocturnes où tant de docteurs prêchent l’athéisme avec l’impertinence de la sottise, n’est-il pas permis à un chercheur de se promener avec ses lecteurs par les chemins salutaires qui l’ont conduit aux horizons lumineux ? On ne manquera pas de dire que c’est le roman de l’âme écrit par un poète, mais les poètes sont des voyants.
Quand on s’approche du seuil de l’éternité, on doit s’incliner avec respect et imiter pieusement ces anciens voyageurs qui lavaient leurs pieds dans la rosée du soir avant de demander l’hospitalité. C’est l’extrême-onction des chrétiens. Tous les philosophes qui ont interrogé la vie future se sont recueillis avec émotion, comme si l’image des dieux dût leur apparaître.
Mais, quoique le poète nous ait donné une origine céleste, le dieu tombé n’a qu’un vague souvenir ; il a beau remonter par son âme les spirales de l’infini, il échoue dans les nuées. Les âmes curieuses sont comme les vagues impatientes dans leur course inféconde : elles n’iront pas plus loin.
Il y a dans ma famille un cachet qui porte cette devise : Plus loin. C’est peut-être aussi cette devise qui m’a inspiré l’ardent amour de la recherche du lendemain.
II. – Histoire de l’âme
I
Pour sonder l’avenir, il faut sonder le passé. Étudions les routes parcourues avant de tenter les routes encore vierges. Prenons la lampe de l’histoire pour marcher dans les voies nocturnes.
Si l’on veut trouver la racine des croyances et des dogmes qui ont traversé de siècle en siècle la conscience humaine, il faut toujours remonter à l’Inde. La plus ancienne notion enveloppée dans les mythes de l’Orient est l’idée de la métempsychose. Seulement les modernes n’ont point pénétré l’esprit ni le caractère de cette doctrine, aussi vieille que la tradition, aussi profonde que la nature.
Les Hindous vivaient sous l’obsession de l’éternité, de l’infini, de l’incommensurable. Les êtres animés et inanimés qui peuplent l’immensité étaient des émanations de la vie universelle. Simple formes, simples manifestations, ils jouissaient d’une existence relative et passagère. Ils paraissaient et disparaissaient dans le temps et dans l’espace ; mais, au milieu de ces métamorphoses, ils conservaient le germe indestructible de la matière et de l’esprit. Ce qui avait été une fois était toujours.
Frappés des merveilles de la création, contemplateurs du monde, ces théologiens primitifs avaient rattaché tous les dogmes religieux aux phénomènes de la nature. La lumière était pour eux le symbole de la mort ; mais de même que la nuit est une transition passagère, de même le principe de la vie pouvait s’effacer sans pour cela finir. Comme le soleil qui se couche et qui dit en s’éclipsant : « Je reviendrai. »
Ne pas être était une condition même de la vie, puisque la vie était soumise à des temps de repos. Le néant ne constituait pas un état permanent ; c’était le sommeil imposé par la nature à tout ce qui s’était agité et pour ainsi dire fatigué dans les limites de l’existence individuelle. La forme seule s’usait ; mais le principe de cette forme était indestructible comme la pensée, éternel comme le monde, impérissable comme le grand Tout.
Le monde était le rêve de Dieu, rêve sans commencement ni fin ; tous les êtres étaient des pensées : ces pensées inséparables de la matière trouvaient elles-mêmes leur forme à travers les innombrables combinaisons de la puissance créatrice. Pris isolément et dans leur apparence actuelle, c’étaient des ombres, et même des ombres fugitives ; mais pris dans la raison générale de l’univers, c’étaient des fragments indissolubles de la grande nature où tout change mais où rien ne se perd.
Tous ces êtres avaient une âme, si par âme on entend la conscience de son éternité. Seulement comme la vie existe, ou du moins se révèle, à des degrés très différents, selon le caractère de chaque créature, le principe de la vie se développait dans le cours des siècles à travers des incarnations successives.
Chaque être inférieur aspirait à monter vers les degrés supérieurs de cette échelle de Jacob dont les pieds posaient sur la terre, mais dont les extrémités se perdaient dans les solitudes étoilées du ciel.
Les minéraux, les plantes, les animaux avaient une âme ; cette âme passait ainsi graduellement d’une vie latente à une forme plus étendue de la vie extérieure. Ce que nous appelons la chaîne de la nature était ainsi la chaîne des progrès de la matière unie à l’esprit et tendant sans cesse vers un épanouissement de l’existence. Dans les anciennes cosmogonies, la création est ordinairement représentée par le serpent, à cause des anneaux qui se succèdent sur le corps de l’animal, à cause surtout des dépouilles que le reptile laisse derrière lui en faisant peau neuve, préfaces de la mort, quoique l’être vivant persiste et continue de se mouvoir dans le cercle du temps.
Grandiose et poétique conception ! Quand l’homme reposait ses yeux sur le spectacle de la nature, il ne voyait pas seulement dans les plantes et les animaux qui vivifient la surface de la terre de simples ornements de la création : il y voyait les formes que le principe de son existence actuelle avait traversées dans ses existences antérieures. Comprendre les arbres, les fleurs et les oiseaux n’était point un effort de son imagination : il avait été lui-même tout ce qui vit. Pour les aimer, il lui suffisait de se souvenir. Dans le parfum sauvage des forêts il respirait ses anciennes transformations, et dégageait des murmures inarticulés de la vie l’écho de ses vagues réminiscences qui se répondaient les unes aux autres jusque dans la profondeur des cavernes sacrées. L’histoire du monde était en un mot son histoire.
À ce sentiment de solidarité entre toutes les existences liées entre elles par la série des incarnations, il faut rapporter sans aucun doute le respect des anciens pour toute la nature. De quel droit l’Indien abattrait-il un arbre séculaire ? Cet arbre est un des langes de sa vie antérieure ; le déchirer se serait se détruire lui-même dans une de ses plus antiques manifestations sur le globe. Tuer un animal, il l’oserait encore moins ; car ce serait attenter à sa propre existence dans une des formations provisoires et nécessaires de sa vie. Cet animal deviendra homme ; c’est une question de temps, et qu’est-ce que le temps ? Une goutte d’eau dans ce fleuve qui cache sa source et qui coule toujours.
L’architecture ne faisait que chanter dans une langue symbolique le poème de cette vie enchaînée par les liens de la continuité et du mouvement ; là les formes apparaissent telles qu’elles sont dans la théologie hindoue, innombrables, fugitives, détachées les unes des autres, ou pour mieux dire, engendrées. Les âmes voyagent dans le temps et dans l’espace : elles revêtent séculairement toutes les figures sous lesquelles l’existence apparaît, disparaît, reparaît. Les monuments sont des rêves de pierre ; mais l’univers lui-même n’est qu’un songe, le songe de la vie universelle, où toutes les incarnations flottent comme les ombres d’une forêt sur l’Océan.
II
Les Grecs et les Romains, s’ils ne l’ont dédaigné, n’ont pas bien compris ce dogme antique de la métempsycose. La tradition s’était perdue. Ils ont remplacé les idées des Hindous par des imaginations poétiques ou par des images symboliques des forces de la nature. On a cru et l’on croit encore que les Hindous, dont les autres peuples de l’ancien Orient ont plus ou moins recueilli les mystères religieux, les doctrines, les croyances, admettaient une renaissance des êtres uniquement régie par le hasard. La métempsychose ainsi envisagée serait une loi fatale et aveugle, en vertu de laquelle l’âme des bêtes passerait alternativement dans le corps des hommes et l’âme des hommes dans le corps des bêtes, sans que rien déterminât ces fluctuations du sort. D’autres ont cru, au contraire, que les anciens Orientaux professaient un ordre mécanique, un mouvement rotatoire des faits. D’après ce système, le principe de la vie, après s’être élevé des degrés inférieurs de la nature jusqu’à l’homme, aurait ensuite rétrogradé de l’homme jusqu’au brin de mousse, en passant par la série des animaux. Ces deux conceptions sont également chimériques.
Les anciens croyaient à l’aspiration de la vie, à l’accroissement infini et illimité de la personnalité renaissante. On a pris pour la règle ce qui était au contraire l’exception. Il y avait bien, il est vrai, des punitions où l’homme, après avoir acquis la prérogative humaine, perdait ses droits à une telle dignité, pour retomber dans les ténèbres du monde inférieur – à peu près comme Nabuchodonosor qui, dit la Bible, fut changé en bête et alla brouter l’herbe des forêts pendant sept années – à peu près aussi comme ces peuples qui, après avoir atteint à la lumière de la civilisation, redescendent dans les profondeurs de la vie barbare. Qu’étaient ces renaissances malheureuses ? Des châtiments, des purifications. La nature disait à l’homme : « Tu as cherché les mœurs de la brute : tu renaîtras brute. Enveloppé dans l’organisation des êtres inférieurs comme dans une prison, tu traîneras lamentablement à l’ombre des bois le spectacle de ta grandeur déchue. Tu t’es ravalé jusqu’au lion par ta férocité, jusqu’au paon par ton orgueil, jusqu’au pourceau par son matérialisme : redeviens ce que tu as voulu être. Les souvenirs vagues de l’existence humaine, dont tu as librement repoussé la lumière, te poursuivront jusque dans la nuit de ta nouvelle existence. Ce sera ton remords et ton supplice. »
L’âme redevenue brute, anima fiera divenuta, comme s’écrie Dante, tel était l’enfer des Hindous. Ces réprouvés qui avaient cherché eux-mêmes et trouvé leur déchéance étaient après tout en dehors des lois ordinaires de la nature. Leur retour aux existences inférieures avait le caractère d’une épreuve. Tôt ou tard le principe ascendant de la vie reprenait ses droits, et les âmes rachetées par leur prison nocturne dans le corps des animaux remontaient à la dignité d’homme.
Pour les Hindous il n’y avait donc ni commencement ni fin ; seulement, il y avait des formes qui, soumises à la loi du temps, naissaient et mouraient. À chacune de ces destructions partielles, l’âme retournait dans le sein de la vie universelle pour s’y recueillir et s’y retremper. L’intervalle entre la mort et la renaissance n’était ainsi qu’un temps de sommeil. Dormir dans le sein de Dieu, cette expression qui a passé dans toutes les langues est l’image fidèle des anciennes croyances. Ce que durait ce sommeil, il est inutile de le rechercher : les anciens ne tenaient pas compte du temps. Habitants tranquilles d’une partie de la terre où rien ne change, où les saisons de l’année ont toutes la même figure, ils croyaient volontiers que les siècles s’amoncellent silencieusement sur les siècles, et que la vie poursuit, sans se hâter, le cours de ses transformations éternelles.
Les Grecs et les Romains ont hérité d’une partie de ces dogmes ; seulement ils y ont mêlé beaucoup de fables. La théologie païenne a cependant recueilli le principe du progrès des existences terrestres. Qu’étaient les dieux et les déesses ? Des hommes et des femmes transformés par la mort. Tous avaient existé : on montrait encore leur berceau ; on racontait leur histoire ; on pouvait suivre les traces de leur passage dans les contrées où s’élevaient leurs temples. Ils s’étaient métamorphosés un jour, en passant de notre sphère à une sphère supérieure de la vie. Maintenant un sang immortel coulait dans leurs veines. La tombe avait le privilège de faire des Dieux. Quand on ne voulait plus d’un roi ou d’un empereur, on le tuait et on lui dressait des autels. Socrate a dit : « Lorsqu’on disposera de mon corps, ne dites pas : on brûle ou on enterre Socrate ; ne me confondez pas avec mon cadavre. » Est-ce l’immortalité de l’âme ou l’immortalité de l’esprit ? Est-ce la raison divine, humaine ou païenne ?
Les pérégrinations de l’âme à travers les différentes formes de la nature et les différentes conditions humaines – la naissance, la mort et la renaissance à perpétuité – le dégagement successif des existences graduées – l’idée que chaque homme portait en lui les traces de ce qui fut et les germes de ce qui sera : tel est le thème sur lequel les cosmogonies anciennes ont brodé d’or le voile noir des mystères.
III
Passer des religions de la nature au mosaïsme, c’est franchir un abîme immense, c’est aborder un nouveau théâtre de faits et d’idées. Que Moïse ait puisé ses dogmes dans les temples de l’Égypte ou qu’il les ait recueillis dans les traditions éparses de sa race, là n’est pas la question. Je constate seulement qu’entre les idées de l’Inde sur les destinées de l’âme et les idées du peuple hébreu – idées qui ont passé plus tard dans la foi chrétienne – il y a toute la distance d’une révolution morale.
Les Hindous croyaient aux émanations, aux incarnations de l’âme. Les Hébreux rejettent cette doctrine comme entachée de panthéisme. Suivant eux, l’âme n’émane pas de Dieu : elle est créée ; l’âme ne s’incarne pas : elle est placée et en quelque sorte soufflée par Dieu même dans le corps de l’homme. Pour bien comprendre l’étendue et la portée de ce contraste dans les notions des deux peuples, il faut remonter à la conception même de l’Être suprême.
La Bible est le second monument de très haute antiquité dans lequel apparaisse un Dieu personnel, entièrement séparé de la nature, gouvernant la matière comme une esclave, disant aux innombrables habitants du globe : « Soyez ! » Et ils sont. Le monde est suspendu à sa volonté comme par un fil. Quand les lois de la nature contrarient passagèrement ses desseins, il les change, il les suspend, il les brise. La pluie attend ses ordres et la foudre lui demande : « Où dois-je tomber ? » Il a deux actions sur l’univers, l’une ordinaire et naturelle, l’autre extraordinaire et surnaturelle ; cette dernière éclate surtout dans ses rapports avec son peuple, avec Israël ; quand il s’agit de ce peuple élu, les miracles ne lui coûtent pas. Faut-il ouvrir les mers ? Il les ouvre. Faut-il prolonger les jours ? Il fait signe au soleil. Faut-il ressusciter les morts ? Il rassemble la poussière dispersée par les vents et de cette poussière il fait le miracle de la vie. Il règne sur les éléments et rien de ce qui a été fait ne règne sur lui. Il est l’éternel, l’incommensurable, le seul, le grand, « je suis ! » Un seul homme a pu le voir en face sans mourir. Et cet homme était Moïse.
La croyance à l’immortalité de l’âme parmi les Juifs est-elle une doctrine saisissable pour l’histoire ? Rien n’existait dans le sens absolu du mot, à l’exception de Jéhovah. Les êtres créés par lui n’étaient que des instruments ; son œuvre faite, il les anéantissait. Les anciens Juifs croyaient, en effet, que le bien et le mal étaient récompensés ou punis sur la terre. « Honorez votre père et votre mère, dit Moïse, pour que vous viviez longuement. » Une Providence active et inévitable distribuait aux vivants les récompenses ou les peines, et cela de génération en génération. Dieu n’avait qu’à retirer sa main pour que tout tombât dans l’éternelle nuit. Un jour, il se repentit d’avoir fait l’homme, et ce jour-là le genre humain fut noyé, moins Noé. Un mot de plus et l’univers était détruit.
Selon la Genèse, Dieu souffla au visage un souffle de vie. Et l’homme devint une âme vivante. Comment les Juifs n’ont-ils pas mieux traduit la grandeur de l’action divine ? Cette âme vivante, c’était l’âme immortelle, c’était une parcelle de l’infini sur le fini : l’homme devait mourir, mais l’âme vivante devait vivre toujours.
Plus tard, il est vrai, la croyance à l’immortalité de l’âme s’introduisit dans le peuple saint ; cette croyance greffée sur l’arbre primitif du mosaïsme prit le caractère des autres dogmes qui faisaient la force et l’originalité de la nation juive.
Mais si l’on ne traduit que par le mot à mot, ce n’est point dans la Bible qu’il faut chercher les idées d’Israël sur l’histoire de l’âme : la Bible garde sur le lendemain un silence majestueux et terrible. Les textes qui renferment pour l’homme une promesse d’immortalité sont obscurs, vagues, impénétrables.4
La Bible presque muette sur ce point ou n’accentuant que de vagues espérances, c’est à la kabbale qu’il faut s’adresser pour connaître les idées du mosaïsme sur l’origine de l’âme et sur les destinées futures.
IV
Les kabbalistes admettent trois espèces d’âmes chez le même homme : l’une céleste, l’autre matérielle et une intermédiaire qui établit pour ainsi dire le lien entre l’esprit et le corps. Distinctions trop subtiles. Nous ne rechercherons pas avec les rabbins le moment où ces trois âmes entrent successivement dans le corps de l’enfant qui se forme : ce sont là des mystères que la sublime science se flatte de pénétrer, mais dont nous lui laissons volontiers le secret. Si l’âme est d’origine céleste, si elle est placée par un souffle de Dieu dans la matière humaine, comment se fait-il que cette substance pure et immaculée se montre sujette au mal, faillible, peccable ? Ici le rabbinisme est obligé de recourir à la légende. La poésie intervient pour cacher sous son aile ce que la conception philosophique a de pauvre et d’inconséquent. Un ange descend au moment où l’âme céleste pénètre dans le cerveau de l’embryon et touche du doigt la lèvre supérieure. On peut voir la trace de ce doigt mystérieux dans le sillon creusé chez chaque homme entre le nez et la bouche. Les effets de cette empreinte sont merveilleux et bien dignes de la main qui la grava. À l’instant même, l’âme perd la mémoire de son origine. Si elle est privée alors de son tranquille repos et de sa béatitude, elle acquiert en revanche ce don nouveau qui est le privilège de l’homme. Elle peut désormais choisir entre le bien et le mal : elle est libre. Les rabbins ne croient pas que cette liberté soit trop payée par le sacrifice de la vie passive qu’elle menait dans un monde meilleur.
Le christianisme a épuré les idées du mosaïsme sur le principe immortel de notre nature. Le fond des croyances est néanmoins resté le même. Dans ces deux religions, l’âme humaine est radicalement séparée de toutes les autres existences terrestres. Elle n’a point passé par la série des créations inférieures : elle vient directement de Dieu. Ce qu’elle était avant de se marier à un corps dont elle doit s’affranchir un jour ? Mystère. Ce qu’elle deviendra et où elle va ? À l’éternité. Mais quelle est donc cette éternité ? Ces questions ont rempli des volumes ; elles ont occupé des conciles. Après tout, il n’en est pas de plus grandes. Plus l’homme avance dans la vie, plus il penche vers ses destinées futures et plus ces sombres problèmes attirent sa pensée mélancolique au fond des tombes. Hamlet, assis au bord d’une fosse ouverte, dans la solitude du cimetière et se posant à lui-même cette énigme dont le fossoyeur est le sphinx – To be or not to be – Hamlet est un de ces égarés sublimes à la manière de Pascal, pour lesquels la vie est la méditation de la mort.
Les théologiens catholiques se sont montrés aussi embarrassés que les rabbins pour concilier l’origine de l’âme avec l’existence du mal. Les plus éminents d’entre eux ont imaginé une création des âmes à l’origine des choses. Les diamants perdus au fond des sables, ignorés et s’ignorant eux-mêmes, attendent qu’on vienne les prendre dans leur sommeil et que le travail du polisseur les revête de cet éclat qui est la vie des pierres. Eh bien ! les âmes, créées au commencement du monde, attendent ainsi dans une sphère invisible que Dieu les appelle pour animer des corps mortels. Cette théorie des âmes sommeillantes est très ancienne. On se demande toujours comment ces âmes divines, quoique distinctes de Dieu, peuvent manifester, après la naissance, des inclinations mauvaises. C’est pour répondre à cette difficulté que les théologiens invoquent sans cesse le dogme de la chute originelle. Les âmes, dont l’origine est céleste, entrent dans des corps pervertis par la faute du premier homme.
Aux yeux des chrétiens, la vie est une épreuve. L’homme passe sur la terre, il n’y demeure pas. Il n’est pas venu ici pour vivre, mais pour mourir. Ce qui s’agite autour de lui dans le temps n’est point réel ; cela paraître être, mais cela n’est pas : l’éternité seule existe. À la fin de l’empire romain, au moment où tout dans l’ancien monde s’écroulait, cette préoccupation de la mort avait frappé au cœur les générations suivantes on fuyait au fond des solitudes pour s’abîmer dans le silence et dans la méditation du grand mystère. Un exemple entre mille : l’un de ces penseurs effrayés, qui avait caché depuis trente ans sa tête dans les cavernes, comme pour s’accoutumer à la nuit du tombeau, rencontre un voyageur qui traversait le désert : « Eh bien ! lui demanda-t-il avec une ironie sublime, les hommes s’amusent-ils encore à bâtir des maisons ? »
Je ne juge point ce que cette frayeur avait d’exagéré : elle tuait la civilisation ; elle éteignait les arts, elle affaiblissait la résistance à l’invasion des barbares : le spiritualisme chrétien s’enveloppait de l’éternité comme d’un manteau pour dédaigner le temps. L’œil fixé ailleurs, il ne voyait pas venir Attila ; il n’entendait pas le bruit sinistre d’une société qui se bouleversait. À quoi bon ? Ce que le solitaire attendait dans le silence des cloîtres ou au milieu des sables du désert, ce n’était pas que le monde vécût, c’est que le monde finît.
V
Les théologiens ont entrevu la vie future. Au moment où l’âme quitte la terre et se dépouille du corps comme d’un vêtement usé, elle paraît seule, nue, tremblante devant Dieu qui l’interroge et qui la juge. Selon qu’elle est trouvée digne de récompense ou de châtiment, elle est sauvée ou damnée. Le ciel ou le paradis consiste pour l’âme dans l’union avec le Saint des saints ; l’enfer, dans la privation de Dieu. Ce premier jugement sera suivi d’un jugement dernier à la fin des temps et d’une résurrection des corps. C’est sur ce fond simple et terrible que l’art du Moyen-âge a jeté le voile de ses mystiques allégories.
On ne saurait croire à quel point les esprits se sont exercés sur toutes les objections que soulevait une doctrine si absolue. Il a été écrit des volumes pour demander ce que deviendraient à la fin des temps les hommes dévorés par les bêtes féroces et comment ils feraient pour retrouver leur corps. La théologie a des réponses pour tout ; elle a dit que les molécules humaines ne se confondaient point avec celles de l’animal et que les unes sauraient bien, un jour, se distinguer des autres. Une des forces de l’Église catholique était de tout définir avec une autorité qu’on devait croire infaillible.
Le protestantisme, qui changea la constitution des croyances, n’altéra qu’en un seul point la foi catholique pour les destinées immortelles de l’homme. La Réformation supprima le purgatoire. C’était l’enfer plus près. La théorie de la purification par la souffrance est antérieure au christianisme ; elle se retrouve dans les mystères de Cérès. Le purgatoire atténuait d’ailleurs ce que l’éternité des peines avait d’épouvantable. Le protestantisme, en faisant le vide entre l’enfer et le ciel, redouble encore la sévérité du dogme.
Le protestantisme a détruit le lien de solidarité qui, dans la croyance des catholiques, continue d’unir les vivants aux morts. Dans l’Église réformée, dès qu’un homme a fermé les yeux pour le grand sommeil, il appartient à Dieu seul ; ses meilleurs amis ne peuvent plus rien pour lui. Son sort est irréparable et ne saurait être modifié par aucune intervention. Dans l’ancien culte, au contraire, la prière des vivants couvre le mort contre les rigueurs de la justice divine. La femme intercède pour son enfant. Et sa voix monte à Dieu comme la voix de la mère vers le trône de Salomon, pour demander que le fruit de ses entrailles ne soit point divisé en deux. Où cette relation entre le monde visible et le monde invisible se montre sous des traits touchants et poétiques, c’est dans cette fête des cimetières qui vient avec la chute des feuilles. – Ce jour-là, ceux qui font semblant de vivre vont rendre visite à ceux qui font semblant d’être morts. – Toute l’humanité réunit ses membres dans une même pensée, dans un amour universel. Ceux qui sont déjà dans la gloire, ceux qui souffrent, ceux qui étaient hier, ceux qui mourront demain, se rencontrent là où le passé et l’avenir se confondent dans un présent éternel.
VI
Les philosophes spiritualistes se rapprochent beaucoup de l’idée chrétienne. Lisez Platon : vous croiriez entendre la voix d’un solitaire méditant au pied de la croix. Mêmes soupirs de l’âme ayant le mal du pays – le mal du ciel – même dédain du monde où les formes extérieures ne sont que les masques des idées divines, même révolte contre les illusions des sens, mêmes élégies sur les misères et les vanités de l’homme qui cherche à saisir le pâle fantôme des choses. L’univers étant la révélation matérielle du Verbe, c’est au Verbe qu’il faut remonter si l’on veut se désaltérer dans les sources mêmes de la vie. L’organisation des êtres créés n’est point le principe ni la cause de leurs facultés ; c’en est au contraire la limite. Le principe de tout, c’est l’âme. Cette âme, née de Dieu, aspire vers Dieu. Elle languit dans l’énervante prison du corps, dans le cercle étroit de l’existence terrestre, dans le monde des apparences grossières et matérielles. Les sens peuvent bien s’enivrer à la coupe que lui présentent les molles voluptés ; mais l’âme, elle, ne s’abreuve point de cette liqueur perfide. Esprit, elle met son bonheur dans les choses de l’esprit. Sa vie est l’exercice de la pensée. Tout ce qui développe la faculté de concevoir et d’aimer est un bien ; tout ce qui l’étreint est un mal. La mort qui desserre les liens de la prison charnelle ne saurait donc être pour l’homme que le plus heureux des événements. La mort soulève le couvercle de plomb sous lequel les ailes de Psyché se repliaient douloureusement. La mort n’est pas la mort ; c’est le commencement de l’immortalité.
Mais que devient l’âme au sortir de sa captivité ? Les philosophes le demandent aux poètes, les poètes le demandent aux étoiles. La migration des âmes dans les sphères célestes est une idée platonicienne ; mais pour peu qu’on interroge les monuments de l’antiquité, on voit que Platon avait reçu cette tradition de l’Égypte où elle était depuis longtemps conservée dans les temples. Il est essentiel de pénétrer les profondeurs de cette croyance. L’âme a été créée pour être unie à Dieu ; mais le fini ne peut comprendre l’infini. Tout ce que l’âme humaine peut espérer c’est donc de se rapprocher toujours de ce centre de la vie universelle sans y atteindre jamais. Les mondes innombrables dispersés dans le ciel sont autant de degrés par lesquels passent les âmes pour s’initier à la Science et à l’Amour. Cette hiérarchie des mondes, qui communiquent les uns aux autres par des liens mystérieux, constitue l’échelle des épreuves à travers lesquelles la pensée s’élève éternellement. L’âme monte d’une sphère inférieure à une sphère supérieure ; toujours mourant et renaissant, l’être humain va d’étoile en étoile, cherchant Dieu à travers l’espace et le temps, ne le trouvant jamais face à face, mais faisant tomber successivement les barrières et les voiles qui le séparent de la lumière incréée.
L’astronomie déclare qu’elle ne comprend pas la vie en dehors de notre planète. Elle a raison, si par vie elle entend les conditions actuelles de notre pèlerinage terrestre ; mais c’est précisément son erreur que de vouloir prendre une des phases de l’existence pour l’existence elle-même. La terre avec les plantes qui la couvrent d’un manteau de verdure, avec les animaux qui la peuplent, avec les hommes qui la gouvernent, la terre n’est après tout qu’un grain de sable dans l’infini. Croire que la vie commence et finit à ce grain de sable, que les destinées de l’âme y sont enfermées, c’est une prétention bien digne des astronomes, mais dont doivent sourire de ciel en ciel les habitants des autres mondes.
Si sur la terre quelques degrés de froid ou de chaleur en plus ou en moins transforment tout à coup les arbres, les animaux, les hommes eux-mêmes, changent la couleur du visage, altèrent la nature des pensées et des sentiments, modifient le langage, les mœurs, la politique, les arts, combien des influences atmosphériques toutes différentes de celles que nous connaissons doivent-elles bouleverser de fond en comble les caractères de la vie ! De ce que nos yeux, même ornés du télescope, ne découvrent point d’êtres organisés dans le soleil, dans la Lune et dans les étoiles, il serait absurde de conclure que ces êtres-là n’existent pas. Quoi ! nous ne pouvons soulever un brin d’herbe sans découvrir à l’œil nu des millions d’insectes qui fourmillent ; nous ne pouvons analyser une goutte d’eau sans reconnaître au microscope que cette goutte d’eau est l’Océan dans lequel vivent, respirent, s’agitent des légions de zoophytes, et nous voudrions que ces masses de matières, ces mondes cent fois grands comme le nôtre qui fourmillent au-dessus de nos têtes, dans le silence des nuits taciturnes, fussent vides et inhabités ! Ô science humaine ! Ô fantôme de l’orgueil !
Quelques théologiens catholiques ont compris eux-mêmes ce que la notion de la vie, limitée à notre globe terrestre, avait d’étroit et de puéril. Ces poètes du dogme ont éprouvé le besoin d’étendre à tout l’univers le mystère de la rédemption. Au moment, disent-ils, où le Christ expira sur la croix et poussa le grand soupir, la mécanique céleste se troubla, le mouvement des sphères fut tout à coup suspendu, le sang du juste coula de monde en monde, et un ange alla porter jusque dans les profondeurs du firmament cette nouvelle : « Il est mort ! » Cette doctrine est d’ailleurs la seule qui s’accorde avec la majesté des faits. Un Dieu immolé ne pouvait faire moins que de mourir pour toute la nature et pour tous les êtres qui peuplent l’espace sans borne. Un tel sacrifice, rétréci aux proportions de notre grain de sable, manque de contrepoids. C’est, pour me servir du langage mathématique, une équation fausse.
VII