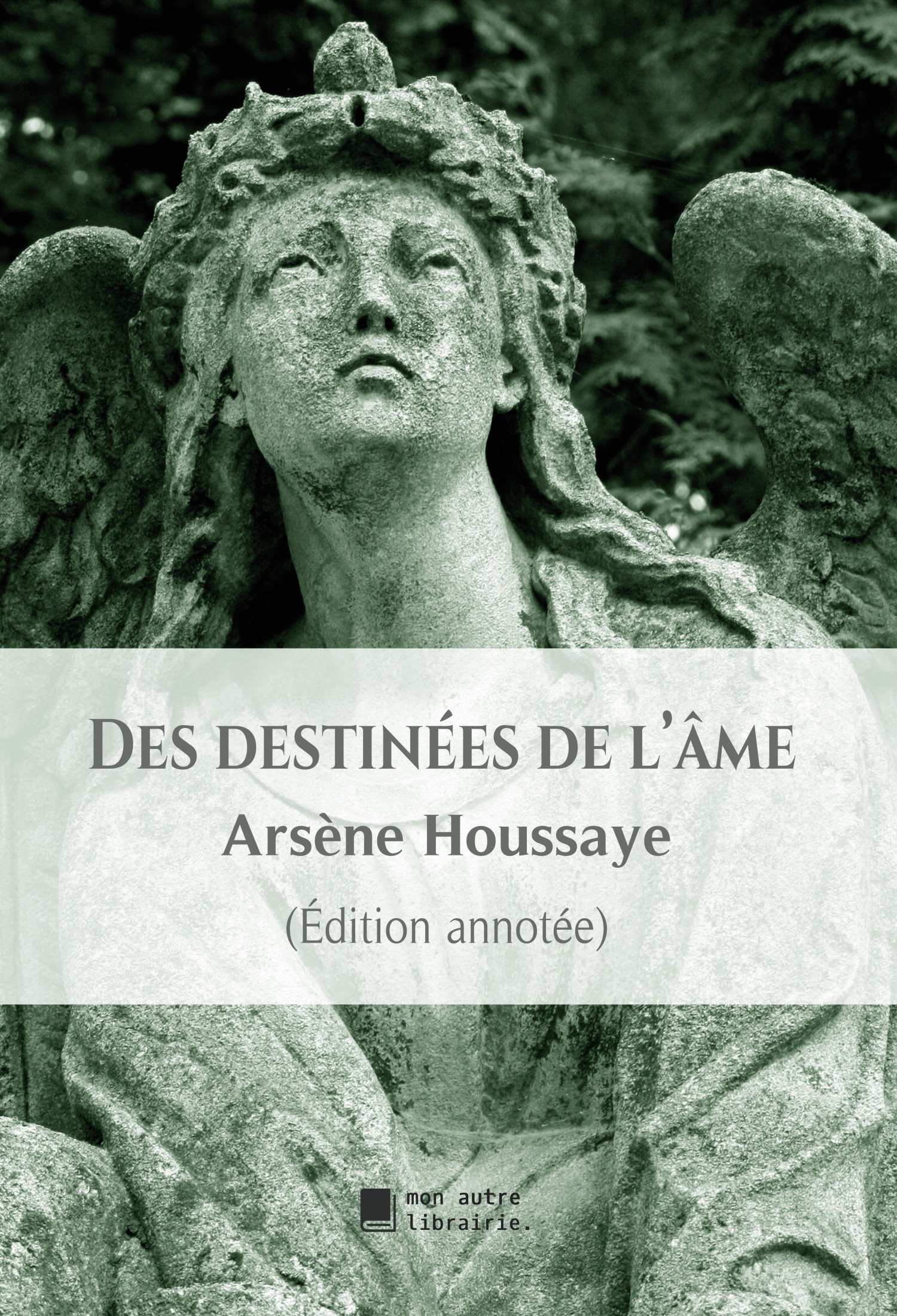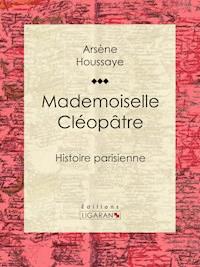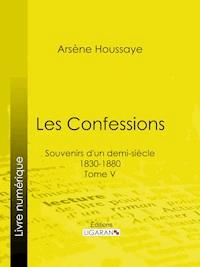
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "Les Muses anciennes ont fait leur temps. Vers 1860 je priai quelques peintres de mes amis de créer les Muses nouvelles. Delacroix esquissa la Passion, Baudry, la Solitude, Cabanel, la jeunesse. neuf poètes devaient consacrer cette renaissance par des sonnets. Banville et Mendès s'en souviennent bien."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mon cher Ami,
Vous me demandez si vous devez continuer la publication de vos Mémoires ou plutôt de vos Confessions, les détails intimes, caractères et portraits, auxquels vous avez de temps en temps initié vos lecteurs, vous autorisant à rééditer ce titre que vous empruntez à Jean-Jacques comme Jean-Jacques l’avait emprunté à Saint-Augustin. Je serais bien maladroit et bien ingrat si je ne vous conseillais pas de continuer. D’abord j’ai pris le plus grand plaisir à la lecture de ces volumes, ensuite j’y ai trouvé, maintes fois, le nom de mon père et le mien escortés des considérations les plus amicales et les plus flatteuses. Il est vrai que vous appartenez, parmi les cadets, à cette grande génération dite de 1830, à qui les fées d’alors, bien fatiguées aujourd’hui, avaient accordé avec la persistante jeunesse du corps l’éternelle jeunesse des sentiments. Vous aviez l’enthousiasme, la foi, l’amour de l’idéal, ce qui n’excluait pas les robustes amours de la réalité. Enfin vous aviez par excellence, les uns pour les autres, ce qui devient de plus en plus rare, l’amitié. Plus l’un de vous s’élevait, plus les autres l’aimaient et chantaient ses louanges. L’émulation y gagnait, la rivalité n’avait rien à y voir. La génération suivante, dont je suis, n’a pas suivi ce bel exemple, et celle qui nous succède ne paraît pas devoir le remettre en vigueur. L’individualisme s’étale sur toute la ligne, et la lutte pour la vie accomplit son œuvre surtout dans la littérature. C’est à qui dévorera son voisin, et l’esprit de commerce s’est presque complètement substitué au commerce des esprits. Nous n’avons que bien rarement de sincères amis parmi nos confrères. Je ne sais même pas si les rivaux existent encore. Nul ne se reconnaît plus le rival de quelqu’un ; chacun se déclare supérieur à tous. Les nouveaux arrivants sont tout de suite des adversaires. Ce n’est même plus querelle d’écoles, c’est concurrence de boutiques. On dénigre la marchandise des maisons achalandées comme si c’était le meilleur moyen de vendre la sienne. Ça passera comme tout ce qui ne sert à rien. L’envie ne fait de mal qu’à l’envieux. « Va, petite bête, disait Tristram Shandy en ouvrant la fenêtre à la mouche qui bourdonnait dans sa chambre et voulait inutilement passer à travers les vitres, va, petite bête, il y a assez de place pour nous deux dans le monde. » Bonne et saine appréciation de tous les bourdonnements de mouches. Il y a assez de place dans ce monde pour tous les hommes de lettres, si j’en juge par le peu de vide que nous causons quand nous n’y sommes plus.
En attendant, je comprends que vous vous complaisiez dans la résurrection d’un temps où les Hugo, les Dumas, les Balzac, les Sand, les Gautier, les Vigny, les Mérimée, s’aimaient et se respectaient, et c’est un vrai régal de lire un livre comme vos Confessions, qui ne contient pas un mot amer contre qui que ce soit, même contre ceux que vous avez aimés et qui vous ont trahi. Vous n’êtes sévère que pour vous. Il est vrai que, qui dit confession dit indulgence pour les autres et pénitence pour soi. À quoi servirait de faire tous les jours un pas de plus vers la mort, si l’on ne devenait pas meilleur en chemin ? Continuez donc cette publication qui rend la vie à tant de choses mortes et qui nous rend la jeunesse à nous qui vivons encore un peu.
Tous vos récits sont sincères, alertes, colorés, touchants. Il se peut que certaines gens vous reprochent de vous confesser trop. – Vous auriez dû, disent-ils, garder pour vous les secrets de votre cœur. – Mais si les poètes ne chantaient pas leurs amours, même en prose, ils ne seraient qu’à moitié poètes, et vous êtes poète de la tête aux pieds. Je ne vois pas Ovide, Catulle, Tibulle et même Horace ne nous parlant pas de leurs maîtresses. Mal en a pris à Virgile, sinon pour sa gloire de poète, du moins pour sa réputation d’homme, de s’en être tenu à la glorification de jeunes bergers. Ça manque un peu trop de bergères, comme l’on dirait aujourd’hui, et si les créations de Juliette, de Desdémone et d’Ophélie n’étaient là pour prouver que Shakespeare savait à quoi, s’en tenir sur les femmes, ses amitiés masculines nuiraient plus à sa mémoire que ne peut vous nuire la confidence de vos amours. Quant aux femmes, elles n’en veulent pas à l’homme célèbre qui divulgue l’amour qu’elles ont eu pour lui ou qu’il a eu pour elles, pourvu que ce soit à l’univers entier qu’il le divulgue. Laure ne reprochera rien à Pétrarque, ni Mme Récamier à Chateaubriand ; et si Mme de Warens se retrouve avec Jean-Jacques dans un autre monde, elle passe son éternité à le remercier de l’avoir déshonorée dans celui-ci. Toutes les femmes sont prêtes au déshonneur qui les immortalise.
Parmi celles qui sont venues chercher sans le savoir la renommée à votre confessionnal, il en est plusieurs, dites-vous dans la préface de ces derniers volumes, qui avaient passé par le mien. J’ai retrouvé en effet parmi vos pénitentes quelques physionomies connues. Par nos études, par nos travaux, par la forme que nous donnons à notre pensée, dans le roman ou sur la scène, nous sommes ces refuges tout indiqués du carrefour populeux que toutes les agitées traversent. Elles ont beau venir de différents points de l’horizon, à un moment donné, elles passent toutes par là. Elles nous racontaient leur histoire, et, comme vous dites encore très justement, cette histoire était toujours la même. C’est qu’il n’y a pas deux histoires pour la femme, il n’y en a qu’une : l’amour. L’histoire n’est diverse que par les circonstances, les dates et les personnages, mais le fait et le sentiment sont toujours identiques. Elles sont ou elles ne sont pas aimées, elles aiment ou elles n’aiment pas, elles se sont données ou elles se sont refusées, elles voudraient se donner ou se reprendre, elles viennent nous demander ce qu’elles doivent faire et ne font que ce qu’elles veulent, quitte à venir nous demander encore comment elles vont se tirer de là. Elles sont sincèrement amoureuses et ne savent pas comment elles ont été infidèles, elles sont vraiment inconsolables et n’aspirent qu’à être consolées. Elles se déclarent très sérieusement à la fin de leur vie affective, et se sentent tout à coup et de très bonne foi à leur premier battement de cœur. Nombreuses sont celles qui nous mentent, plus nombreuses celles qui se mentent à elles-mêmes sans s’en douter et quelquefois jusqu’à en mourir. Nous avons vécu assez tous les deux pour entendre les mêmes femmes nous raconter deux fois, trois fois la même peine, à propos de deux ou de trois hommes différents ; et la dernière fois elles ne se souvenaient pas plus du second que du premier. C’est pour cela que nous les écoutions, bien que l’un de nous les eût écoutées déjà. C’était toujours pareil et c’était toujours nouveau, comme tout ce qui est éternel, comme le soleil et comme la vie.
Que sont-elles devenues, celles qui venaient chez nous ? Quand j’accompagne un de nos contemporains au cimetière, en me promenant, au hasard, après la cérémonie, au milieu des morts, j’en retrouve quelques-unes sous une pierre plus ou moins fleurie, plus ou moins abandonnée.
L’agitation a cessé. La vérité est-elle venue ? L’idéal s’est-il réalisé ? L’infini a-t-il exaucé les prières des années ardentes ? Quel est, dans les amours sans fin, l’élu définitif ? Dieu s’est-il chargé de faire le choix qu’elles n’avaient pas su faire, ou ce rêve est-il à jamais éteint et la couche à jamais froide et désertée ? Quand, par accident, je vais dans le monde, dans un des mondes actuels qui n’en formeront bientôt plus qu’un, je reconnais, avec les yeux intérieurs le plus souvent, quelque survivante se défendant de son mieux contre le passé, le présent et l’avenir, teinte et badigeonnée comme un cadavre en permission de dix heures. Je la regarde errer sous les lustres au milieu de l’indifférence générale, en me disant : « Elle a été passionnément aimée. On a souffert, on a haï, on s’est ruiné, déshonoré, tué pour elle. Autour d’elle rient, dansent, tourbillonnent celles qui en sont encore où elle n’est plus depuis longtemps et qui sont convaincues, comme elle l’était, qu’il ne leur arrivera rien de ce qui est arrivé aux autres. Que d’éternités dans une seule vie ! »
Heureux ceux qui, comme vous, peuvent plonger incessamment dans leurs souvenirs sans en rapporter sur la face l’éternelle pâleur du sépulcre. Moi je serais incapable de ces retours en arrière.
Avez-vous tout dit ? Je me connais, moi, je dirais tout. Ce serait abominable.
Quand je regarde ce qui se passe autour de moi, je me considère comme un saint ; quand je me rappelle ce qui s’est passé en moi, je me tiens pour un monstre. Ne le dites pas.
Bien tendrement à vous.
ALEXANDRE DUMAS FILS.
Marly-le-Roi, 25 octobre 1890.
Figure-toi, ami lecteur, que nous sommes devant la chute du Niagara ou que nous faisons le tour du monde sur quelque navire rapide, mais qui nous semble paresseux.
Nous avons l’avantage de ne pas nous connaître, mais deux courans sympathiques ont touché notre cœur. L’amitié a cela de beau, comme l’amour, que du premier coup elle jaillit de l’âme comme un rayon de soleil sans qu’on fasse rien pour cela. Nous parlons d’abord de toutes choses ; peu à peu, la curiosité mord notre esprit ; nous voulons savoir qui nous sommes. Sans faire trop de façons, nous levons le rideau de notre vie. Eh bien ! je suis un de ces voyageurs. Et si je conte mes aventures et celles de mes amis, ne voyez dans mon récit qu’une franche causerie à bâtons rompus. Ne m’en veuillez pas si je suis tout simple et tout familier, si mes phrases ne revêtent pas l’habit de cérémonie, si je vais étourdiment d’un sujet à un autre. Et si quelque belle et bonne bêtise m’échappe en mes menus propos soyez sûrs que ce n’est pas pour avoir voulu courir après l’esprit.
On a dit fort justement que j’avais écrit les confessions de tout le monde plutôt encore que les miennes.
Il ne faut pas trop m’accuser d’avoir risqué tant de volumes pour conter un peu ma vie, tout en voulant conter celle des autres. Le sage a dit « cache ta vie ». Victor Hugo l’a redit en un beau vers :
Et pourtant l’histoire serait bien plus voilée encore si des conteurs familiers aux beaux jours d’Athènes et de Rome n’eussent pas, en regard des œuvres épiques, peint par de vives couleurs la vie intime de leur temps. Saint Augustin n’a-t-il pas écrit un chef-d’œuvre de vérité en se confessant tout haut. Et avant lui et après lui, combien de pages qui sont de vives lumières dans les ténèbres du passé. Qu’importe s’ils ont mis le moi en scène, si ce moi révèle les passions et les idées de leurs contemporains. Si j’ai eu tort de m’aventurer ainsi en parlant trop de moi tout en parlant des autres, je répondrai à Pascal qui disait : le MOI est haïssable, que Pascal a beaucoup parlé de Pascal. Saint-Simon ne montre bien les figures de son temps qu’en se mettant en scène avec elles. Il a peint l’homme et les hommes. Ainsi a fait Jean-Jacques Rousseau, ainsi ont fait tous les mémorialistes jusqu’à Sand et Dumas. Et pourquoi ne pas citer Napoléon lui-même ? Certes, ce n’est pas par orgueil, c’est par humilité que j’évoque de tels noms. Je veux seulement indiquer qu’après avoir traversé tous les mondes contemporains tantôt poète et romancier, tantôt Directeur du Théâtre-Français, tantôt Inspecteur général des Beaux-Arts, j’ai trouvé presque naturel de peindre ce que j’avais vu, tout en me portraiturant moi-même. J’ai cru ainsi documenter, comme on dit à présent, pour l’histoire future.
Un dernier mot : j’ai eu par la force des choses – si je puis dire – un confessionnal dans ma galerie de tableaux de l’avenue Friedland et dans mon cabinet du Théâtre-Français. Je m’explique : Un homme d’imagination dont les livres ont provoqué beaucoup de curiosités féminines est assailli de femmes romanesques qui dans les jours de crise ou de desesperanza viennent lui ouvrir leur cœur en révolte comme s’il avait la mission de les apaiser. Et ces jours-là les femmes les plus mystérieuses disent tout, avec abondance d’imprécations contre Dieu, contre la famille, contre la passion. Le cri de vérité brûle leurs lèvres. Le confesseur sans le vouloir est du premier coup initié à tous les mystères intimes des belles révoltées de Paris et de l’étranger si bien peintes par Alexandre Dumas II.
Et puisque ce nom glorieux vient naturellement sous ma plume, je le prends à témoin, car bien des pénitentes qui sont venues chez moi se sont risquées chez lui. Dès ses jeunes années il était célèbre, et il était passionnant quoique moqueur. Il avait un hôtel particulier ; aussi vit-on entrer par sa porte comme je vis entrer par la mienne toute une radieuse théorie de très honnestes dames.
Et voilà pourquoi nous avons surpris, en devinant quelquefois ce qu’on n’osait avouer, les passions de notre temps. Il nous arrivait très souvent de nous dire : « Celle-là est allée chez vous, n’est-ce pas ? » Naturellement nous répondions tous les deux : « Jamais ! » Nous n’avons pas trahi le secret du confessionnal.
Mais il y a des secrets qui, peu à peu, tombent dans l’histoire, parce que le temps a passé souvent avec la mort ; parce que l’anonymat sauve tout et parce que les masques se dénouent d’eux-mêmes. Tant pis pour celles qui se sont risquées d’un pied léger dans l’enfer rose ou rouge de la passion.
Tant mieux peut-être, puisque toute femme a dans son cœur le paradis à côté de l’enfer, les joies de l’Amour et les voluptés éplorées du Repentir. Le temps est venu trop vite où il leur faut chanter comme moi :
Au sixième volume de mes Confessions je vais écrire le mot Fin : – fin du livre et fin de l’homme. – Je pourrais continuer ce réveil des Souvenirs, mais j’en ai trop réveillé déjà ! Pourquoi tant de hors-d’œuvre, pourquoi tant d’histoires de moi quand je ne voulais écrire que les mémoires des autres ? C’est bien un peu la faute de Dentu qui voulait le titre de Confessions. Ne croyez pas que ç’a été par un vain jeu de l’esprit, car je pense avoir fait œuvre d’historien, non seulement du cœur humain, mais aussi de mon siècle. Ma vie que je n’ai pas conduite m’a forcé de m’aventurer sur la scène du monde. Tout homme de pensée, s’il est de bonne foi, travaille à dégager les nuées pour faire la lumière.
Il me semble que j’étais quelque peu destiné à écrire l’histoire intime de ce XIXesiècle qui a eu toutes les aspirations des grands siècles. Quand on a vécu si longtemps que moi, quand on a gravi la montagne des neiges éternelles, on se retourne pour revoir toutes les figures qui font le passé rayonnant. C’était un devoir pour moi de peindre ces figures, le hasard des choses m’ayant donné une bonne stalle au spectacle du XIXesiècle. On dégagera un jour de mes Confessions les pages trop personnelles et les pages qui ne vivent qu’un jour pour ne conserver que les chapitres consacrés aux choses que j’ai vues et aux grands hommes qui ont été mes amis.
ARSÈNE HOUSSAYE.
Les Muses anciennes ont fait leur temps. Vers 1860 je priai quelques peintres de mes amis de créer les Muses nouvelles. Delacroix esquissa la Passion, Baudry, la Solitude, Cabanel, la Jeunesse. Neuf poètes devaient consacrer cette renaissance par des sonnets. Banville et Mendès s’en souviennent bien. Je fis mon sonnet sur la Solitude. Ô Muse de la Solitude, combien de fois je t’ai, appelée en mes stations de silence et d’oubli, à la Folie-Riancourt, à Valbon et à Parisis ! Combien de fois j’ai voulu m’évanouir dans ses bras comme une âme en peine. Vivre loin du bruit, avec le dédain des vanités, dans la communion de la nature, c’est la sagesse ! Aussi, bien souvent j’ai rejeté avec tristesse et avec confusion ces pages de mes souvenirs en me disant : « À quoi bon revivre une heure de plus ?Pourquoi ramener la lumière sur ce qui a été moi et qui n’est déjà plus rien ? Pourquoi rouvrir mon cœur pour les curiosités de mon esprit ? »
Mais, quand je veux m’ensevelir sous le blanc et froid linceul filé par la mort de toutes choses, les amis viennent qui me prouvent que le devoir est de vivre – de vivre d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Quand je me suis pendant quelques mois perdu et reperdu dans le tourbillon de Paris, la voix des bois, des vignes, des prairies me rappelle à Bruyères. Non seulement j’y retrouve ma famille que je ressuscite, mais j’y retrouve aussi quelque chose de moi qui ne me suit pas à Paris, une vague poésie de pays natal que je réentends chanter en mon cœur dans l’hymne universel. Ma première jeunesse est couchée là sur un lit de roses pâles que, grâce à Dieu, ces grandes utilitaires qui s’appellent la Vapeur et l’Électricité n’ont pas profané.
Pourquoi ces deux volumes encore de Confessions ? C’est qu’il me restait à peindre bien des tableaux et bien des physionomies de ce siècle où j’ai joué plus d’un rôle sur le théâtre officiel et sur le théâtre libre. D’ailleurs, tout en voulant disparaître de la scène du monde, je sentais que mon cœur avait encore quelque chose à dire ; par exemple j’ai retrouvé en ces derniers temps une petite clef d’or, la clef d’un meuble d’ébène que j’avais oublié quand j’ai écrit mes quatre volumes, quoique ce fût le vrai chiffonnier du cœur.
J’y avais jeté pêle-mêle des lettres de toutes les paroisses : autographes passionnés ou autographes railleurs ; envolées dans le bleu et gaietés sceptiques ; des amours de la veille ou des amours, de l’avant-veille ; papiers de toutes les nuances, de toutes les coquetteries ; des battements de cœur et des larmes ; cachets armoriés, enveloppes de coquines ; style de Sévigné et naïvetés sans orthographe : tout un monde de sentiment, depuis le pôle jusqu’à l’équateur.
Je me promettais toujours de relire ces chefs-d’œuvre ; mais le flot montait sur le flot. Çà et là, pourtant, en ces amours défuntes, ces pastels effacés, ces souvenirs charmeurs, je me retrouvais avec les joies attristées de mon âme et la mélancolie des rêves évanouis. Mais j’avais peur de troubler le silence des mortes. N’était-ce pas un sacrilège de dévoiler encore le secret des femmes qui ont été trahies, car dans la bonne foi de l’heure fugitive, n’avait-on pas juré à toutes de les aimer plus que toujours, plus loin que jamais, jusque dans les profondeurs du ciel !
Un jour, pourtant, j’ai pris ces lettres par poignées, je les ai appuyées sur mon cœur et sur mes lèvres, les larmes me sont revenues, j’ai pleuré sur tous ces tombeaux du bonheur. Et puis, j’ai voulu revivre des joies passées. Hélas ! c’étaient, pour parler en vieux style, les épines sans les roses ; car les roses effeuillées n’avaient plus que le parfum des asphodèles. Combien d’images ! les unes encore tout en relief, les autres s’effaçant dans la pénombre, celles-ci dans tout l’éclat de leur radieuse jeunesse, celles-là se perdant dans la suite des âges.
Rien n’est plus doux et rien n’est plus cruel que le souvenir. Il jette souvent la nuit sur les figures les plus aimées, tandis qu’il se moque quelquefois de nous, en nous représentant des visages grimaçants. Nous arrivons pourtant à ressaisir le sourire des lèvres, l’éclat des yeux, les lignes de l’ovale ou du profil, le charme de la désinvolture, les tons nuancés des cheveux, selon les reflets, de la lumière. Et quelle joie quand la pensée inquiète a recréé celle qui n’est plus ! Mais ce sont là des portraits fugitifs qui s’évanouissent dans nos bras.
Sans avoir la prétention de chiffrer les sept cents femmes et les sept cents concubines du roi Salomon, quand on a, comme moi, traversé en tous sens la vie parisienne pendant trois jeunesses successives, on serait le dernier des hommes si on n’avait pas connu plus ou moins beaucoup de femmes. Il n’y a aucune fatuité à le dire. Si on a le goût du féminisme, oh est entraîné malgré soi dans mille et un embarquements pour Cythère, pavoisant le joli navire de Watteau ou la mystérieuse gondole de Canaletti.
À côté des passions, il y a les camaraderies, les rencontres fortuites aux heures de carnaval, les liaisons dangereuses et celles qui se brisent du premier coup. Je n’ose dire comme Napoléon les « duos de canapé ».
De toutes ces effusions diurnes et nocturnes, il reste, ainsi que le disait le poète :
ou des roses-thé, qui versent l’idéal des parfums.
On est sur la terre pour les joies de l’amour ou pour les joies de l’orgueil.
Tout jeune encore, j’ai mesuré l’orgueil et je l’ai trouvé bien petit devant les splendeurs inouïes de la femme.
Celui qui n’aime pas la femme ne connaît ni la joie des sacrifices, ni les suggestions de l’infini. La femme vous apprend tout : le connu et l’inconnu, le visible et l’invisible. Cette écolière de Satan vous apprend Dieu, – Dieu lui-même !
On trouve par la femme tout ce qu’il faut croire et aimer. Elle est le charme de la famille, elle est la fleur de la solitude. Que d’autres qui se croient plus sages courent à la fortune, aux inquiétudes de la vie publique, aux vanités bruyantes du forum, au néant de la souveraineté, aux angoisses de l’argent, aux goinfreries pantagruéliques, aux saouleries de vins frelatés : – moi je n’ai jamais couru qu’aux joies du travail dans l’atmosphère d’une femme aimée.
Les sentencieux, plus ou moins vermoulus, crieront au libertinage du cœur et des lèvres, parce qu’ils ne comprennent pas qu’en aimant la femme, on est possédé de l’amour du beau, du bien et du vrai. Jésus-Christ l’a compris, puisque la femme parfume l’évangile. Homère, notre premier maître, n’a-t-il pas peuplé l’Olympe de femmes ?
Et maintenant, si vous n’êtes pas convaincu, ami lecteur, jetez ce livre au feu, car ce serait du sanscrit pour vous. Si, au contraire, vous êtes de mon opinion – une opinion bien douce à suivre – vous trouverez ici, dans les évolutions d’un cœur passionné, des récits, un peu risqués souvent, mais toujours dominés par la sublime religion de l’amour.
Aimer la femme est un don comme l’art et la poésie. La plupart des hommes ne recherchent la femme que comme des bêtes plus ou moins féroces à l’heure des secousses et des emportements de la chair. Les privilégiés, en fort petit nombre, aiment la femme à toute heure comme on aime le soleil, le ciel bleu, les forêts, les Océans. Elles inspirent à l’esprit la douceur de vivre, elles répandent autour d’elles des rayonnements et des parfums que seuls les initiés savent voir et respirer. C’est toujours Ève qui a pris à Adam une part de lui-même, une part qu’il veut sans cesse reconquérir.
Il n’y a pas de mot plus juste que celui dont on se servait autrefois, « ma moitié ». Sans la femme, l’homme n’est qu’un commencement et un inachevé.
En toute période de ma vie j’ai voulu ma moitié, je parle plus encore peut-être en idéaliste qu’en réaliste.
J’avais le culte profond et sévère d’Aphrodite sans tomber dans la bêtise des Français, ces traducteurs qui ont trahi toute la poésie grecque. Vénus était la grande déesse génératrice ; non pas la blonde catin mère des amours, mais la noire aphrodite Mélania, la victorieuse et la dominatrice s’appuyant sur Éros et Antéros. Oh ! non, celle qui portait le croissant surmonté d’une étoile à huit rayons n’était pas la drôlesse des petits poètes français.
En ces derniers volumes, que je n’écris que sur la prière des curiosités sympathiques et inespérées qui me sont venues de toutes parts, je suis bien forcé de me remettre au point de départ de ma vie, puisque les pages qu’on va lire me reverront dans le même monde, mais dans d’autres aventures. Je voudrais bien ne plus parler de moi, maintenant que l’oubli file déjà mon linceul, mais il n’y a pas de meilleure école que soi-même pour démasquer les passions. On finit toujours par dire avec Alfred de Musset :
C’est donc par l’étude et le souvenir de mon cœur que j’ai mieux étudié celui des autres. Voilà pourquoi on me retrouvera en scène pour mieux peindre la comédie des passions au XIX° siècle.
Ce XIXe siècle est si plein de toutes choses qu’il faudrait cent volumes pour tout dire. Si je m’étais contenté de ne parler que de moi, un volume eût été déjà trop ; mais, voulant peindre la plupart des figures glorieuses ou originales, les actions de celle-ci ou de celle-là, le tableau varié de tout un siècle tourmenté par des passions plus altières et plus profondes que celles des siècles passés, on trouvera bien naturel que, repassant ma vie et me remettant au point de vue de mon esprit en chaque période, j’y retrouve toute une moisson de souvenirs qui ne seront pas seulement une distraction pour ceux qui aiment les bleuets et les coquelicots, mais qui seront une gerbe pour l’histoire.
Je ne parle pas des pages toutes personnelles comme les infiniment petits romans qui suivent et que je donne en passant pour marquer comment dans les gamineries de l’amour on gagne ses titres en philosophie. Je compris bien alors cette vérité : le silence est d’or et la parole est d’argent – quand elle n’est pas de la fausse monnaie.
Les passions ne prennent le cœur de l’homme qu’après les amorces de l’amour, c’est l’histoire des batailles qui commencent par des escarmouches.
J’avais seize ans, cheveux blonds et yeux bleus ; on disait le gentil Houssaye, mais je n’étais pas gentil du tout. Je faisais le désespoir de toute la maison, parce que j’avais quitté le collège pour faire le diable à quatre. Quel est le rustique qui n’a rencontré les Chloés pour jouer les Daphnis ? Je devins sans le vouloir amoureux de ma voisine, – un ange, vous n’en doutez pas. – Je ne lui disais rien, et elle ne me répondait point.
Un jour, je la suivis dans les bois. À la lisière, devant les chênes et les ormes, je lui pris le bras. Elle rougit et marcha du même pas. Nous voilà loin. Pas un mot. Je vois des violettes, j’en cueille une poignée et je les mets dans son sein. Elle pâlit. Nous marchons toujours. Voici une source dans les rochers. Rosina se penche et se mire, je lui donne à boire dans ma main ; nous buvons bientôt du même coup à la même coupe.
C’est divin. Nous reprenons notre éloquente promenade. Voilà maintenant un nid de rossignols dans une aubépine. « Chut ! dis-je. – Je n’ai pas parlé, » murmure-t-elle.
Plus loin, un rebord moussu : on s’assied. Je prends la main de ma voisine et je regarde ses beaux yeux. « Je vous aime, Rosa. » C’est tout. Survient un bûcheron. « Oh ! si maman le savait ! » Rosina se lève et s’en va. Je lui reprends le bras ; nous revenons par un autre chemin : un second bûcheron ! Nous sortons du bois, je montre un jardin à Rosina ; là il n’y a pas de bûcheron. Nous franchissons la haie et nous nous cachons dans un massif. Il y a un banc de pierre sous un arbre de Judée ; je casse une branche pour Rosina, mais une voix de tonnerre : « Que faites-vous là ? – Rien du tout. » Le maître du jardin nous met à la porte du Paradis avant le péché. Une heure après, tout le pays est ému.
« Mademoiselle, que faisiez-vous ? – Rien. – Que vous disait-il ? – Rien. Que lui répondiez-vous ? – Rien. »
On ne nous envoya pas en cour d’assises. Ce rien, c’était tout !
Nous nous étions adorés dans le silence des bois au rythme chanteur de la source vive !
Ce n’était que le premier chapitre. Le second fut encore plus éloquent, c’est-à-dire plus silencieux. Le sage élève un autel au Silence, se rappelant les paroles de Pythagore : « Tais-toi, ou dis quelque chose qui vaille mieux que le silence. »
Qu’est-ce que la poésie des mots devant la poésie des choses ?
Quand je devins un Parisien, je rencontrai dans le monde une très jolie dame dont on vantait les hautes coquetteries à pied et à cheval. Elle parlait toujours, non pas sans esprit, et on avait beau vouloir l’emprisonner dans la passion, on ne pouvait pas la tenir en place. Je me risquai à recevoir des coups d’éventail et de cravache. Je jouai l’amour éperdu en vers et en prose. Combien d’éloquence en pure perte ! Combien de sonnets chantés sur tous les airs ! Pour elle, je repris mon violon, croyant la charmer avec du Lulli, du Gluck et du Schubert ; mais elle était trop occupée à parler, à parler encore, à parler toujours, pour ouïr la voix tendrement élégiaque de mon violon.
On me demandait souvent si j’avais brisé les ailes du moulin à paroles.
Je répondais que ce moulin-là était inassiégeable, tant il avait toujours le dernier mot.
J’obtins la faveur d’aller prendre le thé chez cette éternelle chercheuse d’esprit.
Dès que je fus dans le petit salon, je voulus embrasser la dame ; mais elle parla avec tant de volubilité que je ne pus placer un point, pas même une virgule.
Elle fut spirituelle, je fis semblant de l’être. Je tentais d’en découdre autant qu’elle-même.
Je répondais, elle répliquait.
On parla de tout, journal du matin et journal du soir.
On continuait à se griser par la parole. De temps en temps je voulais, happer Célimène ; mais elle avait encore un mot à dire, puis un mot.
On servit le thé : de l’or dans du vieux chine. La causerie ne fut plus qu’une chinoiserie : comme la corneille, on abattait des noix trop vertes ; comme le vent d’automne, on effeuillait la forêt de Shakespeare.
Devenu furieux, je tentai encore l’aventure.
– Nous n’y sommes pas, dit-elle.
– Qu’est-ce donc que l’amour pour vous ?
– C’est une conjonction d’astres qui se disent…
– Bonjour ?
– Bonsoir ! je n’ai plus que le temps de m’habiller pour aller au bal. »
Elle sonna.
Tant pis, je la pris sur mon cœur, sans souci de l’habilleuse ; mais soudain l’oiseau babillard s’envola gaiement. Je voulus suivre la belle dans son cabinet de toilette ; mais sur le seuil de la porte elle me tint un discours à perte de vue sur les périls de l’amour et sur les contentements de la vertu. J’étais exaspéré, je pris mon chapeau :
– Adieu, moulin à paroles.
– Adieu, faiseur de sonnets ; je vous attends demain.
Le lendemain, ce fut la même comédie. Toujours l’oiseau babillard, toujours l’oiseau qui s’envole pour chanter sur une autre branche.
Je me rappelai alors la douce et silencieuse Rosa.
N’est-ce pas qu’en amour il faut élever un autel au Silence ? le Silence, qui parle mieux que toutes les Célimènes. Je n’eus raison de celle-ci que dans la silencieuse Venise.
1831
Il y a des aurores amoureuses qui s’impriment plus profondément, comme eaux-fortes de la mémoire, que les réalités brutales parce que les souvenirs embaumés par la poésie vivent plus longtemps que tes souvenirs tombés dans la fosse commune.
Ce ne fut pas sur la Chimère antique, mais sur un beau cheval, robe de corbeau, que je vins la seconde fois à Paris, avec mon père pour compagnon de voyage. Nous descendîmes rue de la Monnaie, tout près d’un ami de ma famille, le célèbre Jennesson, qui fut préfet de police, moins le titre. C’était d’ailleurs pour lui que mon père s’était mis en route.
J’espérais que Jennesson, qui était fort répandu, me promènerait quelque peu dans ce Paris enchanté, mon rêve depuis que ma tête parlait. En effet, il fut bon prince ; dès notre arrivée, il nous proposa non seulement de nous conduire dans les grands théâtres, mais aussi à une fête de l’Opéra qui promettait d’être sans seconde, une fête de charité organisée par la reine pour adoucir le rude hiver de 1831. Les billets qui ne coûtaient qu’un louis, avaient été disputés par le beau monde. On les rachetait maintenant jusqu’à cinq louis. Mon père ne parut pas curieux à ce prix-là, mais Jennesson avait des billets de faveur. « Vous pouvez bien les accepter, nous dit-il ; vous n’en serez pas quittes à si bon marché, il y aura une quête faite par les plus belles femmes de Paris. »
Vint le jour du bal. Quoique mon père aimât l’argent, vrai père de famille qui prévoit que ses enfants en jetteront beaucoup par la fenêtre, il fit bien les choses. Tout enchariboté qu’il fût dans ses terres et ses bois, il avait encore ses heures de jeunesse. Il ne faisait pas le beau comme au temps où il caracolait dans la brigade Nansouty, mais il n’était pas fâché de prendre çà et là un air de mode.
J’avais un caractère si contradictoire, en ce temps-là surtout, que j’étais tour à tour hardi et timide. En entrant à cette fête, où j’étais venu en fiacre, je ne me sentis pas fier du tout. Je marchais sur des charbons. Tout Paris était là ; on me montra dans les loges les personnages de la cour, de la politique et des lettres. Je ne remarquai bien que mon compatriote Alexandre Dumas et Alfred de Vigny, un de mes poètes, coquetant tous les deux dans un bouquet de femmes.
À qui parler ? car j’étais le plus étranger des étrangers. Heureusement que je fis une rencontre dans cet océan de lumière, de diamants et de roses. C’était le général de la Houssaye, qui avait fait amitié avec mon grand-père, au sacre de Charles X, sous prétexte que mon grand-oncle, le général Houssaye, lui avait sauvé la vie en Vendée.
Jennesson, qui connaissait tout le monde et qui savait l’histoire de tout le monde, me présenta au général de la Houssaye comme un poète en herbe, qui ne serait sans doute pas indigne de son grand-oncle. Le général me fut très gracieux. Voyant quelques belles jeunes filles qui n’avaient ni danseurs ni valseurs, il me jeta sur la proie, en vieux soldat qui aime toutes les batailles. Quoique je n’eusse que dix-sept ans, je n’avais pas trop l’air d’un écolier, peut-être parce que j’avais toujours fait l’école buissonnière. J’y allai bon jeu, bon argent.
Me voilà donc sur le champ de bataille de la valse avec Mlle Caroline ***, une belle personne tout-habillée en roseaux. Les Ophélies étaient à la mode. Elle me prit pour ce que j’étais : un joli valseur, comme on dit dans le monde. Cette belle personne était, d’ailleurs, connue du général. Elle appartenait à la famille d’un des derniers maréchaux survivants. Sa mère l’accompagnait sans presque la perdre de vue. Je lui dis quelques mots pour la comparer à Ophélie. Elle me répondit qu’elle n’était pas une héroïne de roman. Je voulus lui prouver qu’une jeune fille, quand elle est douée de toutes les beautés, est toujours l’héroïne du roman de son cœur. Elle me regarda doucement. « Nous danserons tout à l’heure et nous causerons, » me dit-elle. Après la valse j’étais troublé, après le quadrille j’avais pris feu.
Je ne sais par quel caprice soudain elle s’était abandonnée à mon rêve shakspearien. À la fin de la seconde valse Caroline à demi évanouie dans mes bras me dit : « Valsons toujours, valsons toujours ! Je veux mourir en valsant avec vous. Cachez-moi bien, car il y a là-bas une figure qui me fait peur. »
Mais je ne devais jamais plus ni valser ni danser avec elle. Ses paroles mystérieuses bruissent encore à mes oreilles, tant le cœur se souvient ! J’ai été dieu pendant cinq secondes – cinq siècles !
Après le quadrille, ce fut le galop ; la jeune fille passa aux mains d’un jeune monsieur tout confit que lui imposa sa mère. Je regrettais de ne pouvoir continuer la fête avec une si charmante figure, dont le sourire avait pour moi toutes les éloquences. Je pris la première venue pour galoper dans le même tourbillon comme si je poursuivais un rêve.
Ce fut pour moi une grande surprise quand tout à coup un jeune lieutenant de hussards, entraîné dans notre cercle, lâcha sa danseuse et saisit Mlle Caroline ***. C’était par droit de conquête. Il l’arracha des bras de son danseur sans plus de façon que dans un bal de barrière.
Mlle Caroline *** poussa un cri qui domina l’orchestre et qui alla jusqu’au cœur de sa mère, quoiqu’elle fût alors du côté opposé, car le hussard avait bien choisi son moment.
Je vis cette étrange action avec un battement de cœur ; il me sembla que c’était un maître qui reprenait son bien. Je fus horriblement jaloux ; un peu plus, je me jetais à la traverse. Mais le flot nous emportait. Je repassai devant la mère qui était blanche comme la mort. « Ma fille ! ma fille ! » criait-elle, soutenue par deux amies.
Elle s’évanouit, mais elle rouvrit les yeux en criant encore : « Ma fille ! »
Elle voulut courir, comme si elle dût la retrouver.
« Ne criez pas ainsi, lui dit une dame qui avait vu le jeu, vous allez perdre votre fille. – La perdre ! murmura-la mère avec un inexprimable sourire d’amertume et de désespoir. »
Et elle marchait toujours à travers ces vagues joyeuses et bruyantes. Cependant Mlle Caroline *** ne reparaissait pas. Était-elle dans un autre cercle de cet enfer des plaisirs ? Quand la galope fut finie, je m’aventurai çà et là pour retrouver ces deux figures romanesques. Je croyais lire un roman, un roman où j’aurais dû jouer un rôle ; mais je ne retrouvai pas l’héroïne.
La mère elle-même avait disparu. Tout ceci n’avait fait du bruit que dans un tout petit coin de la fête. On en parla à peine pendant un quart d’heure ; on jugea que la mère avait retrouvé sa fille ; on supposa que le hussard, un peu allumé par l’ivresse, avait agi comme en pays conquis ; puis on parla d’autre chose ; d’ailleurs chacun était là pour soi, cherchant une aventure, sans s’inquiéter de celles des autres. Mais moi j’avais toujours sous les yeux la figure toute pâlissante de Mlle Caroline ***, et le cri qu’elle avait jeté retentissait encore dans mon cœur.
Nous déjeunâmes chez Jennesson vers midi, après quelques heures de sommeil. Je lui racontai l’histoire, du moins ce que j’avais vu de l’histoire : « Oui, oui, je vous en dirai des nouvelles. »
Le lendemain, comme nous déjeunions encore ensemble, il me dit : « Vous aviez raison de voir là une scène de drame, mais le dénouement est bien plus terrible. »
Il me passa un journal. « Lisez cela. » Je lus ces lignes, qu’il avait encadrées d’un trait de plume :
« La fête a été splendide, c’est 50 000 francs pour les pauvres. On s’est amusé jusqu’au matin. Décidément, Mme d’Aponye a mis la galope à la mode. C’était une et furia. Nous avons pourtant à regretter un cruel évènement. Une jeune fille s’est évanouie dans le tourbillon, on l’a transportée dans le foyer de la danse, où elle a bientôt succombé à la rupture d’un anévrysme. On dit que sa mère en mourra de désespoir. La reine, toujours si bonne et si sympathique à ceux qui souffrent, a envoyé un chevalier d’honneur vers la désespérée. »
J’étais tout ému et tout pâle ; « Eh bien ? me dit Jennesson. – Il me semble que je rêve ; comment, tant de beauté dans un linceul ! – Ce n’est pas tout ; » Et Jennesson me montra ces quelques lignes, aussi encadrées de noir :
« Nous avons aussi à déplorer un autre malheur ; on nous assure qu’à la fin du bal un jeune officier de hussards s’est brûlé la cervelle sans dire pourquoi. Il s’était battu en duel ces jours-ci avec un de ses camarades. Question de femme, sans doute. »
Le journaliste partait de là pour paraphraser ses sentiments sur le duel et sur le suicide. « Je ne comprends pas, dis-je à Jennesson. – Je crois bien, me répondit-il, c’est le journal qui parle ; mais les journaux ne savent rien, à moins qu’ils ne fassent semblant de ne rien savoir. Maintenant, écoutez-moi, car mon métier est de savoir tout. Mme*** n’a pas retrouvé sa fille à l’Opéra parce que sa fille n’a pas été, comme le dit le journal, au foyer des artistes. Où est-elle allée ? A-t-elle marché de bonne volonté ou a-t-elle été entraînée ? Ce que je sais déjà très bien, c’est que la mère ne voulait pas que la fille vît le hussard, parce que les deux familles sont en guerre comme deux familles corses. D’ailleurs, le hussard était bien jugé par le monde comme un libertin fieffé. Mais Mlle*** aimait M. Émile ***, quoiqu’elle en eût peur, ou parce qu’elle en avait peur.
Or, la mère, tout affolée, ne retrouvant pas sa fille, est venue chercher le préfet de police. On m’a appelé et on m’a donné la mission de trouver la demoiselle ou la damoiselle, si vous voulez, avec pleins pouvoirs de requérir la force armée, si le lieutenant faisait des siennes, car on ne doutait pas que Mlle Caroline *** ne fût avec lui.
« Naturellement, je ne trouvai pas le hussard à la caserne du quai d’Orsay ; mais j’appris là sans beaucoup de diplomatie, qu’on le trouvait souvent la nuit soit à l’hôtel de Champagne, soit rue de Bourgogne, dans l’appartement d’un de ses camarades presque toujours en voyage. J’allai tout droit rue de Bourgogne ; le concierge me jura ses grands dieux qu’il n’avait pas vu le lieutenant depuis quelques jours. – Combien vous a-t-il donné pour que vous me disiez cela ? – Pas un sou, monsieur. – Eh bien, conduisez-moi dans l’appartement.
« Cet homme refusa ; je montai rapidement l’escalier. Je sonnai au premier étage. Ce n’était pas là, mais on m’apprit que je n’avais plus qu’un étage à monter. Je sonnai, l’oreille à la porte. Il me sembla entendre un bruit de pas. Quoique seul et sans écharpe, car je ne voulais pas que l’affaire fît du bruit, je criai, après avoir frappé violemment : « Au nom de la loi, ouvrez. » J’ai une voix qui perce les murs ; une seconde fois, je criai : « Au nom de la loi, ouvrez. » Une forte détonation me répondit. J’avoue que je fus effrayé, non pas pour moi, bien entendu, mais effrayé de l’action de la police.
« Le coup de pistolet n’était-il pas parti parce que j’avais parlé au nom de la loi ? Je ne pouvais pourtant pas rebrousser chemin. Le concierge m’avait suivi avec inquiétude ; il faillit se trouver mal quand il entendit la détonation, « Vous avez une double clef ? lui dis-je. – Oui, monsieur. » Il alla tout défaillant chercher sa seconde clef. Nous entrâmes. Je traversai l’antichambre et le salon. J’ouvris la porte de la chambre à coucher. Horrible spectacle ! un homme venait de tomber mourant, la tête dans l’âtre. Je courus à lui, je le soulevai dans mes bras, il remua les lèvres, mais il ne dit pas un mot ; il avait frappé juste en se frappant au cœur. »
Je dis à Jennesson qu’il eût frappé plus juste en se frappant à la tête, cette mauvaise tête. « Ce n’était pas tout, reprit-il ; à peine l’eus-je relevé à demi contre un fauteuil que je vis sur le lit Mlle Caroline ***, toute blanche dans sa robe de bal, cette robe de roseaux qui vous avait paru si poétique.
Je m’écriai : « Ah ! mon Dieu ! – Ah ! mon Dieu ! répéta Jennesson, c’est le cri qui tomba de mes lèvres, mais elle ne l’entendit pas. Je lui saisis la main. Une main glacée. Les yeux étaient ouverts, la bouche souriait presque, mais il y avait déjà bien, des heures qu’elle était morte. On courut chercher un médecin. Rue Saint-Dominique, on rencontra Magendie, qui ne se fit pas prier pour venir. – C’est fini, dit-il du premier mot, après-avoir jeté son vif coup d’œil. – Je vois bien, lui dis-je, comment il est mort, lui ; mais elle ? – Elle ? dit Magendie tout en dégrafant la robe. Voyez, elle est morte de la rupture d’un anévrysme. – Comment, si jeune ? à dix-sept ans ? – Oh ! mon Dieu, oui ; dans ces robes de bal qui emprisonnent le cœur, il ne faut qu’une émotion Violente pour tuer une femme. – Alors le coupable est là ! – Oui. Voyez : il s’est fait justice. » Magendie poursuivit son examen : « Le coupable n’est peut-être pas si coupable que cela. – Alors, on pourra ensevelir Mlle *** dans le linceul sans tache ? – Je ne veux pas le savoir, dit Magendie ; j’ai trop le respect de la mort. À quoi bon, d’ailleurs ? C’est bien le moins que cette belle créature s’en aille au tombeau dans sa blancheur. »
Quand, le soir, à force de prières, je parvins à accompagner Jennesson et le juge d’instruction dans la chambre mortuaire, je vis la malheureuse mère éplorée, embrassant sa fille comme pour lui redonner une âme ; mais Caroline n’était plus de ce monde où on aime et où on pleure.
On envoya quelques lignes à deux journaux pour déguiser la vérité. L’enterrement devait se faire le lendemain à Saint-Thomas d’Aquin, à la chapelle de la Vierge, mais sans pompe et sans bruit, comme les douleurs qui se cachent.
Jennesson espérait que la vérité n’éclaterait point. La famille du lieutenant avait le matin emporté sa dépouille pour la conduire en Bretagne dans une chapelle de famille. On a prié les journaux de ne pas reparler de son suicide, par respect pour l’armée. « Si le concierge se tait, reprit Jennesson, il ne sera plus question ni de lui ni d’elle. Requiescant in pace. »
J’écoutais encore, le cœur oppressé. Jennesson me prit la main. « Mon jeune ami, faites-vous enlever par les femmes, mais ne les enlevez pas… surtout en robe de bal… Cette jeune fille est peut-être morte étouffée par sa robe et par ses battements de cœur. Et pourtant… »
Bien longtemps après, je causais avec Alexandre Dumas de cette tragique aventure, en lui rappelant que je l’avais entrevu à cette fête célèbre. « Oui, oui, dit-il, je sais l’histoire, mais je croyais que c’était une femme mariée. Cela m’a servi pour Antony. C’est en me demandant pourquoi le hussard s’était tué que j’ai trouvé mon dénouement. »
Un ami de Dumas nous dit alors qu’on ne savait pas encore bien pourquoi le hussard s’était tué : « C’est pourtant bien simple. Il se croyait le maître de la destinée de cette jeune fille. Ce n’était pas la première fois qu’il l’entraînait rue de Bourgogne. La pauvre enfant n’avait pas la force d’échapper à cet oiseau de proie. Quand il la vit morte dans ses bras, il s’imagina sauver son honneur en se tuant lui-même pour faire croire qu’elle lui avait résisté. »
Je pensai alors que puisqu’elle s’était tournée vers moi au bal, j’aurais dû ne pas la quitter d’une semelle pendant toute cette fête de l’Opéra.
Ce n’est pas la pensée de Pascal, le roseau pensant, ni le roseau chantant d’Ovide, qui me fait songer à la blanche figure de Mlle Caroline ***, avec sa robe de roseaux. C’est que je la retrouve toujours dans mon cœur ; c’est que je cherche encore à pénétrer cette mort mystérieuse de la jeune fille après ses paroles affolées, pendant que nous Valsions.
L’âme universelle qui répand sa lumière sur les âmes humaines projette un rayon magique sur chaque berceau. Les fées ne sont que la légende de toutes les images des aïeux qui viennent souhaiter la bienvenue aux petits enfants. C’est là le caractère sacré du pays natal. Ces images des aïeux qui ont aimé et qui ont souffert avant nous forment toujours le pieux cortège invisible poétisant les chemins, les sentiers, les paysages où à notre tour, nous aimons et nous souffrons la vie.
Quand je quitte les solitudes de Bruyères pour le doux enfer de Paris, je dis toujours un adieu attendri au pays natal.
Il y a plus d’un pays natal, celui de nos yeux, celui de notre esprit, celui de notre cœur, je veux dire celui de notre famille, celui de nos joies enfantines et celui de notre premier amour.
Bruyères est un des meilleurs pays de France, respirant l’air des forêts et des montagnes, buvant aux sources de la fontaine minérale, cultivant la vigne et le froment. On vit cent ans dans ce pays-là. Mon père et ma mère, qui n’avaient pas quarante ans à eux deux quand je suis né, m’ont donné un sang généreux dans un corps robuste, quoique souple et mince. Mais l’air vif et savoureux de Bruyères a achevé leur œuvre. Il paraît que je suis trempé dans l’acier, puisque je n’ai jamais connu les abattements qui font chanceler tant d’hommes vers la fin de leur première jeunesse. J’ai subi de terribles maladies, qui eussent couché beaucoup d’hommes superbes dans le tombeau. Mais les quatre médecins légendaires avaient beau me condamner, je riais de leurs prédictions. Je n’ai même pas cru à celle de Louis Veuillot, que ma sœur Cécile m’avait amené un jour pour l’extrême-onction, comme un vrai médecin de l’âme. Il voulait me faire monter au ciel en état de grâce avec une amitié expansive dont j’ai gardé le meilleur souvenir. Mais il dit bientôt à ma sœur en hochant la tête : « Quel malheur ! il était sauvé, le voilà encore perdu ! » Cela voulait dire que, revenant à la vie dans le cortège de mes passions, je reperdais mon âme.
Certes, si j’ai conservé un air de jeunesse à travers les âges, ce n’est pas par la volonté de me sauvegarder. Nul n’a été plus prodigue de ses forces, nul n’a joué pareillement avec sa santé, nul ne s’est autant dépensé dans le travail et dans le plaisir. Ce qui a fait dire à mes amis, qui suivaient consciencieusement les lois de leurs saisons : « Il n’y a point de justice, puisque Houssaye est toujours jeune et que nous sommes d’autant plus vieillis que nous avons été plus sages. » Quoi qu’il m’arrive, on reconnaîtra que j’ai été vaillant contre l’hiver de la vie, puisque j’ai presque prouvé, comme tant d’autres, d’ailleurs, que la vieillesse n’était qu’un mot à l’usage de ceux qui veulent se reposer.
Parlerai-je en passant du pays natal de mon esprit ? Mon grand-père Mailfer, qui avait trouvé le sentiment de l’art en sculptant sur bois ; sa sœur Rose-Aurore Mailfer, qui avait vécu, moitié dame pour accompagner et moitié dame d’atours, dans le Versailles de Marie-Antoinette ; son mari, tour à tour peintre de la reine et de l’impératrice ; ma mère, une femme de hautes vertus, mais romanesque ; un oncle naturaliste, qui avait couru toutes les antiquités de l’Inde, de l’Égypte et de la Grèce pour deviner l’énigme de la vie ; des tantes fort belles, vraies statues de chair, qui me donnaient le sentiment du beau ; un autre oncle, qui ne savait que rire, mais qui avait le rire de toutes les gaietés : voilà quels furent mes convives, au premier festin de mon esprit. J’allais oublier toute une petite bibliothèque donnée à mon grand-père par les filles de Louis XV, car, dès que je sus lire, je ne voulus des contes d’enfants que les contes de Perrault. J’allai du premier pas aux poètes : Homère, Théocrite, Dante, Shakespeare, Molière, me passionnant aussi pour Ronsard, Saint-Amand, Régnier. Je ne parle pas de La Fontaine, que je savais par cœur.
Puisqu’aussi bien on recherche aujourd’hui toutes les origines, voilà le berceau de ma pensée, le berceau où se sont penchées l’Imagination et la Poésie – et la Fantaisie qui fut la mauvaise fée.
Les petites Alpes de Soissons à Laon, qui vont s’étageant de la colline à la montagne, renferment les paysages les plus variés, tantôt sur les rives de l’Aisne, tantôt dans les anfractuosités de toute cette région pittoresque presque partout boisée. Il y a peu de contrées où les révolutions du globe aient pareillement bouleversé la terre. On monte, on descend, on remonte plus haut, on redescend plus bas ; on passe de la prairie encadrée d’arbres, à la colline toute luxuriante de vignes, des sillons fertiles aux steppes infécondes ; on y cultive le blé, la betterave, le colza, tout ce qui fait la richesse de l’agriculture ; en même temps, on y jardine dans les vergers ; voilà les asperges dans les sables, les artichauts dans les zones humides. Et combien de villages et de châteaux qui se cachent dans les arbres, ou qui se démasquent orgueilleusement sur le versant des coteaux ! Mille sources vives jaillissent des rochers et s’en vont, par leurs serpentements, donner la vie aux vallées perdues.
Cette chaîne de montagnes qui s’étend vers Château-Thierry et qui sépare Reims des deux capitales de l’ancienne France, Laon et Soissons, est merveilleusement cultivée. Il y a là toute une population agricole qui vit de son terroir sans jamais tendre la main. C’est la vraie France, puisque c’est l’ancienne Île-de-France : le paysan y est humoriste, laborieux et fier. On y trouve les meilleurs soldats. Jusqu’en 1814 ç’a été la région des batailles. On s’y souvient que sous Philippe le Bel toutes les communes se révoltèrent pour payer par le sang leur droit à la vie dans la liberté. Oui, c’est là que fut fondée la vraie France, Soissons capitale, Laon capitale, Reims, où l’on sacrait les rois. D’autres rois que Clovis, et Louis d’Outremer y sont venus ensuite, rois qu’on ne détrône pas : Racine, Lafontaine, Condorcet, Camille Desmoulins, Alexandre Dumas : tous nés avec l’air de gaieté et de raillerie que donne le vin de Champagne. En est-il en France de plus spirituels que ces cinq-là ? J’en pourrais citer d’autres dont les œuvres répandent le bouquet des vignes champenoises. J’ai vécu mes plus jeunes années dans ces beaux paysages, devant les merveilles architecturales des cathédrales de Reims et de Soissons, les flèches hardies de Saint-Jean des Vignes, les quatre tours, plus hardies encore, qui font de la cathédrale de Laon la huitième merveille du monde, comme l’ont dit Lefuel, Nieuwerkerke, Viollet-Leduc.
Quoique Parisien d’origine, je suis né à deux pas de Laon, en l’Île-de-France, dans cette petite ville de Bruyères qui elle-même, était encore une merveille d’architecture gothique. Bruyères érigée en commune, une des trois ou quatre premières villes du royaume, avait une première enceinte fortifiée autour de son église et une seconde défendue par quatorze tours, autour de ses habitations, avec quatre portes massives, la porte de Reims, la porte de Laon, la porte des Romains et la porte de la Fontaine minérale. Par malheur, j’ai vu tomber tout cela ; la Restauration permit ce sacrilège. On fut plusieurs années à toujours abattre. N’a-t-on pas alors abattu, à Laon, la tour de Louis d’Outre-mer ? Aujourd’hui Bruyères garde à peine les vestiges de ses anciennes forces murales. Il lui reste cependant deux monuments d’architecture : l’église, du Xe siècle, avec ses curieuses sculptures et ses fresques des premiers âges de la peinture en France ; la léproserie de la grande rue qui mérite, comme l’église cathédrale, la sauvegarde des monuments historiques. L’archéologue y trouve encore des curiosités anciennes, quelques fragments de sculpture romaine et la maison surnommée la « Maison d’Henri IV », parce que Henri IV y a couché pendant le siège de Laon. Mon père, qui possédait cette maison, y voulait fonder un musée archéologique, mais il s’est contenté de créer à l’hôtel de ville un tout petit musée et une toute petite bibliothèque.
Cette contrée pittoresque dans l’ancienne Île-de-France, ne veut pas qu’on lui applique le mot « provincial » dans le sens nouveau du mot. Laon, Soissons et Reims, ont gardé le caractère de la capitale : le Tout Paris est là. On y trouve des poètes, des artistes, des archéologues, des bibliophiles. Il y a même des académies. N’oublions pas le mot de Voltaire qui en voulait à Soissons, où il n’avait pu se cacher avec Pimpette. Un jour il frappa d’un mot cruel l’Académie soissonnaise : « Cette fille trop vertueuse qui n’a jamais fait parler d’elle. »
J’en ai trop dit déjà pour marquer mon berceau.
On ne saurait nier le charme pénétrant du pays natal ; c’est toujours avec joie que je retourne à Bruyères, où il n’y a pourtant plus guère pour moi que des tombeaux, mais le pâle fantôme de ma jeunesse ne me retient qu’une heure au cimetière. Les souvenirs des premières années volent devant moi comme de blanches colombes, je les retrouve battant des ailes dans tous les vieux arbres qui sont mes contemporains, au chœur de cette église où je n’étais pourtant pas un catholique fervent, dans ces montagnes où, tout en buvant au rocher, je m’enivre encore du vin capiteux de mes seize ans.