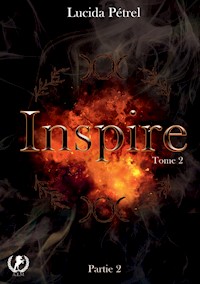Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Art en Mots Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Expire / Inspire
- Sprache: Französisch
C’est la fin d’une histoire.
Baalzephon ne représentait véritablement pas le plus grand danger. Les eaux sont belles et bien sombres, par ici. Et si, après tout, chacun ou chacune d’entre nous constituait une part de leur obscurité ?
Je suis
Lucida Pétrel. Cette histoire est en partie la mienne…
Cette histoire est en partie la nôtre.
À PROPOS DE L'AUTRICE
Lucida Pétrel n’a pas d’âge mais plusieurs voix. Si Lucida devait vivre quelque part, ce serait sur Terre, car les êtres y sont de bonne compagnie – les livres aussi. Elle n’habiterait cependant nulle part ; les plumes préfèrent se laisser promener par le vent. Son univers n’est pas unique, et il est beaucoup. Il y fait doux, parfois humide, on y sourit, on y pleure. Chaque phénomène représente l’occasion d’interroger, de ressentir et, avec un peu de chance, de comprendre. On s’aime et on a peur, là-bas. Quoi d’autre… Ah ! Lucida n’a pas de rêve, ça non. Elle préfère imaginer…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 574
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maintenant,
Tu peux dormir
TOME 3 PARTIE 2
Lucida Pétrel
Urban fantasy
Image : Adobe Stock
Illustration graphique : Graph’L
Éditions Art en Mots
Chapitre 1
LÉANNE
— O.K., restons calmes.
Capucine me dévisage. Pourtant, le calme me semble être le meilleur comportement à adopter.
— T’as pas l’impression qu’on se fout de notre gueule, là ?
— Tu t’emportes, Capucine, taratata !
Je lève l’index entre ses deux yeux, et Cléo éclate de rire. Capucine rougit subitement, la tête sur le point de se métamorphoser en fraise… j’ai horriblement faim, mon Dieu.
— Où est-ce qu’on est ?
En empruntant le peregrinator depuis les Terres lointaines, nous aurions dû nous déplacer jusque sur le territoire de De La Haute Maison. Mais, visiblement, nous n’y sommes pas. Quant à savoir où nous nous trouvons à présent, seule la Magie le sait. Pas trop loin, espérons-le. En tout cas, Gaëtan et Alejo ont disparu. Forcément ! Sinon, toute cette misérable vie serait bien moins trépidante.
Je tourne la tête vers Cléo, lorsque des pinces armées de griffes tordent méchamment mon doigt toujours brandi. La douleur me tire un sursaut et l’envie d’arracher les lèvres de Capucine pour ne plus jamais voir son sourire satisfait me fait bouillir le cerveau.
— Espèce de…
Mon doigt contre mon torse, je plisse les yeux.
— Qu’est-ce que tu vas faire ? me provoque Capucine. Me juger ? M’exécuter ? Ou peut-être que tu m’enfermeras au Pénitencier ?
Capucine est électrique, et sa répartie nourrit ma propre colère :
— Où est-ce que tu veux en venir ?
Loin d’être intimidée, j’avance d’un pas. Capucine m’imite. Elle sait très bien qu’une seule patate dans une de mes joues bien garnies suffirait à m’étaler.
— J’sais pas. Peut-être que j’en ai tout simplement marre de supporter ta présence.
— Non, dis plutôt le fond de ta pensée. T’as commencé, termine.
Capucine ricane en détournant un instant le regard. Elle se mord la lèvre et hoche la tête, comme si elle se préparait à lancer une bombe qui causerait des dommages irréparables. Durant ce court laps de temps, je ressens le besoin de faire marche arrière et de la supplier d’oublier mes derniers mots. Je ne veux plus savoir.
— T’as rien fait. T’as juste regardé, pas vrai ? Tu savais forcément ce qui se passait, tu travaillais pour les dirigeants du Pénitencier, après tout. Pendant que nous, les véritables Traqueurs, on était envoyés en mission pour tenter de canaliser les Ombres et qu’on prenait les coups, toi et tes petits copains, vous vous la couliez douce à écouter des bouffons parlementer ! Alors qu’est-ce que tu fais là ?
Je reste interdite ; Capucine franchit le peu d’espace qui nous séparait encore, me dominant d’une bonne dizaine de centimètres.
— Qu’est-ce que tu fais là, à vouloir donner l’impression de bouger pour une fois ton cul ?! On sait même pas où on est ! On sait pas non plus ce qu’on va faire ! Et tu nous dis de rester calmes ?! Mais merde, Cléo a failli mourir à cause de notre Fourre-Tout, Alejo a été chanceux lui aussi, et qu’est-ce que tu trouves à dire ?!
— Il ne faut pas céder…
— À la haine, c’est ça ?
Capucine secoue la tête et, sans plus crier, m’achève :
— On a tous peur, mais toi, tu délires. Quand quelqu’un voudra te tuer, je me demande bien ce que tu feras de tout ton pacifisme.
— HEHO !
Cléo s’élance vers nous pour nous attraper par les épaules. Un long soupir lui échappe tandis qu’il nous serre contre lui. S’imagine-t-il que ce simple geste va apaiser les tensions ? Nous ne sommes pas deux copines en pleine dispute au milieu de la cour de récré.
— Vous savez ce que dirait Al s’il était là ?
— De nous la fermer, grogné-je.
— Oui, mais vous savez ce que dirait Gaëtan, s’il était là ? se corrige Cléo. Non ? Aaaah, ça fait moins les malignes tout à coup ! Il vous rappellerait qu’on a tous été fautifs dans cette histoire. Tous sans exception.
— Mais…, s’essaie Capucine.
— Moi qui parle. Toi Capu, je suppose que quand le directeur de ton Institut n’est plus venu en aide aux Ombres, t’as pas cherché plus loin. Et, oui, Léanne aurait peut-être pu se démener un peu plus pour monter un dossier contre le Pénitencier, mais pour faire quoi ? Genéniève s’en serait battu les nénés… du moins, le peu qui lui pend encore autour du cou.
Ce mec est répugnant.
— Et moi, si je n’avais tué personne, j’en serais pas là non plus.
Cléo nous relâche en nous tapotant le dos, puis, souriant, il hausse les sourcils.
— Convaincant, non ? Tenez, dit-il avant d’embrasser ses deux poings et de nous les tendre, allez-y, c’est gratuit.
Capucine et moi partons chacune de notre côté. Je fais mine de chercher la bonne direction pendant que Cléo tente une dernière fois de nous réconcilier :
— Oooh, les filles, vous gâchez l’ambiance ! Allez quoi ! Faut pas s’en faire pour si peu !
L’endroit est désert. Je n’ai aucune idée d’où nous pouvons nous situer. Je m’appuie contre le lampadaire solitaire, alors que je prends conscience du silence qui plonge l’endroit dans le sommeil. Il ne fait pas nuit, mais le brouillard n’aide pas à insuffler à ce lieu un peu de vie. Un chat saute depuis un buisson sur la route, il bâille, s’étire, avant de filer devant moi au trot. La petite bête me surveille de façon régulière, sans doute pour s’assurer que je ne cherche pas à l’approcher.
Puis, sans que je ne comprenne ce qui le retient finalement, il décide de poser ses fesses par terre, assez loin de moi pour que je ne distingue qu’une boule de poils noirs sur un fond gris. Il miaule. Une fois, puis une seconde.
— Bon, on reprend le peregrinator ou quoi ? râle encore Capucine.
Cléo me rejoint, alors elle insiste :
— On ne va pas camper ici, si ?
Je choisis de l’ignorer, nous nous sommes suffisamment disputées pour aujourd’hui. Et je préfère d’ailleurs ne plus y penser.
— Joli château, constate Cléo, arrivé à ma hauteur.
Le chat, effrayé par le nouveau venu, s’enfuit à travers d’immenses grilles rouillées.
— Quel château ?
Cléo désigne la silhouette d’un bâtiment, droit devant lui. Sans un mot, il s’en va dans la direction du chat et escalade le portail. Capucine souffle dans mon dos… Avec le besoin d’échapper à sa présence, j’emboîte le pas à Cléo… avec une pointe de curiosité aussi, je dois l’avouer.
Je m’approche lentement, les mains dans les poches de ma veste. Derrière le portail vieillot, une allée s’engouffre dans l’obscurité de la nuit. J’avise la hauteur des grilles.
Comment est-ce que je compte grimper un truc pareil, au juste ?
Au même moment, mes yeux s’arrêtent sur la chaîne qui maintient les portes fermées. Si l’on voulait réellement empêcher toute intrusion, on y aurait au minimum posé un cadenas, ou fait surveiller l’endroit, n’est-ce pas ?
Je hausse les épaules, puis démêle la chaîne. Les portes couinent ; elles crissent lorsque je pousse un battant. La végétation, véritable nuage tentaculaire, est étouffante. Même l’allée de bitume n’a pas su résister à l’attaque des ronces, qui la recouvrent à présent comme un tapis composé de nattes désordonnées. Je chemine avec maladresse, non sans admirer Cléo disparaître dans la nuit, aussi à l’aise que s’il se promenait dans le potager de sa grand-mère. Et alors que je me défais déjà des épines tranchantes d’une ronce récalcitrante, Capucine apparaît à côté de moi, l’air résolu.
— Quoi, tu flippais trop, toute seule dans la nuit ?
Ça m’a échappé, mais je ne le regrette qu’à peine.
— Excuse-moi.
— Pardon ?
Elle me lance un regard instantané, puis croise les bras.
— J’ai déjà la bouche en sang pour ne l’avoir dit qu’une seule fois, alors ne t’imagine pas que je le répéterai.
Je ne peux pas m’empêcher de sourire, même si je n’ai pas l’air malin à me débattre pour ne serait-ce effectuer qu’un pas, mais ma satisfaction disparaît très vite pour laisser place au sérieux.
— Tu as raison, j’aurais pu faire plus. J’aurais dû faire plus, même. Mais c’est difficile d’agir quand tout est…
— En perpétuel changement ? Ouais, on finit par s’y perdre.
Au loin, la voix de Cléo nous interpelle :
— Les filles, dépêchez-vous !
À raison de plusieurs cris de frustration et après avoir perdu la moitié de mon pantalon en supplément des trois quarts de ma dignité en cours de route, je parviens enfin à atteindre ce qui, effectivement, devait ressembler autrefois à un château. Disons qu’avec un toit, des fenêtres et sans doute des portes, ce tas de pierres froides et mousseuses pourrait effectivement être habité.
Capucine et moi entrons en rechignant un peu, traînées par un Cléo quant à lui aussi excité qu’un gosse, pour une raison qui nous échappe complètement. Pendant que je m’évertue à escalader un tas de ruines en mauvais équilibre, Cléo, de l’autre côté, ouvre un semblant de porte. D’un signe, il nous demande de le suivre – comme si ce n’était pas déjà que ce que nous faisions depuis le début.
— Regardez ce que j’ai trouvé.
Nous entrons après lui, et, dubitative, je détaille la grande pièce à la recherche de ce qui peut bien rendre Cléo aussi content de lui.
— Mais avancez, ne restez pas plantées là !
Cléo nous pousse en avant. Capucine et moi nous regardons un instant, puis marchons à travers la salle investie par un vent frais.
— La cheminée est belle, c’est vrai, dis-je innocemment.
Je poursuis mon examen sous le regard attentif de Cléo. Mais qu’est-ce qu’on fait là ?
— Alors, une idée d’où on peut être ? nous défie fièrement Cléo.
— Aucune, soupire Capucine, mais je sais où nous sommes censés être : chez Alejo.
En effet, c’est bien là-bas que nous comptions nous reposer avant de surgir sur le devant de la scène. Mais, la Magie en a vraisemblablement décidé autrement. Nous voilà coincés dans les coulisses de l’histoire…
— Je n’ai pas l’habitude de recevoir de la visite de la part de Traqueurs.
La voix résonne dans mon dos, douce et timide. Je fais volte-face, plaquée au mur.
— De quel Institut venez-vous ?
Le fantôme approche lentement. Sur ses traces, une brume terne se suspend dans l’air, l’espace de quelques secondes, avant de disparaître. Sans retomber, sans s’envoler ; juste, la brume disparaît. Le sourire délicat de la femme me remémore l’expression de ma mère, lorsqu’elle voudrait me convaincre que tout va bien. Ce souvenir m’attriste.
— Katherine, dis-je.
— Enchantée, répond-elle, et vous êtes ?
Nous avons finalement atterri au château de Saulxures. Et Katherine erre toujours entre ses murs.
Capucine me lance un coup d’œil méfiant ; Cléo, lui, sourit bêtement et hoche la tête de haut en bas pour m’inciter à répondre.
— Voici Capucine. Lui, continué-je en désignant Cléo du menton, il a très certainement déjà dû se présenter, n’est-ce pas ?
— Je suis poli, moi, balance le concerné en s’asseyant par terre.
Katherine le couve du regard, les commissures des lèvres légèrement soulevées par une tendresse inexpliquée.
— Et moi, je suis Léanne, une amie de Bella et Alex. Nous venons de De La Haute Maison.
À l’entente de ces deux prénoms, Katherine reporte vivement son attention sur moi. Son visage se déforme en vapeur colorée, sous l’énergie du mouvement, puis se recompose brin de poussière après brin de poussière. Katherine est en train de s’estomper. Son enveloppe, en tout cas.
— Est-ce que leur enfant va bien ?
— Oui, il… Il va bien.
— Et eux ? Ils ne sont pas venus à notre dernier rendez-vous, j’ai craint qu’il leur soit arrivé quelque chose.
Rassemblant tout un tas de forces et de volontés dont je ne suis même pas certaine de disposer, je tente de demeurer stoïque alors que les visages de mes compagnons de voyage se braquent soudain vers moi.
— Ils sont morts.
Katherine réalise un pas de côté pour se détourner de moi, le regard dressé vers la moitié de lune que la partie manquante du toit nous permet d’admirer.
— C’est donc ça, murmure-t-elle, Mélia doit être si triste… Certains seront toujours sacrifiés et, parmi eux, quelques-uns seront faits martyrs. J’ai parfois la malheureuse impression que cela est nécessaire, pour les humains. Ces figures héroïques, ces potentiels raflés en pleine ascension… Oui, nous nous réunissons aveuglément autour de la mémoire des vaincus qui, selon nous, auraient dû vaincre ; autour des torturés qui ont, quant à eux, permis la victoire. Tout cela en nous rappelant les uns aux autres, la terreur, l’effroi que cela a été. En répétant à nos enfants que l’histoire ne doit pas se reproduire, alors même que rien n’a changé. Ces enfants combattront, réprimeront, tueront à leur tour ; ils seront battus, réprimés, tués eux aussi. Nous serons toujours déçus. Et nous décevrons toujours.
Cette fois, je dois retenir mes larmes. Si Alejo était présent, il hurlerait qu’Alex et Bella n’ont pas été sacrifiés. Avec une posture raide et d’une voix sans appel, il corrigerait Katherine : Alex et Bella ont été assassinés.
— Benjamin était un sacrifice, lui aussi…
— Ne comparez pas Baalzephon à Alex et Bella !
Katherine ne sourcille pas. C’est moi, qui ai parlé. Même si j’aurais préféré me montrer capable de comprendre – oui, capable de comprendre cette chose que je refuse d’admettre. Un souffle glacial s’engouffre par les fenêtres béantes ; le silence, brusque et douloureux, me terrorise. Katherine me terrorise. Les informations qu’elle semble détenir, leurs possibles répercussions… La crainte me parcourt la peau comme une caresse fantôme.
— Pourtant, ils sont tous les trois des victimes de guerre, s’excuse Katherine.
Capucine s’avance, jusque-là en sécurité dans un coin de la pièce. Pour la première fois, elle me fait l’effet d’une amie qui vient me prêter main-forte.
— Baalzephon n’a pas souffert de la guerre, il l’a déclenchée.
— Benjamin était un cœur sans corps pour le protéger, qu’on a torturé, encore et encore. Je l’aimais, et il m’aimait, bien que ça l’ait en partie détruit. Après ma mort, le monde s’est chargé d’achever ce qu’il subsistait de lui.
— La dame me paraît avoir quelque chose à confier, les filles, intervient Cléo. Est-ce que vous allez l’écouter, ou vous préférez vous boucher les oreilles, comme les Instituts l’ont fait ?
Katherine penche la tête pour attraper mon regard.
— Nous sommes au château de Saulxures, là où Benjamin a grandi. Là où on a entrepris de lui décaper la peau, pour ensuite pouvoir plus facilement lui briser les os.
Chapitre 2
Excusez mon intrusion, mais il me paraît judicieux que ma plume retrace cette histoire. Une telle interruption peut vous sembler rompre le fil du temps, mais elle n’a rien d’un arrêt sur image. Vous pouvez bien décider de passer ces quelques pages, et alors ne jamais saisir les enjeux qui hantent ces âmes que vous pensez connaître et comprendre, sous prétexte que vous lisez une partie de leur existence.
Je réitère mes excuses : je me sens pleine d’amertume et de ressentiments, ce soir.
J’aimerais pouvoir dire que c’était une sombre époque, car c’en était une, pour sûr, mais ne le sont-elles pas toutes à différents coins de cet univers ? Celle-ci ne l’était pas plus que d’autres ont pu l’être, ou le seront, mais pour Benjamin, elle relevait du cauchemar. Dans ce sens où, chaque fois que ses souvenirs avaient failli emprisonner son esprit, il était parvenu à imaginer n’avoir que rêvé… avoir rêvé un très mauvais rêve, non pas avoir vécu un cauchemar. Voilà. Cela devenait alors plus évident à éloigner de ses pensées.
Eh bien, Benjamin, ce simple rêve aura laissé des traces profondes, des blessures éternelles, des choses on ne peut plus réelles. Et je me le demande encore : qui pourrait affronter des souffrances pareilles ?
Certainement tous ceux à qui vous ne pensez pas à cet instant, bien que vous ne sachiez pas encore de quoi je parle exactement.
J’y viens.
Laissez-moi le temps.
Il fait si froid, ce soir.
Et les arbres sont morts.
C’est sans aucun doute le meilleur moment. Oui, allons-y…
La maisonnette était vétuste, rustique. Lieu propice aux jeux d’enfants, le jardin paraissait constamment fleuri, si bien que le printemps balayait les souvenirs de l’hiver dès l’apparition des premiers bourgeons. Benjamin admirait sa mère désherber le potager à chaque occasion. Lorsqu’il était repu de tranquillité, il retournait aux activités qui remplissaient ses journées : jouer au chevalier avec son voisin.
Plus grand en tout point, Ezra s’était proclamé mentor du petit Ben, comme il aimait l’appeler. Benjamin descendait le chemin de terre qui servait de rue, son bâton à la main, et frappait à la porte d’Ezra pour ne s’arrêter que lorsque son ami lui ouvrait.
Mais ce jour-là n’était pas comme les autres.
— Dépêche-toi ! Dépêche-toi !
Encore très jeune, ce furent les seuls mots que Benjamin parvint à articuler convenablement.
— Durant un instant, j’ai bien cru que tu avais oublié, dit Ezra en attrapant son bâton dans le coin de la porte. Tu sais, j’ai failli partir avec les autres et…
— Dépêche-toi ! Dépêche-toi !
Ezra émit un rire puissant en tapotant la tête de son ami.
— Ça va, on y va. Allez.
Le plus grand hissa le plus petit sur ses épaules. Ils remontèrent la rue ensemble : la mère de Benjamin préférait qu’ils jouent près du jardin, là où elle pouvait avoir un œil sur son fils. Ezra, lui, était bien assez âgé pour aller où bon lui semblait, sans avoir à s’en justifier auprès de quiconque. Naturellement, le petit Ben l’enviait pour ça. Il rêvait de devenir un jour pirate, d’embarquer sur un bateau et de parcourir la mer Perdue, cette étendue d’eau dont lui parlait sa mère tous les soirs avant qu’il ne s’endorme. Plus que tout, il désirait avérer la légende qui racontait qu’aux confins de la mer Perdue se trouvait le secret de la paix planétaire.
En ces temps de guerre, alors que Benjamin ne parvenait pas à accepter la mort de son père sur le champ de bataille, sa mère avait pensé que lui donner espoir en l’avenir pourrait l’aider à comprendre que son père ne l’avait pas quitté en vain. Lui aussi, avait fermement cru en cette légende. Il était donc – à sa façon – parti voguer sur les eaux de la mer Perdue. Ce voyage l’avait tué, mais ses espérances vivaient à présent en Benjamin… Oui, c’était avec ces mots que Hélène réconfortait son fils. Pour un temps, elle était ainsi parvenue à détourner son attention, jusque-là rivée sur le chagrin.
— Bon, agenouille-toi, petit Ben, ordonna Ezra en le déposant à terre.
Benjamin n’hésita pas et se laissa maladroitement tomber sur le sol. Hélène, les mains terreuses sur les hanches, secouait lentement la tête en souriant à Ezra. Il lui rendit sa sympathie, puis leva son bâton, les lèvres pincées en signe de réflexion.
— On va faire comme ça.
Ezra donna trois petits coups de son bâton sur la joue de Benjamin, un sur son épaule gauche, et après avoir réfléchi un instant, deux autres sur son épaule droite ; tout cela, en prononçant ces paroles :
— Au nom de tous les dieux et toutes les déesses qui puissent exister, de ceux et celles dont nous n’avons pas encore entendu parler, et de ceux et celles qui seront oubliés… au nom de la Table de la paix… et, hum… au nom de cette épaule avec laquelle tu manieras l’épée pour secourir les blessés et sur laquelle tu devras les transporter, sans jamais les abandonner, petit Ben, je te fais chevalier de la Table de la Paix. Quel est notre serment ?
Benjamin, qui gardait ses yeux pétillants plantés dans ceux de son aîné, scanda de sa petite voix ces mots sans y trébucher :
— La paix, pour toujours et à jamais.
Et, contrairement à ce que vous pouvez penser, tous ses actes furent guidés par sa volonté de respecter ce serment, quand bien même il ne se souvenait d’aucun de ces mots. Mais Ezra, lui, Benjamin ne parvint jamais à l’oublier.
Ezra et ses parents vinrent un jour vivre chez Benjamin. Hélène lui avait confié que des gens dangereux leur en voulaient pour des raisons qu’elle n’avait pas su lui expliquer. Alors, elle lui avait dit : « Tu sais, Benjamin, je t’ai donné vie dans un monde où peu de choses sont justes. Ezra est victime d’une grande injustice, alors nous devons l’aider. »
Mais Benjamin ne ressentait pas le besoin que sa mère se justifie : après tout, il allait avoir un grand frère. Un grand frère qui passait beaucoup de temps sous le plancher, certes, mais un grand frère tout de même.
Ezra le rejoignait certaines nuits dans la cuisine, lorsque tout le monde dormait d’un sommeil suffisamment lourd pour ne pas les entendre. Mais la mère d’Ezra, très tendue pour une raison que Benjamin ne comprenait pas, se réveillait vite et ordonnait à son fils de retourner se cacher. Un soir, alors qu’Ezra et Benjamin étaient assis face à face à même le sol, Benjamin contemplait d’un air curieux les joues de son ami.
— Quoi ? finit par l’interroger Ezra à voix basse.
Benjamin tendu la main vers le visage de son aîné, et lui toucha le menton à plusieurs reprises.
— Eh oui, sourit Ezra. Je serai bientôt un homme, petit Ben. Mais ne t’inquiète pas, un jour, ce sera ton tour.
— Tu vas patir ?
— Peut-être, enfin, j’aimerais pouvoir le faire.
D’abord, Benjamin se mit à renifler. Ensuite, de légers tremblements secouèrent son menton, puis ses lèvres. Enfin, il éclata en sanglots.
Ezra plaqua une main sur la bouche du petit en lui intimant de faire moins de bruit.
— Arrête de pleurnicher, c’est bon. Je reviendrai te voir. On est comme deux frères, maintenant, non ? Tu n’auras qu’à m’attendre.
Peu à peu, Benjamin retrouva son calme, frotta rageusement ses joues pour essuyer ses larmes, afin de dire :
— Je serai ssss-ur la m-m-m.. Perdue.
— Ça ne m’empêchera pas de te retrouver.
Dans le courant de la nuit, Benjamin rejoignit Ezra sous le plancher. Il se contorsionna tant bien que mal jusqu’à caler le côté de sa tête contre son épaule. Il s’endormit dans l’odeur de poussière, sans même penser aux araignées qui le surveillaient.
Ce ne fut pas la caresse de sa mère qui le réveilla, et il s’en trouva désorienté. Encore embrumé par le sommeil, il mit quelques secondes avant de se rappeler… voilà, il s’était échappé de sa chambre. Ezra remua violemment, tandis que Hélène hurlait dans la cuisine, juste au-dessus d’eux. Saisi par la panique, Benjamin s’immobilisa. Des balles déchirèrent le bois des planches. L’avalanche d’impacts constituait un véritable mélange de bruits : celui des explosions – qui bam ! dans l’air, celui du bois qui se fend – cela grince ; celui des balles qui se fichent dans la terre – tout proche de lui, tout proche de Benjamin, cela fait pop ! Beaucoup de bruits, différents, auxquels il cessa de réfléchir lorsque sa mère supplia, rien qu’une fois.
La tête d’Ezra fut projetée en arrière. Une éternité passa avant que les tirs et les cris ne se tarissent. Benjamin observait curieusement chacune des balles qui l’avait évité, il écoutait sa mère, juste au-dessus, haleter ; tout cela, tandis qu’il baignait dans le sang que la terre peinait à absorber.
— Je vous en supplie, ils sont morts… J’ai un enfant, un petit garçon, mon mari est tombé au combat, je suis tout ce qui lui…
Ce fut comme une main géante qui écrasa la poitrine de Benjamin pour lui voler son dernier souffle ; sa mère fit un pas en arrière – il la voyait, entre deux planches, juste elle, et personne d’autre… les meurtriers demeurèrent à jamais sans visage. Il y eut une dernière détonation. Benjamin ne vit soudainement plus sa mère. En revanche, il sentit un liquide chaud goutter sur son front, puis sur ses joues et dans son cou. Lorsqu’un peu de cette chose glissa dans sa bouche entrouverte, le néant l’accompagna jusque dans ses entrailles.
La graine venait d’être plantée.
Je n’aime pas raconter cette histoire, vous savez. Peu importe la façon dont je m’y prends, je finis par occulter des passages décisifs. Il est complexe d’opérer un choix, si difficile lorsque nous savons notre encre limitée. Je suis la voix silencieuse de plusieurs infimes parties d’une vie qui n’est pas la mienne. Je retranscris ce que je n’ai guère vécu, ce que Benjamin aurait probablement souhaité garder secret.
Je suis fautive, comme tous ceux qui se sont sentis plus prompts à parler au nom de morts qu’au nom de vivants.
Seulement, voyez-vous, il me semble important que vous compreniez que tous ceux qui nous font l’effet d’un monstre en ont un jour croisé un autre. Si l’on vous laissait croupir dans les plus sombres tréfonds de cette Terre, si l’on vous abandonnait aux mains des âmes les plus vindicatives et vicieuses de notre espèce, vous ne sauriez faire autrement que de vous laisser avaler par cette obscurité devenue familière, puis par vous-même devenir ténèbres.
Nous sommes tous le monstre de quelqu’un. Mais pour beaucoup d’entre nous, notre chemin a croisé celui d’un rédempteur.
Benjamin n’a pas eu la chance d’être sauvé. Pire : il l’a été, avant d’être de nouveau abandonné.
Je ne saurais dire combien de temps petit Ben resta là, enfermé entre le plancher et la terre humide ; figé auprès des corps sans vie de son ami et de sa famille ; pétrifié sous le cadavre de sa mère, quant à lui étendu dans la solitude de la pièce à vivre, et dont le sang avait fini par recouvrir le visage entier de Benjamin. Ce que je sais, en revanche, c’est qu’il finit par remonter dans la cuisine et qu’il resta plus longtemps encore blotti contre sa mère. Quelques jours passèrent sans doute, avant qu’il ne se mît à pleurer, et qu’une louve qui passait non loin l’entendît et vînt à le découvrir. L’animal arracha petit Ben au corps de Hélène et l’emporta au pas de course dans la forêt, traversant sur quelques centaines de mètres le village enveloppé dans une aura de mort.
Benjamin se débattit jusqu’à ce que la louve le laissât tomber sur un tapis d’herbe. Elle lui donna deux coups de langue sur chaque joue, enfouit sa truffe dans son cou puis lui caressa le visage pour accompagner ses derniers pleurs. L’enfant enfin épuisé, elle se métamorphosa sous ses yeux en une femme grande et nue.
Le garçon l’observa s’agenouiller face à lui. Il dit :
— M-m-m-maman me pale souvent des Loups-Gaou.
— Je sais. Ne t’inquiète pas Benjamin, non loin t’attendent des gens qui prendront soin de toi. Un endroit où l’on trouve des enfants comme toi.
Benjamin voulut protester, se débattre lorsque la femme reprit son apparence de louve pour le jeter sur son dos, mais la fatigue eut raison de lui et il s’endormit sur le pelage confortable de l’animal. Il ne sentit pas les mouvements de l’Ombre qui courut toute la journée en espérant arriver à destination avant la nuit. Il ne frissonna pas non plus sous la petite pluie qui tomba brièvement, et ne se réveilla toujours pas lorsqu’une femme l’emprisonna dans ses bras pour l’emporter dans un couloir frais et sombre, dépourvu de fenêtre.
Ses yeux ne se rouvrirent qu’à l’entente de chuchotements excités, tout proches, juste contre ses joues. Il vit alors des minuscules têtes posées sur le bois dur qui lui avait engourdi les membres.
— Vous l’avez réveillé, accusa une voix.
La fillette lançait un regard mauvais aux autres.
— C’est toi qui as parlé trop fort, répondit une seconde voix.
— Chut, on va nous entendre.
Benjamin plissa le nez. Cet endroit empestait. Il se redressa. Un nuage de mouches virevolta autour de lui. Il dut attendre que les insectes se dispersent, afin de pouvoir observer l’endroit. Des centaines d’enfants étaient couchés sur des planches de bois. Personne n’avait cru bon d’y disposer des matelas, même rudimentaires.
— On est au château de Saulures, voulut lui apprendre la première voix qu’il avait entendue.
La petite fille avait de jolis yeux bleus qui rappelèrent instantanément à Benjamin ceux de sa mère.
— De Sauxures, reprit un garçon.
— De Saulxures, ne les écoute pas.
L’odeur d’excrément frappait encore Benjamin, peut-être plus fort que n’y parvenait la vision des nuées de mouches qui arpentaient la pièce immense. Les enfants semblaient ne plus les sentir, un peu comme les vaches se laissaient décrotter les yeux dans le parc, à côté de chez lui.
Alors qu’il inspectait les murs froids et lisses qui l’emprisonnaient – il le comprit à cet instant, un enfant se mit à cogner furieusement la porte en métal.
— Les surveillants ne sont pas venus ici depuis trois jours, expliqua le plus âgé des curieux qui ne se lassaient pas de contempler Benjamin.
Au pied de l’enfant en pleine crise de nerfs, d’autres lapaient l’eau dans le sillon qui bordait le mur. Seul Benjamin eut un sursaut lorsque le métal grinça : l’enfant fut happé par des mains et extirpé de la salle. Le claquement de la porte fit encore une fois bondir le cœur de Benjamin. Tout avait été si rapide !
— Des enfants disparaissent tous les jours, poursuivit le même garçon avant d’ajouter sereinement : Je m’appelle Jacques, et toi ?
Benjamin ne put produire le moindre son. Quel était cet endroit ? Pourquoi n’y avait-il que des enfants ? Jacques répondit à une partie de ses questions :
— Je suppose que tu es aussi orphelin. On l’est tous, ici. Tous des orphelins Alchimistes.
— D’ailleurs, quand les enfants sont assez grands pour utiliser leur pouvoir, précisa la fillette aux yeux bleus, ils s’en vont.
Benjamin, tout en réfléchissant, saisit le morceau de pain qu’elle lui tendit. Il parvint à formuler un mot :
— Où ?
Son interlocutrice haussa les épaules.
— Tu sais, ils s’en vont, quoi. Tu sais ce que ça veut dire « s’en aller », ou « partir » ?
Le regard sombre, Jacques murmura :
— Ici, quand on parle de partir, on ne parle jamais de revenir.
L’orphelinat pour enfants Alchimistes de Saulxures vit le jour durant la Seconde Guerre mondiale. Les Traqueurs furent réquisitionnés pour participer aux combats en première ligne, et les Alchimistes durent combler les postes vacants des Instituts. À cette époque, les Instituts de la région ne disposaient pas encore d’écoles maternelles. Les garderies existantes se présentèrent comme une vaste farce, au regard de la quantité d’orphelins que la guerre laissait derrière elle.
La Corporation créa dans la précipitation des orphelinats et, dans l’objectif que toute personne vivante participe à l’effort de guerre, elle en confia la gestion aux Traqueurs dispensés de combat. Beaucoup avaient été blessés sur le champ de bataille, certains y retournaient, d’autres pas. Quoi qu’il en soit, tous s’accordaient à dénoncer l’injustice : pourquoi eux, tandis qu’il s’agissait là d’enfants d’Alchimistes ? Pourquoi eux, devaient abandonner leurs propres enfants en simple garderie ? Pourquoi eux, qui se dédiaient à l’origine à la paix entre les peuples d’Ombres, à l’équilibre entre le monde magique et la société humaine.
La rancœur frappa dès les premiers jours. Elle frappa doublement après la guerre. La Corporation refusa de voir revenir à leurs anciens postes les Traqueurs missionnés dans les orphelinats. Après tout, qui d’autre qu’eux pouvaient être le plus habilité à leur gestion ?
Et, tandis que les Traqueurs avaient combattu l’armée allemande, les Alchimistes, remplissant des fonctions qui n’avaient jamais été les leurs, réclamèrent une compensation sur leur salaire. Au même moment, les Ombres, qui souffraient d’une restriction de droits imposée par le Fourre-Tout de la région, se révoltèrent. L’Institut voulut rétablir l’ordre : nombre d’Alchimistes moururent sur le terrain. Fut accordé aux Alchimistes le droit de tuer pour se défendre et, ainsi, les Ombres furent emportées dans le tourbillon de la haine. La mort rampait partout. Les Alchimistes ont à ce jour conservé leurs privilèges. Tout comme aujourd’hui, l’injustice et le manque de considération rongeaient les Traqueurs. Or, les enfants paient toujours les choix des plus grands.
Je ne pourrais détailler ce qu’a pu vivre Benjamin. Je peux seulement vous dire que petit Ben est mort dans l’heure qui suivit son arrivée au château de Saulxures. Il s’est souvenu jusqu’à son dernier soupir du son bref et sourd que peut produire un gros coup sur un crâne… sur le crâne encore souple d’un enfant.
L’orphelinat fut fermé quelques années plus tard. Après que le Fourre-Tout eut exigé des Instituts la création de nouveaux dortoirs et d’écoles, Digvix fit parvenir un message par le biais d’une Salamandre au château de Saulxures. Inquiet de l’absence de réponse, l’Institut envoya une équipe de Traqueurs sur place, qui découvrit les enfants abandonnés dans le château. Ces mêmes Traqueurs visitèrent l’endroit. Personne ne douta un seul instant de ce qui avait pu s’y passer. Rien ne parle autant que le regard torve ou désincarné d’un enfant. Et l’équipe de Digvix découvrit bien entendu les corps sans vie des surveillants. Ils avaient été noyés. Noyés dans les couloirs même, dans leur chambre ou dans les cuisines. Noyés partout. Dans les lieux les plus secs.
Aucun des enfants ne confia jamais que Benjamin était quelques jours plus tôt entré dans une fureur noire, qu’il avait plongé ses mains dans l’abreuvoir. La Traqueuse ce soir-là en poste devant la grande salle avait déverrouillé la porte en métal, pour faire taire Benjamin. Là encore, aucun enfant ne raconta comment elle s’était effondrée, à peine un premier pas esquissé dans sa direction. Aucun ne dit non plus que le château – tout entier – tomba au même instant dans un silence glacial, certes, mais affreusement rassurant.
Certains s’essayèrent cependant, bien plus tard, à dénoncer les traitements subis à Saulxures. Bon sang ! L’humain refuse toujours de reconnaître le pire lorsqu’il souhaite le meilleur. Il peut-être d’une telle mauvaise foi… d’une foi tellement mauvaise… aucun être vulnérable ne peut lui accorder sa confiance, puisque la vulnérabilité l’offense. Son propre reflet le blesse.
Voilà pourquoi l’humain, sans l’ombre d’une quelconque forme d’humanité, accusera à jamais le monstre qu’il a lui-même engendré d’être capable de monstruosités.
Chapitre 3
ALEJO
— Ça t’est souvent arrivé de vouloir entrer chez toi par effraction ?
Gaëtan et moi avançons dans la ville, le pas tranquille.
Nous avions prévu d’attendre Léanne et les autres à mon appartement, mais nous avions oublié que, pour ça, il nous fallait les clés. Quelle idée de les avoir emportées dans mon sac pour les Terres lointaines ? En même temps, où aurais-je pu les déposer ? Et qui aurait pu prévoir que des Ogres allaient nous kidnapper pour nous déguster ?
— Le vouloir, non. Le devoir, oui.
Et comme nous n’avons rien qui aurait pu nous aider à ouvrir la serrure, nous nous sommes décidés à ne pas perdre plus de temps et à rendre visite aux Vampires. Autant retarder le moment où je devrais trouver un moyen d’enfoncer la porte de mon appartement.
J’espère que les autres ont atterri au moins du côté de Digvix, afin qu’ils puissent rentrer au plus vite.
— Tu crois qu’Hisae nous donnera les réponses à nos questions sans rien en échange ?
Le doute de Gaëtan est justifié. Hisae ne rend jamais service. Pas même à l’un des Vampires qu’elle a pris sous son aile. Kaleb, lui, qui était autrefois à la tête des Vampires de Digvix, ne fait pas plus preuve de générosité qu’elle. Et le fait qu’ils s’aiment comme ne pourraient s’aimer des vivants, n’est pas pour nous aider.
Mais il y a bien une chose qu’on ne peut retirer à Hisae : son sens de l’égalité. En aucun cas elle ne se considère comme la maîtresse de maison, mais plutôt comme une nourricière. Comme une mère de substitution. À son arrivée sur le territoire de De La Haute Maison, Kaleb s’est attiré ses foudres à ce sujet. Hisae méprisait la façon dont il subordonnait les membres de son clan, autant que lui méprisait Hisae pour les raisons contraires.
— Avec un peu de chance, commencé-je, elle sera d’humeur à parler. Nous ne lui demandons pas vraiment service, juste quelques renseignements. Je ne pense pas qu’elle le verra comme une faveur.
— On devrait quand même se méfier.
Je hausse les épaules.
— Qui d’autres voudrais-tu interroger ? Nous ne pouvons pas nous permettre de nous balader dans la forêt, peut-être encore moins maintenant que la Corporation s’y trouve. Elle doit quadriller tout le secteur, et sans aucun doute nous rechercher. Toi pour désertion ; et moi, pour… un tas d’autres raisons.
— Un sacré tas, c’est vrai.
Attentat à la bombe, homicides, évasion, tentative de meurtre sur Genéniève de la Cour Siprès…
— Mais peut-être que ton dossier n’est pas remonté aussi haut, réfléchit Gaëtan. Avec un peu de chance, ils n’auront jamais entendu parler de ton nom.
La chance, c’est ce qui me fait défaut, en ce moment, alors autant ne pas agir sans réfléchir. Pas tout de suite.
Gaëtan pose une main sur mon épaule pour attirer mon attention. Je lève les yeux du sol.
— L’hôtel, dit-il simplement.
Je n’avais même pas remarqué. Nous ne sommes plus qu’à quelques mètres de notre destination. Mais alors que je balaie la rue du regard, je ne vois rien qui me rappelle le repère de Vampires où je me suis rendu pour la dernière fois il y a trois ans. Gaëtan traverse la route pour rejoindre le trottoir d’en face.
— Il devrait être là.
Une vieille dame arrive au bout de la rue. Elle nous observe avec attention, paraissant hésiter quant à faire marche arrière ou non. Tout en surveillant Gaëtan d’un œil méfiant, elle tire son sac contre son torse, entre ses bras.
— Gaëtan, c’est une boutique abandonnée, dis-je un peu plus fort que la normale pour qu’il m’entende.
Il m’ignore, tournoie lentement sur lui-même pour inspecter les environs, puis me répond finalement :
— Oui. C’est ce que les passants sont censés voir, tu ne te souviens pas ? Mais c’est l’hôtel. C’est forcément l’hôtel.
Mon ami remonte la rue de maisons mitoyennes. Il se frotte le visage, apparemment nerveux. Les mains dans les poches, je me retourne vers la vitrine à moitié crasseuse, qui reflète à son tour un visage totalement crasseux. J’ai besoin d’une douche. Et alors que je me mets à rêver de mon appartement, mes pensées reviennent encore à Léanne. Elle n’a pas intérêt à s’être mise en danger. Cléo non plus, d’ailleurs. Je compte sur la présence de Capucine, qui sait éviter les situations compromettantes… en espérant qu’elle pourra convaincre la paire qu’elle se trimballe de ne pas prendre de risques inconsidérés.
La Sarabande de Haendel résonne de façon étouffée depuis le premier ou deuxième étage, juste au-dessus de ma tête. Ça ne peut être qu’elle. Si je peux l’entendre, c’est qu’elle est bien là, dans son hôtel. N’ayant rien à perdre à part peut-être du temps, je me dirige vers la porte de la boutique. Son intérieur poussiéreux et vide détonne à côté des briques rouges des façades.
La main sur la poignée, je pousse la porte. Elle résiste. Je toque. Une fois, deux fois. Et je toque à nouveau pour ensuite retenter d’ouvrir cette porte merdique.
La Magie ne nous donnerait un petit coup de main pour rien au monde, on dirait.
— Laisse tomber, Al. Ils ne sont peut-être plus là, et on va se faire remarquer.
— Ils sont encore ici : tu n’entends pas Hisae jouer du piano ?
Gaëtan secoue négativement la tête, mais revient vers moi pour en avoir le cœur net. Au moment même où la porte s’ouvre avec fracas.
Le visage ovale aux traits fins qui m’accueille, les sourcils légèrement froncés, ne m’est pas inconnu. La jeune fille, certainement plus âgée que moi dans les faits, lâche un petit ricanement maniéré.
— Toi. C’est une blague ?
Effectivement, nous ne sommes pas totalement étrangers.
— Je dois parler à Hisae, dis-je sans préambule en m’invitant moi-même à entrer, puisque mon interlocutrice ne semble pas pressée de s’en charger.
— C’est important, ajoute Gaëtan en suivant le mouvement.
Déjà loin dans le couloir tapissé de velours bordeaux, je ne prends pas la peine de recueillir le consentement de qui que ce soit et me dirige vers la porte du fond. La main sur la poignée, mon bras s’immobilise sous la force de doigts durs comme la pierre.
— C’est toujours important avec toi, rétorque la Vampire en déguisant mal son agacement derrière un sourire poli. Écoute, Traqueur…
— Je ne suis plus un Traqueur.
Plus depuis longtemps. Mes épaules manquent de s’abaisser à cette confidence, preuve que le penser et l’annoncer de vive voix restent deux choses différentes.
— Raison de plus pour m’écouter, alors. Nous n’acceptons plus la visite de Traqueurs, alors encore moins celle de… de n’importe qui. Sauf pour les repas.
La femme ponctue sa phrase d’un regard malicieux.
— Nous avons une annonce importante à faire à Hisae et Kaleb, insiste Gaëtan en s’approchant. Si tu préfères consulter leur avis avant de nous faire entrer, nous n’y voyons pas d’inconvénient.
— Moi, j’en verrai un s’ils refusent de nous voir, insisté-je en posant ma main libre sur le bras de la Vampire.
Sa poigne est si solide que mon membre s’est engourdi. Elle dévoile ses canines et crache comme un chat.
— Snow, dois-je te rappeler ce qui est arrivé à ta dernière venue ? persifle-t-elle.
Quelque chose comme Byron, un vieil ami de Hisae qui m’a mis dans un sale état. Je passais du temps avec les Ombres en dehors de mes heures de travail, avant d’être enfermé au Pénitencier. Un soir où je m’étais rendu à l’hôtel, Byron, de passage dans la région, était quant à lui venu prendre des nouvelles d’Hisae et dormir sur place. À peine étions-nous présentés qu’il profitait de chaque occasion pour me provoquer. Il n’attendait qu’une chose : que je lui offre une raison de me décapiter. Il haïssait les Traqueurs tout autant que les Alchimistes. Sa famille, dont chacun des membres avait été Vampire, avait surtout été éradiquée pour mauvaise conduite deux siècles plus tôt. Seul Byron était parvenu à échapper à la poursuite de son Institut. Le rencontrer m’aura inculqué deux leçons : si vous êtes un Vampire, ne vous nourrissez jamais de sang humain ; et si vous êtes un Traqueur, ne gagnez jamais une partie de cartes contre Byron.
— À ta place, je redouterais l’accueil d’Hisae.
— Je prends le risque.
La Vampire me toise durant quelques secondes, puis relâche finalement sa prise. Le sang circule à nouveau jusqu’à mes doigts. Je ne lui donne pas l’opportunité de changer d’avis et franchis la porte.
— Ta capuche, grogne-t-elle.
Des livres occupent les immenses bibliothèques, et des Vampires occupent d’immenses canapé de style victorien. Nonchalants, parfois endormis, ils écoutent l’un des leurs jouer du violon. C’est du Niccolò Paganini, j’en suis presque certain.
La décoration alliant le bordeaux et le doré dans tous les coins me file toujours autant la migraine. Rien n’a changé. J’évite machinalement les rideaux de soie transparente, attachés au plafond bas. Hisae avait pour habitude de dire qu’ils apportaient à la pièce « une impression d’intimité et une volupté tout à fait notable. »
Gaëtan et moi passons sans être vus, mais en arrivant dans la salle des occupations, comme la surnomment les Vampires, tous les regards sont sur nous. Curiosité, méfiance et envie ondoient sur les visages. L’une des Vampires, assise devant un échiquier, porte son cavalier à ses lèvres. Je crois apercevoir le bout de sa langue en lécher distraitement le bois, tandis que sa tête pivote lentement au rythme de mon avancée. Je contourne le piano, me décale d’un pas sur le côté à la survenue d’une main dans mon champ de vision.
— Alejo.
Encore au bas de l’escalier, je m’arrête à la première marche. Gaëtan manque de me rentrer dedans.
Ça faisait bien longtemps…
— Alejo, c’est bien toi ?
Vêtue d’une simple robe en soie blanche, elle se démarque de tous les autres qui semblent sur le point de se rendre à une reconstitution d’un bal du XIXe siècle. Hisae a tendance à être nostalgique, et donc à s’entourer de gens de son époque qui ne sont pas décidés à oublier leurs us et coutumes passés.
— Que fais-tu là ? m’interroge Clarimonde en s’avançant doucement, comme elle le ferait pour ne pas effrayer un chat.
— Nous venons voir Hisae.
Clarimonde plisse le front et balance ses lèvres d’un côté puis de l’autre, en pleine réflexion. Sur son visage, cette mimique est presque élégante.
— Je devrais vous accompagner.
Je garde le silence. Gaëtan sait que j’avais l’habitude de côtoyer les Ombres, mais je sens qu’il s’interroge. Nous montons néanmoins à l’étage sans qu’il ne pose de question.
La porte des appartements d’Hisae apparaît au fond du couloir. Je ne détourne pas le regard, de peur de croiser celui de Clarimonde qui m’a rattrapé et marche maintenant à mes côtés. Plus loin, un Vampire quitte une pièce. Il s’empresse de refermer la porte dans son dos lorsqu’il nous aperçoit.
— Désirez-vous que je vous annonce ?
Je fais signe à Clarimonde de ne rien en faire. Ou plutôt, j’ouvre la porte sans attendre pour lui formuler ma réponse.
La pièce est éclairée par des bougies, dispersées sur chacun des meubles. La première personne à m’apercevoir est Kaleb, avachi dans un fauteuil. Sans grande réaction, il se contente d’esquisser un petit sourire amusé. Ses yeux pétillent d’impatience, sûrement à l’idée de mes retrouvailles avec sa compagne.
— Qui est-ce, mon amour ?
Hisae est reconnaissable à son intonation de voix perpétuellement langoureuse. Du mouvement dans la pièce adjacente nous prévient de son arrivée, et nous ne tardons pas à découvrir une autre de ses innombrables robes extravagantes.
À ma vue, elle porte une main à sa poitrine avec un geste gracieux. Chez elle, le moindre mouvement est aussi précis que délicat. Même quand elle tue.
— Alejo Snow, lui répond enfin Kaleb en se redressant, comme tu peux le constater.
Les cheveux noir ébène d’Hisae se balancent contre ses hanches lorsqu’elle s’avance jusqu’au Vampire.
— Qu’en penses-tu ? interroge-t-elle Kaleb en passant ses mains sur le tissu de sa robe.
— Tu es magnifique, comme toujours. Mais pourquoi ne pas avoir gardé ton yukata ?
— Eh bien, j’avais simplement envie de me changer.
Hisae se tourne vers moi, puis son regard vient examiner Gaëtan.
— Alejo, je constate que tu n’as toujours pas appris les bonnes manières. Qu’attends-tu pour faire les présentations ?
Avant même que je ne commence à répondre à ses volontés, elle lève lentement une main pour arrêter ce que je n’ai pas pu entreprendre.
— Je ne serai prompte à t’entendre que lorsque cette capuche aura disparu de ta tête.
Habitué aux exigences de la Vampire, je m’exécute, puis annonce :
— C’est un vieil ami à moi. Gaëtan.
L’ami en question baisse légèrement la tête en signe de révérence. On dirait qu’il sait comment s’y prendre, avec Hisae.
— Eh bien, mon cher Gaëtan dépourvu de nom, veuillez m’excuser de ne pas vous recevoir avec plus d’entrain. J’aimerais vous offrir à boire et vous proposer de vous distraire avec nous, seulement, voyez, celui qui se dit être votre ami fut le mien également avant de semer le trouble dans mon hôtel. Je ne saurai lui pardonner d’avoir rompu l’amitié que je partageais avec un dénommé Byron.
— Nous ne sommes pas là pour passer du bon temps, Hisae, dis-je sans me soucier de l’offusquer.
Gaëtan fait un pas vers la Vampire.
— Nous devons parler.
Une esquisse de sourire se fige sur le visage d’Hisae. Elle se dirige vers son piano, les mains posées sur la jupe de sa robe. Silencieuse, elle s’assied et parcourt les touches de l’instrument d’une caresse. Elle joue à nouveau la Sarabande de Haendel. Kaleb, lui, se lève pour se servir un verre, arborant toujours ce même sourire malin.
Je rejoins Hisae, déterminé à attirer son attention.
— Tu ne pourrais pas changer de registre, au moins une fois ?
Tout en poursuivant la mélodie, et sans dévier les yeux de ses mains, elle répond dans un soupir languissant :
— Tu sais combien cette sarabande m’inspire la fin du monde. Comme un élan d’espoir mélancolique. De soulagement et de regrets. Je suis lasse d’errer entre la vie et la mort.
— Oui, je le sais. Et nous avons une nouvelle qui pourrait te réjouir.
Cette annonce stoppe Hisae dans son occupation. Elle me dévisage, curieuse, puis m’incite à poursuivre de vive voix. Satisfait, je me redresse, puis je prends place dans le canapé en face de Kaleb. Gaëtan se positionne derrière moi, les bras croisés. Hisae se lève à son tour.
— La Magie disparaît, tu devrais bientôt voir tes vœux exaucés.
Les Vampires demeurent placides.
— La Grotte des Transcendances a disparu, leur apprend Gaëtan, sa gardienne aussi. Les peregrinator nous transportent à destination seulement par hasard.
À cet instant, Kaleb lâche un rire rauque en posant une main sur le bras d’Hisae, qui s’assied sur l’accoudoir du fauteuil… du moins, autant que le lui permet sa robe.
Je fronce les sourcils, pas plus agacé que surpris par la réaction de Kaleb. Hisae semble de mon avis et lui chuchote ce qui ressemble à un reproche.
— Excuse-moi, ma belle, mais tu avoueras qu’ils ont l’air ridicules. Vous êtes en retard, mes chers.
Il pousse un long soupir pour calmer sa crise d’euphorie, puis reprend :
— À votre avis, pourquoi nous nourrissons-nous à nouveau de sang humain malgré les accords passés avec De La Haute Maison ?
Les poings serrés, je contiens la colère qui me brûle l’estomac.
— Je pensais que, puisque l’Institut ne se souciait plus de vous, vous aviez décidé d’en faire autant.
Quelqu’un s’assied à côté de moi et pose une main sur mon épaule. Un regard sur le côté me rappelle la présence de Clarimonde. Cette Vampire m’a toujours fait penser à un fantôme avec sa capacité à se faire oublier, debout dans un coin de la pièce.
Je dégage doucement son bras et bascule en avant, les coudes sur les cuisses. Elle murmure tristement mon prénom.
Est-ce qu’elle aussi boit le sang d’innocents ?
— Il y a un peu de ça pour certains, répond Kaleb avec soudainement plus de sérieux. La plupart sont surtout très faibles et certainement sur le point de se dessécher. Le sang animal ne leur suffisait plus et ils mouraient de faim, sans vouloir faire de jeu de mots. D’autres n’en pouvaient simplement plus de renier leur véritable nature, n’est-ce pas, Clarimonde ?
Je survole cette dernière information pour me concentrer sur le plus important :
— Et si on apprenait votre existence ?
— Aucune inquiétude, m’assure Kaleb. On attrape les passants dans la rue, juste devant l’hôtel, trop vite pour que qui que ce soit nous surprenne. Aurais-tu oublié que nous sommes plutôt rapides ?
— Aurais-tu oublié que vos victimes vont être recherchées ?
— Mais jamais retrouvées : c’est ce qui compte, non ?
Gaëtan, les bras toujours sur le torse, s’avance.
— Si vous vous contentez d’enterrer les corps dans la forêt, ils peuvent facilement être découverts.
Kaleb sourit à cette remarque.
— Vous sous-estimez Hisae.
Gaëtan et moi échangeons un coup d’œil. J’ai un mauvais pressentiment. Hisae prend une longue inspiration, lève les yeux vers nous, puis boit une gorgée du vin de son conjoint.
— Où étiez-vous pour ne pas savoir ce qu’il se passe ici ? nous interroge-t-elle finalement.
Et merde. Elle nous tient. J’espérais que la conversation se poursuive jusqu’à ce que Kaleb nous lâche des informations. Il a raison, j’ai sous-estimé Hisae.
— Pas à De La Haute Maison, dis-je sans plus de précision, et quand nous sommes rentrés, nous avons vu l’armée territoriale de la Corporation arriver via des peregrinator.
Hisae tend le verre à pied à Kaleb.
— Chercherais-tu de l’aide auprès de moi, Alejo Snow ?
Je ne peux pas éviter la question. Et je ne peux pas mentir. Parce que oui, nous avons besoin d’aide, et il aurait peut-être été préférable qu’une autre personne accompagne Gaëtan la requérir. Finalement, il semblerait que ce soit moi qui me sois mis en danger. Et Gaëtan, qui se masse le front, le sent aussi bien que moi.
— Tu veux savoir ce qu’est devenu ce monde pendant ton absence ? Tu devrais te souvenir que je n’offre rien sans recevoir ma part.
Gaëtan ouvre la bouche, mais je le coupe dans son élan :
— Je suis prêt à accepter n’importe quelle contrepartie en échange de tes informations.
— Non, Al, tu…
Sans regarder Gaëtan, je lui expose la situation :
— Si nous choisissons d’agir, nous devons nous préparer, et comment peut-on le faire si nous ne savons rien de ce qui nous attend ?
D’un signe de tête, j’encourage Hisae à parler.
— Nous donnons les corps aux Loups-Garous. Les deux meutes sont au bord de la guerre, elles ont besoin de toutes leurs forces pour remporter chaque assaut donné ou subi.
Ça ne m’étonne pas. Les Loups-Garous et les Vampires sont les plus doués pour mettre leurs querelles de côté et s’entraider si besoin ; seulement, si je me souviens bien, Hisae n’a jamais porté dans son cœur les Loups-Garous qui habitaient auparavant Digvix.
— Mais nous ne nourrissons que la meute de Enzo. Je n’apprécie pas les mauvaises manières de celle de Digvix.
Je me disais bien.
— Elle fait partie du territoire de De La Haute Maison, maintenant, rappelle Gaëtan.
Hisae hausse les épaules, un geste rare chez elle et qui témoigne de son ennui.
— Elle n’est jamais parvenue à s’intégrer, mais là n’est pas votre plus grand intérêt à connaître les derniers événements.
Je m’apprête à l’interroger sur le sujet, mais elle devance ma question.
— Les rebelles ont chassé les Traqueurs qui restaient à l’Institut Oublié et y ont installé une partie de leur troupe. Le directeur a alors conduit les survivants à De La Haute Maison, pensant être bien accueilli. Seulement, vous connaissez Lutra et son aversion pour les Traqueurs. Il les a laissés croupir dehors. On dit que quelqu’un de De La Haute Maison aurait prévenu la Corporation par le biais d’une Salamandre.
— Les Alchimistes de l’Institut Oublié n’ont pas pu repousser les rebelles ?
Hisae dévoile ses canines en ricanant.
— Les Alchimistes de l’Institut Oublié sont la pire espèce qui soit ! Ils ont quitté leur Institut lorsque leur directeur a proposé d’équilibrer les salaires entre les Alchimistes et les Traqueurs. S’ils avaient su contenir leur cupidité et s’ils n’avaient pas ressenti ce besoin de dominer les Traqueurs, rien de tout ça ne serait arrivé.
Les Alchimistes, plus que les Traqueurs, peuvent se permettre de se détourner de leur Institut : un autre les accueillera toujours. Les Traqueurs, eux, n’ont pas cette sécurité. À quoi bon créer un poste de plus pour quelqu’un qui n’a pas d’autre service à proposer que sa force physique et son maniement des armes ?
— Dès son arrivée, poursuit Hisae, la Corporation a destitué Lutra et a mis l’Institut sous tutelle. Puis, l’armée sur place n’a pas attendu et a installé un camp pour les Traqueurs et les Ombres de l’Institut Oublié. Les blessés, malades ou je ne sais quoi d’autre, ne sont pas encore sur place, mais arriveront très prochainement.
Je déglutis. Hisae harponne mon regard.
— Tu sais à quoi tout cela ressemble, Alejo ?
À une vague migratoire. Et Hisae confirme mes craintes.
— Et ce ne sont que les premiers. D’autres vont venir, car comme vous nous l’avez innocemment rappelé, la Magie disparaît.
De La Haute Maison est l’Institut le plus proche des Terres lointaines. Le plus proche du Grand Aulne. Celui où les Ombres qui dépendent de la Magie de cet arbre vont venir se réfugier. Ce n’est pas seulement une vague migratoire, c’est la première. La prochaine viendra sans aucun doute d’Instituts allemands. Puis des Terres lointaines.
— Alejo, m’interpelle Clarimonde, tu dois aussi savoir que le Fourre-Tout est habité par les rebelles. Par Tom en personne, d’après les rumeurs.
J’avais totalement oublié le Fourre-Tout. Parce que j’essayais d’oublier ce qu’il s’y est produit à mon dernier passage.
— Que sont devenus ceux qui y travaillaient ?
Hisae se lève en déplissant sa robe. Elle se dirige vers la grande table du salon, y récupère un journal que je soupçonne être du secteur des Trois Œil. Elle me le tend, sans me lâcher du regard, puis retourne auprès de Kaleb.
— Tu es sûr de ne pas vouloir boire quelque chose avant ça ? me propose Kaleb, me surprenant par sa sincérité.
Sur la première page, pas de titre. Rien, mis à part une photo en noir et blanc. Une photo où Genéniève pend mollement par le cou, au milieu d’autres dont je crois reconnaître certains visages.
— Ils ont tous été exécutés, dit Kaleb. Tous, sauf un, qui a été torturé à mort.
J’ouvre le journal, seulement constitué des noms des déplorés, et de pages blanches. Un détail qui ressemble bien à Tom. Soit il voulait symboliser la fin de l’histoire de la Corporation, soit il avait en tête de signifier que, maintenant, les rebelles allaient écrire la leur.
— Torturé à mort ? répète Gaëtan, éteint.
— Il était soupçonné d’avoir libéré des prisonniers, le jour de l’assaut du Fourre-Tout par les rebelles.
Je suis incapable de bouger. Mes doigts manquent de laisser glisser les feuilles du journal.
— Un certain Victor Hengelman, ajoute Kaleb.
Léanne va être effondrée.
Tentant de reprendre constance, je me racle la gorge, préviens Hisae que j’emporterai le journal avec moi. Tout me semble bon pour ne pas m’imaginer annoncer la mort de Victor à Léanne.
— À présent, intervient Hisae, discutons de ce que tu pourrais faire pour moi.
— Je t’en prie, dis-je en me frottant les yeux.
Hisae attend de saisir toute mon attention avant de commencer :
— Tom ne s’est pas simplement contenté de s’en prendre à l’Institut Oublié. Il a aussi attaqué les Ombres qui étaient établies sur son territoire. Les rebelles ont éradiqué les Vampires qui y vivaient. Des Vampires qui étaient nos amis.
À ces mots, Clarimonde baisse la tête et fixe le sol. Les Vampires de l’Institut Oublié étaient connus pour leur respect des accords et leur aspiration à la tranquillité. Ils habitaient une abbaye abandonnée, perdue en pleine forêt, non loin de leur Institut.
— Ils n’ont jamais succombé à leur faiblesse ni à la douleur que leur causait la faim, continue Hisae. À eux non plus, le sang animal ne suffisait plus, mais leurs cœurs étaient plus forts que les nôtres, leur amour de la paix aussi. Ils n’ont pas touché un seul homme, ou une seule femme, ce qui leur a valu de rester sans défense devant l’ennemi. Sais-tu ce que Tom a commandé à son armée ?
Un feu sombre illumine les yeux grands ouverts d’Hisae lorsqu’elle articule, les dents serrées :
— Ils ont enfermé les Vampires dans l’abbaye, puis l’ont incendiée. Ils les ont laissés agoniser jusqu’à ce qu’ils perdent toute leur eau, et seulement après… seulement après les cris et l’horreur, ils ont enterré les quelques corps qui restaient, avec une pierre entre les mâchoires. Et lorsqu’ils ont perdu patience, ils ont décapité les derniers cadavres qui avaient résisté aux flammes et les ont laissé pourrir à l’air libre.
Hisae se penche vers moi, une main sur sa table basse. Cette position me donne l’impression qu’elle serait capable de me sauter au cou si je refusais ce qu’elle se prépare à me demander.
— Je veux que tu tues Tom. Je veux que tu me rapportes le cœur de ce psychopathe, pour m’assurer qu’il en ait bien un.
Pour ne rien laisser transparaître de mon hésitation et de ma crainte, je balance avec une indifférence feinte :
— Et comment sauras-tu que c’est réellement le sien ?
Ma voix est restée monotone, ce qui me vaut un regard stupéfait de Gaëtan. Il semblerait qu’il soit l’un des rares à ne pas encore me voir comme un meurtrier.
Hisae fait crisser ses ongles sur la table basse en serrant le poing. Ses pupilles se rétractent, ses lèvres se retroussent sur ses canines.
— Je le reconnaîtrais à son odeur de cruauté et de putréfaction.