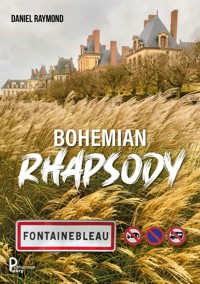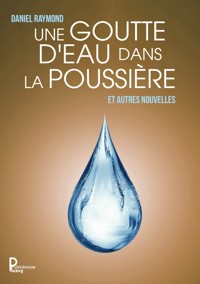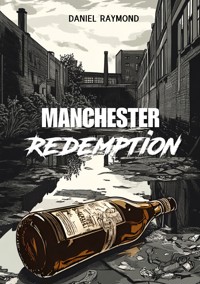
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Billy Shears a dix ans. Dans les rues du quartier d’Old Trafford du Manchester des années 1990, il grandit en marge du système scolaire, entouré de ses camarades John, Martha et Charles. Si ses trois amis brillent dans les études et réussissent professionnellement, Billy, lui, n’a qu’une envie, prendre sa revanche sur l’alcool qui a mis sa famille en lambeaux. Une éducation à la dure l’amènera à produire lui-même une boisson de contrebande, du « Madchester », sans jamais y toucher.
Sa prospérité dans le monde clandestin sera rapide et insouciante, accompagnée par ses trois amis qui le pousseront à officialiser sa distillerie.
Le passage des adolescents dans le monde adulte et celui de la distillerie prohibée dans celui des affaires légales vont rebattre les cartes.
Les affaires de cœur, le poids du passé, l’argent et les jalousies tendront les relations jusqu’au dénouement à l’aube de l’année 2011.
Billy a à peine trente ans, la vie commence.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Daniel Raymond - Né américain, il a été séduit par la France. Il aime avec excès, sans retenue, avec passion. Il tente de faire honneur à l’adolescent qu'il était, si aujourd’hui il portait son regard sur lui. Il aime le grand air, la course à pied, la randonnée, les belles courbes, celles de la nature, celles des corps. Les réparties cinglantes, drôles, percutantes, mais par-dessus tout un gazon impeccable !
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Daniel RAYMOND
MANCHESTER REDEMPTION
« Let me introduce to you, the one and only Billy Shears… »
–Lennon/McCartney
1re partie : LA GENÈSE
« Croire n’est pas savoir. »
–Éric-Emmanuel Schmitt
© SylvieJosse
1/ ONE AFTER909
Pour revenir de l’école, Billy, dix ans, prenait rarement le même itinéraire. Tout dépendait du copain qu’il raccompagnait. Seule certitude, il n’était jamais pressé de rentrer. Pour accompagner John, ses pas le menaient dans Warwick Road avant de piquer à droite vers Rye Bank et Kensington afin d’y admirer les voitures de sport et les jolies filles. Avec Charles, c’était direction le nord pour jeter un œil aux joueurs de cricket sur le terrain d’Old Trafford. Et pour les beaux yeux de la jeune Martha, il aurait été jusqu’à Liverpool. À pied ! Mais aujourd’hui, il n’était pas d’humeur à partager son chemin. Il aurait pu rentrer directement en passant tout droit par Kings Road jusque chez lui à Plumbley Drive, mais la boîte en fer qu’il poussait du pied en décida autrement.
Dans la tête de Billy, il n’y avait pas de boîte en fer, mais une solide boule de cuir cousue main usée par les crampons des plus grands joueurs. Ces joueurs, Billy les imaginait parmi les ombres de la nuit tombante, dansant sur le trottoir de pavés arrondis par l’usure du temps où poussait autant d’herbe que sur l’ancien terrain fétiche au 910 de Maine Road, là où s’élèvent désormais des logements de standing. Dans l’imaginaire du garçon, pas de jeunes footeux prometteurs qui font les beaux jours des magazines sportifs. Ces gars-là, il ne voulait pas qu’ils viennent jouer dans sa banlieue froide et pluvieuse de Manchester. Billy, sur le terrain de son imagination, se voyait faisant la passe au grand George Best, dribblant l’incontournable Roy Kean, plaçant un petit pont au majestueux Wayne Rooney, trompant d’un lob ajusté Peter Schmeichel, le gardien historique de la ville. À Manchester, même quand on était jeune, on vivait le football à l’ancienne, autrement dit local et dans le respect des héros. Et lui dans tout ça, qui était-il ? « Éric the King » bien sûr, le grand Canto, l’homme qui parlait aux mouettes.
En ce début janvier 1990, Billy n’était pas d’humeur causante, pas plus avec les mouettes qu’avec les copains. Quant aux adultes, il s’en méfiait depuis bien longtemps. Et encore un peu plus ces derniers jours. Son père, après une ultime dispute familiale agrémentée de coups et d’insultes qui défiaient le dictionnaire comme l’imagination, avait quitté la maison en maudissant ceux qui y resteraient pour les générations à venir… Sans oublier de leur flanquer une dernière rouste, à lui et à sa mère, pour être sûr que le message soit bien compris.
–Ça vous gêne pas de m’empoisonner l’existence et de bouffer mon pognon… celui que je me tue à gagner. Il faut encore que je supporte vos conneries et vos pleurs ! Tenez, prenez ça ! Là vous aurez une raison de vous plaindre.
Sa mère avait encaissé, comme à l’accoutumée. Mais depuis cette soirée, Billy, qui avait lui aussi eu droit à sa dose de haine, portait une méchante et profonde estafilade en travers de la joue qui, chaque matin devant la glace, lui rappellerait le douloureux souvenir de son père. Le tout entouré pour le moment d’un magnifique coquard qui mettait du temps à s’estomper. Billy avait intégré depuis longtemps que l’alcool qui coulait dans les veines de ses parents ne pouvait que faire de même avec sa famille, la couler ! L’entraîner vers des profondeurs si noires qu’elles finissaient par lui faire peur, lui qui, à l’école pourtant, était toujours le plus brave, le plus courageux, toujours prêt à monter au front pour défendre la veuve et l’orphelin.
L’orphelin surtout, car des veuves il n’en connaissait pas tant que ça.
***
Ce jour-là, du haut des certitudes d’un enfant de dix ans, Billy s’était fait la promesse de ne jamais toucher à une goutte d’alcool. Il serait celui qui décide de son existence. L’alcool et la drogue qui inondaient Manchester ne feraient pas les choix pour lui.
Sans le savoir, il avait posé les bases de son libre arbitre. Plus tard, ce même soir, il alla un peu plus loin encore dans les options qui dicteraient son adolescence et sa vie d’adulte. Il décida qu’un jour, ce serait lui le maître des addictions, lui qui aurait ce pouvoir sur la vie des plus faibles, des plus dépendants. Il contrôlerait les flux d’alcool, et les autres − le reste du monde quand on a dix ans − devraient payer pour ce qu’il avait subi durant toutes ces années.
Parmi les addictions qu’exécrait Billy, la religion tenait une bonne place. S’il n’avait rien contre les croyances quelles qu’elles soient − tant qu’elles restaient du domaine de l’intime −, il vomissait ces rites sociaux faits de gestes sans signification, de rendez-vous honorés simplement pour être vu, de prières apprises par cœur sans être comprises, d’offrandes libératrices des péchés les plus honteux chez les adultes. Quel que soit le dieu, Billy ne voulait pas s’y soumettre si les fondements de ces croyances étaient le pouvoir, l’apparence, la soumission ou le prosélytisme. Ultime paradoxe chez lui, dans ses moments de solitude, pour fuir l’ennui autant que l’indifférence ou la fureur de ses parents suivant leur taux d’alcool, Billy trouvait un vrai plaisir à s’échapper dans la magie des mythologies grecques et romaines. Ces divinités-là étaient plus proches de sa réalité, incarnaient les péchés comme les vertus du monde qui l’entourait. Les différends ne s’y réglaient pas par des prières vite bâclées dans un confessionnal, mais bien dans le face-à-face, le corps-à-corps, qu’ils soient dieux, demi-dieux ou simples mortels. Il les imaginait jurant du haut de l’Olympe ou dans leurs palais. Parmi cette multitude d’images, Billy qui − on l’a compris vomissait sur Bacchus − avait un faible pour Vulcain, Héphaïstos pour les Grecs. Peut-être, en raison du prestige de ses parents, Zeus et Héra − excusez du peu −, mais plus sûrement en raison de sa capacité à maîtriser le feu souterrain, celui de ses forges comme celui qui brûle en chacun de nous.
2/ COME TOGETHER
En 1990, Manchester avait beau avoir troqué sa tenue charbonneuse de ville industrieuse pour celle à paillettes de nouvelle capitale européenne de la culture et des universités, les effets collatéraux de décennies de révolution industrielle restaient inscrits dans ses gènes. La violence et l’alcool étaient les deux piliers bien ancrés dans la tourbe noire et humide de ces terres du nord de l’Angleterre.
La famille de Billy était un parfait exemple de l’aboutissement de cette dérive sociale. Le départ de son père − jusqu’à un hypothétique retour − ne marquerait pas pour autant la fin des tensions à Plumbley Drive, dans cette maison qui se délabrait lentement au fil des hivers longs et ternes. Sa mère, Maggie, chargée du nettoyage dans les écoles, savait très bien trouver elle-même, sans l’aide de son père, les chemins qui mènent aux enfers quotidiens des addictions. Ce soir, à Plumbley Drive, l’humeur serait festive pour célébrer le départ du tyran, mais la soirée avait de grandes chances de finir dans les excès, les coups et les insultes avec de nouveaux « invités » dès que le niveau des bouteilles aurait sérieusement baissé. Ainsi en allaient-ils des nuits familiales alcoolisées, à Manchester comme ailleurs, ainsi en allait-il de la vie de Billy Shears.
Celui qui maîtrise vos addictions à la main sur vos existences ! Voilà donc la grande leçon qu’avait apprise à la dure le jeune Billy avant même de fêter ses 10 ans. Un apprentissage qui n’avait pas grand-chose à voir avec les livres de l’école, mais bien avec les vicissitudes de la vie, dans cet enfer domestique qu’il retrouvait dès qu’il franchissait le pas de la porte à la peinture écaillée de Plumbley Drive. Quand les autres enfants fuyaient le froid et la violence de la rue pour rejoindre la chaleur et la douceur familiale, Billy une fois chez lui n’avait qu’une envie, retrouver la solitude, l’anonymat et le calme que lui offraient les rues des alentours. Ce foyer dans lequel il grandissait était un puits sans fond de désespérance humaine dans lequel il puisait l’essentiel de son savoir brut, sans jamais se laisser aller à y sombrer.
Plumbley Drive et ses environs étaient une énigme pour les urbanistes, pour les sociologues et analystes des composantes urbaines. Les petites maisons ouvrières si terriblement semblables ne parvenaient à se distinguer les unes par rapport aux autres que par des inventions toujours innovantes dans le registre de la décrépitude. Là où le laxisme se serait normalement traduit par des peintures approximatives et des jardins mal tenus, ici on rivalisait en créativité. Les jardins conservaient des arbres morts depuis souvent une décennie, accueillaient de mauvaises herbes inconnues de tous, certaines ayant pris une forme arbustive. Les toitures dégradées faute d’entretien n’étaient pas simplement bâchées, mais recouvertes des objets les plus insolites. Ici, un capot de voiture posé à la hâte sur les tuiles effritées empêchait la pluie intrusive de tremper le bâtiment, là, des planches de récupération pourrissaient tranquillement avant que le propriétaire soit traversé par une idée brillante pour les remplacer. Les petites barrières en bois, qui habituellement font le charme de ces jardins, avaient depuis longtemps cédé face à la vermine et aux coups de pied rageurs des jeunes enfants ou de leurs pères chômeurs qui en avaient fait leurs boucs émissaires.
Le quartier connaissait une mutation constante sans jamais vraiment décoller. Les oppositions sociales y étaient fortes, voire cruelles. Dans certaines rues, la misère plongeait ses racines si profondément qu’il semblait impossible que des jours meilleurs finissent par y germer. À deux rues de là, les voitures rutilantes étaient vierges de bosses, les pelouses étaient tondues, les habitants se saluaient, les façades avaient des peintures qui ne s’écaillaient pas. Globalement, jamais le quartier n’avait réussi à vraiment changer comme si, ici, le passé souvent noir et sordide, par on ne sait quel sortilège, ne voulait pas mourir. Billy s’était demandé si ce n’était pas l’architecture qui était maudite, car ici, que l’on mette les gens à côté ou au-dessus les uns des autres, cela ne fonctionnait pas !
***
Dans la famille de Billy, avec une régularité déprimante, les matins se formaient plus ou moins gris et pluvieux, ouvrant sur des soirées qui se décomposaient avec une régularité effrayante dans le froid et l’alcool.
–Tu ne vas pas bosser ce matin ? lâchait sa mère à son mari sans même lui adresser un regard.
–Je bosserai quand ça payera correctement, répondait-il en piochant, dès le saut du lit, une bière fraîche dans le réfrigérateur.
Souvent, les mots s’arrêtaient là, laissant la place aux bousculades quand ce n’étaient pas les coups.
Billy, sans un mot d’au revoir, filait dans la rue quel que soit la météo, qu’il y ait école ou pas. De toute façon, ses parents ne s’intéressaient plus à son emploi du temps ni à son cahier de correspondance ou à ses résultats depuis longtemps.
L’alcool ce n’était pas pour Billy qui s’en tenait à sa promesse ; ne jamais attacher son destin à celui d’une quelconque dépendance. Cigarettes ou drogues avaient droit au même traitement. Sur le chemin de l’école qu’il fréquenta de façon aléatoire jusqu’à sa majorité, il continua à accompagner John Kite et Charles Spector en gardant toujours un œil bienveillant et protecteur sur la jeune Martha Byrne. C’était là la seule addiction qu’il se permettait. Celui qui aurait voulu manquer de respect à la jeune et belle rousse mancunienne faisait le plus mauvais choix de sa vie. Quelques années plus tard, deux ou trois fiers-à-bras du quartier de Moss Side qui avaient voulu abuser d’elle en garderaient à vie des cicatrices et de profondes douleurs. D’autres inconscients, venus avec les mêmes idées du quartier de Eccles, prétendaient avoir eu un accident de moto pour expliquer leurs contusions multiples !
En grandissant, il arrivait au quatuor « d’oublier » d’aller en cours. Charles avait toujours le sourire et l’imagination qu’il fallait pour expliquer aux professeurs les absences de ses camarades. Les excuses qu’il présentait aux responsables de l’école relevaient des grandes heures du théâtre, alliant allègrement la comédie et la tragédie. John, lui, avait toujours une idée d’excursion ou de lieux à découvrir, surtout quand il y avait une chance d’y rencontrer des filles. Les jours de pluie, Martha emmenait « ses » garçons à l’abri des parapluies métalliques installés à Boardman Alley, à deux pas de King Street. Oubliant sous ces protections de fortune les tristes après-midis du nord de l’Angleterre, les amis refaisaient le monde et rêvaient celui qu’ils allaient construire dès la fin de l’école.
–J’obtiendrai un prix Nobel ! pérorait Martha.
–Mes dessins seront exposés dans des musées, déclamait Charles.
–Je rétablirai la polygamie, assurait John en ne riant qu’à moitié.
–Je ne boirai jamais d’alcool, assénait Billy chaque jour un peu plus fermement.
***
À l’aube de ses quinze ans, Billy, lui, était déjà passionné par les anciennes distilleries artisanales de la ville. Cet alcool qu’il vomissait − au sens figuré n’y ayant jamais touché − exerçait malgré tout sur lui une attirance atavique. Être puni par le directeur de l’école pour une absence inexpliquée ne lui faisait pas peur si à la fin de la journée il avait découvert un nouvel atelier abandonné. On se passionne pour ce que l’on peut !
Sans doute en raison d’une alimentation, disons aléatoire dispensée par sa mère, Billy n’avait pas tant grandi en taille. Juste en force. Les trop nombreux centimètres qui lui manquaient pour atteindre le mètre quatre-vingt qu’il avait tant espéré, il les compensait en force brute, pour cogner, forcer, percuter et tous autres gestes qui permettaient d’assoir son autorité dans la rue quand le besoin s’en faisait sentir. Si dans le quartier d’Old Trafford, où le respect voulait encore dire quelque chose, on ne s’amusait guère à défier la puissance physique des épaules rondes et des bras d’acier de Billy, c’était surtout devant sa ruse et son sens des affaires que l’on s’inclinait.
La force et la ruse, autant d’atouts indispensables à la vie qu’il menait. Une existence régie par des règles qu’il avait apprises dans la rue, au contact de plus âgés, de plus grands, de plus forts, de plus vicieux, jusqu’à ce que son apprentissage soit complet. Dès lors, ce fut auprès de lui que l’on vint s’instruire ou faire allégeance. Ce choix, cette évolution, s’était fait naturellement, sans volonté particulière de sa part. « La vie de Billy Shears devait être écrite d’avance », se disait-il souvent. Il n’avait fait que suivre un chemin déjà tracé, mais par qui ? Billy espérait simplement que l’hérédité n’avait rien à faire dans sa destinée, il ne voulait rien devoir à ce père dur au mal, l’un de ces costauds qui travaillent comme manutentionnaire là où il y a de la demande ; un coup sur les docks, un coup pour décharger des camions à l’origine douteuse. Une seule constante dans ces différents emplois, leur côté éphémère. Rocky Shears ne restait jamais bien longtemps au même poste, le plus souvent rejeté par des collègues qui ne l’appréciaient pas. Au mieux.
3/ PIGGIES
À la fin de l’adolescence, quand l’école n’était déjà plus sa tasse de thé, Billy avait fricoté avec les mauvais garçons de la ville. Oh, pas bien longtemps, juste ce qu’il faut pour réaliser que ce monde n’était pas fait pour lui.
Billy était l’un de ces petits gars râblés comme on en croise cent dans les rues des quartiers pauvres. Si on le cherchait, c’était facile, on le trouvait toujours dans les embrouilles, facilement identifiable avec ses mèches brunes rebelles et bouclées. Être mal habillé était une seconde nature chez lui qui cherchait constamment à se fondre dans une tenue à la mode sans en avoir ni les codes ni les moyens. Mais, curieusement, il dégageait une sympathie dès les premiers contacts, on avait toujours envie qu’il soit de notre côté.
Il n’était pas de la « famille » des mafieux qui tenaient les rênes et il n’aurait jamais de poste à responsabilité. La seule chose qui intéressait les donneurs d’ordre de la pègre locale était son jeune âge, moins de dix-huit ans, pas condamnable ! Après, il serait abandonné comme un mouchoir en papier usagé, ou pire, abattu et jeté pour ne pas laisser de traces. Cette vingtaine de mois qu’il passa à effectuer les basses besognes dans les rues froides et détrempées de la ville, Billy les mit à profit pour apprendre le fonctionnement des économies souterraines. Qui il fallait acheter, de qui et de quoi il fallait se méfier, jusqu’où on pouvait aller.
Depuis toujours, Martha avait alerté Billy.
–Ne t’approche pas de la mafia locale, je les connais, ils sont Irlandais, je sais de quoi ils sont capables.
Si Billy vénérait Martha, il avait déjà endossé ce costume machiste et patriarcal qu’arboraient les jeunes mâles de la ville.
–Tu connais quoi, toi ? Sous prétexte que tes vieux sont venus d’Irlande, tu sais tout de ce qu’ils font dans les arrière-cours ! S’il te plaît, laisse faire les hommes.
Martha essaya bien d’entraîner Billy vers d’autres mondes, d’autres plaisirs, d’autres découvertes, mais ses efforts pour l’éloigner de la tentation de la rue restèrent vains.
–Tu ne viendras pas te plaindre quand il sera trop tard. Tu es encore plus têtu qu’un Irlandais !
Un avertissement dont Billy se souvint, mais un peu trop tard.
Le Cheetham Hill Gang au nord de Manchester faisait les yeux doux à tous les gamins qui traînaient dans les rues. Il y avait toujours une dizaine de livres à gagner pour celui qui savait ouvrir les yeux et courir vite. Billy sut faire valoir ses qualités et séduire les caïds du quartier. Pendant les quelques mois au cours desquels il consacra son temps et son énergie à ce monde des gangs, il grimpa rapidement les échelons sans s’attirer les foudres de la police : vol à la tire de tous les étalages, intimidation de ceux qui ne payaient pas pour être protégés, récupération de dettes et bien évidemment des intérêts laissés à l’appréciation du collecteur, violence plus ou moins gratuite histoire de se construire une réputation. Billy, ayant déjà beaucoup appris du fonctionnement de ces économies et sociétés aussi parallèles que souterraines, décida un jour de prendre ses distances avant d’être définitivement enrôlé dans un gang ou de se faire prendre par la police pour un acte grave et condamnable, réglable au prix fort. Une exception !
***
Encaisser ! C’était là une des spécialités de Billy. Encaisser les coups sans broncher, mais surtout encaisser les mauvais payeurs qui eux ne savaient pas encaisser les coups. L’apprenti voyou, déjà bien rodé, avait inventé une technique spéciale qui fonctionnait à chaque fois. Il se présentait chez le débiteur accompagné d’un faire-valoir et jouait la pièce suivante dont il était le personnage principal.
–Tu vois, mon collègue là, il est champion de boxe universitaire, il a interrompu sa carrière pour disqualification après avoir frappé un adversaire à terre, annonçait Billy sans élever la voix ni se montrer agressif.
Le débiteur avait toujours une excuse improbable à servir pour expliquer son retard de paiement, allant des problèmes dentaires d’une de ses filles au décès soudain d’une tante. Quand il en avait fini avec ses explications, le faire-valoir − supposé champion de boxe − assénait un magistral uppercut à Billy, laissant le débiteur incrédule et bouche bée.
En se relavant, feignant la douleur et l’humiliation, Billy déclarait :
–Tu vois, moi, ce n’est pas grave, si je ne ramène pas l’argent, je prendrai bien pire de la part de mon patron, mais pour toi, ce ne sera pas drôle, mais alors pas drôle du tout. Mon ami, que tu vois là, a besoin d’entraînement et il ne trouve plus de sparring-partner. Le quart d’heure que tu vas passer avec lui couvrira à peine les nouveaux intérêts que tu nous dois. Quant au capital, je me servirai pendant que tu seras occupé.
Billy ne rentra jamais sans son dû ! N’oubliant pas de remettre à son ami boxeur sa part pour son excellent travail. S’il avait bel et bien été exclu de tout combat, c’était pour en avoir truqué un ou deux en faisant semblant de donner ses coups. Le garçon était passé maître dans l’art de la chorégraphie et du coup de poing factice.
Le quotidien de Billy consista pendant quelques mois à collecter les loyers, transférer de l’argent, encaisser les dettes, casser quelques vitrines, dégrader des voitures à coups de marteau. Il rentrait souvent chez lui le soir avec les jointures des mains abîmées. Dans les derniers jours de sa « collaboration » avec les gangs, il refusa de mettre le feu à la maison d’un mauvais payeur. Elle brûla quand même, avec toute la famille du créancier récalcitrant ! Il était temps de prendre le large…
Le savoir qu’il avait acquis au cours de ces mois n’était pas celui qui se dispensait sur les bancs de l’université où ses amis cultivaient leur avenir. Il laissa tomber la vie des rues de Manchester du jour au lendemain, s’inventant une famille à Liverpool qui voulait le voir habiter en bord de mer. Billy n’était alors qu’un adolescent qu’on laissa partir, mais son nom apparaissait désormais sur la liste peu glorieuse des lâcheurs, sur la liste de ceux qui resteraient à tout jamais débiteurs de la mafia irlandaise. Trop inexpérimenté et insouciant pour véritablement s’en rendre compte, Billy jouissait de sa jeunesse qui le rendait, à ses yeux, invincible.
Billy n’avait pas la fibre pour être un larbin, il venait de le prouver. Très jeune, il s’était fait une promesse : ce serait « boss » ou rien. Une évidence qu’il aimait expliquer calmement à ses trois amis étudiants au cours des longues soirées d’hiver mancuniennes au froid et à l’humidité pénétrants. Des moments qu’ils passaient ensemble quoi qu’il arrive.
***
Le quartier chinois, réparti autour de Faulkner Street en plein centre-ville et où une arche importée directement de Chine avait été installée en 1987, était l’une des destinations de balades favorites pour la bande d’Old Trafford. Le bruit, les couleurs, les odeurs inconnues des rues les changeaient radicalement de la grisaille qui habillait si souvent les faubourgs de leur ville. Quand il s’agissait de se retrouver au calme pour fuir l’école, les familles, le froid de la rue et les réunions où on ne parlait que de football, Billy et les trois futurs diplômés du British A-Level − l’équivalent du baccalauréat − se retrouvaient dans une petite enseigne chinoise, Gar-Pan, sur Strefford Road. Une gargote sans âme ni décoration où des chaises dépareillées entouraient des tables bancales. Billy informait le patron, Mister Xi, des risques venus des gangs, John s’occupait de la comptabilité, Charles avait essayé en vain de refaire la décoration et de redessiner la carte, Martha, elle, avait rationalisé et optimisé la production des sauces et des plats.
Ils étaient là chez eux, accueillis comme des princes avec une table à leur disposition dans l’arrière-salle qui n’avait rien de mieux à proposer en termes de chaleur que celle des clients, mais cet espace était à eux. Au cours de ces soirées passées à refaire le monde et à rêver à un avenir loin de la réalité si terne à leurs yeux d’adolescents attardés de Manchester, chacun commençait à affirmer ses choix de vie, ses appétences comme ses futures compétences professionnelles.
Billy, lui, comme toujours, observait le fonctionnement de la vente d’alcool et l’approvisionnement. Ses trois amis étaient sa vraie famille. Une famille choisie c’est autre chose qu’une famille héritée de la reproduction aléatoire de gènes pas toujours recommandables.
D’un côté, il y avait Martha, qu’il aimait passionnément. Comme une princesse à protéger coûte que coûte. Si le courage ne lui avait jamais manqué pour affronter des bandes de loubards qui lui voulaient du mal, il lui avait cependant toujours fait défaut quand la charmante rousse à la taille de guêpe venait se réfugier dans ses bras à la recherche de bien plus que du réconfort. Martha était une fille à part. Sans doute parce qu’elle ne semblait pas appartenir à son époque avec un look désuet, digne du XIXe siècle, bien loin des dogmes en vigueur au XXIe siècle. Pourtant, elle avait tout pour elle, la grâce et les formes, la tête bien faite, bien pleine et plus que jolie. Un soleil semblait en permanence briller en elle éclairant sa peau comme ses yeux mettant le feu à sa chevelure rousse.
Charles avait l’élégance qui avait toujours manqué à Billy. Les deux garçons étaient parfaitement opposés et complémentaires. Billy s’était donné pour mission que personne ne vienne jamais altérer cette différence qui rendait Charles unique. Une mission qui ne fut pas toujours de tout repos et dont Charles ne sut jamais rien.
John, lui, était un diamant brut, doté d’un charme singulier et rayonnant. Tout le monde voulait être l’ami de John, mais John, lui, voulait être l’ami de Billy. Point final ! Là encore, l’association des deux garçons était supérieure à la somme de leurs deux individualités. Quant à la bande des quatre, elle valait tous les carrés d’as des casinos. Même une quinte flush royale ne valait pas mieux ! Leur attachement était né de ces années passées à l’école et dans les rues à se construire en marge de leurs parents. Et aussi d’un événement fondateur qui n’appartenait qu’àeux.
4/ WHAT GOESON
Quand ils avaient une quinzaine d’années, John, Charles et Billy formaient un étonnant attelage qui emportait tout sur son passage. Principalement l’admiration des filles qui pestaient contre Martha, cette incroyable chanceuse que ce trio ne quittait jamais. À eux trois, ils formaient l’homme parfait : la beauté de John, la grâce de Charles, la combativité de Billy. L’amitié sans faille que leur portait Martha ne faisait que rehausser l’éclat de ce tableau.
–Vous me donnez la chair de poulpe, disait-elle souvent à ses amis, ce qui ne manquait pas de déclencher des cascades de rires.
C’est à l’occasion de l’une de ces « sorties extrascolaires » que le Carré d’As de Manchester tissa des liens que plus rien ne pourrait rompre. Charles, pour une fois, avait pris les devants auprès de l’école en annonçant leur absence à quelques jours des fêtes de Pâques. Mieux vaut prévenir que guérir.
Depuis qu’il savait parler, Charles inventait des histoires. C’était un conteur né, capable avec un mot, une odeur, un souffle d’air d’imaginer les scénarios les plus complexes et parfaitement crédibles. Les excuses qu’il inventait ne cessaient d’épater la direction de son école qui, si elle était séduite par l’histoire du jour, accordait un bon de sortie en rigolant sous cape.
Cette fois-là, l’excuse était imparable !
–Monsieur le directeur, mes amis et moi nous ne pourrons assister aux cours demain, car nous devons participer à une bénédiction précédée d’un exorcisme pour le dernier-né de la famille.
Le tout dit par Charles avec un aplomb et un sérieux que rien ne pouvait ébranler.
–Votre famille ? C’est-à-dire, répliqua le directeur curieux d’en savoir plus sur cette nouvelle escapade en préparation.
–C’est une cousine récemment arrivée d’Irlande qui vient d’avoir son premier enfant. Vous savez comment ils sont là-bas, très à cheval sur les affaires religieuses.
Charles, comédien né, prenait dans ces cas-là un air d’enfant de chœur à qui on aurait donné le Bon Dieu sans confession.
Depuis longtemps déjà, Charles et ses amis avaient laissé entendre à l’administration de l’école que leurs familles étaient unies par des liens qui variaient à chaque occasion, ce qui permettait à toute excuse à caractère familial d’être valable pour l’un d’entre eux ou pour les quatre. Pour ne pas risquer de se mettre l’Église à dos − on ne sait jamais −, le directeur leur donna son accord.
***
En guise de bénédiction, les écoliers buissonniers avaient prévu une balade vers Market Street et ses nombreux magasins. Depuis des mois, ils économisaient le produit de leurs divers petits boulots étudiants pour acheter des instruments de musique. À cette époque, être un adolescent anglais, surtout de Manchester, sans jouer d’un instrument, n’était pas envisageable. En ce froid matin de février 1996, ils essayaient des guitares d’occasion bien au chaud dans la cave isolée d’un magasin de musique sur Corporation Street. Coupés du monde extérieur, jouant mal et chantant faux, ils s’imaginaient sur une grande scène, acclamés par des milliers de fans.
En incorrigible dandy, John se trémoussait devant un clavier bringuebalant dont il tirait de curieuses sonorités, Martha inventait des chorégraphies improbables en assurant un chant approximatif. Derrière les caisses claires et les cymbales, Charles proposait une rythmique qui permettait à l’ensemble de se tenir à peu près.
–Garde le tempo, Charly !
Martha, entre deux reprises du couplet d’un titre des Rolling Stones, encourageait Charles, puis, désespérément, elle tentait d’équilibrer le travail de l’improbable formation.
–Moins fort John, on n’entend que toi ! À toi, Billy, sors-nous un solo digne de ce nom !
Quand Billy mit la main sur une guitare électrique Fender d’occasion et claqua un accord de septième mal posé, le monde, dans un incroyable fracas, s’écroula autour d’eux !
À quelques dizaines de mètres de là, l’IRA (Irish Republican Army) venait de faire sauter une camionnette contenant une tonne et demie d’explosif, faisant plus de 200 blessés et causant plus d’un milliard de livres sterling de dégâts ! Alors que les quatre apprentis musiciens rêvaient de gloire dans les sous-sols, la police, prévenue de l’attentat, faisait évacuer le secteur dans une urgence qui confinait à la panique. Malheureusement, l’alerte ne trouva pas son chemin jusqu’aux profondeurs du magasin de musique. Il fallut aux rescapés de la cave la journée entière pour retrouver l’air libre et découvrir une rue couverte de corps inanimés ; les mannequins du magasin Marks and Spencer soufflé par l’explosion.
D’abord sonnés par la violence de la déflagration, Billy, Charles, John et Martha reprirent leurs esprits dans le noir et les gravats.
–Vous êtes où ?
Le premier cri fut celui de Billy, persuadé après son accord de guitare d’être à l’origine du séisme qui venait de secouer la cave. Après quelques secondes d’un silence glaçant, alors que la poussière épaisse et âcre commençait à retomber, John fut le premier à répondre.
–Là, viens m’aider, j’ai le pied coincé sous un amplificateur.
Charles et Martha, à leur tour, sortirent du silence pour donner d’une voix éraillée par la peur, des signes devie.
–À part une énorme bosse sur le crâne, je n’ai rien, assura le percussionniste d’un jour enfoui sous la grosse caisse et un méli-mélo de câbles et de pieds de charleston et caisses claires.
Martha avait été épargnée par la chute des objets en tous genres qui jonchaient le sol de la cave. Immobile, elle était en état de choc, plantée sur ses deux jambes, posant un regard incrédule sur cet espace qui accueillait il y a quelques secondes encore leurs rêves de pop stars qui venaient de tourner au cauchemar !
–Je n’ai rien fait, je n’ai rien fait…
Née coupable, la jeune femme finit par s’écrouler et fondit en larmes.
Après des heures d’efforts, de désespoir, de pleurs, de larmes, de crises de nerfs, alors qu’ils avaient les mains en sang, l’air frais et la lumière pénétrèrent enfin dans la cave par un interstice dans la voûte. Aucune blessure grave n’étant à recenser, ils entreprirent de reprendre leurs esprits, mobiliser leurs forces et déblayer les gravats de l’escalier pour retrouver l’air libre. Pendant tout le temps que dura le travail de mineur pour sortir de ce terrible piège, Billy hurla à s’en briser les cordes vocales. Il hurlait pour encourager ses amis à déblayer la terre et les pierres, il hurlait pour tenter d’identifier d’autres victimes, il hurlait enfin pour tenter d’alerter les pompiers qu’il imaginait dehors à la recherche de survivants. Ces cris qui sortirent de sa gorge pendant des heures, sans que la moindre goutte d’eau y pénètre, ne furent pas vains.
Si le résultat leur permit de retrouver l’air libre, sains et saufs, il n’en fut pas de même pour ses cordes vocales qui portèrent à vie les cicatrices de ces excès. La voix de Billy ne retrouva jamais la clarté de sa jeunesse et se para en permanence d’un voile qui la rendait sourde et menaçante, l’installant de façon définitive dans le camp de ceux qui font leur vie dans la rue.
Il fallut inventer un nouveau mensonge pour expliquer les blessures et éviter des punitions à l’école comme à la maison. Charles fut une nouvelle fois à la hauteur de l’événement, inventant une histoire si compliquée que le directeur les renvoya en cours sans plus de formalité. Les quatre amis étaient désormais des survivants, liés par une expérience unique dans laquelle ils avaient mélangé leurs angoisses, leurs forces, leurs sangs et leurs larmes. Plus rien ne pourrait les séparer. À l’initiative de Billy, comme le font tant d’adolescents certains de maîtriser l’avenir, ils mêlèrent leur sang comme ils avaient vu les Indiens le faire à la télévision dans les westerns de secondezone.
–On se fait des entailles dans la peau et on se donne mutuellement la main, avait décrété John. J’ai vu ça dans un film.
–Tout à fait d’accord, renchérit Martha. C’est un rite africain qui est encore pratiqué à Haïti.
Dans la cour de l’école, Billy se chargea, avec son couteau, des entailles dans les paumes de main, prononçant d’une voix très inspirée quelques paroles qui, bien qu’incompréhensibles, revêtaient un caractère sacré et définitif pour les quatre sang-mêlé.
Comme d’habitude, Charles fut chargé d’expliquer à la direction de l’école pourquoi ils avaient la même cicatrice et le même pansement à la main !
Quant à la musique, ce fut la dernière fois que les garçons touchèrent une guitare. Martha se garda bien de pousser une nouvelle fois la chansonnette − si ce n’est doucement sous la douche − de peur de voir les murs s’écrouler autour d’elle.
***
À la fin des années 1990, John, Charles et Martha, dont les familles avaient su conserver la tête hors de la bouteille, de la seringue ou de la pharmacie, poursuivaient leurs études avec succès. Le commerce pour John, les beaux-arts pour Charles et les sciences pour Martha. Si les quatre jeunes gens s’étaient un peu éparpillés pour cause d’études supérieures, ils ne laissaient jamais passer une semaine sans se téléphoner, se rendre visite, s’inquiéter du bien-être de l’un, de la réussite de l’autre, des soucis du dernier. John, Charles et Martha préparaient leur entrée dans le monde adulte par la grande porte des universités. Billy, lui, y était déjà entré depuis longtemps par un tout autre chemin.
Fidèle aux serments de son enfance, il veillait sur ses amis tout en établissant les bases de l’empire qu’il voulait construire. Un empire dont on parle peu dans les manuels des universités, un empire pour lequel les formations sont rares et peu sanctionnées par des diplômes. Un empire clandestin qui se voulait libre de toutes contraintes.
La famille de Martha Byrne, comme celle de Billy, avait toutes les raisons de sombrer dans la misère de l’alcool et des addictions. Vers la fin du XIXe siècle, la famille Byrne, fuyant la pauvreté de son Irlande natale, trouva celle à peine plus ragoûtante de Manchester. À l’époque, la ville, l’une des premières au monde à être industrialisées, était surnommée « Cottonopolis », métropole de l’industrie du coton qui attirait dans ses usines près du tiers de la production mondiale ! Si la famille Byrne avait fui la pauvreté, elle avait aussi évité les turpitudes de l’alcool de patates qui rongeait l’Irlande. Arrivée à Manchester, elle avait trouvé dans la religion la force et la détermination pour résister à un nouveau naufrage.
Sauver son foie avec sa foi !
5/ SOMETHING
1998 ! Manchester sortait d’une période plus que difficile. L’alcool et la violence sociale hérités de l’ère industrielle apparaissaient presque comme un bon souvenir face à la réalité du moment. Les gangs, l’héroïne, le crack et les meurtres minaient la ville, faisaient régner la terreur dans les rues, stoppaient net tous les investissements, impactaient tous les chiffres d’affaires qui n’avaient pas trait à la drogue. La religion et le foot permettaient à peine de tenir le choc. Le Coran, la Bible, la Torah, la règle du hors-jeu et la taille des buts faisaient office de Code civil.
C’est en surfant sur cet antagonisme entre anciennes et nouvelles addictions que Billy fit ses premiers placements d’entrepreneur pour produire de l’alcool de contrebande. On était au début de cette année où le monde avait les yeux tournés vers le voisin français qui accueillait la Coupe du monde de football, mais une autre aventure commençait pour Billy. N’allez pas imaginer un univers digne des grandes années de la prohibition, on ne parlait alors que du tout petit artisanat local d’un adolescent devenu trop vite adulte.
Les débuts ne furent pas des plus faciles. Il fallut plusieurs tentatives avant de sortir un produit digne de ce nom, quelque chose de buvable, sans trop d’arrière-goût et avec une couleur acceptable. Billy trouva un couple de retraités, anciens employés de la distillerie de gin et vodka Spirit of Manchester qui conservait dans leur garage des alambics et tout le matériel nécessaire à la distillation en souvenir du bon vieux temps. Ces deux-là, Nancy et Dan, formaient l’archétype du couple de retraités des faubourgs de Manchester. Septuagénaires aux cheveux blancs, la silhouette fine qui commençait à se voûter, un quotidien qui se sclérosait doucement sans qu’ils s’en offusquent vraiment, usés par des années de labeur et des moyens financiers qui ne permettaient pas de rêver.
–Tu pourrais t’habiller au lieu de rester en robe de chambre du matin au soir !
Dan houspillait Nancy constamment sur ses tenues vestimentaires, ou plus exactement sur son absence de tenue !
–Je m’habillerai quand tu te seras rasé correctement et que tu répareras tout ce qui ne fonctionne plus dans cette foutue baraque.
Nancy n’était pas non plus en panne de reproches pour son conjoint.
La vie filait au rythme de ces scènes de ménage qui comblaient le vide de ces journées d’oisiveté.
La proposition de Billy fut accueillie avec le même enthousiasme que les numéros gagnants du loto. Un but, un défi, des moyens, de quoi rêver et vivre de nouveau, voilà ce que ce gamin d’à peine vingt ans apportait sur un plateau dans le foyer de leur vie qui ne demandait qu’à être rallumé.
***
L’aventure ne fut pas individuelle, mais bien collective. Chacun y mit du sien.
–On n’a pas fait un pacte du sang pour rien, s’amusait à rappeler John.
Martha, plongée dans ses livres de chimie et de biologie, finit par trouver un équilibre entre les différentes matières premières et les temps d’incubation idéaux. L’une de ses idées brillantes fut d’ajouter une touche de poivre et de piment dans la boisson.
–Ça rappellera le temps des colonies aux retraités, rigola Billy, prêt à tout pour séduire ses futurs clients.
Loin d’être « bio », les premiers litres fabriqués chez Nancy et Dan furent testés avec succès dans l’arrière-salle d’un pub des quartiers nord par quelques piliers de comptoir. Billy attendit quelques jours pour être sûr qu’il n’y avait pas d’effets secondaires… L’affaire était lancée, il suffisait de passer à la vitesse supérieure. Une question d’organisation pour Billy.
La nouvelle se répandit rapidement parmi les anciens employés de la distillerie, enchantés de valoriser leur savoir-faire, d’occuper leur temps libre et d’arrondir leurs fins de mois. Habitués aux produits fins élaborés dans le temps, ils hésitaient à tester leur nouvelle production. Trouver la matière première ne fut pas un véritable problème, Billy était prêt à tout distiller, maïs, seigle, orge, betterave, pomme de terre, canne à sucre, tout était bon à faire bouillir, même le sorgho et les fruits plus ou moins avariés entraient en jeu.
À proximité de l’école de Charles, un marché forain nourrissait une bonne partie des habitants du quartier. Régulièrement, des tonnes de légumes et de fruits avariés prenaient le chemin du centre d’incinération à la charge de la collectivité.
–Je sais comment vous apporter de la matière première pour pas cher, annonça-t-il dès les premiers jours à ses amis. Si vous n’êtes pas regardant sur l’aspect de la marchandise, je vous assure que vous aurez de la qualité au meilleur prix !
Un système de livraison fut rapidement mis en place dans cette opération gagnant-gagnant qui ne nécessita aucune mise de fonds pour Billy. Le rêve de tout nouvel entrepreneur.
Billy était un businessman débutant, buveur de thé, qui fournissait à petite échelle une clientèle en mal de boissons bon marché. Point final. Pas de racket, pas de menace, juste le marché de l’offre et de la demande. Les Mancuniens avaient soif ! Sortir le soir au pub devenait toujours plus difficile, le froid, la pluie, les gangs, l’insécurité… sans même parler des contrôles d’alcoolémie de la police qui poussaient à boire à la maison. Billy avait de quoi répondre à leurs attentes et les rassasier. Le tout à la maison ! Les livraisons à domicile avant l’heure, dans une ville où le ciel est rarement votre ami ! Le climat de Manchester peut se résumer facilement : des pluies fréquentes toute l’année. Avec, pour habiller le tout, des hivers assez froids et une humidité constante portée par le vent, avec des nuages qui ne laissent que peu de chance au soleil de venir vous chauffer la couenne. Et pour ceux qui aiment les excès, de temps en temps, une petite dépression arrivée de l’Atlantique pour faire bonne mesure. En cette année 1998, le record de froid de la ville venait d’être battu en janvier avec une température de -15 °C.
Et on nous parle de réchauffement climatique !
Dans les premiers pubs qui servirent en catimini la production de Billy, la boisson fut appréciée des travailleurs qui ne parvenaient plus à chauffer correctement leurs foyers. Cet hiver-là, particulièrement rude, lança la mode du Madchester.
–Remets-moi un peu de chauffage central, demandaient les clients en venant passer commande au bar. Ça me chauffe les entrailles ton truc.
–Ça coûte moins cher que le charbon ou le fioul, notaient ceux qui ne pouvaient plus se passer de leur dose quotidienne.
Quand ce n’étaient pas leurs doses quotidiennes… pour le plus grand bien de la caisse du patron et de celle de Billy.
***
Vous vous voyez à tout juste dix-huit ou vingt ans monter une distillerie clandestine ? Billy non plus, à vrai dire. Mais sa force résidait autant dans sa détermination que dans sa confiance absolue en ses amis et dans cette destinée qui semblait écrite d’avance. Quelques mois auparavant, lors d’une soirée « revival » à parler du bon vieux temps autour d’une tasse de thé, Billy avait longuement développé son projet et fini par intéresser toute la bande.
La vie des quatre d’Old Trafford était à un tournant. Ce fameux embranchement où la vie d’adolescent laisse la place à celle d’adulte. À ce drôle de carrefour, ils n’avaient pas fait le même choix. Ils en firent le constat à l’occasion de l’un de ces rendez-vous du samedi soir qui restaient comme des balises au bord de leur route commune.
Il suffisait à chacun de regarder son voisin, confortablement assis dans un fauteuil en cuir de ce club cosy où ils s’étaient donné rendez-vous, pour constater que l’époque des gamins des rues qui se réunissaient sous un abri de fortune était bien révolue.
–Qui l’aurait cru ? John, son éternelle cigarette à la main dans un costume de lin payé par les subsides de son université, regardait ses amis avec de grands yeux ébahis. Vous vous rendez compte du chemin qu’on a parcouru ?
–Et quoi ? rétorqua Charles qui, toujours aussi dandy, ne trouvait rien de bizarre à la situation, tant qu’il était avec ses amis, la vie lui convenait.
–On n’a jamais cru en rien si ce n’est en nous ! philosopha, comme toujours, Martha qui assumait pleinement ce qu’ils étaient en train de devenir. Billy, on a toujours su que tu deviendrais un patron, que tu n’aurais pas besoin de passer comme nous par l’université.
Alors que Charles et John rigolaient en hochant la tête, ils levèrent leur verre de Coca au projet de Billy. Ce dernier, après un temps de silence et de réflexion alors que son regard se mettait à briller, prit la parole.
Quand Billy exposa son plan, les pages de l’enfance se tournèrent définitivement, ouvrant de nouveaux chapitres. Chacun prenait sa voie, les universités proposant des voies aussi royales que respectables aux uns alors que pour Billy, c’était la rue et ses règles.
Enfermés dans leurs cursus universitaires, les trois étudiants, enthousiastes pour leur ami, restaient malgré tout un peu sceptiques sur l’avenir de cette boisson clandestine. La magie de la solidarité de l’enfance joua pourtant à plein.
La scientifique, le commercial, l’artiste, chacun y avait finalement mis le meilleur de lui-même pour prodiguer des conseils, des avis, des recommandations, des précisions techniques, des innovations pour se démarquer du marché traditionnel. Le tout sans oublier des précautions pour rester sous les radars de la police. Mieux que pour une start-up, le business plan était posé noir sur blanc par John, les recettes de distillation affinées par Martha, les étiquettes dessinées par Charles.
L’Ancien Monde n’avait qu’à bien se tenir, Billy Shears, à peine vingt ans, arrivait aux affaires !
Il faut croire que l’on apprend de bonnes choses dans les universités de Manchester − comme dans ses rues −, car la petite entreprise − association de malfaiteurs ? − connut une réussite fulgurante. Les étudiants étudiaient et Billy prospérait ! Les réunions du week-end entre les quatre amis ressemblaient plus à des conseils d’administration qu’à des soirées pizzas.
***
Avec les années, Billy avait appris à connaître tous les bas-fonds de sa ville, ses travers et ses perversions. De son côté, par passion, Charles en explorait le passé culturel et historique. Lors des rendez-vous du samedi soir, il arrivait toujours avec une nouvelle anecdote à raconter, sa « découverte de la semaine » comme il aimait à la présenter.