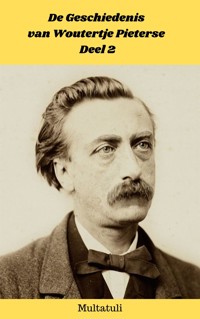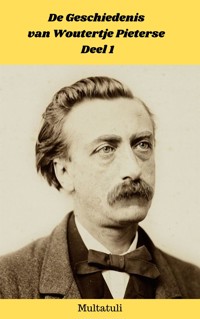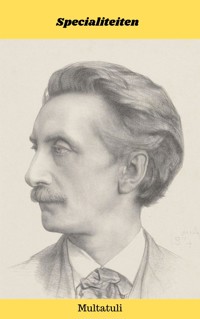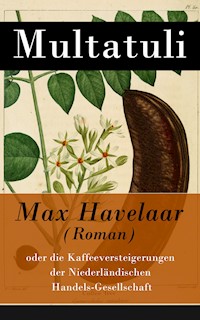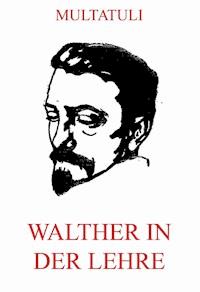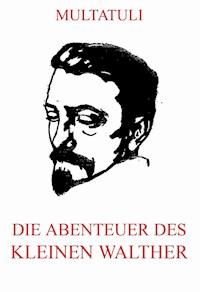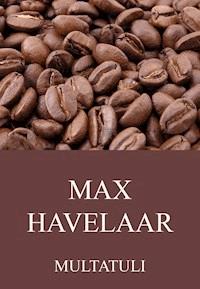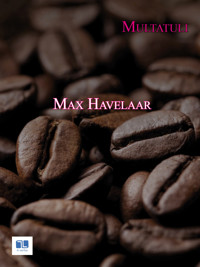
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: A verba futuroruM
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
1860. "Max Havelaar" . Ce titre n'est pas seulement aujourd'hui la marque d'un commerce équitable, c'est d'abord un roman pamphlet dénonçant le colonialisme – un des premiers – système économique injuste et cruel qui sévissait aux Indes hollandaises.pour ce roman et dans le monde en général sous la supervision des états européens, principalement.
C'est également le cri de révolte d'un des premiers lanceurs d'alerte, anarchiste, Edouard Douwes DEKKER, dit Multatuli – « j'ai beaucoup supporté »
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 585
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Max Havelaar
Multatuli
I
Je suis commissionnaire en cafés, et je demeure, Canal des Lauriers, n° 37. Il n’est pas dans mes habitudes d’écrire des romans ou autres choses de la même farine. J’ai donc longuement réfléchi, avant de me résoudre à commander deux rames de papier de plus qu’à l’ordinaire, et à commencer l’ouvrage que vous avez en mains, cher lecteur. Cet ouvrage, il vous faudra le lire, que vous soyez commissionnaire en cafés, vous-même, ou n’importe quoi. Non seulement, je n’ai jamais écrit quoi que ce soit qui ressemble à un roman, mais en ma qualité de commerçant, tout ce qui ressemble à un roman m’est parfaitement insupportable. Depuis des années, je me demande à quoi servent les romans, et rien ne me stupéfie plus que l’impudence avec laquelle un poète ou un romancier ose vous faire accroire ce qui n’est jamais arrivé, et, le plus souvent, ce qui ne peut être arrivé. Si, moi, dans ma branche de commerce, — je suis commissionnaire en cafés et je demeure Canal des Lauriers, n° 37 — je faisais une déclaration à un commettant, — un commettant, est un négociant qui vend du café, — où il y eut la millième partie des mensonges qui forment le gros des poésies et romans, il s’adresserait immédiatement à Busselinck et Waterman. Ce sont aussi des commissionnaires en cafés, mais vous n’avez pas besoin de connaître leur adresse. Donc, je me garde bien d’écrire des romans ou de faire d’autres fausses déclarations. J’ai toujours observé que ceux qui se mêlent de ces affaires-là finissent mal. J’ai quarante trois ans ; il y en a vingt que je fréquente la Bourse, et je peux me présenter quand on demande un expert en ces matières. En ai-je vu tomber des maisons ! Et, le plus souvent, quand je remontais aux causes de leur chute, je les trouvais dans la mauvaise direction que leurs chefs avaient reçue dans leur jeunesse. Moi, je dis : de la vérité, et du bon sens, et je m’y tiens. Naturellement, je fais une exception pour l’Écriture Sainte. Notre mauvaise éducation commence à la lecture des poésies enfantines de Van Alphen, et cela dès son premier vers sur les marmots, qu’il prétend être tous adorables. Comment, diantre, ce brave homme a-t-il pu adorer ma petite sœur Gertrude, aux yeux chassieux, ou mon frère Gérard qui passait son temps à se fourrer les doigts dans le nez. Il prétend que c’est par tendresse, qu’il a fait ces poésies-là ! Quand j’étais enfant, je me disais souvent : „ah ! mon petit père, que je voudrais te rencontrer ! Et si tu m’avais refusé des billes de marbre, ou un gâteau contenant mon nom en toutes lettres, — je m’appelle Batave, — oh ! je n’aurais pas pris de gants pour t’appeler : „menteur !” Or, jamais, je n’ai vu Van Alphen. Il était même déjà mort, je crois, lorsqu’il nous racontait en vers que mon père était mon meilleur ami, — moi, je lui préférais le petit Paul Winser, qui demeurait, près de nous, rue des Bataves — et que mon petit chien était la reconnaissance même…. Nous n’avions pas de chiens, chez nous, parce qu’ils sont tous plus malpropres les uns que les autres. Mensonge, que tout cela ! Et l’éducation des enfants se continue de la même façon. Ainsi, votre petite sœur est venue dans un gros chou, chez la fruitière du coin ! Tous les Hollandais sont braves et généreux ! Les Romains étaient bien heureux que les Bataves leur laissassent une petite place au soleil ! Le bey de Tunis avait des coliques néphrétiques dès qu’il voyait flotter le drapeau hollandais ! Le duc d’Albe était un monstre ! La marée, en 1672, je crois, dura plus longtemps que d’ordinaire, pour défendre et protéger la Hollande ! Mensonges ! La Hollande est restée la Hollande, parce que nos ancêtres faisaient bien leurs affaires, et qu’ils avaient la foi véritable. Voilà tout. Plus tard, on recommence de plus belle. Ainsi, par exemple, une fille, c’est un ange. Un ange ! L’auteur de cette trouvaille n’a jamais eu de sœurs. L’amour, c’est la béatitude ! On enlève l’objet aimé, un objet quelconque, et l’on fuit au bout du monde — mais, le monde n’a pas de bouts, et cet amour-là n’est qu’une sottise. Nul ne dira que je vis mal avec ma femme — c’est une fille de Last et Co, commissionnaires en cafés, — on n’a jamais trouvé rien à redire à notre mariage. Je suis membre souscripteur du jardin zoologique Natura Artis Magistra, (La nature est la maîtresse de l’art,) ma femme a un châle long de deux cents francs, et pourtant, il n’a jamais été question entre nous d’un amour ayant absolument besoin de se loger au bout du monde. Notre mariage accompli, nous avons fait une petite excursion à La Haye. Là, elle a acheté de la flanelle, et m’en a fait des gilets que je porte encore ; jamais l’amour ne nous a poussés plus loin. Sottises et mensonges, vous le voyez bien. Et mon mariage est-il moins heureux que celui des insensés qui se rendent phthisiques ou chauves, par amour ? Mon ménage serait-il mieux règlé, si, jadis, il y a dix-sept ans, j’avais dit en vers, à ma fiancée, que je désirais l’épouser ! Allons donc ! J’aurais pu faire tout cela aussi bien que n’importe qui ; faire des vers est un métier, certes, moins difficile que celui de tourneur en ivoire. S’il n’en était pas ainsi, comment les papillotes à devises seraient-elles si bon marché, — Frédéric écrit papillottes, avec deux t, je ne sais pas pourquoi. — D’autre part, allez demander le prix d’un jeu de billes de billard ! Je n’ai rien contre les vers, en eux-mêmes. Veut-on aligner des mots ? qu’on le fasse, mais qu’on ne dise que la vérité tout comme en prose. „ Qu’il meure ” rime avec : „ C’est une heure. ” Soit, c’est parfait : si réellement il faut qu’il meure et si c’est une heure qui sonne. Mais, s’il n’est que midi et demi, moi qui n’aligne pas mes mots, je dirai : Qu’il meure, et, Il est midi et demi. Le rimeur, lui, est obligé par le : meure du premier vers, à nous donner une heure entière, et il faut qu’une heure sonne, pour qu’il meure. Le malheureux est forcé de tricher. Il faut donc que l’heure du supplice ou l’arrêt de mort soit changé. De toutes façons, il ment. Et ce ne sont pas seulement les vers qui poussent les jeunes gens au mensonge. Entrez au théâtre, et prenez la peine d’écouter les balivernes qu’on vous débite. Le héros de la pièce tombe à l’eau, un homme sur le point de faire faillite l’en retire, le noyé donne la moitié de sa fortune à son sauveteur. C’est faux, archifaux ! Dernièrement, mon chapeau alla tomber dans le Canal des Princes, — Frédéric dit : s’en alla, — je donnai quatre sous au gamin qui me le rapporta, et il me fit toute sorte de remerciements. J’aurais certainement donné un peu plus, s’il m’avait tiré de l’eau moi-même, mais à coup sûr, je ne lui eusse pas donné la moitié de ma fortune. À ce compte-là, il ne faudrait pas tomber plus de deux fois à l’eau, pour être complètement ruiné. Le pis de ces représentations théâtrales, c’est que le public s’identifie tellement à l’action et aux personnages, qu’il les applaudit. J’aurais beaucoup donné pour jeter tout le parterre dans une mare ou dans un lac ; au moins je serais arrivé à savoir à quoi m’en tenir sur la sincérité de ses bravos ! — Frédéric dirait : bravi. Somme toute, moi, qui fais passer la vérité avant quoi que ce soit, j’avertis un chacun que je ne paierai pas une prime de sauvetage aussi exorbitante. Que celui qui ne voudra pas me repêcher à moins me laisse tranquille, ne me sauve pas. Néanmoins, les dimanches et fêtes, je donnerai plus que dans la semaine, parce que, ces jours là, je porte ma chaîne de cannetille, et mon habit, numéro un. Oui, le théâtre corrompt plus de monde que les romans. C’est tout un étalage. Oripeaux, fausses dentelles, papiers dorés, frappés à l’emporte-pièce, clinquant et verroterie, tout cela vous attire, vous enivre ! Je ne parle, bien entendu, que des enfants et des personnes qui ne sont pas dans les affaires. Ce monde de la rampe ment et vous trompe, même, quand il veut représenter la pauvreté. Une fille, dont le père s’est ruiné, travaille pour soutenir sa famille. Très bien. La voilà assise, cousant, tricotant, ou brodant. Mais comptez-moi les points qu’elle fait, pendant la durée d’un acte entier. Elle bavarde, elle soupire, elle va à la fenêtre, mais elle n’avance pas son ouvrage. Vous m’avouerez que la famille qui peut vivre de son travail n’a pas de grands besoins. Cette fille est naturellement l’héroïne de la pièce. Elle a jeté deux ou trois séducteurs en bas de son escalier. Elle s’écrie, à tous moments : „Ô ma mère ! ma mère !” Et elle représente la vertu. Qu’est-ce-qu’une vertu à laquelle il faut un an pour tricoter une paire de bas ? Tout cela ne donne-t-il pas une fausse idée de la vertu et du travail pour vivre ? Mensonges ! mensonges ! Tout-à-coup revient son premier amant, qui, jadis, était employé dans les bureaux de son père. Aujourd’hui, cet amant est millionnaire. Ils se marient. Voyons ! Est-ce possible ? Un millionnaire ne se marie pas avec la fille d’un failli. Et si, par exception, selon vous, cela peut se faire sur les planches, je n’en suis pas moins en droit de soutenir qu’on trompe le public, et qu’on lui fait prendre l’exception pour la règle ; oui, on mine sa moralité, en lui donnant l’habitude d’applaudir sur la scène, ce qui, dans la vie est réputé ridicule, stupide, fou par un tas d’honnêtes gens, commissionnaires et négociants. Quand je me mariai, moi, nous étions treize employés au bureau de mon beau-père Last et Co, et Dieu sait si nous avions à faire ! Autres mensonges scéniques : quand le héros s’en va sauver la patrie, de son pas de théâtre, pourquoi la porte du fond s’ouvre-t-elle toujours toute seule ? Puis… comment un personnage qui parle en vers, peut-il savoir juste ce que l’autre va lui répondre, et lui préparer sa rime ? Par exemple, quand le général dit à la princesse : „Madame, il est trop tard, les portes sont fermées.” Comment peut-il deviner qu’elle s’écriera : „Mes braves défenseurs, dégainez vos épées.” Écoutez ! si, en apprenant que les portes sont fermées, la princesse répondait qu’elle en attendra l’ouverture, ou qu’elle reviendra plus tard, que deviendraient la rime et la mesure. N’est-ce donc pas une bien mauvaise plaisanterie que de représenter le général regardant la princesse dans le blanc des yeux, pour savoir ce qu’elle veut faire après la fermeture des portes. D’ailleurs, garantissez moi donc que la princesse n’aura pas envie d’aller se coucher, au lieu de dégainer quoi que ce soit. Et la récompense de la vertu ! Oh ! Oh ! Oh ! Il y a dix-sept ans que je suis commissionnaire en cafés — Canal des Lauriers, no 37 — et j’ai vu bien des choses. Eh bien ! Je n’ai jamais vu personne plus maltraité sur cette terre que la vérité, la trop patiente vérité. La vertu récompensée !… Donc, de la vertu vous faites une marchandise. Dans le monde, il n’en est pas ainsi ; et laissez-moi trouver bon qu’il n’en soit pas ainsi. Le beau mérite, si la vertu était sûre de trouver sa récompense. À quoi bon cette supercherie et ce manque de vérité, aussi sots que malhonnêtes ! Tenez : il y a Lucas, notre garçon de magasin, qui travaillait déjà chez le père de Last et Co, — dans ce temps-là, la raison sociale était Last et Meyer, mais les Meyer se sont retirés, — Lucas était pourtant bien un garçon vertueux. Jamais il ne manquait un grain au magasin ; il allait à l’église, et ne buvait pas. Quand mon beau-père était à sa campagne, à Driebergen, Lucas gardait la maison, la caisse, et tout le reste. Un jour, il toucha trente-six francs de trop à la Banque, et il les rapporta. Aujourd’hui, il est vieux, goutteux, et il ne peut plus servir. Il ne gagne plus rien, car il se fait beaucoup d’affaires chez nous, et il nous faut des jeunes gens. Eh bien ! ce Lucas, je le considère comme très vertueux ; quelle est sa récompense ? Un prince vient-il lui farcir ses poches de diamants ? Une fée lui beurre-t-elle ses tartines ? Non ! Parbleu ! Il est pauvre, et il reste pauvre. Pourquoi ? Parce qu’il faut que cela soit ainsi. Je ne puis l’aider, moi, — nous avons bien assez de payer tous les jeunes employés qui s’occupent de nos nombreuses affaires, — mais si je le pouvais, si Lucas était à même, dans ses vieux jours, de mener une vie facile, où serait son mérite ? Alors tous les garçons de magasin et tous les autres hommes deviendraient des gens vertueux ! Est-ce pratique et croyez-vous que ce soit dans les intentions de Dieu ? Non, puisqu’il n’y aurait plus de récompense particulière, réservée aux honnêtes gens, après leur mort. Sur la scène on prend cela, à rebours, et l’on ment. Je suis vertueux aussi, et, du diable, si je demande une récompense pour cela ? Quand mes affaires marchent, — et elles marchent, − quand ma femme et mes enfants se portent bien, de manière que je n’aie affaire ni au médecin ni au pharmacien ; quand bon an mal an, je puis mettre quelques économies de côté, pour le jour où Frédéric viendra me remplacer, et où je me retirerai à ma campagne de Driebergen,… eh bien !… quand il en est ainsi, je suis content. C’est la conséquence naturelle des circonstances et de mon travail ; mais je n’exige rien pour ma vertu. Et je suis vertueux, quand même. La preuve en est dans mon amour pour la vérité. Après mon attachement à la foi, cet amour là est mon inclination principale. Je désirerais que vous fussiez convaincu de tout ce que j’avance, lecteur, parce que là se trouve la raison de ce livre. Une autre passion dominante, chez moi, c’est l’amour de ma profession. Comme vous le savez, lecteur, je suis commissionnaire en cafés, Canal des Lauriers, n° 37, eh bien ! c’est à mon respect inaltérable pour la vérité, et à mon zèle pour les affaires que vous devez les pages suivantes. Je vous raconterai comment cela s’est fait. Obligé de prendre congé de vous, pour le moment, — c’est l’heure de la Bourse, — je vous invite à mon second chapitre. Au revoir, donc. Voici ma carte. Mettez la dans votre poche, je vous prie. Cela ne peut pas vous gêner, et, qui sait, cela peut vous être utile. Le C° que vous y voyez, c’est moi, depuis que les Meyer ont quitté la partie. Le vieux Last, c’est mon beau-père. Laissez-moi donc terminer ce chapitre en vous recommandant notre adresse : LAST & Co. Commissionnaires en cafés, Canal des Lauriers, 37
II
La Bourse était faible. La vente du printemps améliorera, sans doute, la situation. N’allez pas penser, cependant, qu’il ne se fasse pas d’affaires chez nous. Chez Busselinck et Waterman, cela va encore plus doucement. Ah ! l’on assiste à d’étranges choses quand on fréquente la Bourse, durant une bonne vingtaine d’années. Figurez-vous que Busselinck et Waterman viennent d’essayer de m’enlever Ludwig Stern. Pensant bien que la Bourse vous est peu connue, je vous dirai que Stern est, à Hambourg, une des premières maisons de Cafés. Or, la maison Last et Co a toujours servi la maison Stern. Un hasard m’a mis sur la piste de la fourberie tentée par Busselinck et Waterman. Ils proposaient à Stern de lui rabattre un quart pour cent sur les courtages. Quels intrigants ! Voici ce que j’ai fait pour parer le coup : à ma place, un autre se fût empressé d’écrire à Ludwig Stern qu’il lui ferait un rabais égal, espérant que sa maison prendrait en considération les longs services à elle rendus par Last et Co. — Tous comptes faits, j’ai calculé, qu’en cinquante ans, notre raison sociale a gagné, avec Stern, plus de huit cent mille francs. Nos rapports datent du système continental, quand nous faisions, par Héligoland, la contrebande des denrées coloniales. Tout autre commissionnaire en eût écrit bien davantage. Intrigues et bassesses, ma foi, non. Je me suis rendu au Café de Pologne, j’ai demandé plume, encre, papier, et j’ai écrit : »Monsieur, la grande extension prise par nos affaires, dans ces derniers temps ; les ordres multiples qui nous viennent des maisons les plus honorables de l’Allemagne du Nord. …et ceci est l’exacte vérité… …nécessitent, chez nous, une augmentation de personnel.” Entre nous, notre teneur de livres s’occupait encore, passé onze heures du soir, hier, à notre bureau : il avait perdu ses lunettes, et ne pouvait mettre la main dessus.
Je continuai : »Le besoin se fait surtout sentir de jeunes gens bien élevés, et comme il faut, pour la correspondance allemande. Certes, beaucoup de jeunes allemands, résidant à Amsterdam, possèdent les capacités requises ; mais, vu la légèreté et l’immoralité croissantes de la jeunesse, vu l’accroissement incessant du nombre des chevaliers d’industrie, considérant la nécessité d’unir une bonne conduite à l’exécution ponctuelle des ordres donnés, une maison qui se respecte…” et ceci, de plus en plus vrai. »…comme celle de Last et C°, commissionnaires en cafés, Canal des Lauriers, n° 37, ne peut être assez circonspecte dans l’engagement de ses employés.” Lecteur, savez-vous bien que le jeune allemand, qui, à la Bourse, se tenait près le dix-septième pilier, s’est enfui avec la fille de Busselinck et Waterman ! Or, notre petite Marie va entrer dans sa treizième année, au mois de septembre prochain. »J’ai eu l’honneur d’apprendre du sieur Saffeler. Saffeler voyage pour Stern. »…que l’honorable chef de la raison sociale Ludwig Stern, a un fils, monsieur Ernest Stern, qui, pour achever ses études commerciales, désire être employé, durant quelque temps, dans une maison hollandaise. En vue de… Ici, je revins sur la question de mœurs, précitée, je racontai l’histoire de l’enlèvement de Mademoiselle Busselinck et Waterman, pensant qu’il n’y avait pas de mal à le faire connaître. Et je repris : »En vue de tout cela, je ne demande pas mieux que de charger Mr. Ernest Stern de la correspondance allemande de notre maison.” Par délicatesse, je laissai de côté toute question d’honoraires, ajoutant : »Si Mr. Ernest Stern veut bien demeurer chez nous, Canal des Lauriers, n° 37, ma femme le soignera comme son propre fils, et son linge sera raccommodé à la maison.” Marie ravaude et reprise à merveille. Je terminai ainsi : »Chez nous, on sert le Seigneur.” Cela ne peut manquer d’être utile au jeune Stern, sa famille étant luthérienne. Ma lettre finie, je l’ai expédiée sur le champ. Vous comprenez que le vieux Stern ne pourra passer décemment à Busselinck et Waterman, quand son fils sera employé dans nos bureaux. Maintenant, je suis curieux de voir quelle réponse on fera à ma lettre.
Revenons-en à mon livre, s’il vous plaît. Un soir, il y a quelque temps de cela, en passant dans la rue des Veaux, je m’étais arrêté devant la boutique d’un épicier qui assortissait un petit lot de Java, ordinaire, beau-jaune, qualité Chéribon, cassé, avec balayures, ce qui m’intéressait énormément, étant observateur de naissance. Voilà que la figure d’un monsieur, debout devant une librairie voisine, figure qui ne m’était pas inconnue, me donne dans l’œil. Évidemment, lui et moi, nous cherchions à nous reconnaître, nos regards ne cessant pas de s’entre-croiser. J’étais, je l’avoue, trop absorbé par mes balayures pour m’apercevoir qu’il était très pauvrement vêtu. Autrement, je ne me serais pas occupé de lui. Mais l’idée me vint que c’était peut-être le voyageur d’une maison allemande, cherchant un commissionnaire solide. Il avait en effet, tout l’air d’un allemand et d’un voyageur. Ses cheveux très blonds, ses yeux bleus, sa contenance, et sa mise dénonçaient l’étranger. Au lieu d’un pardessus, une espèce de châle pendait sur son épaule, — Frédéric dit shall, mais ce n’est pas mon avis, — comme s’il sortait d’un wagon. Croyant trouver un client, je lui tendis ma carte : Last et Co, commissionnaires en cafés, Canal des Lauriers, n° 37. Il s’approcha d’un bec de gaz, la parcourut du regard et me dit : — Je vous remercie, mais je me suis trompé… Je pensais avoir le plaisir de retrouver un ancien camarade d’école, mais… Last ? ce n’est pas son nom. — Pardon, répliquai-je, avec ma politesse ordinaire, je suis monsieur Duchaume, Batave Duchaume… Last et C°, c’est la raison sociale de ma maison de commission, Canal des Lau… — Mais, Duchaume, ne me reconnaissez-vous pas ? Regardez-moi… regardez-moi bien. Plus je le regardais, plus je me souvenais en effet de l’avoir vu ; mais, chose singulière, de sa personne il s’exhalait comme un extrait de parfumerie étrangère. Ne riez pas, lecteur, tout-à-l’heure vous comprendrez pourquoi. Mon homme n’avait pas une goutte d’odeur sur lui, j’en étais sûr, et pourtant je sentais quelque chose d’agréable, de pénétrant, quelque chose qui me rappelait… ah ! pour le coup, m’y voilà ! — Est-ce vous, m’écriai-je, qui m’avez débarrassé du Grec ? — Moi-même, dit-il. — Et comment cela va-t-il, depuis ce temps là ? Je lui racontai que nous étions treize au bureau, et qu’il s’y faisait une masse d’affaires. Puis, à mon tour, je lui demandai comment il allait, prévenance que je regrettai plus tard. Mon ancien ami ne me paraissait pas dans une situation prospère, et je n’aime pas les pauvres, pensant que, d’ordinaire quand un homme est malheureux, il l’est par sa faute. Dieu n’abandonne pas quelqu’un qui le sert fidèlement. Si je lui avais tout simplement dit : nous sommes treize au bureau, et bien le bonsoir ! j’en aurais été délivré, sur-le-champ. Mais, une fois engagé dans une série de demandes et de réponses, il me devenait de plus en plus difficile, — Frédéric dit : d’autant plus, mais ce n’est pas mon avis, — de le planter là. D’autre part, je dois avouer, que, dans ce cas, vous n’auriez pas eu ce livre sous les yeux ; mon livre étant la conséquence de cette rencontre. J’aime à faire la part des choses et des gens, et quiconque n’agit pas comme moi est un esprit mal fait que je ne puis souffrir. Oui ! Oui ! c’était bien lui qui m’avait tiré des mains de ce maudit Grec. N’allez pas penser, au moins, que j’aie jamais été pris par des pirates, ou que j’aie eu maille à partir avec les Dardanelles. Non. Je vous ai déjà dit, qu’après mon mariage, je m’étais rendu à La Haye, avec ma femme. Là, nous visitâmes le Musée du Mauritshuis, et nous achetâmes de la flanelle, rue des Tourbières. C’est la seule excursion que mon commerce m’ait permise ; il se fait tant d’affaires chez nous ! Ce fut à Amsterdam, qu’à cause de moi, il donna au Grec en question, un coup de poing sur le nez, si bien appliqué, que le sang coula abondamment. Ce diable d’homme se mêlait toujours des choses qui ne le regardaient pas. C’était en 33 ou 34, je crois, et dans le mois de septembre, car il y avait kermesse à Amsterdam. Mes parents ayant l’intention de faire de moi un pasteur, j’apprenais le latin. Plus tard, je me suis souvent demandé pourquoi il est nécessaire de savoir le latin, pour dire en hollandais : Dieu est bon ? Enfin, je suivais la classe latine du Lycée — à présent on l’appelle : Gymnase, — et il y avait kermesse à Amsterdam. On avait établi un tas de baraques, au marché de l’Ouest, et si vous êtes Amsterdammois, lecteur, si vous êtes de mon âge, vous vous rappellerez qu’un de ces établissements en plein vent se distinguait par les yeux noirs et les longues tresses d’une jeune fille, vêtue à la Grecque. Son père aussi était Grec, ou tout au moins, il avait la mine d’un Grec. Ils vendaient toute sorte de parfumeries. J’avais justement l’âge qu’il fallait pour trouver belle la susdite jeune fille, sans me trouver sur moi le courage de lui parler. D’ailleurs, cela ne m’eût servi à rien, les filles de dix-huit ans regardant un garçon de seize ans comme un enfant, ce dont je ne les blâme nullement. Pourtant, nous autres, garçons de la quatrième classe, nous venions chaque soir au marché de l’Ouest pour regarder la belle Grecque. L’individu, qui se tenait tout à l’heure devant moi, avec son châle sur l’épaule, y vint un jour avec nous, quoique moins âgé d’une couple d’années, et conséquemment trop innocent, trop naïf pour partager notre admiration. Mais il était le premier de notre classe, — très intelligent et très capable, je dois en convenir, — et il aimait beaucoup à rire, à jouer et à se battre. Voilà pourquoi il se trouvait avec nous. Nous étions donc au nombre de dix, pour le moins, à regarder cette jeune fille, d’assez loin, et nous demandant comment nous nous y prendrions pour faire sa connaissance. En fin de compte, on décida de se cotiser pour lui acheter quelque chose. Mais, à qui incomberait-il d’attacher le grelot ? Qui de nous se déciderait à lui parler ? Chacun le voulait, nul ne l’osait. On tira au sort, mon nom sortit du chapeau. J’avoue que je n’aime ni courir ni braver un danger inutile. Je suis époux et père, et je tiens pour fou quiconque cherche le péril, parfaitement d’accord, en cela, avec l’Ecriture Sainte. Il m’est vraiment agréable de remarquer combien je suis resté conséquent avec moi-même, dans mes idées sur le danger, puisqu’en ce moment mon opinion à ce sujet est exactement la même que ce soir là, où les vingt-cinq sous de notre cotisation à la main, je m’arrêtai devant la baraque du Grec. Mais voilà, que, par fausse honte, par respect humain, je n’osai pas avouer que je n’osais pas ! mes camarades étaient là. Ils me poussaient. Il me fallut bien aller de l’avant. Peu après, sans savoir comment, je me trouvai devant la baraque. Je ne voyais plus rien, pas plus la fille que le reste. Tout dansait devant moi. Je me mis à bégayer un passé indéfini de je ne sais plus quel verbe grec… — Plaît-il ? fit-elle. Je me remis tant soit peu, et je continuai avec le premier vers de l’Iliade : — Meenin aeide thea… (Chante, déesse, la colère) et… que l’Egypte était un don du Nil… Je suis convaincu, que, j’aurais fini par entrer en conversation avec elle, si, à ce moment, un de mes camarades, plus espiègle que les autres, ne m’avait donné, dans le dos, un coup si violent que j’allai m’aplatir sur la devanture de l’étalage. Cette devanture, à mi-hauteur d’homme, servait de fermeture à la baraque. Je sentis un poignet de fer me saisir au collet… un autre poignet m’empoigna beaucoup plus bas… je me balançai dans l’air, un instant, et avant de bien me rendre compte de ce qui se passait, je me trouvai dans la baraque du Grec. Alors, une voix qui s’exprimait en français, de la façon la plus intelligible, s’écria : « Ah ! gamin ! attends ! Je vais appeler la police ! » En ce moment-là, je me trouvais bien près de la belle fille, mais cela ne me faisait pas le moindre plaisir. Plein de trouble et de frayeur, je pleurais et je demandais pardon ; mais, inutilement. Le Grec me tenait par le bras et me flanquait des coups de pied. Je cherchais mes camarades… je les appelais !… le matin même nous nous étions beaucoup occupés d’un Scévola qui avait mis la main dans un brasier, et dans nos thèmes latins, nous avions trouve cet acte héroïque et sublime !… Ah ! Oui ! Pas un d’entre eux n’était resté près du feu… Pas un ne se fût brûlé, pour moi, le bout du petit doigt ! Je le croyais… Mais, pas du tout, voilà que tout-à-coup, mon Homme-au-châle entre dans la baraque par une porte de derrière. Il n’était ni grand, ni fort… Il avait à peine treize ans ; mais c’était un petit gaillard, vif et courageux. Je vois encore étinceler ses yeux, calmes, d’ordinaire, il allongea un maître coup de poing au Grec, et je fus sauvé. Plus tard, j’appris que le Grec l’avait rossé d’importance : mais, comme j’ai pour principe invariable de ne jamais me mêler des choses qui ne me regardent pas, je me sauvai à toutes jambes. Moi, je ne l’ai donc pas vu. Voilà pourquoi sa physionomie me fit humer les parfums d’Orient les plus exquis, et voilà comment il est prouvé qu’à Amsterdam il est possible de se prendre de querelle avec un Grec. Aux kermesses suivantes, quand ce descendant de Léonidas venait s’installer, lui et sa baraque, au marché de l’Ouest, j’allais toujours m’amuser ailleurs.
Faisant de la philosophie à mes heures, il faut, lecteur, qu’en passant, je vous dise comment les choses de ce monde se coordonnent miraculeusement. Si les yeux de cette fille avaient été moins noirs, si elle avait eu des tresses plus courtes, si mes camarades ne m’avaient pas jeté sur la devanture du Grec, vous ne liriez pas ce livre. Donc, remerciez la Providence de ce que tout se soit passé ainsi. Croyez-moi, tout est bien établi, ici-bas, et les gens qui se plaignent ne sont pas de mes amis. Par exemple, Busselinck et Waterman… Mais, il me faut continuer, sans digressions : mon livre devant être achevé avant la vente du printemps. À vous dire franchement, — je suis bien obligé d’en convenir, moi, l’ami de la vérité, — la rencontre de mon ancien condisciple ne m’était rien moins qu’agréable. Je vis tout de suite que ce n’était pas une relation solide. Il était très pâle, et lorsque je lui demandai l’heure, il ne put me répondre. Ce sont là des symptômes auxquels un homme qui a fréquenté la Bourse une vingtaine d’années, ne se trompe pas. En ai-je vu tomber, de ces maisons ! Croyant qu’il prendrait à droite, j’allais prendre à gauche. Mais, il me suivit, et la conversation s’engagea, bien contre mon gré. Je ne pouvais m’ôter de la cervelle qu’il n’avait pas de montre ; et je m’aperçus en outre que sa petite redingote était boutonnée jusqu’au menton ; — mauvais signe ! — de sorte que, tant que je le pus, je laissai tomber notre entretien. Il me raconta qu’il était allé aux Indes, qu’il s’était marié, qu’il avait des enfants. Je n’avais rien à redire à tout cela, mais je n’y trouvais rien d’intéressant. Arrivé devant la petite rue de la Chapelle, qu’en temps ordinaire je ne prends jamais, — cette ruelle étant indigne d’un homme comme il faut — je m’arrêtai, faisant mine de la prendre. Je la dépassai même, pour lui faire bien comprendre qu’il n’avait plus qu’à marcher droit devant lui, et je lui dis le plus poliment possible :… il faut être poli avec tout le monde, ne sachant pas si plus tard, on ne doit pas se retrouver : — Enchanté de vous avoir rencontré, monsieur… mais… mais… je vous demande pardon. Il faut que j’entre là !… Alors il me regarda d’une singulière façon, et saisissant un bouton de ma redingote, il me répondit : — Mon cher Duchaume, j’ai quelque chose à vous demander. Je frissonnai. Il n’avait pas de montre et il allait me demander quelque chose ! Naturellement, je répliquai que je n’avais pas le temps, que je devais aller à la Bourse, quoiqu’il fît nuit. Mais quand on a fréquenté la Bourse une bonne vingtaine d’années, et qu’une ancienne connaissance vous demande quelque chose, sans savoir l’heure !… Je rattrapai mon bouton ; je saluai toujours poliment, et je pris la petite rue de la Chapelle, ce que je ne fais jamais, parce que ce n’est pas comme il faut, et qu’avant tout, je tiens à être comme il faut. J’espère bien, du reste, que personne ne m’aura vu la traverser.
III
Le lendemain, au retour de la Bourse, Frédéric m’annonça que quelqu’un était venu pour me parler. Sur le portrait qu’il m’en fit, je reconnus l’Homme-au-châle. Comment m’avait-il déniché ? Ma carte ! Pardieu ! Ma carte ! Il me prit l’envie de retirer mes enfants du Lycée, trouvant très ennuyeux d’être persécuté, vingt ou trente ans après, par un camarade d’école qui porte un châle au lieu d’un pardessus, et qui ne sait vous dire l’heure qu’il est. Aussi, ai-je défendu expressément à Frédéric d’aller au marché de l’Ouest, quand il y a des baraques. Le jour suivant, je reçus une lettre, avec un gros paquet. Voici la lettre : » Cher Duchaume, Je trouve qu’il aurait bien pu écrire : » Cher Monsieur Duchaume, — En fin de compte, je suis commissionnaire… » Hier, je suis passé chez vous dans l’intention de vous adresser une demande. Je crois que vous vous trouvez dans une bonne position… C’est vrai, nous sommes treize, au bureau. » … et je désirerais profiter de votre crédit, pour venir à bout d’une affaire, qui est pour moi d’une grande importance. Ne croirait-on pas qu’il s’agit d’une commande pour la vente du printemps ? » À la suite de diverses circonstances, je me trouve, pour le moment, tant soit peu à court d’argent. Tant soit peu ! Pas de linge ? Il appelle ça : tant soit peu ! » Je ne puis donner à ma chère femme tous les agréments de la vie ; de plus, l’éducation de mes enfants n’est pas telle que je la voudrais, vu l’état de mes finances. — Agréments de la vie ? Éducation des enfants ? ah ! ça ! veut-il louer une loge à l’Opéra pour sa femme ? Compte-t-il mettre ses enfants dans un collège, à Genève ? On était alors en automne… il faisait un froid de loup, et il logeait dans un grenier sans feu. J’ignorais cela, lors de la réception de sa lettre, mais plus tard j’allai chez lui, et aujourd’hui encore, je suis vexé du ton cavalier de son épître. Que diantre ! Que le pauvre dise qu’il est pauvre ! Il faut qu’il y en ait, des pauvres ! C’est nécessaire, dans la société. Pourvu qu’ils ne demandent pas l’aumône et qu’ils n’ennuient personne, je ne m’oppose pas à ce qu’il y en ait. Mais, se faire une réclame parce qu’on est dans la misère !… c’est de l’outrecuidance. Voyons la suite de la lettre : » Puisque le devoir m’incombe de subvenir aux besoins de tous les miens, j’ai résolu de mettre à profit un talent que la nature m’a accordé. Je suis poète… Pouah ! Vous savez, lecteur, ce que moi et tous les gens raisonnables pensent de ça ! » … et écrivain. Depuis mon enfance j’exprimais en vers tout ce que j’éprouvais. Plus tard, j’écrivais jour par jour, tout ce que j’avais vécu. Dans tout cela, il y a des articles de valeur. Je cherche un éditeur. Mais, là est la difficulté. Le public ne me connaît pas ; et les libraires me disent : faites-vous connaître d’abord, nous vous publierons ensuite. Nous en faisons autant, dans les cafés. Les marques ! Les marques avant tout. » Pourtant, si mon travail vaut quelque chose comment puis-je le prouver, sans un libraire qui le publie… Or, les libraires demandent, à l’avance, le paiement des frais d’impression. Et, je trouve qu’ils ont bien raison ! » Il ne me convient pas de les leur avancer, en ce moment. Toutefois, convaincu que mon œuvre couvrira ses frais, ce que je suis prêt à signer, sur ma parole d’honnête homme, je me décide à profiter de notre rencontre. Vous m’avez encouragé… Il appelle cela encourager ! …à m’adresser à vous. Je viens donc vous demander si vous voulez garantir, à un libraire, les frais de ma première édition, ne fût-ce que pour un petit volume. Pour cette première épreuve, je vous laisse entièrement le choix. Vous trouverez, dans le paquet, ci-joint, beaucoup de manuscrits qui vous prouveront que j’ai pensé, travaillé et souffert. J’ai vu bien des choses… — Travaillé ! Et il n’a jamais été dans les affaires ! » …et si le don de raconter et de bien dire ne me fait pas complètement défaut, ce n’est certes pas, faute d’impressions que j’échouerai. » Dans l’attente d’une réponse amicale, je suis votre ancien camarade d’école… ” Et son nom se trouvait au bas de ce fatras, en toutes lettres. Je le passe, ne voulant humilier personne. Vous devinez, cher lecteur, la figure que je fis, en voyant qu’on me proposait de m’élever à la dignité de commissionnaire en vers ! Je suis certain que si l’Homme-au-châle, — ce sera le seul nom que je lui donnerai, — m’avait rencontré en plein soleil, il ne m’aurait pas adressé une pareille demande. J’ai l’air d’un homme grave, et d’un homme comme il faut. Mais, il faisait nuit ; je n’ai donc pas le droit de m’en formaliser. Il va sans dire que j’avais l’intention bien arrêtée de ne pas mettre le nez dans ses élucubrations. Je lui aurais bien fait remettre son paquet par Frédéric, mais j’ignorais son adresse, et il ne me donna plus signe de vie. Je pensai qu’il était malade ou mort. La semaine passée, il y avait réunion chez les Rosemeyer qui travaillent dans les sucres. Frédéric nous accompagnait pour la première fois. Il a seize ans, et je trouve bon qu’un jeune homme aille dans le monde. Autrement il court au marché de l’Ouest ou dans tout autre mauvais lieu. Les jeunes filles pianotaient et chantaient ; puis, laissant le piano, elles se mirent à table ; au dessert, on vint à parler de choses et d’autres, et l’on taquina Frédéric sur quelque chose qui lui était arrivé au salon, tandis que dans une pièce éloignée, nous faisions une partie de whist à la mode de Gand. — Oui ! oui ! s’écriait Elisabeth Rosemeyer, Louise a pleuré ! Papa, Frédéric a fait pleurer Louise ! Ma femme fut d’avis que puisqu’il en était ainsi, Frédéric ne nous accompagnerait plus à la réunion. Elle supposait qu’il avait pincé Louise, ou commis quelque inconvenance du même genre. Je me préparais à y joindre de mon côté un petit mot bien senti, quand Louise s’écria : — Non ! non ! Frédéric a été bien aimable ! Je voudrais qu’il recommençât. Quoi donc ? Il ne l’avait pas pincée, alors. Non, il avait tout simplement récité quelque chose. Une plaisanterie, au dessert, convient à la maîtresse de la maison. Cela remplace un mets. Madame Rosemeyer — les Rosemeyer se donnent de la Madame, parce qu’ils font dans les sucres, et sont associés dans le fret d’un navire — madame Rosemeyer devina que ce qui avait fait pleurer Louise pourrait bien nous amuser aussi, et elle dit : da capo à Frédéric, qui devint rouge comme un dindon. Pour rien au monde je n’aurais pu m’imaginer ce qu’il venait de débiter, connaissant son répertoire, à un cheveu près ; c’était : les Noces des Dieux, les Livres de l’Ancien Testament, en vers, et un épisode des Noces de Gamache, que les enfants trouvent amusant, parce qu’il y a l’histoire d’un diseur de bonne aventure. Dans tout cela, qu’est-ce qui avait donc pu causer l’attendrissement de Louise ? — Énigme ! Il est vrai qu’une jeune fille a vite la larme à l’œil. „ Frédéric ! Frédéric ! Frédéric ! ” On cria ce nom sur l’air des Lampions, jusqu’à ce que celui qui le portait se fut rendu au vœu général. Frédéric commença. Ne tenant pas à fatiguer la curiosité du lecteur, je dirai tout de suite, qu’à la maison, les enfants avaient ouvert le paquet de l’Homme-au-châle ! Oui… et Frédéric et Marie y puisèrent une présomption et un sentimentalisme qui, plus tard, m’ont occasionné bien des ennuis de ménage. Pourtant, lecteur, il me faut reconnaître que ce livre sort aussi du paquet en question. Je vous l’expliquerai tout-à-l’heure, en règle, désirant qu’on me tienne pour un véritable ami de la vérité et pour un honnête commerçant. Notre raison sociale est : Last et Co commissionnaires en cafés, Canal des Lauriers, n° 37. Frédéric se mit alors à réciter une chose pleine de non sens, ou plutôt vide de bon sens. Un jeune homme écrivait à sa mère qu’il était tombé amoureux fou d’une jeune fille, et que sa fiancée s’était mariée à un autre, — en quoi, elle avait grandement raison, selon moi ; — malgré cela ce jeune homme aimait beaucoup sa mère. Voilà une aventure bien claire, et trouvez-vous qu’il faille beaucoup de phrases pour la raconter ? Eh bien ! J’ai mangé un petit pain avec du fromage, j’ai pelé deux poires, et j’aurais eu le temps de consommer la seconde, avant la fin du récit de Frédéric. Mais Louise pleurait, de nouveau, et toutes les dames déclaraient que c’était bien beau. Mon Frédéric, pensant, je crois, avoir fait quelque chose d’héroïque, déclara qu’il avait trouvé cette rapsodie dans le paquet de l’Homme-au-châle. J’expliquai à la partie masculine de l’assemblée comment cela se trouvait chez moi. Mais, je me gardai de parler de la Grecque et de la ruelle de la Chapelle, à cause de Frédéric. Tout le monde m’approuva, et l’on dit que j’avais bien fait de me débarrasser de cet individu. Vous verrez tout-à-l’heure que dans cette liasse de papiers, il y avait des œuvres plus solides de fond ; le présent ouvrage en contient quelques échantillons. Somme toute, les Ventes de cafés de la Société-de-Commerce, s’y rattachent. Et si je m’en occupe, c’est qu’elles touchent à la profession pour laquelle je vis. Plus tard, l’éditeur me demanda si je ne voulais pas ajouter ici le récit de Frédéric. J’y consentis pourvu qu’on sût que je ne m’occupais pas de ces vétilles-là. Vanités et mensonges ! Je mets un terme à ces réflexions pour ne pas trop grossir mon livre. Tout ce que je veux en dire, c’est que ce conte a été rédigé en 1843, aux environs de Padang, marchandise d’une marque inférieure. Bien entendu, c’est du café que je parle. Récit fait par Frédéric.
Mère! quoique éloigné du pays, Où je reçus le jour, Où perlèrent mes premières larmes, Où je grandis sous tes yeux… Où ta sollicitude maternelle voua Ses soins à l’âme de ton enfant, Et tout amour veilla à mes côtés, Me tendant la main après chaque chute… Bien que le sort semblât déchirer Les liens qui nous attachaient l’un à l’autre… Et que je sois seul sur la rive étrangère, Avec moi-même, et Dieu… Ni la peine, ni la joie, Ni la douleur n’en doute pas, N’ont ébranlé le cœur de ton adoré, Et son amour, pour toi, ma mère ! Deux années se sont à peine écoulées, Lorsque, là-bas, pour la dernière fois, Silencieux, aux bords de la mer, Je regardai, en face, l’horizon… Lorsque j’invoquai à travers l’espace Le bel avenir auquel je m’attendais, Et, dédaignant audacieusement le présent, Je me créai des paradis… Lorsque le cœur m’éclairant Au milieu des entraves de la route, Je me traçai vaillamment une issue, Et, en rêve, me crus bienheureux… Mais, depuis l’adieu suprême, Le temps, quoique passé comme une ombre, Soudaine et insaisissable, Comme un spectre,… A laissé de son passage, Des traces ineffaçables ! Ma coupe joyeuse fut vidée jusqu’à la lie, J’ai pensé, et j’ai lutté, J’ai acclamé mon bonheur, et j’ai imploré Dieu… C’est comme si j’avais traversé des siècles ! J’ai cherché le salut de la vie, J’ai trouvé, et j’ai perdu ; Et enfant, un moment auparavant encore, Dans une heure j’ai vécu des existences ! Pourtant mère ! crois-moi, Devant Dieu ! … je te le jure Mère ! crois le ! Non, ton fils ne t’oubliait pas ! J’aimais une jeune fille. Ma vie entière Me semblait embellie par cet amour, Qui était le bouquet de mon cœur, Martyr de l’humanité Par l’accomplissement du devoir… Heureux de ce trésor Que Dieu m’avait réservé, Que je devais à sa grâce Mes larmes en témoignaient, Amour et religion ne faisaient qu’un pour moi… Et mon esprit en extase Montait en grâces, et en prières, Pour elle seule, comme encens, au Très-Haut ! Cet amour a été mon souci, L’inquiétude a tourmenté ma vie, Et une douleur aiguë A percé mon tendre cœur. Je n’ai recueilli que de l’angoisse et de l’affliction, Là où je m’attendais à l’extrême jouissance, Et au lieu du bonheur auquel je tendais Ma vie a été empoisonnée, et abreuvée d’amertume… Souffrir en silence m’était une volupté ! Inébranlable, je restais plein d’espérance, L’adversité me la rendait plus chère : Pour elle il m’était doux de tout endurer, de tout supporter ! Je ne comptais ni malheurs, ni calamités, Le chagrin m’était joie, Je voulais subir tout, tout,… Pourvu que le sort ne me privât pas de celle que j’aimais ! Cette image pour moi la plus belle sur la terre, Que je portais en mon cœur Comme un trésor inestimable, Et que je gardais fidèlement… M’était jadis étrangère ! Et quand même cet amour durerait Au-delà de mon dernier soupir, Qui, dans une meilleure patrie, Enfin, me la rendra… Il eut, pour moi, un commencement ! Qu’est-ce-que l’amour, Qu’un beau jour commence, Auprès de l’amour inspiré Par Dieu à l’enfant, Avec la vie, avant la parole ? Lorsqu’à peine sorti du sein, À la mamelle de sa mère Il se désaltère, Et cherche la lumière dans le regard maternel ? Non ! il n’est pas de lien, Qui serre indissolublement les cœurs. Comme le nœud, formé par Dieu, Entre la mère et l’enfant ! Et mon âme qui s’attachait ainsi À la beauté passagère, Qui ne me fit sentir que des épines, Sans me tresser une fleur… Est-ce que cette âme oublierait L’amour dévoué d’une mère, Et le cœur d’or de femme Dont les caresses étouffaient Mes premiers cris ? Dont la voix apaisait mon agitation, Dont les baisers séchaient mes larmes, Et qui me nourrissait de son sang ? Mère. Ne le crois pas ! Devant le ciel, je te le jure, Mère ! tu ne dois pas le croire ! Non ! ton enfant ne t’oubliait pas. Ici je suis loin de tout ce qui pourra Nous rendre la vie douce et calme, là-bas, Et les souvenirs d’enfance, Souvent invoqués et célébrés, Ne se trouvent pas, pour moi, sous ce ciel : Un cœur solitaire ne connaît pas de joie. Le sentier de ma vie est rapide, et couvert de ronces, Je me courbe sous l’adversité, Et le fardeau dont je suis chargé, M’étreint et me déchire le cœur… Ils en sont témoins les pleurs Que je verse, au sein de la nature, Dans les heures de lassitude Où ma tête tombe de tristesse… Alors, épuisé, cette plainte s’est presque Fait entendre au milieu de mes souffrances : » Père ! donne-moi parmi les morts, » Ce que la vie ne m’a pas donné, » Père ! donne-moi là-haut, » Entre les bras de la mort, » Père ! donne-moi là-haut, » Ce que je n’ai pas goûté ici-bas… le repos ! » Mais, restant… sur mes lèvres, Cette prière n’arrivait pas au Seigneur, Je me mis à deux genoux, Et je sentis m’échapper un soupir, Qui signifiait : » pas encore, ô Seigneur ! Rends-moi ma mère, d’abord ! »
IV
Avant de continuer, je dois vous dire que le jeune Stern est arrivé. C’est un gentil garçon. Il semble vif et capable, mais je crois qu’il est un peu dans les nuages. Marie a treize ans. Son trousseau est bien en ordre. Je l’ai mis au copie de lettres pour s’exercer au style hollandais. Je suis curieux de savoir si nous aurons bientôt des commandes de Ludwig Stern. Marie lui brodera une paire de pantoufles… au jeune Stern, bien entendu. Busselinck & Waterman en sont pour leurs frais. Un commissionnaire comme il faut n’intrigue pas, c’est moi qui le dis. Le lendemain de la réunion chez les Rosemeyer, qui font dans les sucres, j’appelai Frédéric et lui ordonnai de m’apporter ce paquet de l’Homme-au-Châle. Il faut que vous sachiez, lecteur, que dans ma famille je suis très strict sur la religion et la moralité. Eh bien, la veille, exactement au moment où je venais de peler ma première poire, je lisais sur la figure de l’une des jeunes filles, que dans ces vers il se trouvait quelque chose qui n’était pas de bon aloi. Moi-même je n’avais pas prêté l’oreille à tout ça, mais j’avais vu qu’Elisabeth avait émietté son petit pain, et cela me suffisait. Vous vous apercevrez, lecteur, que vous avez affaire à quelqu’un qui connaît son monde. Je me fis donc remettre par Frédéric cette fameuse pièce de la veille, et je trouvai bientôt le vers qui avait fait émietter le petit pain d’Elizabeth. On y parle d’un enfant à la mamelle, — ça peut encore passer, — mais « à peine sorti du sein » voyez-vous, c’était là une expression que je ne trouvais pas convenable — d’employer, bien entendu — et ma femme non plus. Marie a treize ans. On ne parle pas chez nous de « chou » ou de choses semblables ; mais appeler ainsi les affaires par leur nom, cela ne se doit pas non plus, parce que je tiens essentiellement à la moralité. Je fis promettre à Frédéric, maintenant qu’il savait la pièce « extérieurement » comme dit Stern, de ne plus la réciter jamais — au moins pas avant d’être membre du club Doctrina, où ne viennent pas de jeunes filles — et j’enfermai les vers dans mon pupitre. Mais il me fallait savoir s’il ne se trouvait pas dans ce paquet autre chose pouvant causer du scandale. Je me mis donc à chercher et à feuilleter. Je ne pouvais pas tout lire, car j’y trouvais des fragments en langues qui m’étaient inconnues, et voilà que mes yeux s’arrêtèrent sur un chapitre intitulé : Rapport sur la culture du café dans la résidence de Menado. Je sautai de joie, car je suis commissionnaire en cafés, — Canal des Lauriers, n° 37 — et Menado est une bonne marque. Ainsi cet Homme-au-Châle, qui faisait des vers si immoraux, avait travaillé dans le café aussi. Maintenant, je regardai le paquet d’un tout autre œil, et j’y trouvai des pièces qui, bien que je ne les comprisse pas toutes, dénotaient réellement une connaissance des affaires. Il y avait des inventaires, des déclarations, des calculs en chiffres, sans ombre de rime, et le tout était exécuté avec tant de soin et d’exactitude, que, franchement, — car j’aime la vérité, — l’idée me vint que cet Homme-au-Châle, si le troisième commis était un jour congédié — ce qui peut arriver puisqu’il devient vieux et infirme — pourrait très-bien le remplacer. Il va sans dire que je prendrais d’avance des informations sur son honnêteté, sa religion et son comme-il-faut, car je n’admets personne dans mon bureau, avant d’être bien renseigné là-dessus. C’est mon principe invariable. Vous l’avez vu dans ma lettre à Ludwig Stern. Ne voulant pas montrer à Frédéric que j’en venais à m’intéresser au contenu de ce paquet, je le renvoyai. Ça commençait à m’égarer en effet de prendre en mains toutes ces pièces l’une après l’autre, et d’en lire les titres. Il est vrai qu’il y avait beaucoup de vers, mais j’y trouvais aussi beaucoup de choses utiles, et j’étais frappé de la variété des sujets traités. J’avoue, — car j’aime la vérité, — que moi, qui ai toujours fait les cafés, je ne suis pas à même de juger de la valeur de tout, mais, même sans toucher à la critique la seule liste des titres était déjà curieuse. Puisque je vous ai raconté l’histoire du Grec, vous savez que j’ai été un peu latinisé dans ma jeunesse, et quoique je m’abstienne de toute citation dans la correspondance, — ce qui ne serait pas de mise au bureau d’un commissionnaire, — je pensais pourtant en voyant tout cela : un peu de tout, et rien à fond : de omnibus aliquid, de toto nihil ; Ou, la quantité, et non pas la qualité, multa, non multum. Mais, je pensais de la sorte plutôt par malice, que par conviction, et par le désir de répondre en latin à ce paquet plein de pédantisme et d’érudition, qui se trouvait là, planté devant moi. En m’arrêtant un peu plus longtemps sur une pièce quelconque il me fallait bien reconnaître que l’auteur paraissait être parfaitement à la hauteur de sa tâche, et montrait même une grande solidité dans ses raisonnements. J’y trouvai en fait d’articles et d’études :
Le Sanscrit, mère des langues germaniques. La pénalité en cas d’infanticide. Origine de la noblesse. La différence entre les idées : Temps infini et Éternité. Sur le calcul des probabilités. Le livre de Job. (Il y avait encore quelque chose sur Job ; mais c’était des vers.) Proteïne dans l’atmosphère. Politique de la Russie. Les voyelles. Les prisons cellulaires. Les anciennes thèses sur l’horreur du vide : horror vacui. Abolition désirable des peines contre la calomnie. Les causes de l’insurrection des Hollandais contre l’Espagne ne se trouvant pas dans l’aspiration à la liberté religieuse ou politique. Le mouvement perpétuel, perpetuum mobile, la quadrature du cercle, et la racine des nombres sans racine. Pesanteur de la lumière. Décroissance de la civilisation depuis la naissance du Christianisme (Hé ! Hé ! ?) Mythologie de l’Islande. Sur l’Émile de Rousseau. La procédure civile en affaires de commerce. Sirius, centre planétaire. Les droits d’importation considérés comme impratiques, impudiques, injustes et immoraux. (Jamais ça ne m’était venu à l’oreille.) Les vers comme langue primitive. (Je n’en crois mot.) Les termites ou fourmis blanches. Les établissements scolaires comme contraires à la nature. La prostitution dans le mariage. (C’est une pièce infâme.) Questions hydrauliques par rapport à la culture du riz. Apparence de suprématie de la civilisation occidentale. Le cadastre, l’enregistrement, et le timbre. Les livres pour enfants, les fables, et les contes. (Je veux bien lire ça parce qu’il insiste sur la vérité.) Les intermédiaires commerciaux. (Ça ne me va pas du tout. Je crois qu’il veut abolir les commissionnaires. Je l’ai mis pourtant de côté, parce qu’il s’y trouve des choses dont je puis faire usage pour mon livre.) Droits de succession, un des meilleurs impôts. La pudeur comme invention. (Ça je ne comprends pas.) Sur la multiplication. (Ce titre semble tout simple, mais, il se trouve beaucoup, dans cette pièce, à quoi je n’avais pas songé auparavant.) D’un certain esprit des Français, comme conséquence de la pauvreté de leur langue. (Cela je l’accepte. Esprit et pauvreté… il doit s’y connaître.) Rapport entre les romans d’Auguste Lafontaine et la phthisie. (Je lirai ça pour sûr parce qu’il y a dans le grenier des livres de ce Lafontaine. Cependant l’Homme-au-Châle prétend que cette influence ne se manifeste qu’à la deuxième génération. Or, mon grand-père ne lisait pas.) Puissance des Anglais en dehors de l’Europe. Jugement de Dieu au moyen-âge et à présent. L’arithmétique chez les Romains. Sur le manque de poésie chez les accordeurs de piano. Le piétisme, la biologie et les tables tournantes. Les maladies contagieuses. L’architecture mauresque. Influence des préjugés, visible dans les maladies dites occasionnées par les courants d’air. (N’ai-je pas dit que la liste était curieuse ?) L’Unité Allemande. Les longitudes en mer. (Je pense qu’en mer tout est aussi long que sur terre.) Devoirs d’un gouvernement relativement aux amusements publics. Sur la conformité entre les langues Écossaise et Frisonne. La prosodie. Sur la beauté des Nimoises et des Arlésiennes, avec une étude sur le système de colonisation des Phéniciens. Les contrats agricoles à Java. Sur la force aspirante d’un nouveau modèle de pompe. Légitimité des dynasties. Sur la littérature populaire dans les rapsodies javanaises. Nouvelle méthode de prendre les ris. La percussion appliquée aux grenades à la main. (Cette pièce date de 1847, ainsi avant Orsini.) Sur l’idée de l’honneur. Les livres Apocryphes. Sur les lois de Solon, de Lycurgue, de Zoroastre, et de Confucius. L’autorité paternelle. Shakespeare comme historien. L’Esclavage en Europe. (Je ne comprends pas ce qu’il veut dire avec cela.) Moulins hydrauliques à vis. Sur le droit souverain de faire grâce. Éléments chimiques de la canelle de Ceylan. Sur la discipline dans les navires de commerce. Amodiation de l’opium à Java. Règlements relatifs à la vente des poisons. La canalisation de l’Isthme de Suez, et ses conséquences. Payement des fermages en nature. Culture du café a Menado. (J’ai déjà nommé cette pièce.) Sur le partage de l’Empire Romain. La sentimentalité des Allemands. L’Edda Scandinave. Devoir de la France de donner un contre-poids à l’Angleterre dans l’Archipel des Indes. (Écrit en français, je ne sais pas pourquoi ?) Fabrication du vinaigre. Sur la vénération pour Schiller et Goethe dans la bourgeoisie allemande. Droits de l’homme au bonheur. Droit d’insurrection en cas d’oppression. (Écrit en javanais. Ce n’est que plus tard que j’ai su ce titre-là.) Responsabilité ministérielle. Quelques points de procédure criminelle. Sur le droit d’une nation d’exiger que les impôts soient employés à son profit. (Ceci était de nouveau en javanais.) Sur l’A double, et l’ETA Grec. Sur l’existence d’un Dieu impersonnel dans le cœur des humains. Sur le style. Constitution pour l’Empire d’Insulinde. (Je n’ai jamais entendu parler de cet Empire-là.) Sur le manque d’éphelcustie dans nos grammaires. La pédanterie. (Je crois que cette pièce est écrite en parfaite connaissance de cause.) Obligation de l’Europe envers les Portugais. Les voix des forêts. Combustibilité de l’eau. (Sans doute il veut parler de l’eau forte.) La mer lactée. (Je n’en ai jamais rien entendu de cette mer. Cela semble quelque chose aux alentours de Banda.) Devins et prophètes. L’électricité comme force motrice, sans fil de laiton. Flux et reflux de la civilisation. Sur la contagion épidémique de l’État. Sur les Sociétés de commerce privilégiées. (Là dedans se trouvent, par-ci par-là, des choses dont j’ai besoin pour mon livre.) L’étymologie comme ressource dans les études ethnologiques. Les rochers à nids d’oiseau au Sud de Java. Point où commence le jour. (Ça je ne comprends pas ?) Les opinions personnelles comme mesure de responsabilité dans le monde moral. La galanterie. Versification des Hébreux. Le siècle des inventions : Century of inventions du marquis de Worcester. La population non consommante dans l’île Rotti près Timor. (Comme on y doit vivre à bon marché, là.) L’anthropophagie des Battas, et la chasse aux têtes chez les Alfourous. Méfiance dans la moralité publique. (Il veut, je crois, abolir les serruriers. Moi, je suis contre ça.) Le droit, et les droits. Béranger comme philosophe. (Encore incompréhensible pour moi.) Antipathie des Malais contre le Javanais. Sur la non-valeur de l’enseignement dans les soi-disant Universités. L’esprit peu charitable de nos ancêtres visible dans leurs conceptions de Dieu. (Pièce impie !) La cohérence des sens. (C’est vrai, dès que j’aperçus l’Homme-au-Châle, je flairai l’essence de roses.) La racine pointue du cafier. (Ceci je l’ai mis de côté pour mon livre.) Sentiment, sensibilité, sensiblerie, sentimentalité, et cetera. De confondre la Mythologie et la Religion. Le sagouier aux Moluques. Sur l’avenir du commerce de la Hollande. (Ceci est proprement la pièce qui m’a décidé à écrire mon livre. Il dit qu’il n’y aura pas toujours de si grandes ventes de cafés, et je vis pour mon métier.) La Genèse. (Pièce infâme !) Les Sociétés secrètes chez les Chinois. Le dessin, comme écriture naturelle. La vérité en poésie. (Oui-dà !) Impopularité des moulins à décortiquer le riz, à Java. Rapport entre la poésie et les mathématiques. Les spectacles chinois. Prix des cafés de Java. (Ceci je l’ai mis de côté.) Sur un système monétaire européen. Irrigation des terrains communaux. Influence du croisement des races sur l’esprit.