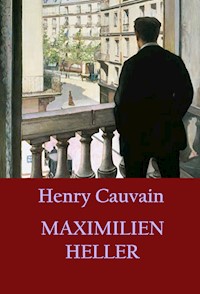Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ginkgo éditeur
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Un homme, de grande et fine stature, solitaire et misanthrope, vivant quasiment reclus en compagnie d’un chat, doté d’une prodigieuse capacité d’observation et de déduction logique, adepte d’opium et de chimie et s’il le faut de déguisements, accompagné d’un médecin auquel il vient de se lier et qui est le narrateur de toute l’histoire, se lance dans une enquête pour prouver l’innocence d’un homme accusé injustement de meurtre.
Il ne s’agit pas de Sherlock Holmes mais de Maximilien Heller, héros de ce roman écrit plus de quinze ans avant la première enquête du célèbre détective anglais. Publié en 1870 par un jeune auteur de vingt-trois ans, Maximilien Heller est une formidable aventure policière dans le sillage d’Edgar Allan Poe et d’Émile Gaboriau et un joyau à redécouvrir du patrimoine littéraire français.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les Retrouvés
— Collection dirigée par Xavier Mottez —
Henry Cauvain
1847 — 1899
MAXIMILIEN HELLER
1870
GINKGOéditeur
© Ginkgo Éditeur, 2021
Couverture : Karl BRIOULLOV, Portrait de N. Koukolnik (1836)
PREMIÈRE PARTIE
I
Ce fut le 3 janvier 1845, à huit heures du soir, que je fis la connaissance de M. Maximilien Heller.
Quelques jours auparavant, j’avais été abordé dans la rue par un de mes amis, Jules H..., qui, les premiers compliments échangés, m’avait dit avec une insistance toute particulière :
— Voici déjà quelque temps que je voulais aller chez vous, mon cher docteur, pour vous prier de me rendre un grand service. Un de mes anciens confrères du barreau, M. Heller, qui demeure ici près, est dans l’état de santé le plus alarmant. Nous avions d’abord cru, ses amis et moi, que son mal était plus moral que physique. Nous avons essayé tous les moyens de distraction possibles, nous nous sommes efforcés de ranimer son courage, nous avons tâché de donner quelques aliments à son intelligence, que nous avons connue autrefois si belle et si lumineuse. Je dois convenir que tous nos efforts ont échoué. Il ne nous reste plus qu’à implorer le secours de la science. Ce que notre amitié n’a pu faire, votre autorité de docteur le fera peut-être. Maximilien a une nature énergique, et il ne cédera guère, je crois, qu’à une raison supérieure. Allez donc chez lui un de ces soirs, mon cher ami, et voyez ce que vous pouvez pour ce pauvre garçon. Je vous serai tout particulièrement reconnaissant du bien que vous lui ferez.
La semaine suivante, pour condescendre au désir que m’avait exprimé mon ami, et bien que cette visite me répugnât un peu, — car j’avais entendu parler de M. Maximilien Heller comme d’un excentrique désagréable et fort maussade, — je me rendis chez mon nouveau malade.
Il demeurait dans une des rues tortueuses de la butte Saint-Roch.
La maison qu’il habitait était très étroite, — elle n’avait que deux fenêtres de façade ; — mais, en revanche, sa hauteur était exagérée.
Elle se composait de cinq étages et de deux mansardes superposées.
Au rez-de-chaussée était une boutique de fruitier peinte en vert qui s’ouvrait sur la rue.
Une porte basse, treillagée en sa partie supérieure, donnait accès dans l’intérieur de la maison.
Après avoir traversé un long couloir sombre dont le parquet cédait sous le pas, on arrivait brusquement à deux marches vermoulues, qu’on apercevait à peine dans l’obscurité et contre lesquelles on trébuchait inévitablement.
Le bruit de cette chute avertissait le portier qu’un visiteur se présentait dans son immeuble.
C’était un moyen fort ingénieux, assurément, d’économiser les frais d’une sonnette.
J’étais encore tout saisi de l’émotion désagréable qui suit un faux pas imprévu fait dans l’obscurité, lorsque j’entendis une voix aigre comme celle d’une sorcière sortir d’une sorte de niche pratiquée sous l’escalier.
— Que voulez-vous ? chez qui allez-vous ? me cria l’invisible cerbère.
— M. Maximilien Heller est-il chez lui ? répondis-je en tournant la tête du côté d’où la voix était partie.
— Au sixième, la porte à droite ! répondit laconiquement ce portier fantastique.
Je me mis en devoir de commencer l’ascension.
Soit par ignorance, soit pour simplifier sa besogne, l’architecte n’avait pas donné aux escaliers la forme tournante qu’ils ont d’ordinaire.
Ils se composaient d’une série d’échelles droites, aboutissant à des paliers étroits sur lesquels s’ouvraient les portes noircies des chambres.
J’arrivai enfin au sixième étage.
Une lueur que j’aperçus au fond d’un étroit corridor me servit de guide.
Cette lueur était celle d’une petite lampe fumeuse suspendue à un clou près de la première porte à droite.
— Ce doit être là ! pensai-je.
Je frappai doucement.
— Entrez, me répondit une voix faible.
Je poussai la porte, qui n’était fermée qu’avec un loquet, et j’entrai dans la chambre de M. Maximilien Heller.
Cette chambre présentait un singulier spectacle.
Les murs étaient dénudés, et couverts, seulement par places, de lambeaux d’un papier vulgaire.
À gauche, un rideau en perse, d’un rose fané, pendait à une tringle et cachait sans doute un lit placé dans le renfoncement du mur.
Un feu de mottes brûlait dans la petite cheminée.
Sur une table située à peu près au milieu de cette modeste cellule, des papiers et des livres étaient amoncelés dans le plus beau désordre.
Maximilien Heller était étendu dans un grand fauteuil, près de la cheminée.
Sa tête était renversée en arrière, ses pieds reposaient sur les chenets. Une longue houppelande enveloppait son corps, maigre comme un squelette.
Devant lui, dans les cendres, chantait une petite bouillotte de fer-blanc qui dialoguait avec un grillon caché dans l’âtre.
Maximilien buvait énormément de café.
Un gros chat, les griffes rentrées sous sa poitrine fourrée, les yeux demi-clos, faisait entendre son ronron monotone.
Lorsque j’entrai, le chat se leva en faisant le gros dos ; son maître ne bougea pas. Il resta immobile, les yeux toujours fixés au plafond, ses mains blanches et effilées posées sur les bras du fauteuil.
Je fus surpris de cet accueil, j’hésitai un instant, puis enfin je m’approchai de ce singulier personnage et lui dis l’objet de ma visite.
— Ah ! c’est vous, docteur ? fit-il en tournant légèrement la tête de mon côté ; on m’a en effet parlé de vous. Prenez donc la peine de vous asseoir. Au fait, ai-je une chaise à vous offrir ? Ah ! oui, tenez, je crois qu’il m’en reste encore une dans ce coin-ci.
Je pris la chaise qu’il m’indiquait du doigt et vins m’asseoir à côté de lui.
— Ce brave Jules ! continua-t-il, il m’a trouvé bien malade, la dernière fois qu’il est venu me voir, et m’a promis de m’envoyer la Faculté... C’est vous, la Faculté ?
Je m’inclinai en souriant.
— Oui, je souffre beaucoup... J’ai depuis quelque temps des éblouissements, et ne puis soutenir l’éclat de la lumière... J’ai toujours froid.
Il pencha son long corps vers la cheminée et attisa le feu avec les pincettes. La flamme qui jaillit éclaira d’une lueur rouge la figure de cet homme étrange.
Il paraissait avoir trente ans au plus ; mais ses yeux entourés d’un cercle noir, ses lèvres pâles, ses cheveux grisonnants, le tremblement de ses membres, en faisaient presque un vieillard.
Il se rejeta lourdement dans son fauteuil et me tendit la main.
— J’ai la fièvre, n’est-ce pas ? dit-il.
Sa main était brûlante, son pouls rapide et saccadé.
Je lui fis toutes les questions d’usage ; il me répondait d’une voix faible et sans tourner la tête.
Lorsque j’eus fini mon examen :
— Voilà un homme perdu ! pensai-je.
— Je suis bien malade, n’est-ce pas ? Combien croyez-vous qu’il me reste encore à vivre ? dit-il en me regardant fixement.
Je ne répondis pas à cette question singulière.
— Souffrez-vous depuis longtemps ? demandai-je.
— Oh ! oui !... fit-il avec un accent qui me glaça... oh ! oui !... c’est là, ajouta-t-il en touchant son front.
— Voulez-vous que je vous fasse une ordonnance ?
— Volontiers, répondit-il d’un air distrait.
Je m’approchai de la table, qui était, comme je l’ai dit, surchargée de livres et de manuscrits, et, à la lueur vacillante d’une bougie, j’écrivis rapidement l’ordonnance.
Quelle ne fut pas ma surprise, quand j’eus fini, de voir debout, à côté de moi, mon malade qui regardait avec son sourire étrange les quelques lignes que j’avais tracées.
Il prit le papier, le considéra quelque temps, et haussant les épaules :
— Des remèdes ! fit-il, toujours des remèdes ! Croyez-vous réellement, monsieur, que cela puisse me guérir ?
Il fixa sur moi, en disant ces paroles, son grand œil mélancolique, et, froissant le papier entre ses doigts, il le jeta dans les flammes.
Puis il s’appuya contre la cheminée, et me prenant la main :
— Pardonnez-moi, me dit-il d’une voix qui devint douce tout à coup, pardonnez-moi ce mouvement de vivacité ; mais, bon Dieu ! vous avez eu là une singulière idée ! Vous êtes jeune, continua-t-il avec son éternel sourire, et vous croyez votre médecine toute-puissante.
— Ma foi ! monsieur, répliquai-je d’un ton un peu sec, je crois que le mieux serait de vous soumettre à un traitement et à un régime en rapport avec votre état...
— Mon état mental, voulez-vous dire ? Vous me croyez fou, n’est-ce pas ?... Eh bien, vous avez raison. Chez moi, le cerveau domine tout et prend toute la place ; c’est une ébullition perpétuelle. Ce feu qui me dévore ne me laisse pas un instant de repos... La pensée !... la pensée !... ah ! monsieur, c’est un vautour qui me ronge sans cesse !
— Pourquoi ne cherchez-vous pas à vous affranchir de ce joug cruel ? Pourquoi ne donnez-vous pas quelque repos et quelque distraction à votre esprit ?
— Des remèdes, des distractions !... interrompit-il avec vivacité ; vous êtes tous les mêmes ! On achète les uns chez les pharmaciens, les autres à la porte des théâtres, n’est-ce pas ? et on doit être guéri... Si on n’est pas guéri, on doit mourir... Et la Faculté n’a rien à se reprocher...
II
— Vous n’avez donc ni parents ni amis ?... Il m’interrompit encore.
— Des parents ? non !... mon père est mort fort jeune, peu de temps après ma naissance. Ma pauvre mère... (il me sembla que sa voix s’altérait au moment où il prononçait ce mot)... ma pauvre mère, pendant vingt ans de sa vie, travailla pour m’élever, pour me donner une instruction brillante, libérale ; elle mourut à la peine ! Voyez l’ironie du sort ! Huit jours après sa mort, j’héritais d’un vieil oncle dont on soupçonnait à peine l’existence et qui me laissait une petite fortune. Des amis ? Oui, j’en ai quelques-uns. Jules d’abord, un bon garçon, mais il rit trop, et son rire me rend malade ; puis tous ceux que vous connaissez et qui ont eu la charité de me recommander à vos bons soins. Ils me croient fou, eux aussi, et quand je suis au milieu d’eux, ils me prennent pour le plastron de leurs plaisanteries. Je suis leur amusement, leur bouffon, avec mes grands yeux, mes longs cheveux, mon grand nez et mes airs mélancoliques !... Voilà mes amis ! Vous voyez ces livres, qui sont là, sur ma table, ces liasses de manuscrits ? Ils vous indiquent que j’ai cherché dans le travail l’oubli de moi-même. J’ai été reçu avocat, j’ai même plaidé... Mais je me suis bientôt aperçu que tous mes efforts et tout mon travail avaient pour résultat d’enrichir quelques gredins et d’en arracher d’autres à l’échafaud qu’ils méritaient : j’ai eu honte de ce métier !... J’ai écrit, j’ai beaucoup écrit, afin de soulager ma pauvre tête et d’éteindre ce feu qui me brûle. Le remède n’a pas été efficace... Que voulez-vous ? Je suis philosophe, et je dois mourir philosophe.
Il fit une longue pause.
— Ne croyez pas cependant, reprit-il enfin ; que j’aie de la haine pour l’humanité... Mon Dieu non ! Mais je trouve les hommes inutiles. Je me passe de leur esprit, de leurs travaux, de leur génie... Oui, ces quelques tisons que vous voyez là, dans l’âtre, le murmure de ma bouillotte et le ronron de mon chat m’ont inspiré des vers mille fois plus beaux que ceux de vos grands poètes, des pensées mille fois plus ingénieuses que celles de vos moralistes, des réflexions plus profondes et plus élevées à la fois que celles des plus illustres prédicateurs. Pourquoi donc alors lirais-je les œuvres des hommes ? Pourquoi écouterais-je leurs discours, qui ne vaudront jamais ceux que j’entends en moi ?... Aussi, depuis longtemps, toute ma vie se passe dans cette chambre, dans ce fauteuil... et je pense, je pense toujours. C’est un travail incessant. J’ai là, continua-t-il en posant un doigt sur son front, j’ai là des traités d’économie politique qui pourraient régénérer votre société ruinée et abâtardie... J’ai des systèmes de philosophie qui réunissent en un seul tableau toutes les connaissances humaines et les étendent en les affranchissant des entraves où les retient la routine de vos professeurs ! J’ai des plans de maisons plus confortables que celles que vous habitez ; des projets d’agriculture qui pourraient transformer la France en un immense jardin dont chaque habitant aurait sa part productive ; j’ai des codes où l’équité et le bon droit ont toute la place qui leur manque dans les vôtres. Mais à quoi bon livrer tout cela au grand jour ? Les hommes en deviendront meilleurs ? Que m’importe ! En serais-je soulagé ? Non. Voyez ces mille manuscrits qui remplissent ma mansarde ; ils sont sortis de là... et je souffre toujours autant.
Il se rejeta dans son fauteuil et continua avec feu :
— Voulez-vous savoir encore pourquoi cette flamme intérieure est si ardente, si dévorante ? C’est que je n’ai jamais pleuré ! Non, jamais, jamais une larme n’est venue mouiller ma paupière ! Voyez comme le tour de mes yeux est noir : cela vient de là, j’en suis sûr. Voyez-vous ces rides de mon front, cette pâleur de mes lèvres ?... C’est que jamais cette rosée bienfaisante des larmes n’a baigné ma douleur et rafraîchi ma souffrance ; tout se passe en moi, rien ne sort de moi.
Ici sa voix s’altéra :
— Les autres hommes, lorsqu’ils souffrent, vont se jeter sur le sein d’un ami et s’en reviennent consolés... Moi, je ne puis. Je suis, comme je vous le disais tout à l’heure, le Prométhée de ce vautour infernal : la pensée, incessante, dominatrice et cruelle ! Ma douleur est comme un fer aigu, qui, lorsque j’essaie de le lancer loin de moi, revient contre ma poitrine avec plus de violence, et me mord au cœur !... Tenez, je ne sais pourquoi, vous m’inspirez de la confiance et je vais tout vous dire. Aussi bien, je n’ai peut-être pas longtemps à vivre, et je ne veux pas que mes secrets meurent avec moi. Tout ce que je vais vous conter est contenu là...
Il me désigna une liasse de papiers poudreux jetés dans un coin de la chambre.
— Mais qu’est-ce que cela vous fait, après tout ?...
— Non, non, continuez, dis-je vivement ; si vous saviez combien vous m’intéressez !
J’étais en réalité très ému.
— Où en étais-je donc ? Mon Dieu ! qu’il fait chaud ici ! Ma tête est comme serrée dans un étau... Je crois vraiment que la glace me ferait du bien... Veuillez entr’ouvrir un peu cette fenêtre.
Je me levai pour satisfaire son désir. Lorsque je revins près de lui, ses yeux étaient fermés, sa respiration était sifflante, une légère sueur perlait sur ses tempes : il s’était endormi…
Je considérai longtemps le pauvre dormeur, dont ce violent effort avait brisé les forces, et qui restait devant moi, pâle, immobile, inanimé.
Le feu jetait ses dernières lueurs et éclairait le visage de Maximilien Heller, qui était d’une beauté singulière, presque fantastique.
C’était un singulier et triste spectacle que celui de ce philosophe qui, avant trente ans, s’était retiré des hommes, parce qu’il trouvait les hommes « inutiles », de ce rêveur que le rêve avait tué, de ce penseur que l’excès de la pensée faisait mourir de lassitude.
Les quelques paroles que je venais d’échanger avec Maximilien Heller m’avaient inspiré je ne sais quelle mystérieuse sympathie pour ce malheureux jeune homme. Tout en le contemplant avec attention, je me demandais si véritablement ces cordes invisibles qui rattachent l’homme à son semblable étaient à jamais brisées en lui, et je cherchais, pensif, par quels moyens je pourrais arriver à guérir cette douloureuse maladie morale qui consumait son âme et son corps.
III
J’allais me retirer en me promettant bien de revenir sous peu de jours faire une seconde visite à cet intéressant malade, lorsque j’entendis un pas lourd qui gravissait lentement l’escalier : je prêtai l’oreille. Les pas approchaient. Était-ce une illusion ? Il me sembla même entendre un bruit de sanglots.
Enfin un coup sec ébranla la porte, et une voix rude cria :
— Ouvrez, au nom de la loi !
Le chat fit un soubresaut de colère. Maximilien ouvrit péniblement les yeux. Son premier regard tomba sur moi :
— Ah ! bon !... Je me rappelle... fit-il d’une voix éteinte. Mais pourquoi m’avez-vous réveillé, monsieur, en frappant si...
Un second coup résonna contre les ais vermoulus.
— Qu’est-ce que cela signifie ? dit Maximilien en fronçant les sourcils. Veuillez ouvrir, docteur...
J’ouvris la porte.
Un gros monsieur ceint d’une écharpe tricolore apparut sur le seuil. Quelques personnages de sombre mine se montraient dans le fond.
— Excusez-moi, monsieur, fit le nouveau venu en s’inclinant devant moi à plusieurs reprises... Ma visite est un peu tardive... Mais vous savez : le devoir... impossible de remettre la chose à demain. Vous êtes bien M. Maximilien Heller ?
Maximilien s’était levé et regardait avec son œil calme l’homme à l’écharpe.
— Non, monsieur ! répondit-il en avançant d’un pas. Maximilien Heller, c’est moi.
— Ah ! mille pardons, monsieur, je ne vous apercevais pas. C’est qu’il fait un peu sombre chez vous, jeune homme. Je dois commencer par vous rassurer et vous dire que la vue de mon écharpe ne doit vous inspirer aucune crainte.
— Monsieur, dit le philosophe d’un ton rude, je suis fort souffrant. Je vous prie donc de m’exposer brièvement le motif de votre visite, et de me laisser ensuite le repos qui m’est nécessaire.
L’écharpe tricolore dont la rotondité de l’inconnu était ornée indiquait suffisamment sa qualité. C’était un respectable commissaire de police dans l’exercice de ses fonctions.
Je craignis un instant que la brusquerie de Maximilien ne lui attirât quelque verte réponse de la part de ce magistrat.
Mais, heureusement, le commissaire paraissait posséder ces qualités de douceur, de patience et de politesse que donne la longue habitude des hommes. Accoutumé, par l’exercice de sa profession, à se heurter aux caractères les plus abrupts, les plus indisciplinés, le magistrat finit par acquérir sur lui-même un surprenant pouvoir. Son cœur doit être insensible et mort à tous sentiments humains qui pourraient détruire cette invariable sérénité d’âme que la justice, comme la religion, exige de ceux qui veulent la servir.
— Ayez l’obligeance de me suivre, monsieur, répondit courtoisement le commissaire. Nous vous retiendrons le moins longtemps qu’il nous sera possible ; mais votre témoignage nous est nécessaire.
Maximilien se leva péniblement de son siège. Il était si faible que je demandai au magistrat la permission d’accompagner le malade pour lui prêter le secours de mon bras.
M. Bienassis — ainsi s’appelait le digne représentant de l’autorité — y consentit sans peine.
Nous traversâmes le long et sombre corridor, et arrivâmes à une porte qu’on distinguait à peine dans l’obscurité.
Un agent prit la petite lampe et l’approcha de la serrure qu’un ouvrier, amené par le commissaire, fit sauter en un tour de main.
Une bouffée d’air glacé vint frapper nos visages.
— Hum ! grommela un agent derrière moi, il aurait bien dû fermer sa fenêtre avant de partir !
— Gustave ! fit M. Bienassis en se tournant vers un des hommes qui le suivaient, allez nous allumer une bougie, et fermez cette lucarne.
L’agent fit ce qui lui était ordonné. Nous entrâmes dans une mansarde plus petite encore que celle occupée par Maximilien. Pour tout mobilier, une table, deux chaises et un lit, sur lequel gisait une mauvaise paillasse.
Dans un coin de la chambre, on distinguait une caisse noire fermée par un cadenas.
Le commissaire s’assit près de la table, étala devant lui plusieurs papiers contenus dans un grand portefeuille ; et, après avoir invité Maximilien à prendre place sur une chaise, à côté de lui, il fit un signe du doigt à un agent qui s’approcha aussitôt de la porte, et dit à voix haute :
— Faites entrer le prévenu.
Je me tenais debout derrière M. Heller.
Un bruit de pas retentit dans le corridor ; un instant après, on vit apparaître à la porte de la mansarde un homme livide, aux cheveux ébouriffés, aux yeux hagards, marchant avec peine entre deux agents qui le soutenaient sous le bras.
— Approchez !... dit M. Bienassis qui contemplait attentivement le nouveau venu par-dessus ses lunettes d’or.
L’homme, assisté de ses deux acolytes, fit quelques pas dans la chambre.
— Vous vous nommez Jean-Louis Guérin ? demanda M. Bienassis.
Le malheureux regarda le commissaire d’un œil hébété et ne répondit pas.
— Vous étiez, depuis huit jours, au service de M. Bréhat-Lenoir ?
Pas de réponse. Le commissaire poursuivit avec calme :
— Savez-vous de quel crime vous êtes accusé ? On vous soupçonne d’avoir empoisonné votre maître. Qu’avez-vous à répondre ?
Un tremblement convulsif s’empara du prévenu. Il ouvrit deux ou trois fois la bouche pour parler, mais la terreur l’étreignait à la gorge, et il ne fit entendre que des sons inintelligibles.
— Voyons, Guérin, reprit le commissaire en détachant un moment ses regards du visage du prévenu pour les reporter sur les papiers placés devant lui, qu’il feignit de classer, nous ne sommes ni des juges ni des bourreaux, et nous ne voulons vous faire aucun mal : parlez sans crainte ; dites ce que vous voudrez, mais parlez. Il peut se faire que vous soyez innocent, bien que les charges qui pèsent sur vous soient graves et sérieuses. Je vous ferai remarquer que votre silence, votre trouble peuvent être mal interprétés et servir de preuves contre vous. Avouez-vous avoir acheté de l’arsenic avant-hier chez l’herboriste Legras ?
Le prévenu fit un violent effort pour se dégager des mains de ceux qui le serraient ; mais ce fut en vain : il vit que ses tentatives seraient inutiles, que la fuite était impossible. Alors des larmes jaillirent de ses yeux, et d’une voix entrecoupée par les sanglots :
— Laissez-moi ! s’écria-t-il, laissez-moi !... Je suis innocent ! oh ! messieurs, je suis un honnête homme, je vous le jure ! J’arrive de mon pays, et vous pouvez le demander là-bas... je suis un honnête homme !... J’ai une pauvre vieille mère... j’étais venu à Paris pour gagner un peu d’argent, car elle est infirme et ne peut pas travailler... Moi ! un assassin !... Oh ! mon Dieu !... mon Dieu !...
Il joignit ses mains chargées de menottes et fit un effort pour les lever vers le ciel... puis soudain les forces parurent l’abandonner. Il poussa un profond soupir ; si les agents ne l’avaient soutenu, il serait tombé, la face contre terre, sur le carreau de la mansarde.
— Portez-le sur ce lit, fit M. Bienassis en désignant le grabat placé dans un coin de la petite pièce.
Maximilien posa sa longue main amaigrie sur l’épaule du commissaire et lui dit avec un sourire plein d’amertume :
— Vous dites, monsieur, que cet homme est un assassin ?
M. Bienassis se retourna, un peu surpris, puis secouant la tête :
— Il y a contre lui des charges accablantes, fit-il d’une voix si basse que seuls nous pûmes l’entendre. Il n’a pourtant pas l’air d’un criminel. Je dois m’y connaître, monsieur, et je vous dis : De deux choses l’une, ou bien cet homme est parfaitement innocent, ou bien c’est un affreux scélérat et un grand comédien...
M. Bienassis fit encore un signe à l’un de ses agents afin de lui recommander d’avoir l’œil sur le prévenu dont l’évanouissement pouvait bien être simulé. Se tournant ensuite vers le serrurier, qui, debout près de lui, attendait ses ordres :
— Ouvrez-moi cette malle, dit-il, et dépêchons-nous.
Le serrurier brisa, à coups de marteau, le cadenas qui fermait la caisse noire. M. Bienassis s’approcha alors, sa bougie à la main, et souleva le couvercle.
La malle était remplie d’habits grossiers et de linge de paysan ; mais les habits étaient soigneusement brossés ; le linge, d’une blancheur éblouissante, exhalait le parfum champêtre de la lavande. Tous ces pauvres objets étaient rangés avec un soin qui témoignait que la main d’une femme, d’une mère attentive et prévoyante, avait présidé à ces humbles apprêts.
Le malheureux Guérin était revenu de son évanouissement : on l’avait assis sur une chaise. Les yeux pleins de larmes, il suivait les mouvements des agents qui bouleversaient rapidement tout ce bel ordre, dépliaient les hardes du pauvre garçon, les secouaient, fouillaient les poches et palpaient les doublures.
— Tiens ! un nœud de rubans ! fit tout à coup l’un des agents en tirant d’un coin de la malle un bouquet fané entouré de faveurs roses.
Il le jeta, en riant, à un de ses camarades.
— Prends-le, Gustave, dit-il, tu le donneras à ta prétendue.
M. Bienassis lança un regard de colère à son agent. En entendant cette plaisanterie un peu cruelle, le prévenu s’était soulevé sur son siège et avait serré violemment l’une contre l’autre ses deux mains liées.
Maximilien Heller s’était levé, lui aussi, et considérait cette scène d’un air sombre.
— Monsieur le commissaire, dit le prévenu d’un air suppliant, voulez-vous me laisser ce nœud de rubans ?
— Montrez-moi cela, dit M. Bienassis.
Il examina quelque temps le bouquet avec attention, le palpa, parut hésiter une seconde, puis enfin ordonna qu’on le remît au prévenu.
Cependant les agents continuaient leur perquisition sous l’œil attentif du commissaire ; mais ils avaient beau tourner et retourner les vêtements, enfoncer leurs doigts dans tous les coins de la caisse, ils ne paraissaient pas trouver ce qu’ils cherchaient.
— Laissez cette caisse, dit enfin M. Bienassis, lorsqu’il vit le résultat infructueux des recherches... Visitez un peu cette paillasse... c’est peut-être là que nous trouverons l’argent.
La paillasse fut retournée, défoncée, mais en vain.
Le commissaire ne se découragea pourtant pas ; il fit inspecter par ses agents, avec un soin extrême, les carreaux qui pavaient la chambre ; il fit briser le bois des chaises, qui aurait pu être creusé de façon à recéler de l’or ; la table fut démontée, les murs sondés à coups de marteau ; on fouilla les cendres de la cheminée.
Enfin, après s’être livrés pendant près d’une heure à ce minutieux travail, les agents s’arrêtèrent, fatigués, et s’entre-regardèrent aussi penauds que des chasseurs qui ont battu la campagne toute la journée sans découvrir la moindre trace de gibier.
— C’est inconcevable ! c’est inouï en vérité ! murmurait M. Bienassis en tenant sa tête à deux mains. Qu’est-ce que cet argent a pu devenir ? Cet homme n’avait pas de connaissances à Paris, pas de complices, c’est évident... Le crime est commis hier, nous l’arrêtons il y a une heure, et il est impossible de mettre la main sur la somme volée !
Le philosophe ne paraissait prêter aucune attention au monologue du commissaire de police ; son regard s’était fixé sur Guérin, dont il considérait avec intérêt la physionomie bouleversée.
Après quelques minutes de réflexion, M. Bienassis parut se décider à tenter un nouvel effort auprès du prévenu.
— Le résultat de nos recherches paraît vous être favorable, lui dit-il ; ne croyez pas cependant que la justice renonce à poursuivre ses investigations. Une somme considérable a été dérobée dans la nuit du meurtre ; il faut qu’elle se retrouve ; elle se retrouvera. Les plus graves soupçons pèsent sur vous ; tout vous désigne comme l’assassin de M. Bréhat-Lenoir : les preuves sont palpables, évidentes. Il ne vous reste qu’un moyen de vous sauver : la franchise. Avouez votre crime, révélez l’endroit où vous avez caché l’argent volé, dites le nom de vos complices ; la justice vous tiendra compte de votre sincérité et vous pourrez échapper à la peine capitale qui vous menace. Le prévenu murmura d’une voix brisée :
— Je suis innocent !
— Réfléchissez ; demain, peut-être, il sera trop tard ; la justice aura découvert ce que vous lui cachez ; il ne vous restera plus d’aveux à faire.
— Je suis innocent !
— C’est bon ; dès ce moment, je ne vous adresse plus la parole : le juge d’instruction saura ce qu’il devra faire.
M. Bienassis se tourna alors vers Maximilien Heller.
— Je vous demande pardon, monsieur, dit-il, de vous avoir fait assister à cette scène... ; mais votre témoignage peut nous être précieux, et je vous prie de me dire tout ce que vous savez sur le prévenu. Il a passé huit jours dans cette chambre voisine de la vôtre avant de trouver une place. N’avez-vous jamais aperçu quelque chose de suspect dans sa conduite ?
— Ah ! c’est pour cela que vous m’avez fait venir ?
— Sans doute ; on ne demeure pas quelque temps à côté d’un homme sans remarquer ses habitudes, ses fréquentations. A-t-il reçu quelqu’un pendant le court séjour qu’il a fait ici ?... N’avez-vous jamais entendu un bruit de voix ?... Sortait-il souvent pendant le jour ou dans la soirée ?
Le philosophe se leva sans répondre et s’approcha de Guérin, qu’il considéra quelque temps de son œil calme et profond.
— Vous deviez vous marier, n’est-ce pas ? lui dit-il, à votre retour au pays ?
— Oui, monsieur, répondit le prévenu en roulant de gros yeux effarés.
— Eh bien ! vous pouvez commander vos habits de noce ; et vous, continua-t-il de sa voix brève en s’adressant aux agents de police qui le contemplaient bouche béante, veillez bien sur cet homme, car avant deux mois d’ici il sera libre !
Et, se drapant dans sa longue houppelande brune, Maximilien Heller sortit de la chambre avec l’air hautain de don Quichotte défiant les moulins à vent.
Je me tournai alors vers le commissaire, qui murmurait en rassemblant rapidement ses papiers :
— C’est étrange ! tout cela est véritablement bien étrange...
— Veuillez excuser mon ami, monsieur, dis-je un peu embarrassé ; il est souffrant, et vous comprenez...
— Votre ami, monsieur, s’expliquera, j’espère, devant le juge d’instruction, répliqua le commissaire de police d’un ton de léger dépit ; pour moi, ma mission est terminée et je vais remettre mon rapport.
En achevant ces mots, il sortit accompagné de son escouade d’agents qui entouraient le prévenu. Le bruit de leurs pas s’éteignit peu à peu dans l’escalier, et tout rentra dans le silence.
IV
Je me hâtai de rejoindre Maximilien Heller.
Je le trouvai assis dans son fauteuil, en train de tisonner, avec les pincettes, le feu qui se mourait.
— Eh bien, lui dis-je, que pensez-vous de tout ceci ?
Il haussa les épaules.
— Lesurques et Calas vont avoir un compagnon dans le martyrologe de la justice humaine, répondit-il tranquillement.
— Vous croyez que cet homme est innocent ?
— Oui, je le crois... mais, après tout, qu’importe ? Il se renversa dans son fauteuil et ferma les yeux.
Malgré cette indifférence apparente, il était facile de voir qu’il ressentait une singulière émotion. Ses mains, agitées par un tremblement continuel, glissaient et remontaient fiévreusement le long des bras du fauteuil.
Évidemment sa pensée travaillait avec activité ; son imagination ardente était encore pleine du triste spectacle qu’il venait d’avoir sous les yeux.