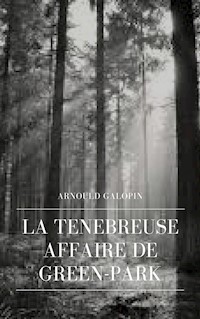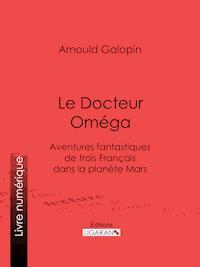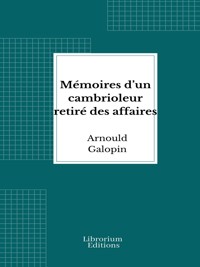
0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Französisch
Croyez-vous au Merveilleux ?
On a déjà tant dit, écrit, argumenté sur la question qu’il semble que le sujet soit épuisé.
Et pourtant, non !… Épuiser un sujet c’est le connaître à fond, et qui peut se flatter d’avoir approfondi l’Inconnu ?
Pour moi, je crois au Merveilleux. Qu’on l’appelle comme on voudra, il n’y a point d’effet sans cause… Or, j’ai vu l’effet, qu’importe si la cause doit être provisoirement classée sous ce vocable imprécis.
Je demande donc à ceux qui sont de mon avis de me suivre, non pas dans le dédale obscur de raisonnements abstraits, mais tout simplement dans les galeries du musée du Louvre. D’ailleurs, je n’y force personne.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mémoires d’un cambrioleur retiré des affaires
Arnould Galopin
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782385743192
PREMIÈRE PARTIE
Ioù le lecteur peut être assuré que ce qu’il va lire n’a pas été imaginé à plaisir
Croyez-vous au Merveilleux ?
On a déjà tant dit, écrit, argumenté sur la question qu’il semble que le sujet soit épuisé.
Et pourtant, non !… Épuiser un sujet c’est le connaître à fond, et qui peut se flatter d’avoir approfondi l’Inconnu ?
Pour moi, je crois au Merveilleux. Qu’on l’appelle comme on voudra, il n’y a point d’effet sans cause… Or, j’ai vu l’effet, qu’importe si la cause doit être provisoirement classée sous ce vocable imprécis.
Je demande donc à ceux qui sont de mon avis de me suivre, non pas dans le dédale obscur de raisonnements abstraits, mais tout simplement dans les galeries du musée du Louvre.
D’ailleurs, je n’y force personne.
. . . . . . . . . . . . . . .
Donc, nous voici dans la longue enfilade des salles. Je tiens à vous prévenir qu’il y fait aussi noir que dans la cervelle du plus fumeux des philosophes.
Jusque-là, rien d’étrange. C’est la nuit, voilà tout. Les échos soulevés par les pas sur le parquet se prolongent à l’infini.
Pour m’en tenir à ma comparaison avec ce qui touche au domaine de la pensée, je dirai que ces échos ressemblent au « martèlement » d’une idée obsédante, comme on en a dans les états de demi-rêve.
Les hautes fenêtres reçoivent, de l’extérieur, la lumière blafarde et fausse des candélabres électriques.
Çà et là, percent des lueurs… Ce sont, aperçues dans un rayon oblique, les dorures du lambris.
Le jour, c’est à peine si on les remarque — tant est grande leur profusion — mais la nuit, ces rares éclats incertains ont quelque chose d’inquiétant, comme des yeux qui veillent dans l’ombre.
Ailleurs, c’est le mystère, le silence, rien !
La nuit où je notai ces impressions était celle de Noël.
Les cloches de Saint-Germain-l’Auxerrois annonçaient la messe de minuit et leur son pénétrait, assourdi, dans les galeries sombres, aussi atone que la clarté lointaine des réverbères.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deux gardiens poursuivant leur ronde nocturne venaient de s’engager dans la salle des Antiquités Égyptiennes. L’un portait une lanterne sourde. Précisons ! Il importe de ne rien laisser dans le vague, que ce qui demeure inexplicable.
Le premier s’appelait Bartissol et était du Midi… Il seyait au second, qui était Bas-Breton, de se nommer Logarec.
— Entends, dit Bartissol. Voilà la messe qui sonne… Y en a qui vont réveillonner et bambocher toute la nuit… Qu’est-ce que ça te dit à toi, vieux ?
— À moi ?… rien, fit Logarec rêveur.
— Eh bien, à moi, ça me dit qu’on n’est pas de ceux-là, de ceux qui font la fête !…
— Ah bien sûr !
— Tiens ! voilà notre réveillon à nous.
Et le Méridional, d’un geste rageur, déposa lourdement sa lanterne sur le sarcophage de la reine Tia.
Ils s’arrêtèrent et s’adossèrent à la clôture placée devant les collections.
Le Breton renversa son bicorne sur sa nuque, croisa les bras et se mit à suivre, en face de lui, les jeux de la lumière bleuâtre sur les glaces de la fenêtre.
Là-bas, loin, sur la place, à l’origine de cette lumière, il suffit du passage d’une phalène, d’un insecte gros comme un rien, pour qu’ici, sur les vitres, ce soit une fantasmagorie énorme, aux larges ailes de vampire.
On supposera peut-être que je prépare mon atmosphère ? Non pas !… Que les sceptiques tentent l’expérience ! Je crois plutôt, en certaines circonstances, à la collaboration secrète de phénomènes bizarres mus par un agent insaisissable, et provoquant l’événement qu’aucune des lois établies ne saurait expliquer.
C’est précisément en cela que consiste le Merveilleux.
Je ne dis rien d’autre que ce qui fut un gardien du Louvre, qui se trouvait être Breton, regardait se jouer la lumière électrique sur les glaces d’une fenêtre de la salle des sarcophages.
Et ce gardien disait :
— Sais-tu, Bartissol, à quoi je songe ?… aux nuits de Noël de chez nous. Elles étaient bleues comme celle-ci, à cause du clair de lune sur la neige, mais il y avait plus de neige dans ce temps-là qu’aujourd’hui… ou bien c’est le pays qui n’est pas le même… On allait en bande à la messe de minuit, et puis on revenait gelé, transi et bien content de trouver une bonne bûche qui pétillait dans l’âtre. Alors… on réveillonnait avec des crêpes, du boudin, et les anciens racontaient des histoires.
— Ah oui ! fit Bartissol, les vieux en ont toujours de bonnes.
— La plupart du temps, reprit le Breton, c’étaient des contes qui font peur… Nous… les gosses, on dormait à moitié, mais on se réveillait toujours dès qu’on parlait du Korrigan.
— Hé ! railla Bartissol, qu’est-ce que c’est que ça, le Korrigan ?
— C’est comme qui dirait une sorte de loup-garou…
— En as-tu vu ?
— Moi… non, mais il y a des gens qui en ont vu.
— Et à quoi cela ressemble-t-il ?… à une bête ?
— Non… Ce serait plutôt un homme… certains croient que c’est un damné… un mort qui revient, comprends-tu ?
— Eh bien ! vous êtes gais là-bas, en Bretagne… Chez nous, à Pézenas, on réveillonne aussi, mais on chante et on boit, Bou Diou ! et les garçons dansent avec les filles… ça, c’est s’amuser, quoi !… Enfin, bref, quelle figure a-t-il, ton Korrigan ?
— Cela dépend… Quelquefois, on ne voit que deux yeux…
— Hein ? deux yeux, sans corps ?
— Il paraît… Deux yeux qui brillent dans la nuit et qui se mettent à vous poursuivre… D’autres fois, cela vous saisit brusquement par derrière… vous renverse, et il y a des malheureux que l’on a trouvés morts, la figure déchirée… le ventre ouvert…
— Brrr !…
L’homme du Midi tortilla sa longue moustache d’un geste vainqueur d’ancien dragon et se mit à rire doucement. Il n’était pas de ceux qui croient aux Korrigans ni aux contes de bonne femme.
Le petit Logarec, ancien quartier-maître de la flotte, se réservait et n’en pensait pas moins.
Cependant, les deux gardiens tombèrent d’accord sur ce point qu’il était abusif, à l’heure où tous les vivants s’amusent, de condamner deux fonctionnaires à garder trois ou quatre personnages, défunts depuis des siècles.
— Que l’on veille sur les diamants, dit Bartissol, je comprends ; sur les tableaux, passe encore, mais supposer que quelqu’un aura jamais l’idée d’enlever une vieille dame comme cette reine-là…
— Des fois…, répliqua Logarec.
— Et que veux-tu qu’on en fasse ?
— Toi ou moi, rien, pardi ! mais un savant, un collectionneur ! ces gens-là n’ont pas des idées comme tout le monde… Avoue que c’est drôle tout de même, ces antiquités… Je trouve que ça vous a quelque chose d’impressionnant…
Et, tout en parlant, Logarec, rêveur, contemplait la glace qui recouvrait le sarcophage dans lequel était enfermée la pauvre reine Tia.
La tête et le haut du buste de la momie étaient dégagés des bandelettes, ainsi que ses mains, ramenées sous le menton. Ce masque de mort sévère, de couleur sombre, aux traits profondément accentués, paraissait de bronze. On l’eût pu prendre pour une figure sculptée en haut-relief, n’eût été une sorte d’humidité persistante entre les deux bords des paupières.
Le gros œil de cyclope de la lanterne sourde posée sur la glace éclairait le visage en dessous et rebroussait de bas en haut toutes les ombres.
Attiré, malgré lui, Bartissol regardait aussi.
— Non, vois-tu, fit Logarec, tu diras ce que tu voudras, mais ces morts-là ne sont pas comme les autres… Te figures-tu bien ce que nous serons, toi et moi, cinq ans seulement après qu’on nous aura enterrés ?…
— En voilà des idées… non, mais t’es pas un peu « marteau », mon pauvre Logarec ?
Bartissol avait la voix puissante et, dans le grand vide des hautes salles, les échos de cette voix répercutée par les caissons résonnaient étrangement.
Il s’en aperçut, sans doute, car il continua, baissant le ton :
— Satané « nigousse » ! va ! Il finirait par vous donner la tremblote.
Puis haussant les épaules :
— Ces Bretons tous superstitieux comme des vieilles femmes.
Et, pour se donner une contenance, le Méridional, plus impressionné qu’il ne voulait le paraître, repoussa de dépit la lanterne qui glissa sur la glace du sarcophage.
Les ombres se déplacèrent violemment, bouleversant les traits de la momie et, subitement, le visage de la reine Tia changea d’expression.
Bartissol tourna le dos.
Quant à Logarec, il coulait un regard furtif vers ce masque mystérieux qui l’attirait étrangement.
Tout à coup, il tressaillit.
— Qu’as-tu donc ? demanda Bartissol en faisant lui-même un mouvement involontaire.
— Moi… rien… répondit Logarec.
Le Méridional fit claquer ses doigts.
— C’est toutes tes histoires aussi… Secouons-nous. Bon Dieu… Tiens, entends-tu comme on chante dans la rue… À Pézenas, on est gai comme cela… pas de fête sans chansons. Crier à pleine gorge, voilà qui vous chasse les idées noires… mais on n’en a pas chez nous. Aussi, on chante toujours… Je me rappelle, l’année où j’ai tiré au sort…
Brusquement, Bartissol se sentit saisir par le bras.
Logarec fixait sur lui deux yeux agrandis par la peur.
— Tu as entendu ?… souffla-t-il.
— Quoi ?… les « réveillonneurs » qui chantent ?
— Non… là… je ne sais pas… Quelque chose a craqué !…
— Bah !… c’est une lame de parquet…
— Je ne crois pas… c’était comme qui dirait dans l’air…
— Tu ne vas pas croire que c’est le Korrigan… je suppose…
— Ne ris pas, Bartissol, je te dis que quelque chose a craqué…
— Eh oui… c’est le parquet… parbleu !
— Non… Cela sonnait le creux…
— Le creux !… le creux !… tu ferais devenir les gens fous, ma parole… Tu sais pourtant bien que le parquet est mauvais, qu’il y a un tas de lames qui fléchissent… même qu’on a déjà fait trente-six enquêtes pour le réparer… mais avec l’administration !…
— Tu crois ? interrogea Logarec anxieux…
— Quand je te le dis… tiens, prends la lanterne, tu vas voir… je vais te montrer l’endroit où…
Bartissol n’acheva pas…
Un craquement bien distinct cette fois, sonore, indéniable, venait de se faire entendre et, comme l’avait dit le Breton, il paraissait s’être produit en l’air, à hauteur d’homme.
— Hein ? balbutia Logarec, tu vois bien que ce n’est pas le parquet ?…
— Ça vient des portes, alors, jeta Bartissol en se hâtant vers la sortie.
Logarec, tenant en main la lanterne sourde, rejoignit son compagnon.
Ils examinèrent successivement les deux portes de dégagement, placées vis-à-vis l’une de l’autre.
Elles étaient d’ailleurs fermées.
— Ça a pu craquer tout de même, hasarda Bartissol.
— Ici, peut-être…
Et Logarec désignait la grande vitrine qui fait face aux fenêtres.
Ils s’approchèrent.
Le rayon projeté par la lanterne sourde fit scintiller les dorures d’un autre sarcophage vide, celui-là, et placé debout à gauche de la baie.
À l’instant même où la projection mettait en lumière l’effigie du personnage égyptien qui avait été enseveli dans cette haute boîte, un nouveau craquement retentit… Et celui-là sonnait le creux… il provenait sûrement du sarcophage !…
Les deux gardiens s’arrêtèrent et, d’un même mouvement, se montrèrent le couvercle sommé d’une face grimaçante et surchargé de lamelles d’or.
Le sourire figé du Pharaon semblait rivé sur eux !
Puis, ce sourire s’effaça… les yeux d’émail brillèrent et parurent glisser comme des yeux vivants qui suivent la fuite d’une image…
C’était maintenant un grincement continu… la figure virait à gauche d’une seule pièce…
Et les gardiens n’avaient conscience que d’une chose… c’est que le sarcophage allait s’ouvrir !…
De son mouvement lent et régulier, le couvercle continuait de tourner.
Cela ne dut pas en réalité durer plus de quelques secondes, mais, dans l’état de surexcitation où se trouvaient les deux témoins de cet effarant spectacle, ces secondes-là valaient une éternité.
J’ai déjà expliqué que le sarcophage était placé debout sur le côté gauche de la porte vitrée qui fait communiquer les deux salles…
D’ailleurs tous les visiteurs du Louvre qui ont traversé ces galeries avant leur réinstallation, se rappellent certainement cette gaine oblongue, habillée de haut en bas de signes polychromes et terminée par une effigie, de roi mort qui vous regarde de façon inquiétante. Pour peu qu’ils veuillent prendre, à cette heure nocturne, la place de mes deux gardiens, ils conviendront sans peine du tragique de la situation.
Logarec n’avait pas lâché la lanterne, et le tremblement qui agitait son bras faisait courir sur le mur, au-dessus du sarcophage, à sa droite, à sa gauche, des ombres fantastiques…
Un heurt sourd !…
Le couvercle venait de se rabattre sur le chambranle de la porte vitrée…
Les deux gardiens comprirent, plutôt qu’ils ne le virent, que la cavité de la bière béait devant eux.
La lumière, dans les mains de Logarec, dansait de façon désordonnée et à cette lueur incertaine et mouvante, ils distinguaient dans la boîte funèbre une vague forme humaine, toute droite, et qui bougeait.
Un bras noir se dressa soudain et, aussitôt, une silhouette démesurée se profila sur la muraille.
Alors, ils n’y tinrent plus… Le Breton laissa choir sa lanterne et tous deux prirent la fuite avec le sentiment très net que le Ramsès au grand bras tendu les poursuivait.
Dans sa chute, la lumière s’était éteinte… En revanche, la clarté de la lune entrait maintenant à flots par les fenêtres et étendait, de distance en distance, de grands rectangles blancs régulièrement coupés de croisillons noirs.
Et tandis que se multipliaient, se heurtaient, au profond des ténèbres, les échos soulevés par les pas précipités des fugitifs, dans le pâle rayon lunaire, un homme avançait sans bruit…
IIl’alerte
Logarec et Bartissol traversèrent en courant la salle où grimacent dans les vitrines les innombrables divinités égyptiennes, la salle des Colonnes, la salle des Bijoux Anciens… Ils franchirent la Rotonde d’Apollon et se jetèrent comme des fous dans l’escalier que domine la Victoire de Samothrace.
Là, Logarec osa se retourner.
Rien !…
Rien que les immenses ailes éployées de la colossale déesse décapitée.
Bartissol se devait de paraître audacieux jusqu’au bout.
— Il faut prévenir le chef, dit-il résolument.
— Vas-y… toi… fit Logarec…
— Non… suis-moi… il nous croira mieux si nous sommes deux.
Logarec se rendit d’autant plus volontiers à cette excellente raison que ce vaste escalier sonore et vide le glaçait d’épouvante.
Ils montèrent.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quelques minutes après, trois hommes arrivaient devant la Victoire de Samothrace, puis grimpaient les marches qui précèdent la Rotonde d’Apollon.
— C’est là, chef, indiqua Logarec en tendant une main qui tremblait dans la direction des salles obscures.
Ils allaient poser le pied sur le seuil de la première galerie, lorsqu’un autre veilleur, affolé, fit soudain irruption en bousculant le gardien-chef qui fut projeté contre le mur.
— Quoi ?… qu’est-ce qu’il y a encore ? s’écria une grosse voix enrouée.
Logarec et Bartissol se tenaient prudemment l’un derrière l’autre.
L’homme, bouche bée, regardait son chef sans parvenir à articuler un mot.
— Expliquez-vous à la fin, ordonna le supérieur… Vous avez vu quelqu’un ?…
— Eux… chef, bredouilla le veilleur… en désignant Logarec et Bartissol… Je les ai aperçus… ils couraient… et puis, derrière eux, un moment après… quelque chose est apparu… on aurait dit un homme, mais je ne suis pas bien sûr… cela ne faisait pas de bruit… on aurait juré…
— Où étiez-vous ?
— Là, dans la salle des Bijoux Anciens…
— Et ce… que vous avez vu, venait d’où ?
— De là-bas, répondit le veilleur, en montrant l’enfilade des salles…
— Mais, il fallait appeler, couper la retraite à cet homme, si homme il y a… où est-il allé ?
Le fonctionnaire eut un geste vague…
— Je crois qu’il est descendu, dit-il.
— Alors, les veilleurs d’en bas l’auront vu sortir…, qu’on aille les chercher… ou plutôt non… je vais les faire monter.
Et il appela :
— Heurtebize !… Papillon !…
Deux gardiens somnolents montèrent pesamment l’escalier. Ils n’avaient rien vu et considéraient, ahuris, un peu narquois, ce groupe de quatre hommes dont trois étaient livides.
— Alors, par ici, s’écria le chef en se frappant le front…
Il fit quelques pas et, s’arrêtant devant la porte d’Apollon, il dit à Bartissol :
— Allez me chercher Caraton.
Celui-ci arriva bientôt. C’était le préposé à la garde des Diamants de la Couronne.
— Vous savez bien quelque chose ? lui demanda le chef.
— Je sais qu’il y a alerte, mais j’ignore de quoi il s’agit.
— Alors vous n’avez rien vu ?
— Rien, chef.
— Mais enfin, s’écria le gradé, cet homme n’a pourtant pas pu s’envoler ?…
— C’est que ce n’était pas un homme, murmura Logarec… du moins, un homme vivant…
— Qu’est-ce que vous me chantez là ? espèce de serin.
— Demandez à Bartissol, chef.
— C’est sorti d’un sarcophage, affirma le Méridional.
— Ah ! pour le coup, c’est trop fort…
— Oui… le sarcophage s’est ouvert, ça… je l’ai vu… je ne rêvais pas…
Le chef haussa les épaules, puis il dit brusquement :
— C’est bien… allons voir… suivez-moi tous et attention, hein ? que l’on referme les portes, après que nous serons passés.
Logarec, Bartissol, leur camarade de la salle des Bijoux Anciens, les deux gardiens du grand escalier et celui de la galerie d’Apollon, emboitèrent le pas à leur supérieur.
On arriva dans la salle où avait eu lieu la scène fantastique, cause de tout ce branle-bas.
Les deux gardiens, témoins de l’étrange aventure, poussèrent une exclamation en désignant le sarcophage placé à gauche de la porte vitrée… Le couvercle s’était refermé et la figure noire du Ramsès fixait sur la petite troupe son immuable sourire énigmatique.
— Il était ouvert, pourtant, haleta Logarec…
— Quoi ? fit le chef ?… ce sarcophage ?
— Oui, chef, il s’est ouvert devant nous.
Le supérieur incrédule fit pivoter le couvercle…
— Vous voyez, il n’y a rien, dit-il.
— C’est que la momie s’en est allée, alors.
— La momie ?… quelle momie ? vous savez bien que ce sarcophage-là est toujours vide…
— Pourtant… la forme que nous avons vue…
— Moi aussi, j’ai vu quelque chose, intervint le gardien de la salle des Bijoux Anciens.
— Eh ! parbleu oui, fit le chef, vous avez vu passer ces deux poltrons-là…
— Oui, mais derrière eux…
— Derrière eux ?… vous avez aperçu leur ombre au clair de lune… C’est stupide… toute cette histoire ne tient pas debout… que chacun retourne à son poste et que cela soit fini.
Les gardiens se dispersèrent ; on rouvrit les portes et les veilleurs allèrent reprendre leur faction.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le gardien-chef venait de s’engager dans l’escalier qui conduit à son logement, situé sous les combles, lorsqu’un cri le cloua au sol.
Au même instant, il vit une masse débouler à ses pieds, trébucher et se retenir au mur. Un bicorne roula sur les marches de l’escalier.
Le chef reconnut le gardien des Diamants de la Couronne.
— Parlez, qu’y a-t-il, mais parlez donc, animal !
Le pauvre garçon ne parvenait qu’à proférer un son rauque qui sortait de sa gorge, continûment :
— Ô…ô…ô… oh !
Et son doigt tendu montrait la galerie d’Apollon…
Interloqué, le gardien-chef vint à ce malheureux qui tremblait et le secoua rudement par les épaules.
— Mais parlez donc, s’écria-t-il, qu’est-ce qu’il y a ?… qu’avez-vous vu ?
L’autre regardait le supérieur de ses grands yeux hagards…, ses lèvres remuaient, mais il n’en sortait que des sons inintelligibles !…
À la fin, cependant, des mots se précisèrent :
— Il y a… il y a… balbutia-t-il.
— Quoi donc ?… bon Dieu !
— Il y a… chef… qu’on a volé…
— On a volé !… Qu’est-ce qu’on a volé ?
— Le… le… « Régent », chef…, oui… le… Régent !…
Et le gardien s’effondra sous le poids de cet aveu.
La face déjà congestionnée du chef devint pourpre… la surprise, l’émotion, la colère le suffoquaient.
Il se mit à crier à tue-tête :
— Vous êtes fou !… volé !… volé !… le Régent !… vous êtes fou !… fou, vous dis-je.
Mais tout en se rassurant de la sorte, il n’en prenait pas moins le subalterne par le bras, le poussait devant lui, et, son falot dans la main droite, se ruait vers la galerie d’Apollon.
Alors, le malheureux gardien montra la vitrine où sont exposés les Diamants de la Couronne :
— Là !… là !…, fit-il.
Il n’en dit pas davantage, mais le spectacle qui se présentait en ce moment aux yeux du supérieur en disait plus long que tous les commentaires.
Il rugit, serra les poings :
— Ah ! vingt Dieux de vingt Dieux !… les misérables !…
Un rectangle, juste assez grand pour livrer passage à une main, était nettement découpé dans la glace de la vitrine. Le morceau enlevé était posé tout à côté ; un petit amas de mastic où se voyaient encore des empreintes de doigts, occupait le milieu de ce carré de verre. Et, à la hauteur de l’ouverture béante, le fin support d’argent sur lequel le célèbre joyau se présentait naguère, libre de tout contact, en pleine lumière, ce support se courbait à sa place habituelle comme un point d’interrogation, tendant ironiquement sa griffe vide !
C’était fou, en effet, invraisemblable, inadmissible !…
Et pourtant, le fait était là…
On avait volé le Régent, en plein musée du Louvre, à la barbe de son gardien !
IIIquelques traits de lumière sur le mystère
Oui, on avait volé le Régent !
Et j’en puis ici fournir la certitude avec quelques preuves à l’appui, puisque le voleur… c’était Moi !
Bien qu’assez réservé de ma nature, j’estime que le moment est peut-être venu de me présenter.
Je me nomme George-Edgar Pipe, sujet anglais, cambrioleur professionnel, et jouissant, en la matière, de quelque autorité. Certes, mon nom n’a point d’éclat ; il n’a figuré sur aucune manchette de journal, bien que mes « exploits » aient, durant cinq années, défrayé les chroniques des Deux-Mondes.
La raison de cette obscurité ?… elle est bien simple ; jamais je ne me suis laissé prendre.
Le cas me paraît assez exceptionnel pour que j’en fasse ici mention ; il explique, au surplus, comment, si mes actions sont devenues célèbres, mon nom est demeuré parfaitement ignoré.
Je ne taxerai pas à ce propos le Destin d’injustice, à l’exemple de certains auteurs de mémoires. Cette obscurité me plaît… Je suis modeste.
Toutefois, l’heure est venue de sortir de ma tour d’ivoire, d’abord parce que, retiré des affaires, j’ai désormais quelques loisirs et, ensuite, parce que la prescription m’est acquise et que ma liberté n’aura pas à souffrir des aveux que je pourrai faire.
Donc, on s’est beaucoup occupé de moi sans me nommer jamais. Néanmoins, mes « exploits » offrent tous un trait caractéristique auquel il est aisé de les reconnaître.
Ce trait est justement leur anonymat.
Tous les grands vols, cambriolages et autres coups d’audace dont l’auteur est demeuré inconnu, tous ceux-là sont de moi.
Je peux bien le dire aujourd’hui, puisque la justice ne me fera plus l’honneur de s’occuper de mon humble personne.
Je me ferai cependant un devoir d’exposer par le détail mes façons de procéder.
Cette relation sera, je l’espère, de grand enseignement, car ne s’improvise pas cambrioleur qui en a fantaisie.
C’est mieux qu’un métier, c’est un sacerdoce. Ses fidèles sont de grands méconnus. Le cambrioleur n’est-il point, comme l’a si bien dit Stevenson, le seul aventurier qui nous reste ici-bas ?… Songez donc à la lutte incessante qu’il livre, un contre tous, seul contre la société civilisée tout entière. Et le courage donc ? Avouez qu’il en faut une jolie dose pour s’introduire la nuit dans une maison, crocheter une serrure, forcer une porte sans savoir ce que l’on trouvera derrière… Ah ! on paye souvent bien cher, vous pouvez me croire, les quelques bénéfices que l’on retire de telles expéditions.
La suite de ce récit me donnera raison ou tort, mais j’ai conscience d’accomplir une œuvre de justice en réhabilitant un art que trop de maladroits ont compromis et que l’aveuglement des masses a taxé stupidement d’infamie.
Mais, m’objectera-t-on, pourquoi vous, un sujet anglais, êtes-vous venu vous faire la main en France ?
L’explication est des plus simples.
J’avais, depuis longtemps, formé le projet d’enlever, non point de ces objets de pacotille que tous les bourgeois ont chez eux, mais une pièce rare, unique, qui eût un nom, une histoire et représentât une fortune. Les pierreries célèbres, celles qu’ont portées les rois, me semblaient répondre à mon dessein.
Pour quelle raison, alors, suis-je venu en France ?
Sans doute, nous avons des diamants, de célèbres diamants comme ceux de la couronne d’Angleterre, par exemple ; mais, je le déclarerai tout net : ils sont mieux gardés que chez vous. La France apparaît aux étrangers comme un vrai pays de cocagne, et cela est particulièrement vrai pour les gentlemen qui s’adonnent au cambriolage.
Ici, point de ces promiscuités fâcheuses avec des surveillants d’éducation précaire… on n’est jamais obligé de se colleter avec des malappris… Tout vous est largement ouvert… On est chez soi… Il n’y a qu’à se baisser pour prendre, si le cœur vous en dit.
La France est, avant tout, le pays du savoir-vivre.
Autre motif : si l’on est pris — car il faut tout prévoir — si l’on est pris, cela devient sérieux en Angleterre et désobligeant au possible : dix ans de hard labour pour la moindre des peccadilles, autant dire la mort civile et naturelle par surcroît.
Inversement, que risque-t-on chez vous ? Cinq ans, dix ans de villégiature qu’on n’aurait jamais songé à s’offrir ; un voyage au long cours dans des régions clémentes, au climat sain et tempéré, sous des cieux toujours bleus, au milieu de décors féeriques.
On s’évade facilement de ces régions-là… et l’on peut, au retour, se refaire une situation. On a acquis de l’expérience et la considération qui entoure généralement les voyageurs.
Voilà pourquoi j’ai choisi la France… Résolu à commettre un vol qui en valût la peine, je décidai de m’emparer du Régent.
Pour mener mon projet à bien, je choisis le jour de Noël, qui est d’heureux augure en Angleterre et, dans l’après-midi du 24 décembre, je me mêlai aux nombreux curieux qui s’écrasaient dans les galeries du Louvre.
Après un examen attentif des locaux, mon plan fut vite arrêté ; je devais attendre la nuit, sans trahir ma présence, dans les salles du musée même.
Cela m’évitait d’avoir recours au procédé de l’escalade et s’accordait mieux avec mon caractère qui ne désire qu’une chose passer inaperçu.
Après avoir inspecté les diverses salles du Louvre, j’optai pour celle des Antiquités égyptiennes, où sont exposées les momies, salle assez peu fréquentée du public et, profitant d’un moment où il n’y avait personne, je me glissai rapidement dans une haute boîte, sorte de gaine oblongue qui — je m’en étais assuré quelques minutes auparavant — était vide et pouvait contenir un locataire de ma modeste corpulence.
Je ne sais s’il vous est arrivé d’habiter quelque temps dans l’intérieur d’un sarcophage… Ceux qui l’auront tenté me comprendront. À vrai dire, on y est très mal ; on y respire à grand’peine, et cela sent affreusement le moisi.
Mais la situation s’aggrave lorsqu’on y doit rester des heures comme c’était mon cas.
La nuit vint ; j’entendis fermer les portes… Les minutes s’écoulaient, lentes, lentes ! et j’avais l’impression, à la longue, de revivre les millénaires qui nous séparent de la première dynastie.
J’étais fort indécis en somme… Comment sortirais-je de là ? Je n’avais encore rien trouvé lorsque, vers minuit, j’entendis les gardiens pénétrer dans la salle. Ils s’arrêtèrent, se mirent à causer et, n’ayant rien de mieux à faire, j’écoutai.
On sait quels étaient leurs propos. La contemplation prolongée de la reine Tia, les considérations funèbres qui s’ensuivirent, la nuit, la solitude et le naturel superstitieux de l’un d’eux les mettaient dans un état d’infériorité certaine.
Ce me fut une inspiration. Plutôt que de compter sur le hasard qui pourrait bien ne point se manifester, je résolus de mettre à profit l’énervement de mes deux gêneurs et de frapper un grand coup.
C’est alors que je commençai à remuer doucement dans mon sarcophage.
L’effet fut prompt et rassurant… Les gardiens avaient peur… Ils n’étaient plus à craindre. Je graduai mes effets de terreur en souriant de leur épouvante… Alors, bien sûr de moi, je poussai l’audace jusqu’à m’évader de mon coffre, je ne dirai pas à leur nez, car ils fuyaient déjà à toutes jambes. J’étais libre de mes mouvements et seul dans cette salle tout à l’heure trop bien surveillée.
N’avais-je pas raison de proclamer plus haut ma foi dans l’influence que peut avoir le Merveilleux ?
Cependant je n’étais pas au bout de mes peines. Il me fallait gagner la galerie d’Apollon, où je savais qu’était exposé le Régent, mais que je savais aussi spécialement gardée par un veilleur de nuit.
Je me lançai provisoirement sur les traces de mes deux nigauds, de ce pas subreptice et silencieux qui convient au fantôme d’un Pharaon.
Je vis bien, en traversant une salle, que mon apparition faisait quelque impression sur un gardien probablement dérangé dans son sommeil… L’alarme allait être donnée ; je ne pouvais songer d’ailleurs à me risquer à l’aveuglette dans la galerie d’Apollon, et comme je venais d’arriver en haut de l’escalier de la Victoire, je m’aperçus que l’on avait là, fort à propos, reconstitué certain portique orné de deux cariatides provenant, je crois, des ruines de Delphes.
Ce détail a peu d’importance ; ce qui en avait plus pour moi, c’est qu’on avait, au fond de ce portique, tendu un rideau à la grecque dans le dos des deux cariatides.
Je me cachai derrière ce rideau et attendis.
J’assistai dans cet incognito qui me sied au conciliabule d’un homme à grosse voix et de mes deux gardiens de la salle des Antiquités Égyptiennes, puis je compris que le veilleur des diamants était appelé et convié à se joindre à la ronde.
Alors je sortis doucement de ma cachette et revins à pas de loup vers la Rotonde.
Tout le monde était occupé à discuter dans la salle des momies.
Moi, le plus doucement possible, je gagnai la galerie d’Apollon… Elle était vide, comme je m’en doutais.
Vite, ma petite lampe de poche, mon diamant de vitrier ! Les feux du Régent guident ma main à travers la vitrine… Zzz !… Zzz !… Zzz !… Zzz !… quatre coups de diamant en rectangle… Je colle un paquet de mastic sur la partie délimitée… Je tire à moi, la vitrine est ouverte !… Je recueille le Régent, le mets dans mon gousset, puis j’ouvre sans bruit une fenêtre à laquelle j’attache la cordelette de soie qui ne me quitte jamais, et je me lance dans le vide.
Il était temps ; des pas se rapprochaient.
Que l’on se figure, si l’on peut, la joie d’un heureux cambrioleur arrivant sans accroc, au pied du mur du Louvre, avec le Régent dans sa poche !…
IVoù il est prouvé une fois de plus que l’homme n’est qu’un jouet entre les mains du destin
Je vois d’ici le lecteur sourire et je devine la pensée qui lui est venue à l’esprit.
Il se dit évidemment : « Quel être naïf que ce cambrioleur qui se figure pouvoir convertir en espèces un diamant connu de tous… Mais le premier marchand auquel il l’offrira le fera tout de suite arrêter, c’est certain. »
Non, ce n’est pas si certain que cela. Voyons, vous supposez bien qu’un homme de mon acabit, un professionnel du cambriolage ne se serait pas risqué à tenter un coup comme celui-là, s’il n’avait su d’avance où placer le produit de son travail ». Je ne suis plus un novice et la discrétion que j’observe en toutes choses m’a valu la confiance, je dirai plus, l’amitié de certain négociant d’Amsterdam qui s’entend, comme pas un, à tailler le diamant.
C’est à lui que je m’adresserai. Il partagera le Régent en plusieurs morceaux et le vendra ainsi au détail, en prélevant, comme il est juste, pour sa part, une sérieuse commission. Tout compte fait, il me reviendra de cette vente quelques petits millions que je saurai employer, je vous prie de le croire.
Édith, d’ailleurs, m’aidera de son mieux, car pour gaspiller l’argent, elle n’a pas sa pareille.
Puisque je viens de prononcer le nom d’Édith, je crois que je ne dois plus tarder à vous la présenter. Édith est ma maîtresse, une maîtresse ravissante, exquise, jolie, comme le sont les Anglaises quand elles se mettent à être jolies. Je l’ai connue à Ramsgate où j’étais allé me reposer un peu des fatigues du métier, il y a de cela un an, et j’avoue que, depuis notre première rencontre, elle a toujours fait preuve d’une fidélité vraiment exemplaire. De plus, et cela est aussi très appréciable, aucun nuage n’est venu ternir notre lune de miel.
Bien entendu, je n’ai jamais révélé ma profession à Édith, car les femmes, si parfaites qu’elles soient, ont toujours une tendance à trop bavarder et, bien que je m’honore de pratiquer le cambriolage, j’ai craint qu’elle n’éprouvât quelque répugnance pour cette sorte d’art que réprouve une morale trop étroite. Elle me croit, sinon riche, du moins fort à l’aise et ignore, la pauvre chatte, que les deux billets de mille francs qui se trouvent dans mon secrétaire constituent pour l’instant toute ma fortune.
C’est, vous le devinez, à Édith que je songeais en regagnant pédestrement mon domicile, là-haut, sur la butte Montmartre.
La période de morte-saison que je venais de traverser ne m’avait pas permis de m’installer, comme je le souhaitais, dans un quartier aristocratique, mais bientôt ce désir se trouverait exaucé, grâce au Régent, et George-Edgar Pipe, au lieu d’habiter un petit logement meublé de deux cents francs par mois, aurait son hôtel à lui, ses domestiques, son auto.
Alors, les gens qui aujourd’hui le regardaient avec mépris, ambitionneraient l’honneur de lui être présentés, car à Paris, comme à Londres, cela est un fait constant, on ne s’inquiète guère de savoir comment les gens se sont enrichis. Les moyens employés pour parvenir importent peu, c’est le résultat qui est tout.
Or, le « résultat », je l’avais là, dans la poche de mon gilet, sous la forme d’un petit polyèdre que je palpais amoureusement, de temps à autre, entre le pouce et l’index.
Au moment où j’arrivais devant ma porte, une crainte me saisit. Depuis que je vivais avec Édith, c’était la première fois que je découchais…
Comment allait-elle prendre la chose ?
Bah ! me dis-je, je trouverai bien un prétexte pour m’excuser… Et tout en montant l’escalier, je préparais ma défense, mais, chose curieuse, moi qui d’ordinaire ne manque pas d’imagination, j’avais beau me torturer la cervelle, je ne trouvais rien… mais là, absolument rien.
En désespoir de cause, je me résolus à invoquer l’excuse de l’attaque nocturne… Cela réussit toujours et a l’avantage d’exciter terriblement les nerfs des femmes… C’est cela… Je dirais que l’on m’avait attaqué, que fort heureusement des agents étaient accourus à mon appel, que l’on avait arrêté mes agresseurs, et que j’avais dû aller au poste pour y décliner mes nom et qualité, subir la confrontation de rigueur et signer une plainte en bonne et due forme…
Édith, à n’en pas douter, se laisserait facilement convaincre… Peut-être ferait-elle un peu la moue, mais j’ai un moyen infaillible pour dérider mon adorable maîtresse et la rendre plus aimante que jamais.
J’introduisis doucement ma clef dans la serrure, ouvris la porte et la refermai sans bruit, puis, après m’être débarrassé dans le vestibule de mon chapeau et de mon pardessus, je me dirigeai vers la chambre d’Édith la nôtre par conséquent, car vous supposez bien que nous ne faisions pas lit à part. D’ordinaire, une petite lampe d’albâtre brûlait, toute la nuit, sur la cheminée, aussi fus-je assez surpris de trouver la pièce obscure… J’avançai de quelques pas, cherchai en tâtonnant le commutateur. Une clarté brusque jaillit et je constatai, avec une émotion que l’on s’imagine sans peine, que le lit était vide.
Édith, elle aussi, avait découché !
Je ne pus croire, tout d’abord, à une telle audace de sa part. Édith était plutôt d’une nature timide et il me semblait impossible qu’elle eût pris, en ne me voyant pas rentrer, une si brutale décision. Sans doute était-elle allée à ma rencontre… et je la verrais bientôt reparaître… Peut-être aussi, comme elle était très peureuse, s’était-elle réfugiée chez une voisine qui habitait sur le même palier et nous rendait, de temps à autre, quelques menus services.
J’errais dans la chambre, comme une âme en peine, inquiet et furieux tout à la fois, quand un billet placé sur la table de nuit frappa mes regards. Je m’approchai vivement, m’emparai de ce papier et ne pus retenir un cri de rage.
Édith était partie… elle avait, c’est le cas de le dire, filé à l’anglaise !
« Mon cher Edgar, m’expliquait-elle, l’air de Paris ne me vaut rien et je sens bien que je ne m’habituerai jamais à la vie française… Excusez-moi de vous quitter si brusquement, mais je ne pouvais plus y tenir… J’ai ce que nous appelons là-bas le homesickness[1] et j’ai besoin de me retremper un peu dans l’atmosphère du Strand et de Piccadilly. J’ose espérer que vous vous consolerez vite, et que vous m’excuserez aussi de vous avoir « emprunté » quelque argent pour couvrir mes frais de voyage et me permettre de vivre tranquille, en attendant que je trouve une situation. J’ai pris les deux mille francs qui étaient dans le secrétaire et je vous les renverrai peut-être un jour. Dans le cas où vous déménageriez, prévenez-moi poste restante, bureau de Charing Cross. Je ne vous dis pas adieu, Edgar, car j’espère bien vous revoir. Je vous aime encore, croyez-le, mais décidément, je m’ennuyais trop à Paris… »
Bien que je sois, depuis longtemps, cuirassé contre les coups du sort, j’avoue que celui-là me sembla plutôt dur et que, dans ma rage, je prodiguai à Édith tous les noms que le slang de Whitechapel réserve d’ordinaire aux affreuses créatures d’Aldgate ou de Drury-Lane… Il y avait sur la cheminée un portrait de ma maîtresse, je le jetai sur le parquet, le piétinai avec frénésie et lacérai furieusement le kimono de soie bleue qu’elle avait oublié sur un fauteuil.
Ainsi, elle avait fui, la petite hypocrite, fui en emportant toutes mes économies : ces deux mille francs sur lesquels je comptais pour passer en Hollande !… Elle avait, au moyen d’une pince, forcé la serrure de mon secrétaire…
Moi, Edgar Pipe, le « roi des cambrioleurs », j’avais été refait par une femme ! et cela, au moment où je venais d’accomplir une expédition qui m’assurait la fortune.
J’explorai quand même les tiroirs de mon secrétaire, espérant qu’Édith, prise de remords au moment de partir, m’aurait au moins laissé un ou deux billets… Mais non… elle avait tout pris, la misérable, et je me trouvais main- tenant avec quarante francs en poche ! !
Je me jetai tout habillé sur mon lit et ne tardai pas à m’endormir profondément, car les émotions, chose bizarre, exercent sur moi une singulière influence. Au lieu de m’énerver et de m’horripiler jusqu’à l’exaspération, elles finissent par m’anéantir et je goûte alors un sommeil de brute.
Plus je suis ennuyé, plus je dors et je dois à cette heureuse disposition physique de supporter sans trop de tourments les épreuves de la vie. En général, l’homme est mal armé contre l’adversité ; dès qu’un événement fâcheux vient déranger ses projets ou détruire ses espérances, il se laisse aller au désespoir, crie, se lamente et souhaite même la mort. Moi, j’éprouve d’abord une secousse des plus violentes, mes nerfs se tendent à se briser, mais cet état de surexcitation n’est que passager et ne tarde pas à faire place à un profond abattement… Une sorte de torpeur s’empare de moi, paralyse mes membres, jetant sur ma douleur comme un baume bienfaisant, et pendant douze heures, et même davantage, je jouis d’un sommeil de plomb que ne hante aucun rêve, que ne trouble aucun cauchemar. Quand je me réveille, je suis calme, reposé, lucide et, de nouveau, prêt à la lutte. La catastrophe qui s’est, la veille, abattue sur moi me semble lointaine… lointaine, et je me demande même comment elle a pu un instant troubler mon esprit.
Le lendemain du jour où j’avais appris en même temps, et la brusque disparition d’Édith, et celle de mes deux mille francs, j’étais plus calme que jamais.
Je m’habillai avec soin, me fis du thé, puis je m’assis dans un fauteuil, ma Bible entre les mains.
Cela vous étonne peut-être qu’un cambrioleur lise la Bible ?
Et pourquoi ne la lirait-il pas ? Est-il défendu à un homme, à quelque catégorie qu’il appartienne, de chercher des conseils dans les livres saints ?
J’en connais qui font de la Bible leur livre de chevet et ne valent pas mieux que moi, bien qu’ils jouissent dans notre trompeuse société d’une réputation inattaquable…
En somme, tout n’est-il pas convention en ce monde ?
L’homme de loi qui passe sa vie à spolier des héritiers, le financier qui ruine des centaines de petits rentiers, le marchand qui vend ses denrées le triple de ce qu’il les a payées et trompe encore sur le poids, l’individu taré qui épouse une femme pour sa fortune, le député qui trafique de son mandat pour patronner de louches entreprises et toucher des pots-de-vin en secret, ces gens-là sont-ils moins méprisables que le cambrioleur qui dérobe au Louvre un des Diamants de la Couronne ?
Puisque l’argent est le but de la vie et que l’on n’est pas encore arrivé à le supprimer, ne faut-il pas que l’on s’en procure ? Et tenez, puisque je vous parlais de la Bible… écoutez le conseil sur lequel je viens justement de tomber :
« La fortune est pour le riche une ville forte ; la ruine des misérables, c’est leur pauvreté[2]. »
Est-il rien de plus juste ?
Grâce au Régent que j’ai là, dans ma poche, je pourrai bientôt me réfugier dans cette « ville forte » dont parle l’Écriture et devenir l’égal des individus peu recommandables auxquels je faisais allusion plus haut. Quel sera mon crime ? Je n’aurai fait, en somme, que priver le public parisien de la vue d’un diamant précieux, mais je suis sûr que l’administration prévoyante ne manquera pas de remplacer la pierre absente par une autre en toc qui fera absolument le même effet.
Il paraît d’ailleurs que, dans les musées, lorsqu’un vol se produit, c’est toujours ainsi que l’on procède.
Qui pourra se plaindre ? À qui aurai-je porté préjudice ? à l’État… Bah !… il est assez riche pour supporter cela.
Le Régent avait changé de main et il allait enfin être utile à quelqu’un… Je m’étais laissé dire que ce diamant pesait 136 carats — environ vingt-huit grammes — et qu’il était estimé de douze à quinze millions. Il faudrait vraiment que la fatalité s’en mêlât pour que je n’en retirasse pas au moins deux millions… Je ne suis pas ambitieux… deux modestes millions me suffiraient…
Quelle petite dinde que cette Édith ! et comme elle regretterait son coup de tête, quand elle apprendrait que je mène à Londres un train de vie sinon fastueux, du moins assez enviable…
Elle chercherait sûrement à se rapprocher de moi et (je me connais) elle aurait peu de chose à faire pour obtenir son pardon. Un homme comme moi excuse facilement les fautes d’autrui et le petit cambriolage auquel s’était livré Édith n’était, à mes yeux, qu’une peccadille. L’acte en lui-même ne m’indignait nullement… ce que je reprochais à la petite sotte, c’était de l’avoir accompli à l’heure où j’avais besoin de toutes mes disponibilités pour établir définitivement ma fortune.
J’allais être obligé, moi qui avais des millions en poche, de me livrer, pour me procurer quelque argent, à un de ces menus cambriolages qui sont parfois plus dangereux que les grands.
Je risquais non seulement de me faire arrêter, mais encore de perdre à jamais le diamant que j’avais eu tant de peine à acquérir.
Tout en roulant dans mon esprit ces peu rassurantes pensées, je consultais un petit carnet sur lequel j’avais noté, depuis mon arrivée à Paris, les différents « coups » qui pouvaient être tentés, soit chez des industriels, soit chez des rentiers, et offraient à l’ « opérateur » le moins de risques possible.
Nous autres, cambrioleurs, nous sommes généralement mieux renseignés qu’on ne le croit. Un bavardage, une note parue dans les journaux, un petit entrefilet de rien du tout, nous sont parfois de précieuses indications. Un exemple entre cent. J’avais lu, quelques jours auparavant, dans un grand journal du matin, qu’un sieur Bénoni, rentier, demeurant 210, boulevard de Courcelles, avait oublié dans un taxi une sacoche contenant soixante-douze mille francs en billets de banque et que le chauffeur, un honnête Auvergnat, était venu lui rapporter cette sacoche.
Ce simple fait divers avait retenu mon attention. Je l’avais découpé et collé dans mon « diary ». Je ne pensais pas, à cette minute, utiliser le renseignement, car j’avais un autre projet en tête et ne m’embarrassais point de semblables vétilles, mais aujourd’hui que la petite canaillerie d’Édith me forçait à « remettre la main à la pâte » et à travailler de nouveau dans le « demi-gros », je me mis à étudier l’affaire Bénoni.
Il me parut que ce rentier qui se promenait avec une sacoche contenant soixante-douze mille francs devait être pour un cambrioleur un excellent gibier, et en procédant par déduction, j’en arrivai à établir assez exactement — du moins à mon avis — le cas psychologique du sieur Bénoni. C’était à coup sûr un homme qui brassait de grosses affaires, achetait comptant et vendait de même, puisqu’il avait sur lui de l’argent liquide. Il devait faire le commerce des objets d’art ; c’était un amateur ou un marchand, mais je le supposais plutôt amateur, car un marchand est en général un homme prudent et méfiant, qui n’oublierait pas dans un taxi un sac bourré de billets de banque. Il n’y a qu’un amateur qui puisse avoir de ces distractions.
↑
Mal du pays
↑
Proverbes
,
X
, 15.
Vune surprise à laquelle je ne m’attendais pas
Il était urgent que je me livrasse à une petite enquête sur ce Bénoni qui me paraissait « bon à faire », comme nous disons en argot de métier.
Je me rendis donc boulevard de Courcelles, interrogeai habilement la concierge, et ne tardai pas à acquérir la conviction que mes prévisions étaient à peu près exactes. Le père Bénoni était un antiquaire. On le disait fort riche, mais un peu « piqué » et ses distractions étaient légendaires. C’est ainsi qu’il lui arrivait souvent de sortir sans chapeau, d’oublier son pardessus, ou de laisser un chauffeur de taxi se morfondre des heures devant une porte. Un homme aussi étourdi était certainement peu ordonné ; chez lui, tout devait être en vrac, comme chez les brocanteurs. Le père Bénoni vivait seul avec un vieux domestique, un ivrogne fieffé qui faisait, durant l’absence de son maître, de fréquentes visites à un marchand de vins établi au coin du boulevard et de la rue Desrenaudes.
Je ne tardai pas à lier connaissance avec ce domestique, qui se nommait Alcide, et, au bout de vingt-quatre heures, nous étions les meilleurs amis du monde. J’offris force tournées, il bavarda et je fus bientôt aussi renseigné que lui sur les habitudes et les manies du père Bénoni.
— Le vieux, me dit Alcide, est la crème des patrons… jamais un reproche… et le ménage n’est pas dur à faire… un coup de balai de temps en temps, quelques coups de plumeau par-ci par-là et c’est tout… Avec ça de la liberté, autant qu’on en veut, car Monsieur sort souvent… surtout le soir… Figurez-vous que, malgré ses soixante-sept ans, il court encore le guilledou… Si c’est pas honteux… un homme de son âge !… Mais je ne m’en plains pas, car j’en profite pour aller au cinéma… J’adore ça le cinéma, et vous ?
Alcide venait, sans qu’il s’en doutât, de me livrer l’appartement de son patron. C’était d’ailleurs une bonne bête que cet Alcide, et pour peu qu’on le flattât et surtout qu’on lui « rafraîchit la dalle » — suivant sa propre expression on en tirait tout ce qu’on voulait. Je lui donnai rendez-vous pour le soir même au cinéma des Ternes où il arriva, légèrement éméché.
En attendant que le spectacle commençât, nous causâmes, et mon nouvel ami me documenta non seulement sur son patron, mais encore sur le local où je m’apprêtais à pénétrer. La disposition des lieux m’était maintenant familière, et j’étais sûr de ne pas faire un pas de clerc. Tout en conversant avec le brave Alcide, j’explorais doucement ses poches, car une idée m’était venue. J’espérais qu’il avait sur lui les clefs de l’appartement, mais j’eus beau le fouiller avec ma dextérité habituelle, je ne trouvai rien qu’une pipe, une blague à tabac et un briquet.
Tout à coup, j’eus une inspiration… Je me tâtai, me tournai et me retournai sur mon fauteuil, puis dis à mon compagnon d’un air contrit :
— Ah !… il m’en arrive une bonne… Figurez-vous que j’ai perdu mes clefs…
— Alors, vous ne pourrez pas rentrer chez vous ?
— C’est à craindre… bah ! tant pis, je prendrai une chambre à l’hôtel… satanées clefs, va !… Je les aurai perdues dans le métro…
— Moi, dit Alcide, j’étais comme vous autrefois, je perdais toujours mes clefs… même que mon patron a failli me renvoyer pour cela, mais maintenant, cela ne m’arrivera plus, car lorsque je m’absente, je les laisse toujours chez le concierge.
J’étais fixé… l’effraction que je croyais pouvoir éviter devenait nécessaire. Heureusement que j’avais sur moi un attirail complet de cambrioleur.
Le spectacle commença. Alcide applaudit en voyant sur l’écran l’annonce d’un film sensationnel intitulé La Sandale Rouge.
— Ah ! me dit-il, ça, c’est un truc épatant… Je l’ai déjà vu trois fois, et je ne m’en lasse jamais… Il y a là-dedans, un sacré type de détective qui est joliment malin et un chien qui joue absolument comme un homme.
Les scènes se succédaient avec une rapidité folle, car le film était très long, paraît-il, et il fallait l’expédier en un nombre déterminé de minutes, afin le programme pût être épuisé à onze heures juste.
Par une ironie assez étrange, cela débutait par un cambriolage accompli dans des conditions particulièrement difficiles, mais comme on voyait bien que ce n’étaient pas des « professionnels » qui jouaient dans cette pièce ! Le cambrioleur était d’une maladresse insigne et opérait avec une naïveté ridicule. Il forçait un coffre-fort comme il eût ouvert un placard, et ne prenait même pas la peine de masquer avec le pan de sa jaquette la petite lampe électrique suspendue à la ceinture de son pantalon.
Quant au détective, c’était bien le plus grand benêt qui se pût voir, et il serait à souhaiter que nous n’eussions jamais devant nous des gaillards plus dégourdis.
Non, vraiment, ceux qui se figurent que des films semblables peuvent inspirer les jeunes gens qui se destinent au cambriolage, ceux-là se trompent étrangement. De pareils spectacles ne servent qu’à fausser l’esprit des débutants, et à faire d’eux ce que nous appelons des « mazettes ». Ils veulent, dans la vie, opérer comme au cinéma et se font cueillir à la douzaine.
Si un jour, je me décide à paraître sur l’écran — la chose n’est pas impossible, après tout — alors, le public comprendra la différence qu’il y a entre un vulgaire escarpe et un artiste de la cambriole.
Profitant d’un moment où Alcide était absolument empaumé par une scène tragique, je me levai doucement, longeai dans l’obscurité l’étroit couloir ménagé entre les fauteuils et, deux minutes après, j’étais dans la rue.
Du cinéma des Ternes au 210 du boulevard de Courcelles, il n’y a que deux pas, et pendant qu’Alcide suivait attentivement les phases palpitantes de la Sandale Rouge, un autre cambrioleur, qu’il ne soupçonnait pas, montait tranquillement l’escalier qui conduit à l’appartement de M. Bénoni. Le vieil antiquaire habitait au troisième et j’étais sûr, ce soir-là, de ne pas le rencontrer chez lui, car, ainsi que me l’avait appris ce bon Alcide, il passait sa soirée chez une petite poule des Batignolles.
Au premier étage, je rencontrai une dame et m’effaçai poliment. Elle me décocha un petit coup d’œil en coulisse et je crus remarquer que je ne lui étais pas indifférent. Je continuai à monter lentement, et arrivé au troisième, je me penchai sur la rampe de l’escalier… Personne !… J’écoutai quelques instants et, n’entendant aucun bruit, je m’approchai de la porte de l’antiquaire.
Tirant alors de ma poche mon trousseau de cambrioleur, je me mis à caresser doucement la serrure qui s’ouvrit du premier coup, car cet étourdi d’Alcide n’avait même pas pris la précaution de donner un tour de clef.
Je refermai la porte sans bruit et fis jouer le déclic, de ma petite lampe de poche. J’étais dans une antichambre tendue d’andrinople ; un tapis moelleux recouvrait le parquet ; des meubles qui n’avaient rien d’ancien étaient placés le long de la muraille et je m’étonnai de ne pas trouver là quelqu’un de ces bahuts, de ces coffres à ferrures, de ces cassettes moyenâgeuses qui ornent habituellement l’intérieur d’un collectionneur. Ce qui me frappa aussi, ce fut l’extrême propreté de cet appartement où je m’attendais à voir tout pêle-mêle. Une grande porte en laqué blanc et à bouton de cuivre ouvragé s’offrait en face de moi. D’après le plan que m’avait involontairement fourni Alcide, c’était là que devait se trouver le cabinet de M. Bénoni. Il s’agissait de faire vite, car j’ignorais à quelle heure devait rentrer le bonhomme.
Je tournai résolument le bouton, la porte s’ouvrit, mais ô surprise ! un flot de clarté m’aveugla dès l’entrée, en même temps qu’une voix dure, prononçait, avec un accent bizarre : « Un pas de plus et vous êtes mort !… »
C’est seulement à cette minute que j’aperçus celui qui me menaçait. Il se tenait debout, derrière un bureau et braquait sur moi le canon d’un revolver. C’était un homme d’une quarantaine d’années, solidement bâti, très brun, et dont les yeux brillaient comme des ampoules électriques.
J’avais eu un mouvement de recul, mais la voix reprit, plus sèche, plus impérieuse :
— Si vous tentez de fuir, je tire !
Et ce disant, l’inconnu s’avança vers moi.
Nous sommes, dans notre métier, préparés à toutes les surprises, mais avouez que celle-là était plutôt roide.
Je me ressaisis cependant et cherchai une excuse :
— Pardon… Monsieur… balbutiai-je. Je croyais trouver ici M. Bénoni à qui j’ai une affaire à proposer et…
L’homme brun éclata de rire, eut un haussement d’épaules, puis m’ordonna de lever les mains, ce que je fis sans murmurer, car je voyais toujours le petit canon du revolver braqué entre mes deux yeux…
— Je vous assure… repris-je… c’est à M. Bénoni que je désirais parler… il était d’ailleurs prévenu de ma visite…
— Ah ! répliqua mon interlocuteur d’un ton narquois… ah ! il était prévenu de votre visite… Est-ce lui aussi qui vous avait prié de crocheter sa serrure ?…
— Je…
— Taisez-vous, gredin… vous êtes un cambrioleur… un maladroit cambrioleur, voilà tout…
C’était la première fois que l’on m’appelait maladroit et c’était la première fois aussi que je me trouvais face à face avec un de mes « fournisseurs » habituels.
On a beau avoir du sang-froid, ces coups imprévus vous coupent bras et jambes.
— Oui, un maladroit… reprit l’homme brun avec un haussement d’épaules… on prend ses informations, que diable ! et l’on ne vient pas stupidement se jeter dans la gueule du loup…
Ne sachant que répondre, je répétais machinalement le nom de M. Bénoni…
— Qu’est-ce que vous me chantez avec votre Bénoni ?… est-ce que je le connais, moi, votre Bénoni ?… vous cherchez une défaite, mais ça ne prend pas… vous savez… Vous êtes ici chez le comte Melchior de Manzana, attaché d’ambassade…
— Cependant… fis-je avec un peu plus d’assurance, c’est bien ici le troisième étage ?
— Mais non… idiot… c’est le deuxième… vous n’avez donc pas remarqué qu’il y a un entresol… Faut-il que vous soyez bouché, tout de même… Et vous vous livrez au cambriolage !… c’est probablement la première fois que vous opérez ?…
— Oui… c’est la première fois, avouai-je humblement, dans l’espoir d’attendrir l’homme au revolver…
— Vous n’aurez pas de sitôt l’envie de recommencer, prononça-t-il sèchement, car je vais incontinent vous remettre entre les mains des sergents de ville…
— Oh ! je vous en supplie… ne faites pas cela… ayez pitié de moi… je ne vous ai, en somme, causé aucun préjudice… et puis, j’ai une circonstance atténuante… ce n’est pas chez vous que je venais… il y a erreur.
— Vous êtes bon, vous, avec vos erreurs… Ah ! vous prenez gaîment les choses ! Vous vous introduisez chez les gens dans l’intention de mettre à sac leur appartement et quand vous tombez sur quelqu’un qui ne veut pas se laisser faire vous vous excusez, en disant : « Pardon… il y a erreur… » C’est commode cela… oui, très commode en vérité, mais je ne saurais admettre une telle excuse… mon devoir est de vous faire arrêter, car si je vous laissais partir, demain vous recommenceriez votre joli métier et feriez peut-être des victimes…
— Oh ! non, je vous le jure, répondis-je d’un ton larmoyant…
— Ta, ta, ta !… tout ça, c’est de la blague… vous cherchez à m’apitoyer, mais vous n’y réussirez pas… D’ailleurs, vous ne dites pas un mot de vrai… vous prétendez vous être trompé d’étage, cela n’est pas exact….
— Je vous jure que j’allais chez M. Bénoni…
— Oui… dites que vous y êtes allé, et que, n’ayant rien trouvé chez lui, vous avez pensé vous rattraper ici… Ça ne prend pas… allez raconter cela à d’autres, mais pas à moi…
Je crus devoir jouer le grand jeu.
— Monsieur, écoutez-moi, répliquai-je… je sais qu’il sera bien difficile de vous convaincre… cependant… si vous voulez m’accorder quelques minutes d’attention…
— Vous n’allez pas me faire une conférence, je suppose… Ah ! non, en voilà assez !… Allons, ouste ! descendez avec moi chez le concierge…
— Une seconde, je vous en prie…
— Descendez, vous dis-je…
— Vous ne voulez pas m’écouter, vous avez tort !… Tenez, je m’explique… Je ne sais quelle est votre situation de fortune, mais si vous consentez à me laisser libre, je vous donne cinq cent mille francs…
— Vous êtes fou…
— Non… c’est sérieux… tout ce qu’il y a de plus sérieux… Vous m’avez pris pour un cambrioleur… eh bien ! vous vous êtes trompé… je suis riche… riche à millions, entendez-vous.
Mon interlocuteur me regarda d’un air inquiet…
Comme je m’étais rapproché, il crut sans doute que j’allais me jeter sur lui, car il leva de nouveau son revolver, mais sans me laisser intimider par ce geste, je repris avec plus de force :