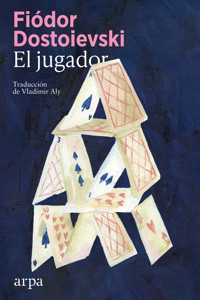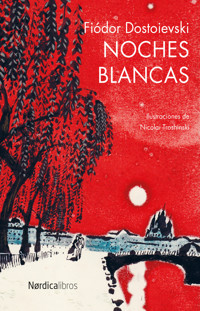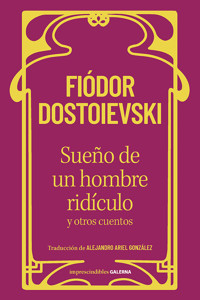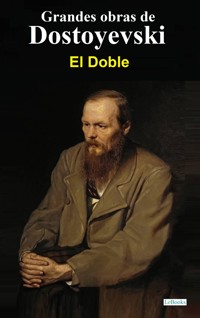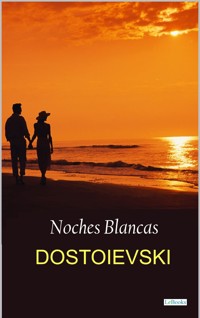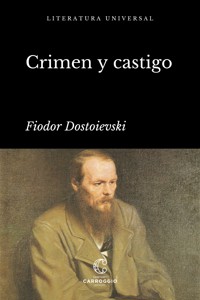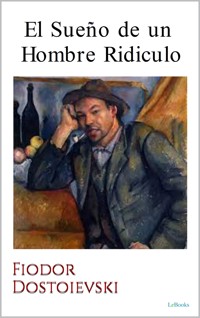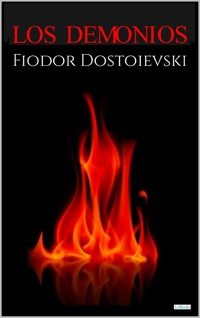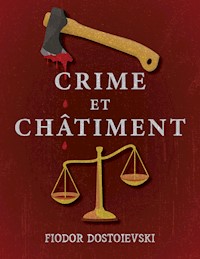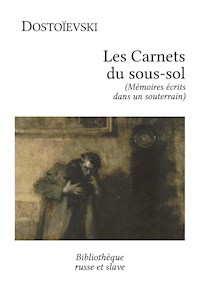
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bibliothèque russe et slave
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Les Mémoires écrits dans un souterrain, publiés en 1864 et présentés comme deux fragments des mémoires d'un homme reclus, coupé d'un monde qu'il hait et qui l'humilie et dans lesquels il expose sa conception du monde et quelques épisodes de sa vie, sont en quelque sorte le prélude et la matrice des grands romans de Dostoïevski.
« Je suis malade... Je suis méchant. [...] J'avais alors vingt-quatre ans. Ma vie était déjà morne, déréglée, farouchement solitaire. Je ne fréquentais personne, évitais même les conversations et me blottissais toujours davantage dans mon coin. »
Traduction d'Henri Mongault, 1926.
EXTRAIT
Je suis malade... Je suis méchant. Je n’ai rien d’attrayant. Je crois avoir une maladie de foie. Au reste, je n’entends rien à ma maladie et ignore sa nature. Je ne me soigne pas et ne me suis jamais soigné, malgré l’estime que je professe pour la médecine et les médecins. De plus, je suis fort superstitieux, ou du moins suffisamment pour estimer la médecine. (Mon instruction ne m’empêche pas d’être superstitieux.) Non, je ne veux pas me soigner, par méchanceté. Vous ne comprenez sûrement pas. Mais moi je comprends. Bien entendu, je ne saurais vous expliquer qui pâtira de ma méchanceté ; je sais parfaitement que je ne puis « faire une crasse » aux médecins en ne recourant pas à leurs soins ; je n’ignore point qu’en agissant de la sorte, je ne cause du tort qu’à moi seul. Pourtant, si je ne me soigne pas, c’est par méchanceté. Je souffre du foie : eh bien, qu’il souffre encore davantage !
À PROPOS DE L'AUTEUR
Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski est un écrivain russe, né à Moscou le 30 octobre 1821 et mort à Saint-Pétersbourg le 28 janvier 1881. Considéré comme l'un des plus grands romanciers russes, il a influencé de nombreux écrivains et philosophes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BIBLIOTHÈQUE RUSSE ET SLAVE
— LITTÉRATURE RUSSE —
Fyodor Dostoïevski
Достоевский Фёдор Михайлович
1821 – 1881
MÉMOIRES ÉCRITS DANS UN SOUTERRAIN(Les Carnets du sous-sol)
Записки из подполья
1832
Traduction d’Henri Mongault et Marc Laval, Paris, 1926.
© La Bibliothèque russe et slave, 2014
© Henri Mongault et Marc Laval, 1926, 1955
Couverture : Serafino MACCHIATI, Le Visionnaire [détail] (1904)
Chez le même éditeur — Littérature russe
1. GOGOLLes Âmes mortes. Traduction d’Henri Mongault
2. TOURGUENIEVMémoires d’un chasseur. Traduction d’Henri Mongault
3. TOLSTOÏLes Récits de Sébastopol. Traduction de Louis Jousserandot
4. DOSTOÏEVSKIUn joueur. Traduction d’Henri Mongault
5. TOLSTOÏAnna Karénine. Traduction d’Henri Mongault
6. MEREJKOVSKILa Mort des dieux. Julien l’Apostat. Traduction d’Henri Mongault
7. BABELCavalerie rouge. Traduction de Maurice Parijanine
8. KOROLENKOLe Musicien aveugle. Traduction de Zinovy Lvovsky
9. KOUPRINELe Duel. Traduction d’Henri Mongault
10. GOGOLLe Révizor — Le Mariage. Traduction de Marc Semenoff
11. DOSTOÏEVSKIStépantchikovo et ses habitants. Traduction d’Henri Mongault
12. Les Bylines russes — La Geste du Prince Igor. Traductions de Louis Jousserandot et d’Henri Grégoire
13. PISSEMSKIMille âmes. Traduction de Victor Derély
14. RECHETNIKOVCeux de Podlipnaïa. Traduction de Charles Neyroud
15. TOURGUENIEVPoèmes en prose. Traduction de Charles Salomon
16. GONTCHAROVOblomov. Traduction de Jean Leclère
17. GOGOLVeillées d’Ukraine. Traduction d’Eugénie Tchernosvitow
18. DOSTOÏEVSKIMémoires écrits dans un souterrain. Traduction d’Henri Mongault
19. KOUPRINELe Bracelet de grenats — Olessia. Traduction d’Henri Mongault
20. GOGOLTarass Boulba. Traduction de Marc Semenoff
PREMIÈRE PARTIE
Le souterrain.
Bien entendu, l’auteur des « Mémoires » et les « Mémoires » eux-mêmes sont imaginaires. Néanmoins des personnages tels que le rédacteur de ces mémoires non seulement peuvent, mais même doivent exister dans notre société, étant donné les circonstances générales dans lesquelles elle s’est formée. Je voulais présenter au public, plus en relief qu’à l’ordinaire, un des caractères d’une époque récente. C’est l’un des représentants d’une génération qui s’en va. Dans ce fragment, intitulé « Le Souterrain », ce personnage se présente, lui et sa manière de voir, et veut pour ainsi dire expliquer les causes qui l’ont suscité et devaient le susciter dans notre milieu. Dans le fragment suivant viendront les véritables « Mémoires » de ce personnage sur quelques événements de sa vie.
FIODOR DOSTOÏEVSKY.
1
JE suis malade... Je suis méchant. Je n’ai rien d’attrayant. Je crois avoir une maladie de foie. Au reste, je n’entends rien à ma maladie et ignore sa nature. Je ne me soigne pas et ne me suis jamais soigné, malgré l’estime que je professe pour la médecine et les médecins. De plus, je suis fort superstitieux, ou du moins suffisamment pour estimer la médecine. (Mon instruction ne m’empêche pas d’être superstitieux.) Non, je ne veux pas me soigner, par méchanceté. Vous ne comprenez sûrement pas. Mais moi je comprends. Bien entendu, je ne saurais vous expliquer qui pâtira de ma méchanceté ; je sais parfaitement que je ne puis « faire une crasse » aux médecins en ne recourant pas à leurs soins ; je n’ignore point qu’en agissant de la sorte, je ne cause du tort qu’à moi seul. Pourtant, si je ne me soigne pas, c’est par méchanceté. Je souffre du foie : eh bien, qu’il souffre encore davantage !
Il y a longtemps que je mène cette existence : vingt ans. J’en ai maintenant quarante. Je suis un ancien fonctionnaire, un fonctionnaire grincheux. Je trouvais du plaisir à être grossier. Ne prenant pas de pots-de-vin, je me devais bien cette compensation. (Piètre saillie : mais je ne la bifferai pas. Je l’ai écrite dans l’idée qu’elle serait très spirituelle ; je vois à présent que je voulais seulement faire le malin ; aussi la laisserai-je exprès !) Lorsque des solliciteurs en quête de renseignements s’approchaient de mon bureau, je grinçais des dents et j’éprouvais une jouissance toujours nouvelle quand j’avais réussi à les mortifier. Et j’y réussissais presque toujours. C’étaient pour la plupart des gens timides : des solliciteurs, n’est-ce pas ! Quelques-uns pourtant crânaient, un officier notamment pour qui je ressentais une aversion particulière. Il refusait de plier et faisait sonner son sabre d’une manière déplaisante. Durant dix-huit mois ce fut la guerre à cause de ce sabre. Je finis par avoir le dessus. Il cessa de le faire sonner. D’ailleurs cela se passait dans ma jeunesse. Mais savez-vous, messieurs, en quoi consistait l’essentiel de ma méchanceté ? Le nœud de l’affaire, le comble de la vilenie résidaient dans le fait qu’à chaque instant, même lors de mes pires accès d’humeur, je m’avouais honteusement que je n’étais ni méchant ni même aigri, et que je prenais plaisir à effaroucher inutilement les moineaux. J’ai l’écume aux lèvres, mais apportez-moi une bagatelle, offrez-moi du thé sucré, je vais me calmer et même m’attendrir, dussé-je ensuite être furieux contre moi-même et de honte souffrir d’insomnie durant des mois. Tel est mon caractère.
Je viens de mentir en disant que j’étais un fonctionnaire grincheux. J’ai menti par méchanceté. Je badinais seulement avec les solliciteurs et l’officier ; au fond je n’aurais jamais pu devenir méchant. À chaque instant je discernais en moi une foule d’éléments tout à fait opposés à la méchanceté. Je les sentais grouiller en moi. Je savais que toute ma vie ils avaient grouillé en moi, demandant à sortir ; mais je les retenais, ne les laissais pas sortir exprès. Ils me tourmentaient, honteusement, jusqu’à me donner des convulsions, et m’excédaient, oh ! comme ils m’excédaient ! Ne vous semble-t-il pas, messieurs, que je me repens maintenant devant vous, que je vous demande pardon ?... Je suis sûr que vous en avez l’impression... Peu m’importe d’ailleurs...
Je n’ai pas su devenir non seulement méchant, mais même quoi que ce soit : ni méchant, ni gredin, ni honnête ; ni héros, ni moucheron. Maintenant je termine mes jours dans mon coin, en m’aigrissant par cette maligne et vaine consolation qu’un homme intelligent ne peut sérieusement devenir quelque chose, que seul un imbécile le devient. Oui, l’homme du XIXe siècle est moralement tenu d’être une créature sans caractère ; l’homme de caractère, l’homme d’action doit être une créature bornée. C’est ma conviction de quadragénaire. J’ai maintenant quarante ans ; or, quarante ans, c’est toute la vie, c’est l’extrême vieillesse. Vivre plus de quarante ans est inconvenant, vulgaire, immoral ! Qui vit plus de quarante ans ? Répondez sincèrement, de bonne foi. Je vais vous le dire : les imbéciles et les gredins. Je le dirai en face à tous les vieillards, à tous ces respectables vieillards aux cheveux argentés et au parfum suave ! Je le dirai en face au monde entier ! J’ai le droit de parler ainsi, car je vivrai jusqu’à soixante ans. Jusqu’à soixante-dix ! Jusqu’à quatre-vingts !... Attendez ! Laissez-moi reprendre haleine...
Assurément vous pensez que je veux vous faire rire ? Là encore vous êtes dans l’erreur. Je ne suis pas si gai qu’il vous semble, ou que peut-être il vous semble ; d’ailleurs si, agacés de ce bavardage (or je sens déjà que vous êtes agacés), il vous prend fantaisie de me demander qui je suis, — je répondrai : un assesseur de collège1. J’ai servi l’État afin d’avoir de quoi manger (uniquement pour cela) ; et lorsque, l’année dernière, un parent éloigné me laissa par testament six mille roubles, je démissionnai aussitôt et m’installai dans ce coin. Auparavant j’y campais ; maintenant je m’y suis installé. Ma chambre est misérable, au bout de la ville. J’ai pour domestique une vieille paysanne, méchante par bêtise, et qui de plus sent toujours mauvais. On m’assure que le climat de Pétersbourg m’est nuisible, et qu’avec mes maigres ressources il est fort cher d’y vivre. Je sais tout cela, je le sais mieux que tous ces donneurs de conseils, sages et expérimentés. Mais je reste à Pétersbourg ; je n’en partirai pas ! Je ne pars pas parce que... Eh ! qu’est-ce que ça peut bien faire, que je parte ou non ?
Après tout, de quoi un homme comme il faut peut-il parler avec le plus de plaisir ?
Réponse : de soi.
Eh bien ! je vais parler de moi.
2
JE veux maintenant vous raconter, messieurs, que vous désiriez ou non l’entendre, pourquoi je n’ai pas su devenir même un moucheron. Je vous déclare solennellement que bien des fois j’ai voulu le devenir. Mais je n’y ai pas réussi. L’excès de conscience est une vraie maladie, je vous le jure. Dans la pratique, il suffirait amplement de la conscience ordinaire, c’est-à-dire de la moitié, du quart de la portion qui échoit au malheureux homme de notre XIXe siècle, ayant en outre la malchance d’habiter Pétersbourg, la ville la plus abstraite et la plus réfléchie de l’univers. (Il y a des villes réfléchies et irréfléchies.) Il suffirait parfaitement, par exemple, de la conscience dont vivent tous ceux qu’on appelle les hommes immédiats2, les hommes d’action. Je parie que vous pensez que j’écris tout cela par bravade, pour faire de l’esprit aux dépens des hommes d’action, et que, par bravade de mauvais ton, je fais sonner mon sabre, comme mon officier. Voyons, messieurs, qui peut tirer vanité de ses maladies et en faire parade ?
D’ailleurs, suis-je seul à agir ainsi ? — Tous le font ; ils tirent vanité de leurs maladies, et moi peut-être plus que tous. Ne discutons pas ; mon objection est absurde. Pourtant je suis persuadé que non seulement beaucoup de conscience, mais même toute conscience est une maladie. J’insiste là-dessus. Laissons cela pour un instant. Dites-moi : d’où vient que parfois comme à dessein — aux moments mêmes où j’étais le plus capable de concevoir « toutes les finesses du sublime », comme on disait jadis chez nous — il m’arrivait non de concevoir mais de commettre les actions les plus vilaines, celles que... bref, celles que tout le monde commet sans doute, mais qui survenaient comme à dessein, lorsque je me rendais le mieux compte qu’il ne fallait pas les commettre ? Plus j’avais conscience du bien et du sublime, plus je m’enfonçais dans ma fange au risque de m’y enliser complètement. Mais surtout tout cela semblait se trouver en moi, non par hasard, mais comme à juste titre ; comme si c’était pour moi l’état le plus normal et non une maladie et une corruption ; si bien que je finis par perdre l’envie de lutter contre cette corruption. Finalement je crus presque (et peut-être je crus vraiment) que ce devait être mon état normal. Mais au début, quels tourments j’endurai dans cette lutte ! Je ne croyais pas qu’il en fût de même pour les autres, et toute ma vie je dissimulai cela comme un secret. J’avais honte (peut-être même ai-je encore honte maintenant) ; j’allais jusqu’à ressentir une jouissance secrète, anormale, vile, à revenir parfois dans mon coin par une nuit infâme de Pétersbourg ; à songer avec force que ce jour-là j’avais encore commis une vilenie, qu’on ne peut changer le fait accompli, et à me ronger intérieurement, à me torturer, jusqu’à ce que la douleur se transformât en une douceur honteuse, maudite, et finalement en une vraie jouissance ! Oui, en jouissance. J’insiste là-dessus. Voilà pourquoi j’ai dit que je voulais savoir avec certitude si les autres éprouvaient de pareilles jouissances. Je m’explique : la jouissance provient précisément de la conscience trop claire de l’humiliation ; de ce qu’on sent soi-même qu’on est arrivé à la dernière limite, que c’est affreux, mais ne peut être autrement ; qu’il n’y a pas d’issue, qu’on ne deviendra jamais un autre homme, que si même il restait encore du temps et de la foi pour faire peau neuve, on ne le voudrait sûrement pas ; le voulût-on, on n’arriverait pourtant à rien, car en réalité il n’y aurait peut-être aucune transformation possible. Mais surtout et finalement, parce que tout cela se passe d’après les lois normales et fondamentales de l’hyperconscience et d’après l’inertie qui découle directement de ces lois, et qu’en conséquence non seulement on ne fait pas peau neuve, mais on ne fait rien du tout. Il résulte, par exemple, de l’hyperconscience qu’on a raison d’être un gredin ; comme si c’était pour le gredin une consolation de sentir qu’il est vraiment un gredin ! Mais en voilà assez... J’ai disserté ; et qu’ai-je expliqué ? Par quoi s’explique ici la jouissance ? Mais je m’expliquerai. J’irai jusqu’au bout ! C’est pour cela que j’ai pris la plume...
J’ai, par exemple, beaucoup d’amour-propre. Je suis méfiant et susceptible comme un bossu ou un nain ; mais, en vérité, il y a eu des moments où, s’il m’était arrivé de recevoir un soufflet, je m’en serais même réjoui. Je parle sérieusement : j’aurais su trouver là aussi une sorte de jouissance, bien entendu la jouissance du désespoir, mais c’est dans le désespoir qu’on éprouve les plus brûlantes jouissances, surtout lorsqu’on conçoit fortement que la situation est sans issue. Or, dans le cas du soufflet, la conscience du traitement infligé accable. Et surtout j’aurais beau me raisonner, je me sentirais toujours le premier coupable et, ce qui est le plus vexant, coupable innocemment et, pour ainsi dire, d’après les lois de la nature. Coupable, d’abord, parce que je suis plus intelligent que tous ceux qui m’entourent. (Je me suis toujours estimé plus intelligent que mon entourage, et parfois, le croirez-vous, je m’en suis même fait scrupule. Du moins, j’ai, toute ma vie, regardé les gens de côté, et n’ai jamais pu les dévisager.) Enfin je suis coupable parce que, s’il y avait en moi de la générosité, je n’en souffrirais que davantage en concevant toute son inutilité. Je ne saurais certainement rien faire de ma générosité : ni pardonner, car l’offenseur m’a peut-être frappé d’après les lois de la nature, auxquelles on ne saurait pardonner ; ni oublier, car, bien qu’il s’agisse des lois de la nature, c’est quand même offensant. Enfin, si même je ne voulais pas être généreux et désirais au contraire me venger de l’offenseur, cela me serait tout à fait impossible, car je ne me déciderais sûrement pas à agir, même si je le pouvais. Pourquoi cela ? Je veux en dire deux mots à part.
3
CHEZ les gens qui savent se venger et en général se défendre, comment, par exemple, cela se passera-t-il ? Dès que le sentiment de la vengeance, supposons, s’empare d’eux, il domine alors leur être tout entier. Pareil personnage fonce droit au but, les cornes baissées, comme un taureau furieux ; et seul un mur pourrait l’arrêter. (À propos : devant un mur pareils personnages, c’est-à-dire les hommes immédiats, les hommes d’action, s’inclinent sincèrement. Pour eux un mur n’est pas une excuse, comme par exemple pour nous, chez qui la pensée a supprimé l’action ; ce n’est pas un prétexte pour rebrousser chemin, prétexte auquel les gens de notre sorte ne croient pas eux-mêmes, mais dont ils sont toujours enchantés. Non, ils s’inclinent en toute sincérité. Pour eux un mur a quelque chose de calmant, de définitif, peut-être même de mystique. C’est une sorte de résolvant moral... Mais il sera question du mur après.) Eh bien ! c’est cet homme immédiat que je considère comme l’homme réel, normal, tel que voulait le voir la tendre mère nature elle-même, en le mettant au monde. Je l’envie furieusement. Il est stupide, j’en conviens, mais peut-être que l’homme normal doit être stupide, qu’en savez-vous ? C’est peut-être même fort beau. Et je suis d’autant plus convaincu de cette quasi-présomption, que si par exemple on prend l’antithèse de l’homme normal, c’est-à-dire l’homme hyperconscient, sorti évidemment non du sein de la nature, mais d’une cornue (c’est presque du mysticisme, monsieur, mais je présume cela aussi) — cet homme de cornue s’efface parfois à un tel point devant son antithèse qu’il s’estime lui - même loyalement, avec toute son hyperconscience, une souris et non un homme. Admettons que ce soit une souris hyperconsciente, c’est tout de même une souris ; tandis que l’autre est un homme, et par conséquent... etc. Et surtout il s’estime lui-même une souris ; personne ne l’en prie ; or c’est un point important. Considérons maintenant cette souris en action. Admettons, par exemple, qu’elle soit aussi offensée (elle l’est presque toujours) et désire aussi se venger. Il y a peut-être plus de rancune accumulée en elle que dans l’homme de la nature et de la vérité3. Le désir vil et bas de rendre le mal à l’offenseur la travaille peut-être davantage que l’homme de la nature et de la vérité ; car, par sa bêtise innée, l’homme de la nature et de la vérité considère sa vengeance comme un simple acte de justice, et la souris, par suite de son hyperconscience, nie ici la justice. On arrive enfin au fait, à l’acte même de la vengeance. En plus de sa vilenie initiale, la malheureuse souris a déjà eu le temps d’accumuler autour d’elle d’autres vilenies, sous forme de questions et de doutes ; elle a joint à une question tant d’autres questions insolubles que, forcément, il se forme autour d’elle une mixture fatale, une boue infecte, composée de ses doutes, de ses émotions, enfin des crachats que lui envoient les hommes immédiats, qui font solennellement cercle sous forme de juges et de dictateurs, et rient d’elle à gorge déployée. Bien entendu, il ne lui reste qu’à faire de la patte un geste de désenchantement sur tout, et avec un sourire de mépris affecté, auquel elle-même ne croit pas, à se retirer honteusement dans son trou. Là, dans son souterrain sordide, infect, notre souris offensée, humiliée, bafouée, se plonge aussitôt dans une rancune froide, venimeuse, et surtout éternelle. Durant quarante ans, elle se rappellera son injure jusqu’aux moindres détails, les plus honteux ; et chaque fois elle y ajoutera de son cru des détails encore plus honteux, en s’irritant malignement par le jeu de sa propre imagination. Elle-même rougira de son imagination ; pourtant elle se rappellera tout, ruminera tout, inventera des offenses imaginaires, sous prétexte qu’elles auraient pu aussi arriver, et ne pardonnera rien. Elle commencera bien à se venger, mais par à-coups, en détail, de derrière un coin, incognito, sans croire à son droit de se venger ni au succès de sa vengeance, et sachant d’avance qu’elle-même souffrira cent fois plus de ces tentatives que celui qui en est l’objet et qui n’en aura cure. À son lit de mort elle se remémorera tout avec les intérêts accumulés dans l’intervalle et... Mais précisément ce demi-désespoir, froid et répugnant, cet ensevelissement conscient pour quarante ans dans un souterrain, sous l’empire d’un chagrin, cette situation sans issue, qui, bien que provoquée, laisse place à une lueur d’espérance, tout ce poison des désirs inassouvis, refoulés, toute cette fièvre d’hésitations, de résolutions prises pour toujours et de repentirs reparaissant un instant après — tout cela constitue l’essence de la jouissance bizarre dont j’ai parlé. Elle est si subtile, parfois si difficile à concevoir, que les gens tant soit peu bornés ou même simplement les gens aux nerfs solides n’y comprennent rien du tout. « Peut-être que ceux qui n’ont jamais reçu de soufflets ne la comprennent pas non plus », ajouterez-vous en souriant. Et vous insinuerez ainsi poliment que, dans ma vie, j’ai peut-être reçu un soufflet, et parle donc en connaisseur. Je parie que vous le pensez. Mais rassurez-vous, je n’ai pas reçu de soufflet, bien que votre opinion là-dessus me soit tout à fait indifférente. Je regrette peut-être de n’en avoir pas assez donné dans ma vie. Mais en voilà assez ; pas un mot de plus sur ce thème fort intéressant pour vous.
Je continue tranquillement à parler des gens aux nerfs solides, qui ne comprennent pas un certain raffinement des jouissances. Ces messieurs, dans certains cas par exemple, tout en mugissant, comme des taureaux, à pleine gorge, ce qui leur fait grand honneur, se calment aussitôt devant l’impossible, comme je l’ai déjà dit. L’impossible, c’est un mur de pierre ! Quel mur de pierre ? Mais, bien entendu, les lois de la nature, les déductions des sciences naturelles, les mathématiques. Du moment qu’on vous démontre, par exemple, que vous descendez du singe, inutile de vous renfrogner ; admettez la chose telle quelle. Du moment qu’on vous démontre qu’au fond une goutte de votre propre graisse doit vous être plus chère que cent mille de vos semblables, que c’est à cela que se ramène finalement tout ce qu’on appelle vertus, devoirs et autres rêveries et préjugés, admettez la chose, il n’y a rien à faire ; car « deux fois deux font quatre », c’est un axiome. Essayez de le nier.
« Permettez, vous criera-t-on, impossible de s’insurger ; c’est « deux fois deux font quatre » ! La nature ne vous consulte pas ; elle n’a cure de vos désirs, et peu lui chaut que ses lois vous plaisent ou non. Vous êtes obligés de l’accepter telle qu’elle est, et par conséquent d’accepter aussi tous ses résultats. Un mur est donc un mur... etc., etc. »
Mon Dieu, que m’importent les lois de la nature et de l’arithmétique, lorsque, pour une raison quelconque, ces lois et « deux fois deux font quatre » me délaissent ? Bien entendu, je ne briserai pas ce mur avec mon front ; mais je ne me résignerai pas uniquement parce que c’est un mur de pierre et que les forces m’ont manqué.
Comme si ce mur de pierre était pour de bon un apaisement et contenait ne fût-ce qu’une parole de paix, seulement parce qu’il représente « deux fois deux font quatre ». Ô absurdité des absurdités ! Ne vaut-il pas mieux tout comprendre, tout concevoir, toutes les impossibilités et toutes les murailles de pierre ; ne s’incliner devant aucune d’entre elles, si cela vous répugne ; aboutir par les opérations logiques les plus rigoureuses aux conclusions les plus répugnantes sur le thème éternel de sa propre responsabilité à propos du mur de pierre, bien que le contraire saute aux yeux ; et par suite, en silence et en grinçant des dents, s’engourdir dans l’inertie, en rêvant qu’on ne peut même pas se fâcher contre quelqu’un ; qu’il ne se trouve pas d’objet à qui s’en prendre et peut-être qu’il ne s’en trouvera jamais ; qu’il y a ici une substitution, un truc, une tromperie ; que c’est tout bonnement la bouteille à encre, — on ne sait qui et on ne sait quoi, — mais que, malgré toutes ces incertitudes et ces trucs, vous avez pourtant mal, et d’autant plus mal que vous en ignorez la cause !
4
HA, ha, ha ! — vous exclamerez-vous en riant — mais après cela vous trouverez aussi une jouissance dans le mal de dents ! — Et puis ? Il y a aussi de la jouissance dans le mal de dents, répondrai-je. Je sais qu’il y en a, car j’ai eu mal aux dents tout un mois. Certes, on ne s’irrite pas en silence, on gémit ; mais ces gémissements ne sont pas francs, ils sont malicieux ; or la malice est le nœud de l’affaire. Ces gémissements expriment la jouissance du patient ; s’il n’y trouvait pas de plaisir, il ne les pousserait pas. C’est un bon exemple, messieurs, et je vais le développer. Dans ces gémissements s’exprime d’abord toute l’inutilité de votre mal, humiliante pour votre conscience ; toute la légalité de la nature, dont vous vous moquez, bien sûr, mais dont vous souffrez pourtant, et elle non. Ensuite, la conscience que sans avoir d’ennemi vous avez mal ; la conscience qu’avec tous les dentistes possibles, vous êtes entièrement l’esclave de vos dents ; que si quelqu’un le veut, elles cesseront de vous faire mal, et que s’il ne veut pas, cela durera encore trois mois ; et qu’enfin, si vous n’êtes pas d’accord et continuez à protester, il ne vous reste en guise de consolation qu’à vous fouetter vous-même, à taper du poing contre votre mur, et rien d’autre. Eh bien ! de ces injures sanglantes, de ces railleries venues on ne sait d’où, naît finalement la jouissance, jouissance qui atteint parfois la volupté suprême. Je vous prie, messieurs, d’écouter une fois gémir un homme instruit du XIXe