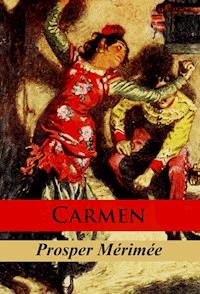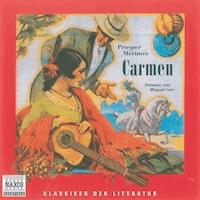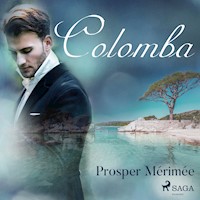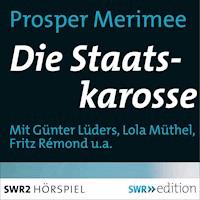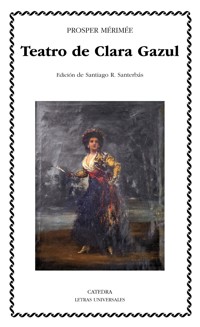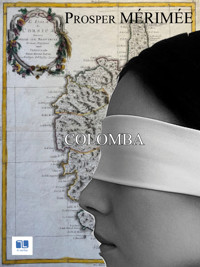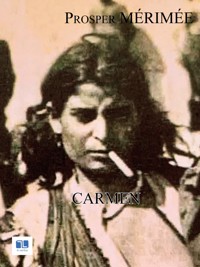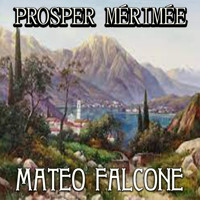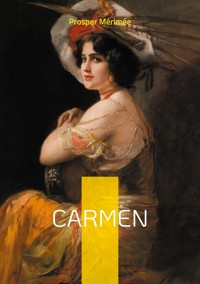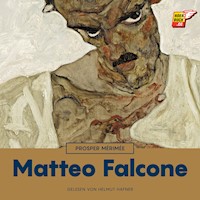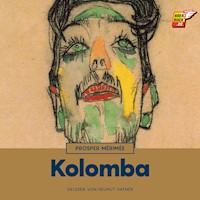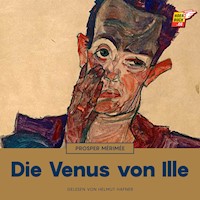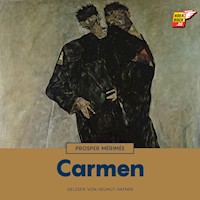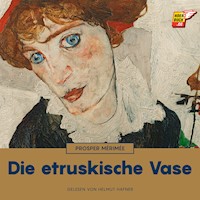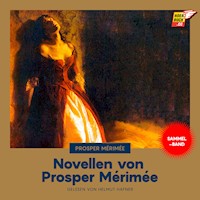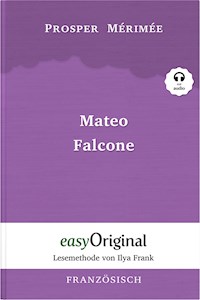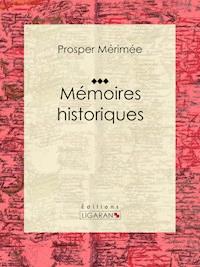
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "M. Prescott s'est acquis par ses travaux historiques une réputation méritée aux États-Unis, sa patrie, et, ce qui veut encore mieux, en Angleterre, où ses ouvrages ont eu plusieurs éditions. Il a même été traduit en France, et parmi les lecteurs de la Revue il y en a peu sans doute à qui son nom ne soit familier. L'histoire d'Espagne paraît avoir été sa part l'objet d'une étude assidue. Sans parler de la Conquête du Mexique et de celle du Pérou, on lui doit une..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335055429
©Ligaran 2015
M. Prescott s’est acquis par ses travaux historiques une réputation méritée aux États-Unis, sa patrie, et, ce qui vaut encore mieux, en Angleterre, où ses ouvrages ont eu plusieurs éditions. Il a même été traduit en France, et parmi les lecteurs de la Revue il y en a peu sans doute à qui son nom ne soit familier. L’histoire d’Espagne paraît avait été de sa part l’objet d’une étude assidue. Sans parler de la Conquête du Mexique et de celle du Pérou, on lui doit une Histoire des rois catholiques Ferdinand et Isabelle, qui est devenue classique, même à Madrid. Celle de Philippe II, publiée à la fin de 1855, est son dernier ouvrage, dont deux volumes seulement ont paru. On peut s’étonner que M. Prescott ait passé de Ferdinand à Philippe sans s’arrêter à l’époque la plus brillante de l’histoire d’Espagne, le règne de Charles-Quint. Il s’est borné à écrire sur la vie de ce prince une dissertation très remarquable : c’est une suite de notes et d’observations recueillies avec une excellente critique, coordonnées avec méthode ; mais on voudrait que l’auteur, en les transformant en un récit historique, eût comblé lui-même l’espèce de lacune laissée dans ses travaux. Isabelle et Ferdinand ont préparé la grandeur de l’Espagne ; toutefois, en réunissant en une seule monarchie des peuples autrefois divisés, en portant au dehors de la Péninsule les forces et l’activité qu’ils avaient pour ainsi dire créées, ils laissèrent à l’Espagne le germe d’une maladie politique que le génie de Charles-Quint parvint à dissimuler peut-être, mais dont Philippe II hâta l’explosion fatale. Ainsi, à mon avis, les trois règnes s’enchaînent par une liaison intime et l’on regrette qu’un auteur si éclairé et si impartial dans son appréciation des rois catholiques n’ait pas traité dans tous ses développements cette grande trilogie.
Probablement ce n’est ni l’étendue ni les difficultés du sujet qui ont retenu l’historien américain dans une carrière qui lui semblait réservée. Je crains qu’il n’ait cédé à un sentiment de modestie selon moi exagéré. L’Histoire de Charles-Quint par Robertson est en possession d’une si grande renommée partout où la langue anglaise est en usage, que, M. Prescott le dit lui-même dans sa préface, « les lecteurs du dernier siècle n’étaient pas fort exigeants en matière de recherches historiques. » Robertson n’a pas fait toutes celles qu’il aurait pu faire ; je n’en veux d’autre preuve que la facilité avec laquelle il a admis les traditions romanesques sur le séjour de Charles-Quint à Yuste. D’ailleurs, bien des sources autrefois fermées sont ouvertes aujourd’hui, et un assez grand nombre de documents jusqu’alors inconnus se sont produits de nos jours, qui n’ont pas été refondus encore dans une histoire générale. Si l’on trouvait, ce qu’à Dieu plaise, un manuscrit complet de Polybe, si, dans les fouilles que M. Beulé fait près de Tunis, on découvrait des tables de bronze contenant les dépêches d’Annibal au sénat de Carthage, il faudrait se résigner à écrire une nouvelle histoire romaine après Tite-Live, si Tite-Live s’était trompé, ce que je soupçonne quelquefois. Je ne compare pas Robertson à Tite-Live ; je dis seulement qu’il écrivit à une époque où l’usage des gens de lettres était de composer une histoire avec des livres imprimés. On polissait l’œuvre rude et grossière d’un ancien, on réformait ses jugements, on en prononçait de nouveaux, rarement après une enquête nouvelle. Aujourd’hui, bien que nous n’ayons pas entièrement perdu l’habitude d’exploiter à notre profit les labeurs de nos devanciers, nous accordons difficilement une estime durable à l’écrivain qui se borne à dire en langage moderne ce que ses prédécesseurs avaient dit dans le style de leur temps. Au contraire, celui qui a le courage de remonter aux sources originales, qui s’applique patiemment à vérifier ce que personne ne s’est mis en peine d’examiner, quand même il n’arriverait qu’à prouver la certitude d’une opinion reçue de confiance, cet écrivain, dis-je, s’il ne s’attire pas les applaudissements du vulgaire, obtiendra toujours l’estime et la reconnaissance des personnes studieuses. Perfectionnement dans les méthodes de recherche, perfectionnement dans l’art de la critique, voilà les progrès que les études historiques ont faits depuis le commencement du siècle, et c’est, je pense, un des titres de gloire qui recommandera à la postérité la littérature de notre époque.
Historia quoquo modo scripta delectat. Cet aphorisme n’est point admis par M. Prescott, qui apporte autant de soin à travailler son style qu’à bien choisir les matériaux dont il fait usage ; peut-être même pourrait-on parfois lui adresser le reproche de n’avoir pas assez caché le travail et d’avoir prodigué des fleurs de rhétorique qui n’ajoutent rien à l’intérêt de sa narration. Loin de moi, bien entendu, la pensée de prétendre critiquer, ou même juger, au point de vue grammatical, le style d’un auteur qui écrit dans une autre langue que la mienne : je suis persuadé que M. Prescott s’exprime dans l’anglais le plus pur, mais les observations que je me permets de lui adresser ne s’appliquent pas à l’anglais particulièrement ; elles conviennent à toutes les langues. L’histoire est un genre de composition trop grave pour admettre des ornements sans une certaine réserve ; elle doit surtout se garder des phrases agréables à l’oreille lorsqu’elles n’expriment pas une idée juste. Lord Macaulay, comme tous les écrivains de génie, a fait école. Sa phrase, d’un tour tantôt familier, tantôt poétique, toujours vive et pleine d’images, exerce une séduction irrésistible. Je l’ai entendu pourtant accuser par quelques-uns de ses compatriotes, partisans, et pour cause, du style parlementaire, c’est-à-dire négligé, de trop sacrifier aux grâces et d’usurper pour la narration historique des couleurs qu’ils prétendent n’appartenir qu’à la poésie. Je ne partage nullement la sévérité de cette opinion. Si lord Macaulay écrit l’histoire en poète, c’est un défaut qu’il a en commun avec Hérodote, et dont je ne me plaindrai point. Ce que je sais, c’est que jamais le poète ne fait oublier à l’historien ses devoirs, et qu’il est vrai, même lorsqu’il est le plus brillant. Pourquoi le blâmer de donner à son récit le coloris d’un poème, s’il n’en abuse pas pour me faire illusion, si ses phrases éloquentes n’ont en définitive pour but comme pour résultat que de me faire comprendre mieux sa pensée et de resserrer, pour ainsi parler, le lien qui doit unir le lecteur à l’écrivain ? M. Prescott, qui paraît avoir été frappé de la manière de lord Macaulay, ne l’imite pas toujours avec bonheur. On s’aperçoit qu’en cherchant le pittoresque, il admet quelquefois trop aisément une idée fausse pour ne l’avoir pas examinée avec assez d’attention. Il décrit, par exemple, l’entrée d’un prince et nous montre des chevaliers du XVIe siècle revêtus de mailles (mail-clad, in complete mail). M. Prescott savait pourtant mieux que personne que les Espagnols de Philippe II ne s’armaient pas comme les Normands de Guillaume ou les Anglais de Richard Cœur-de-Lion. Plus loin, c’est un roi qui paraît revêtu d’un manteau d’hermine sans tache (spotless hermine). Qu’est-ce que de l’hermine sans tache ? Pour quiconque n’a pas les connaissances d’un marchand fourreur, ce qui constitue l’hermine, ce sont précisément les taches noires tranchant sur le fond blanc de la fourrure. Voilà des critiques bien minutieuses sans doute ; ces négligences passeraient inaperçues dans un auteur moins élégant que M. Prescott. Par contre, je voudrais, pour être juste, pouvoir citer une foule de passages où le lecteur, sous le charme d’un récit plein de vie et de mouvement, croit assister aux grandes scènes du XVIe siècle et les suit avec l’intérêt passionné d’un contemporain.
L’inconvénient inévitable d’une histoire de Philippe II, et qu’aucun talent ne saurait complètement pallier, vient de la grandeur même du sujet. Sans imposer à l’historien des règles dont le poète dramatique s’affranchit à présent, on voudrait qu’il trouvât un lien commun entre les épisodes qu’il doit raconter. Pour l’auteur comme pour le lecteur, c’est une bonne fortune que de rencontrer un de ces personnages qui dominent leur époque, et qui, de même que le protagoniste des tragédies antiques, est le centre de toutes les péripéties et tient sans cesse la scène occupée : ici, le théâtre est si grand, que l’acteur principal, quelle que soit sa taille, est nécessairement rapetissé. L’empire de Charles, il est vrai, était encore plus vaste que celui de son fils ; mais, grâce à sa prodigieuse activité, on le trouve partout où se passent de grandes choses. Il prend une part d’action considérable à tous les évènements de son époque, et il en est en quelque sorte l’âme qui lui imprime son mouvement. Avec une ambition non moins effrénée, Philippe n’aimait ni la guerre ni les aventures. Prudent à l’excès, il délibérait souvent lorsqu’il aurait dû agir. Dans une circonstance où Charles serait monté à cheval, Philippe écrivait vingt lettres, dont aucune peut-être ne contenait un-ordre précis. Travailler était sa vie, mais trop souvent ce travail était stérile. Le maître d’un empire immense se perdait dans des détails d’administration et différait toujours à prendre un parti. Il hésitait encore plus pour autoriser ses lieutenants. Craignant de leur laisser trop d’initiative, il les accablait d’ordres minutieux ; il les retenait dans les occasions ; il les trahissait même, soit en les abusant de vaines espérances, soit en leur cachant ses véritables intentions. Philippe ne ressemblait à son père qu’en un seul point : la méfiance. Du moins Charles, qui était payé pour en avoir, savait la dissimuler et prendre au besoin un air de bonhomie et de franchise où la multitude se laissait facilement gagner. Plusieurs de ses généraux l’avaient trahi. Le connétable de Bourbon, avec ses bandes noires, avait rêvé de se créer en Italie une souveraineté indépendante. Après lui, le marquis de Pescaire avait eu la même pensée ; car l’exemple Quichotte, s’attendant de chevalier errant à devenir empereur, n’était pas tout à fait une idée de fou. Seulement il ne fallait pas commencer par courir les déserts pour redresser les torts, mais par rassembler une troupe de bandits braves et dévoués.
Les riches-hommes de Castille et d’Aragon, qui autrefois bouleversaient l’Espagne à leur gré, avaient perdu leur goût pour la guerre civile sous le gouvernement ferme et sévère de Ferdinand et d’Isabelle. Les guerres étrangères offrirent un nouveau but à leur ambition. En conquérant des terres à leurs maîtres, ils essayèrent d’en conquérir pour eux-mêmes. Le premier, Gonsalve, le grand capitaine, fut véhémentement soupçonné d’avoir trop de goût pour le royaume de Naples, qu’il avait gagné à Ferdinand. La composition des armées à cette époque donnait aux généraux habiles et heureux un pouvoir considérable dont ils étaient tentés d’abuser. L’infanterie se recrutait en majeure partie d’aventuriers de toutes les nations, gens de sac et de corde, faisant de la guerre un commerce et vendant leur épée au plus offrant. La cavalerie n’était guère mieux disciplinée ni plus facile à gouverner que l’infanterie. Les hommes d’armes étaient des gentilshommes, pleins d’ambition et d’orgueil, dont la susceptibilité n’était pas moins dangereuse parfois que l’avarice des aventuriers. Lautrec livrait à son désavantage la bataille de La Bicoque, forcé de combattre parce que ses Suisses, faute de solde, allaient l’abandonner. La gendarmerie française, et Bayard des premiers, refusaient nettement de monter à la brèche de Padoue, parce que des gentilshommes n’étaient pas faits pour combattre à pied. Dans toutes les armes, le bien du pays que l’on servait était le moindre souci de l’homme de guerre. La gloire pour quelques-uns, pour tous l’espoir du pillage et de prisonniers à mettre à rançon, tels étaient les mobiles les plus puissants qui animaient une armée du XVIe siècle. Le général qui avait la réputation d’enrichir ses soldats était sûr d’être suivi par eux, de quelque côté qu’il déployât sa bannière.
Charles-Quint, avec le coup d’œil du génie, avait su discerner les hommes rares sur le dévouement desquels il pouvait toujours compter, et les ambitieux habiles qu’il pouvait employer avec avantage, tant que leurs intérêts seraient communs avec les siens. Il se servit avec succès des uns et des autres. La première leçon dans l’art de gouverner qu’il donna à son fils fut pour le mettre en garde contre ses futurs serviteurs. « Le duc d’Albe, disait l’empereur dans une lettre confidentielle qui s’est conservée, est le plus habile ministre et le meilleur capitaine que j’aie dans mes États. Consultez-le surtout pour les affaires militaires, mais ne vous en rapportez pas entièrement à lui sur ce sujet, pas plus que sur tout autre. Ne vous en rapportez à personne qu’à vous-même. Les seigneurs seront trop heureux de capter votre bienveillance, afin de gouverner sous votre nom ; mais si vous vous laissez mener de la sorte, ce sera votre ruine. Le seul soupçon que vous souffrez qu’on prenne de l’influence sur vous ferait un tort immense. Servez-vous de tous, mais ne comptez sur aucun absolument. » Tels furent les conseils que Philippe reçut à dix-sept ans (1543), lorsque Charles lui confia la régence d’Espagne ; il ne les oublia jamais.
M. Prescott, après avoir fait un portrait fidèle et très impartial de Philippe II, en résume les traits principaux, et conclut en le présentant comme le type complet du caractère espagnol. Pour moi, qui ne connais pas de personnage plus haïssable que Philippe II, ni de nation que j’estime plus que le peuple espagnol, je ne puis laisser passer sans commentaire la conclusion de M. Prescott. Au fond, nous sommes assez près de nous entendre. À mon sentiment, le caractère d’un peuple ne consiste pas dans les préjugés qu’il doit à des circonstances fortuites, pas plus que le caractère d’un homme ne doit se confondre avec l’éducation qu’il a reçue. Philippe, sans conteste, représentait tous les préjugés des Espagnols au XVIe siècle, mais il n’avait pas leurs vertus nationales ; la noblesse des sentiments, la générosité, l’esprit chevaleresque, ne trouvaient aucune place dans son cœur desséché. On s’explique facilement l’intolérance religieuse des Castillans. Un peuple qui a passé sept siècles sous les armes à reconquérir pied à pied son territoire envahi, à défendre sa religion opprimée par les barbares, qui a trouvé dans sa foi seule la force de résister et de vaincre, n’est que trop enclin à confondre dans une même haine les adversaires de sa religion avec les ennemis du pays. Assurément le fanatisme des Espagnols au XVIe siècle est aussi excusable que le patriotisme exclusif des Romains ou des Grecs. L’amour de la patrie a toujours ses violences, et pour les Espagnols, patrie et religion avaient eu longtemps la même signification. M. Prescott a dit que les autodafés furent la légitime conséquence des longues guettes des chrétiens contre les musulmans ; ce mot est une distraction sans nul doute, et son Histoire de Ferdinand et Isabelle le dément ou l’explique. Lorsque Isabelle fonda l’inquisition dans ses États, le peuple de Castille se méprit sur le but de cet abominable tribunal. D’abord il n’y vit qu’une suite naturelle de la guerre qu’il venait de faire à des ennemis acharnés et encore redoutables. La victoire n’avait pas éteint la haine qu’inspiraient les infidèles. Pendant les longues discordes civiles qui avaient déchiré l’Espagne depuis le XIVe siècle, les juifs et les musulmans soumis aux princes de la Péninsule avaient cultivé le commerce et l’industrie et s’étaient enrichis aux dépens des chrétiens. Le gentilhomme qui avait vendu son bien à un banquier juif pour s’acheter un cheval et des armes, et servir la cause de son souverain, était tombé dans la misère, et voyait les vaincus de la veille de nouveau possesseurs de la terre qu’il avait conquise, arrosée de son sang. On applaudit aux premiers jugements de l’inquisition, parce que la multitude, toujours injuste dans sa passion, se crut vengée. Torquemada se chargea promptement de démontrer qu’il n’en voulait pas seulement aux Maures relaps, et que son effrayante impartialité n’épargnerait ni les patriotes les plus éprouvés, ni les plus vieux chrétiens, du moment qu’ils trouveraient un dénonciateur. Ce ne fut pas sans une vive opposition que l’inquisition s’établit en Espagne, et telle fut l’horreur qu’elle inspira à ses débuts, que Torquemada et ses acolytes durent rendre leurs jugements et les faire exécuter presque par surprise, et qu’ils furent obligés de s’entourer longtemps d’un appareil militaire assez imposant pour comprimer l’indignation publique.
Mais après deux générations, lorsque l’insurrection des comuneros eut épuisé l’énergie du pays, l’inquisition régna par la terreur, et son règne fut long et paisible. Loin de chercher à combattre le monstre, on ne pensa plus qu’à le désarmer à force de soumission. La terreur fait vite l’éducation d’un peuple. Une mère qui a vu brûler son voisin, peut-être parce qu’il se baignait trop souvent (ce qui sent son Morisque, selon les docteurs), laissera son fils dans sa crasse baptismale, et tâchera d’en faire un bigot, pour qu’il ne passe pas pour un hérétique. « Donnez-moi l’instruction publique, disait Leibnitz, et je changerai le monde. » Il y a quelques années, me trouvant à Barcelone, je voyais souvent un bambin de sept ou huit ans, nouvellement arrivé de Buenos-Ayres, et recueilli par une famille avec laquelle j’étais fort lié. Plusieurs fois par jour, en se levant, en se couchant, à l’heure des repas, il ne manquait jamais de dire à haute voix, et d’un ton de fausset : « Meurent les sauvages unitaires ! » Dans la République Argentine, dès qu’un enfant pouvait articuler un mot, on lui apprenait ces belles paroles, de par le dictateur, et mieux eût valu pour un écolier oublier de réciter son credo que d’omettre cette imprécation contre les sauvages unitaires. J’essayai de savoir quelles gens étaient ces unitaires ; on me l’expliqua, mais tout ce que j’ai retenu, c’est qu’en certaines choses ils ne partageaient pas la manière de voir de Rosas. L’enfant n’en savait pas un mot ; mais s’il fût resté en Amérique à recevoir cette belle éducation, peut-être à vingt ans eût-il trouvé tout simple qu’on fusillât quelqu’un pour le fait d’être unitaire. « Meurent les hérétiques ! » c’était la prière qu’on apprenait aux enfants dans l’Espagne du XVIe siècle, et probablement ce fut la première que bégaya Philippe. Devenu roi, il assistait à un autodafé, et disait que si son fils avait encouru la sentence du saint tribunal, il mettrait lui-même le feu aux fagots.
Il n’y a rien de si dangereux que les convictions profondes chez les hommes d’un esprit médiocre appelés à exercer un grand pouvoir. Philippe était convaincu de son infaillibilité ; il se croyait fermement une mission divine, et de la meilleure foi du monde il pensait que les ennemis de sa politique étaient les ennemis de la religion. Quand il tuait les gens, je ne doute pas que par surérogation il ne crût les envoyer en enfer. Son fanatisme, augmenté de son orgueil immense, avait détruit chez lui tout sentiment d’humanité, et peut-être ses plus mauvaises actions ne lui coûtèrent-elles pas un remords. Quant à ses peccadilles, car il en fit plus d’une, étant d’un pays où le soleil est fort ardent, il pensait sans doute, comme cette grande dame, que Dieu y regarderait à deux fois avant de condamner un prince d’une si bonne maison, le fils d’un empereur et le souverain dont le soleil ne quittait jamais les États.
« Cette intrépidité de bonne opinion » chez Philippe II se montre avec toute son horrible naïveté dans la vengeance si longtemps préparée qu’il exerça contre le baron de Montigny. C’est un des épisodes les plus intéressants de l’histoire de M. Prescott, et je n’hésiterais pas à le traduire tout entier, s’il n’avait été déjà dans la Revue l’objet d’une analyse approfondie par M. L. de Viel-Castel. Quelques mots suffiront pour rappeler au lecteur cette horrible tragédie.
Le seul crime de Florent de Montmorency, baron de Montigny, était d’avoir osé porter à Philippe les respectueuses représentations des seigneurs flamands contre des édits tyranniques. Il fut arrêté à Madrid lorsque l’exécution des comtes d’Egmont et de Hoorne y fut connue. Pendant près de trois ans, on le tint prisonnier en Espagne, tandis qu’on lui faisait secrètement son procès en Flandre. Lorsque grâce au duc d’Albe l’ordre régnait dans les Pays-Bas, lorsque Montigny commençait à être oublié, lorsque le terrible gouverneur écrivait au roi que le moment était Venu de compléter la soumission des Flamands en leur accordant une amnistie, alors seulement Philippe fit étrangler Montigny. Il le fit étrangler dans le plus grand secret, après s’être fait écrire officiellement que Montigny était malade, qu’il était au plus mal, qu’il n’y avait plus d’espoir. En signifiant la sentence au condamné, on lui laissa espérer, toujours en vertu des instructions du roi, qu’il pourrait faire une sorte de testament, c’est-à-dire acquitter ses dettes et faire des legs pieux, à la condition de déclarer dans cet acte qu’il mourrait de mort naturelle. Tout avait été merveilleusement calculé pour tromper les contemporains et dérober le crime à la postérité ; mais Philippe ne craignait que les contemporains. Il fit déposer aux archives de Simancas toutes les pièces de l’affaire, ses ordres, ses dépêches, le procès-verbal vrai et le procès-verbal faux de la mort de Montigny. Bien plus, il en fit part au duc d’Albe, qu’il n’avait pas consulté et qu’il n’avait pas besoin d’instruire. Il semble que, tourmenté d’une certaine vanité d’auteur, il eût regretté que de si belles inventions restassent ignorées. Cette relation, qui était adressée à Bruxelles, fut prudemment traduite en chiffres. Le roi, minutieux en tout, et qui ne pouvait voir une feuille de papier écrit sans y mettre une apostille, après avoir rappelé les sentiments de dévotion que Montigny avait fait voir à ses derniers moments, et ce mot du confesseur chargé de l’assister qui disait : « Il s’est montré aussi bon catholique que je désire l’être moi-même, » le roi avait dicté d’abord cette observation : « Peut-être est-ce une illusion de Satan, qui, nous le savons, n’abandonne jamais l’hérétique à sa dernière heure. » Puis par réflexion, en marge de la minute, il écrivit de sa main : « Effacez cela dans la traduction en chiffres ; des morts il faut toujours bien penser. » Pourtant il ne voulut pas perdre sa remarque, qui subsiste, et qu’on voit avec la minute de sa lettre au duc d’Albe dans les archives de Simancas.
L’impassibilité de Philippe dans les actions les plus horribles et les plus honteuses confond tellement les idées, qu’on se demande si l’homme capable de pareilles choses mérite d’être poursuivi comme une bête féroce par le fer et par le feu, ou seulement d’être enfermé dans une loge de fou. Assurément sa conscience n’était pas celle du reste des hommes. S’il lui échappe un trait d’humanité, il s’en excuse. Il donne quelques aunes de drap noir pour que les domestiques de Montigny accompagnent décemment à l’église les restes de leur maître, mais il a grand soin de dire au duc d’Albe « que la dépense était minime, les domestiques étant en très petit nombre». On ne peut comparer la tranquillité d’âme de Philippe qu’à celle du bourreau qui verse le sang et n’a point de remords, sachant qu’il est l’instrument de la loi. Philippe était, croyait-il, l’instrument de la Providence, et ses passions haineuses lui semblaient des voix d’en haut.
Comme on ne prête qu’aux riches, les contemporains de Montigny, qui avaient dû croire à sa mort naturelle, se dédommagèrent en faisant honneur à Philippe II de la mort violente de don Carlos son fils. M. Prescott, après avoir étudié ce grand problème historique avec le soin le plus scrupuleux, n’a pas trouvé de preuves suffisantes pour prononcer un verdict de meurtre contre le monarque, comme dans l’affaire de Montigny ; mais il laisse voir des soupçons terribles qui, de la part d’un écrivain d’ordinaire si plein d’impartialité et de circonspection, ressemblent fort à une conviction morale. Quant à moi, je ne connais sur la mort de don Carlos d’autres documents que ceux dont M. Prescott a fait usage, et cependant mes conclusions seraient toutes différentes. Il me semble que l’historien américain ne s’est pas assez complètement dégagé des idées de son pays et de notre temps pour examiner les pièces de cet étrange procès, et que contre son habitude il a tiré des inductions un peu trop hardies de quelques passages qui se prêtent à une interprétation beaucoup plus naturelle et moins tragique. J’essaierai d’exposer ici le petit nombre de faits bien avérés sur lesquels on peut fonder un jugement. Je présenterai en la discutant l’opinion à laquelle M. Prescott paraît donner la préférence, et le lecteur décidera.
Les poètes et les romanciers se sont tellement exercés sur le personnage de don Carlos, qu’ils ont à peu près complètement fait oublier les témoignages des contemporains sur le caractère de ce prince. Il importe de les rappeler, et d’abord je citerai Brantôme, observateur toujours curieux et d’ordinaire exact, témoin désintéressé, et trop avide de scandale pour nous cacher les découvertes qu’il aura pu faire en ce genre. Il séjourna quelque temps à la cour d’Espagne en 1564, c’est-à-dire un peu plus de trois ans avant la catastrophe que nous aurons à raconter. « Don Carlos, dit-il, étoit fort nastre, estrange, et avoit plusieurs humeurs bigarrées. » Nastre est un mot encore usité dans le Périgord dans le sens de sournois, mauvais garnement. Les humeurs bigarrées, c’était, je pense, un terme du langage courtisanesque qu’il n’est pas trop facile de comprendre aujourd’hui ; cependant la suite du portrait fait voir que Brantôme croyait que la tête de son altesse était un peu dérangée. Les ambassadeurs vénitiens, qui avaient mission, comme on sait, d’étudier le caractère des princes et d’en entretenir le conseil de la république, écrivaient à leur gouvernement qu’il annonçait une cruauté précoce, et entre autres preuves qu’un de ses amusements était de faire rôtir des lièvres tout vivants. Ce trait de gentillesse n’annonce pas des dispositions pour abolir les autodafés. De bonne heure il avait été tourmenté par la bile. Il avait de fréquents accès de fièvre. Sa croissance avait été arrêtée, et peu de personnes croyaient qu’il pût arriver à l’âge d’homme. Le duc d’Oñate possède un portrait de don Carlos peint par Sancho Coello ou dans son école. Au point de vue de l’art, c’est un ouvrage médiocre, mais il est évident qu’il a été fait d’après nature, et il est permis de le croire ressemblant, à la façon dont il est étudié. À vrai dire, le principal défaut, c’est l’exécution trop minutieuse de toutes les parties, et la vérité des accessoires est une présomption en faveur de la ressemblance du personnage. Ce qui frappe d’abord, c’est la triste tournure du modèle, ses épaules voûtées, sa tête penchée en avant et son expression mélancolique. Le teint est pâle, les yeux morts, toute l’habitude du corps dénote un être maladif. Strada dit qu’il avait une épaule plus haute que l’autre et qu’il boitait, humero elatior et tibia altera longiore erat. Pour surcroît, à l’âge de seize ans, il tomba sur la tête en trébuchant dans un escalier, et il fallut le trépaner, opération toujours assez délicate, et qui l’était encore plus pour les chirurgiens de ce temps. Il fut longtemps entre la vie et la mort, jusqu’à ce qu’on s’avisât de lui apporter des reliques d’un frère Diego, mort un siècle auparavant en odeur de sainteté. C’est ce moine qu’on voit aujourd’hui au musée du Louvre, peint par Murillo au moment où il est soulevé de terre par la ferveur de sa prière, tandis que des anges font la cuisine à sa place, car il était le cuisinier de son couvent. Le saint apparut la nuit au malade et lui annonça sa guérison. Par jalousie de métier, le médecin du prince prétendit s’en attribuer l’honneur, mais on ne l’écouta guère. Fray Diego pour ce fait fut canonisé. Malheureusement don Carlos n’en devint pas plus sage. « Il aimoit fort à ribler le pavé, dit Brantôme, et faire querelles à coups d’épée, fust de jour, fust de nuit, car il avoit avecque luy dix ou douze enfans d’honneur des plus grandes maisons d’Espaigne, les uns les forçant d’aller avecque luy et en faire de mesme, d’autres y allans d’eux-mêmes de très bon cœur… Quand il alloit par les rues quelque belle dame, et fust-elle des plus grandes du pays, il la prenoit et la baisoit par force devant tout le monde. Il l’appelloit bagasse, chienne, et force autres injures leur disoit-il… » Je suis obligé d’abréger la citation. Les querelles à coups d’épée dans la rue étaient alors fort communes en Espagne, et les comédies de Lope de Vega et de Calderon en font foi. De mon temps, en Andalousie, les jeunes gens qui donnaient des sérénades la nuit interdisaient rentrée de la rue où demeurait leur maîtresse, et rossaient les téméraires qui osaient vouloir rentrer chez eux malgré la consigne. Quant aux autres divertissements de son altesse, ils devaient sembler fort étranges, car le respect pour les femmes fut de tout temps un des traits du caractère castillan. Brantôme et Cabrera content bien d’autres gentillesses de don Carlos. Un jour, mécontent de son cordonnier, qui lui avait fait des bottes trop étroites, il les lui fit manger, coupées en morceaux et fricassées. Le prince aimait les bottes larges, non du pied, car on ne dit pas qu’il eût des cors, mais la mode était aux bottes à tiges en forme d’entonnoir, et de plus il avait coutume de cacher dans les siennes une paire de pistolets, mauvaise habitude pour un homme si colérique.
Une fois il rossa son gouverneur, une autre fois il voulut jeter par la fenêtre son chambellan. Mécontent du cardinal Espinosa, président du conseil de Castille, qui venait de chasser de Madrid un acteur qu’il aimait, il prit au collet son éminence, et la main sur la poignée de sa dague : « Faquin, dit-il, vous osez vous en prendre à moi ? Par la vie de mon père, je vais vous tuer ! » Ses brutalités, ses polissonneries à la rigueur pourraient passer pour jeux de prince, j’entends de prince élevé comme pouvait l’être un fils de Philippe II, systématiquement entouré d’imbéciles ou de coquins subalternes intéressés à le corrompre. Don Carlos avait une vertu qu’il ne tenait pas de son père. Il était fort généreux. Il disait : « Qui est-ce qui donnera, si un prince ne donne pas ? » Malheureusement ses bienfaits tombaient le plus souvent sur les compagnons de ses débauches.
Au milieu de la vie dissolue qu’il menait, il avait des velléités de se mêler des affaires publiques et s’irritait que son père ne l’admît pas à ses conseils. Tout prouve que Philippe II ne fit aucun effort sérieux pour le corriger ; seulement il lui laissait voir clairement l’aversion que lui inspirait sa conduite. Il l’éloignait de lui et l’entourait d’espions. Enfant, don Carlos avait peur de son père ; jeune homme, il le prit en haine. Seul il osait braver le despote tout-puissant, et même se moquer de lui. Brantôme, que je cite toujours, rapporte que don Carlos avait fait relier un gros livre de papier blanc auquel il mit ce titre : Grands et admirables voyages du roi don Philippe. Le texte portait : Allé de Madrid à l’Escurial, – de l’Escurial à Madrid, – de Madrid à Aranjuz, etc., « et ainsi de feuillet en feuillet en emplit le livre par telles inscriptions et escritures ridiculeuses, se mocquant ainsi du roy son père et de ses voyages et pourmenades qu’il faisoit en ses maisons de plaisance ; ce que le roy sceut et en vist le livre, dont il en fust fort aigri contre luy. » Cette méchante plaisanterie du petit-fils de Charles-Quint aurait été bien plus dangereuse, s’il avait eu réellement du goût et de l’aptitude pour les affaires. Malheureusement il pensait, comme le gentilhomme de Molière, qu’un prince sait tout sans avoir rien appris. Il voulait jouer un rôle, avoir une cour, et probablement il se figurait qu’il aurait alors de meilleures occasions de rosser les gens et de les insulter. Au moment où la nécessité de remplacer l’infante Marguerite comme gouvernante des Pays-Bas fut bien reconnue, don Carlos crut que ce gouvernement était son fait. On ne sait s’il le demanda à son père ; mais lorsqu’il apprit la nomination du duc d’Albe, il s’emporta, défendit au duc d’accepter, et, selon son habitude, le menaça de le tuer. De fait, il le désarma et le tint en respect jusqu’à ce que le prince, voyant qu’il n’était pas le plus fort, alla cacher son désespoir et sa fureur dans son appartement. C’est peu de jours après cette scène de violence que don Carlos fut arrêté. Malheureusement à partir de ce moment les témoignages contemporains deviennent plus rares et plus obscurs.
Un des plus curieux, sinon des plus vraisemblables, vient d’un valet de chambre du prince qui a écrit la relation manuscrite des faits dont il prétend avoir été le témoin. M. Prescott en a obtenu une copie, et paraît en faire cas. On ignore le nom de l’auteur, par conséquent on ne peut guère apprécier sa véracité ; mais en beaucoup de points il se montre aussi bien renseigné que les ministres étrangers qui ont pris le plus de soin pour approfondir cette ténébreuse affaire. C’est une présomption en faveur de son exactitude. On ne peut douter d’ailleurs, d’après certains détails, qu’il n’ait vécu à la cour, à portée de voir et d’apprendre beaucoup de choses inconnues au public.
Selon cette relation, don Carlos, aux approches de la Noël de l’année 1567, paraissait en proie à une agitation extraordinaire. Il dit et répéta devant ses gens qu’il voulait tuer un homme avec lequel il avait querelle. Il tint le même propos devant son oncle don Juan d’Autriche, qu’il aimait et respectait plus que personne à la cour. Le 28 décembre, toute la famille royale, selon l’usage, devait communier publiquement. La veille, don Carlos, allant se confesser, ne fit point de difficulté de révéler à l’ecclésiastique qu’il avait choisi son désir et son intention de commettre un meurtre. Épouvanté de cet aveu, le confesseur lui refusa l’absolution. Don Carlos, plus surpris qu’irrité, essaya de trouver des prêtres moins sévères, et ayant réuni en consultation jusqu’à seize moines, casuistes renommés, il leur demanda s’il ne pouvait pas recevoir l’absolution et communier avant d’expédier son ennemi. Tous répondirent avec fermeté qu’il n’y avait pas d’absolution pour lui tant qu’il entretiendrait de semblables pensées. Alors le prince se rabattit à demander qu’on voulût bien lui donner à la communion une hostie non consacrée, afin d’éviter le scandale que le refus de communion ne manquerait pas d’occasionner. Un des casuistes, persuadé qu’il avait affaire à un maniaque, et jugeant qu’il était important de savoir à qui le prince en voulait, lui fit entendre que, pour se prononcer, les docteurs avaient absolument besoin de savoir quel était cet ennemi si détesté dont il voulait se défaire, à quoi don Carlos, sans la moindre hésitation, répondit : « C’est mon père. » Aussitôt, on avertit le roi, qui se trouvait alors à l’Escurial.
Telle est la version du valet de chambre. Nous remarquerons d’abord qu’il a pu entendre les menaces de mort proférées par le prince, mais qu’il n’a pas assisté à la consultation des docteurs. Toute cette partie de son récit, outre l’étrangeté, se concilie difficilement avec les dates. La scène de la consultation aurait eu lieu avant le 28 décembre 1567. Don Carlos ne fut arrêté que le 18 janvier 1568. Quelque temporiseur que fût Philippe II, on a peine à croire qu’il ait attendu si longtemps pour prendre un parti à l’égard d’un homme qu’il avait tout lieu de craindre, et qui portait des pistolets dans ses bottes.
Poursuivons. L’auteur de la relation déjà citée ajoute, et cette fois le fait est confirmé par la correspondance du nonce apostolique, que le 17 janvier don Carlos envoya commander pour le lendemain huit chevaux au directeur des postes. Celui-ci se hâta de répondre qu’il n’en avait pas, et fit aussitôt prévenir le roi, après avoir par provision envoyé loin de Madrid tous les chevaux qu’il avait. Philippe savait déjà, du moins en partie, les projets de son fils, car, « depuis quelques jours, écrivait le nonce, ce très religieux monarque faisait dire des prières dans plusieurs monastères pour que le ciel l’inspirât dans une affaire de la dernière gravité ». S’il faut en croire le valet de chambre, don Juan d’Autriche, de son côté, aurait prévenu le roi que don Carlos était parvenu à emprunter une somme considérable, 150 000 ducats ( ?), et lui avait proposé à lui, don Juan, de l’accompagner dans sa fuite. Le 18 janvier, don Juan étant allé voir le prince, celui-ci l’avait accusé de trahison, aurait mis l’épée à la main, et don Juan aurait été obligé de se défendre et d’appeler les gens pour prévenir un duel entre oncle et neveu. Cette scène est rapportée par d’autres contemporains avec quelques variantes, et n’est pas absolument improbable.
Don Carlos, toute la cour le savait, avait fait une espèce d’arsenal de sa chambre à coucher. Notons en passant cette manie de s’entourer d’armes, si fréquente chez les personnes dont la raison est altérée. La porte de cette chambre à coucher était munie de verrous formidables, et le prince y avait fait adapter un mécanisme qui lui permettait, en tirant un cordon de son lit, d’ouvrir lui-même sa porte aux gens qu’il voulait recevoir. Ces précautions, et surtout les armes, inquiétaient fort le roi. On commença par déranger le mécanisme des verrous sans que le prince s’en aperçût. Le 18 janvier, au milieu de la nuit, le valet de chambre susdit, étant de service en dehors de la chambre à coucher du prince, vit arriver le roi, revêtu d’une armure et ayant un casque sur la tête. Il était accompagné du duc de Féria, son capitaine des gardes, de quatre ou cinq gentilshommes, et d’une douzaine de soldats. Don Carlos dormait profondément, et la porte fut ouverte sans bruit. Le duc de Féria, entrant le premier sur la pointe du pied, se saisit d’abord d’une épée et d’un poignard placés au chevet du lit, puis d’une arquebuse chargée à balle, déposée un peu plus loin, mais à portée du dormeur. En ce moment, le prince s’éveillant demanda : « Qui va là ? » Le duc répondit : « Le Conseil d’État. » Aussitôt le prince saute à bas du lit et cherche ses armes, mais déjà les soldats s’en étaient emparés. Le roi, qui attendait ce moment pour entrer, se présenta alors, et lui intima l’ordre de se recoucher et de se tenir tranquille. « Que me voulez-vous ? demanda le prince. – Vous l’apprendrez bientôt, » répondit le roi, qui fit aussitôt fermer et cadenasser portes et fenêtres. En même temps il faisait enlever une cassette remplie de papiers et tous les meubles qui auraient pu servir d’armes ; on emporta jusqu’aux chenets. En se retirant, le roi dit au duc de Féria qu’il lui confiait la garde du prisonnier, dont il aurait à répondre sur sa tête. « Vous feriez mieux de me tuer tout de suite ! criait don Carlos. Si vous ne me tuez pas, je me tuerai moi-même. – Vous n’en ferez rien, dit le roi ; ce serait l’action d’un fou. – Je ne suis pas fou ; mais vous me traitez si mal que vous me réduirez au désespoir ! » La voix du prince était à demi étouffée par les sanglots. Il demeura étendu sur son lit, versant un torrent de larmes. Le lendemain, le roi réunit son conseil et fit instruire le procès du prisonnier. La séance dura, dit le valet de chambre, depuis une heure de l’après-midi jusqu’à neuf heures du soir, et le procès-verbal ou le dossier formait un cahier épais d’un demi-pied.