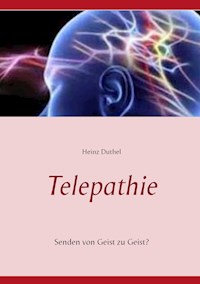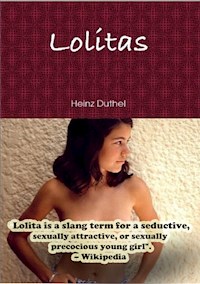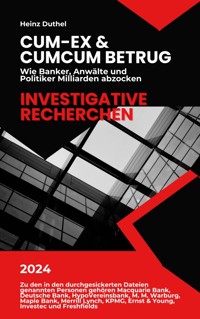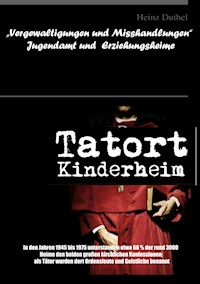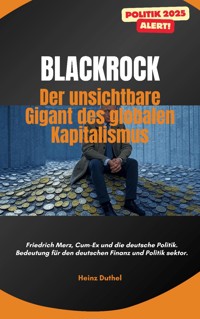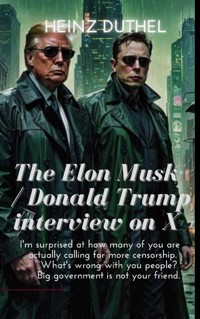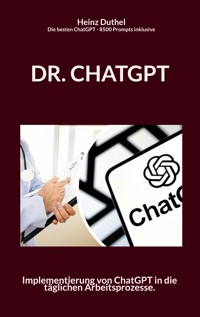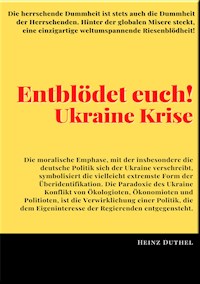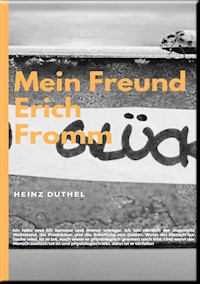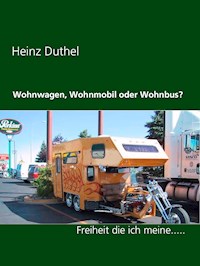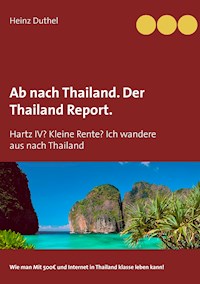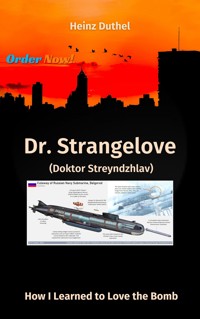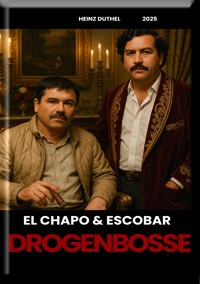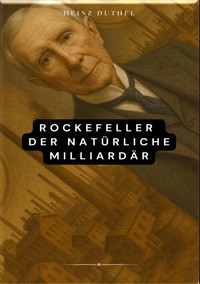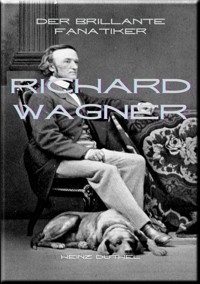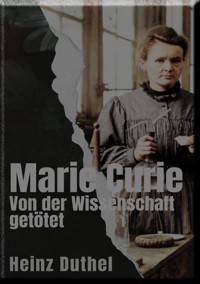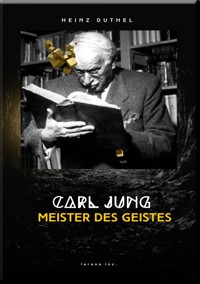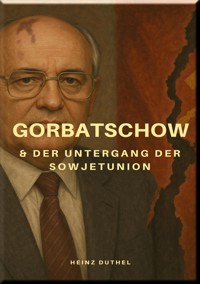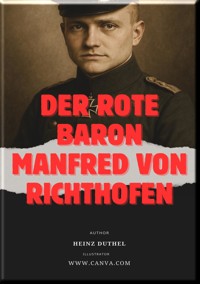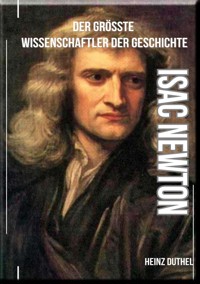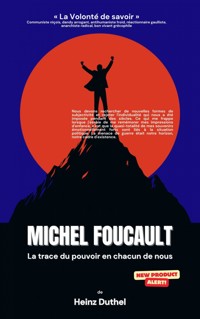
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Et si tu n'avais jamais vraiment pensé librement — mais seulement ce que le pouvoir t'a autorisé à penser ? Et si chacune de tes décisions, de tes passions, de tes peurs avait déjà été façonnée par des mains invisibles ? Michel Foucault, l'un des penseurs les plus influents du XXᵉ siècle, a pulvérisé la croyance en une vérité immuable. Il a révélé comment le pouvoir ne règne pas seulement dans les institutions, mais s'infiltre profondément dans nos corps, notre langage, nos désirs — jusqu'à guider nos vies de l'intérieur. Ce livre t'emmène au cœur de la biographie fascinante et contradictoire d'un homme qui n'a jamais cessé de se réinventer : communiste et dandy, anarchiste et bon vivant, critique acharné de toutes les certitudes — et en même temps défenseur acharné de ceux que la société relègue : prisonniers, malades, stigmatisés, oubliés. Duthel montre comment la pensée de Foucault a radicalement transformé notre vision du savoir, de la vérité, de la sexualité et de l'identité — et pourquoi ses idées sont plus actuelles que jamais. Tu découvriras comment la pression invisible des normes sociales te façonne, comment les « vérités » sont fabriquées pour mieux contrôler — et comment apprendre à briser ce cercle. Lire ce livre, c'est plonger dans les labyrinthes cachés du pouvoir — et découvrir combien de ce pouvoir vit déjà en toi. Un portrait provocateur, captivant et profondément personnel d'un penseur qui nous oblige à tout remettre en question — y compris nous-mêmes. Es-tu prêt à débusquer les traces invisibles du pouvoir en toi ?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 91
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michel Foucault - La trace du pouvoir en chacun de nous
Heinz Duthel
Heinz Duthel :
J'écris simplement parce que je ne sais pas encore quoi penser de ce qui me tracasse tant. Je suis un expérimentateur, dans le sens où j'écris pour me changer et cesser de penser comme avant.
La question de savoir qui était réellement Michel Foucault se pose dès le début de cette longue nuit. Jusqu'au bout, le philosophe français a rejeté le cadre rigide de l'identité. Il s'est mis en garde à plusieurs reprises contre l'idée d'une vérité ultime transformant les individus en êtres assujettis.
Dans la préface de L'Archéologie du savoir (1969), le philosophe masqué, comme le qualifiait le quotidien Le Monde dans une interview tardive, nous lance un appel sans équivoque. La première heure de La Longue Nuit sur Michel Foucault brosse plusieurs moments marquants de sa vie, sans pour autant dresser un portrait unifié des multiples visages de celui qui mourut du sida en 1984 à l'âge de 57 ans. Communiste nicéen, dandy arrogant, antihumaniste froid, réactionnaire gulliste, anarchiste radical, bon vivant grécophile : telles sont quelques-unes des formules employées pour tenter d'inscrire une vérité sur le sujet insaisissable de Foucault.
Il a un temps chanté la chanson de la mort de l'auteur, si populaire parmi les structuralistes. Néanmoins, Foucault a insisté pour que sa vie soit comprise comme une partie de son œuvre. Une constante tout au long de sa vie est son soutien aux membres stigmatisés de nos cultures, aux marginalisés, aux exclus, aux prisonniers, à ceux qui n'ont pas voix au chapitre dans l'ordre dominant, ou seulement la voix erronée que le régime du savoir leur a attribuée .
Les aliénés, les malades, les délinquants, ceux dont la société qualifie les désirs de pervers et qui sont préférentiellement soumis aux appareils de pouvoir. La deuxième heure examine l'analyse du pouvoir par Foucault, abordant ainsi un aspect central de sa pensée. L'accent est mis sur la question de savoir comment les complexes du pouvoir et du savoir affectent le corps et l'âme des individus, comment les pratiques des institutions et les discours scientifiques façonnent et façonnent notre subjectivité.
Les images dans lesquelles nous nous reconnaissons, les termes que nous utilisons pour nous décrire en tant qu'êtres sexuels, par exemple, et même nos comportements les plus élémentaires, selon la thèse de Foucault, sont façonnés par les traces largement invisibles du pouvoir. Ce n'est pas un hasard si la phase de la théorie du pouvoir de Foucault coïncide avec son engagement politique radical dans les années 1970. La troisième heure est consacrée à l'œuvre tardive de Foucault, dans laquelle le philosophe opère un changement de perspective.
C'était au début des années 1980. Foucault séjournait fréquemment en Californie, expérimentant les drogues et explorant diverses formes de plaisir érotique. Plutôt que de se demander comment nous devenons des objets de relations de pouvoir, il se concentrait désormais sur le thème de la formation de soi.
En revenant aux techniques anciennes du soi, Foucault cherche des possibilités de construire ses propres formes subjectives, précisément en résistance aux dispositifs de pouvoir et à l'exigence de vérité. Que le programme éthique du souci de soi ne soit pas un repli apolitique dans la sphère privée, comme Foucault en a parfois été accusé, apparaît clairement dans un texte de 1982. Comme souvent dans l'œuvre de Foucault, on dirait entendre la voix de Nietzsche derrière ses mots.
Le surhomme se défait des formes culturelles de l'existence humaine, tel un serpent émergeant de sa cage de peau devenue trop étroite. L'objectif principal aujourd'hui n'est sans doute pas de découvrir ce que nous sommes, mais de le rejeter. Nous devons imaginer et construire ce que nous pourrions être si nous voulons échapper à la double contrainte politique inhérente à l'individualisation et à la totalisation simultanées des structures de pouvoir modernes.
Nous devons rechercher de nouvelles formes de subjectivité et rejeter l'individualité qui nous a été imposée pendant des siècles. Ce qui me frappe lorsque j'essaie de me remémorer mes impressions d'enfance, c'est que la quasi-totalité de mes souvenirs émotionnellement forts sont liés à la situation politique. La menace de guerre était notre horizon, notre cadre d'existence.
Bien plus que la vie de famille, les événements de l'histoire du monde constituent la substance même de nos souvenirs. Je dis « les nôtres » car je suis sûr que la majorité des garçons et des filles de cette époque ont vécu la même expérience. Notre vie privée était véritablement menacée, et c'est sans doute pourquoi je suis fasciné par l'histoire et le lien entre l'expérience personnelle et les événements dans lesquels nous sommes impliqués.
Je crois que c'est là le point de départ de mon inclination théorique. Ce fragment autobiographique est issu d'une de ses conversations tardives, où Foucault partage ses préoccupations personnelles plus volontiers que dans sa jeunesse. Le philosophe situe ici les origines de sa pensée dans ses expériences d'enfance.
Le fait que les êtres humains soient projetés dans des situations historiques qui déterminent leurs horizons, que des conditions contingentes façonnent la perception collective, fascinait Foucault, alors étudiant qui avait obtenu son baccalauréat en 1943 dans la France occupée par les nazis. La menace du fascisme, cette pathologie du pouvoir, comme il la nommerait plus tard, avait très tôt orienté sa vie théorique et politique. Près de dix-sept ans plus tôt, le 15 avril 1943,
Le 1er octobre 1926, Paul-Michel Foucault naissait dans une famille aisée de médecins à Poitiers, en province française. Le premier de ses deux prénoms évoque son père mal-aimé, ce qui, selon ses amis, aurait motivé Foucault à abandonner sa famille à son arrivée à Paris en 1945. Dès lors, il se faisait simplement appeler Michel.
Après avoir passé avec brio les examens préalables à l'entrée à l'université, Foucault entre en 1946 à l'École normale supérieure, rue Dulles, pour y entreprendre des études de philosophie et de psychologie. Commence alors une période de martyre. Michel, alors âgé de dix-neuf ans, ne parvient pas à s'intégrer à la communauté des normaliens, dont les générations précédentes comptent des figures aussi illustres que Jean-Paul Sartre, Raymond Aron et Maurice Merleau-Ponty.
Une atmosphère de performance et de compétition pèse souvent sur les étudiants de l'École. D'anciens élèves, souhaitant garder l'anonymat, rapportent que chacun d'eux nourrissait sa propre névrose. Foucault se retirait dans la solitude et se moquait de ses camarades avec une intelligence cruelle qui devint bientôt célèbre.
Foucault se trouve en désaccord avec quiconque s'intéresse à lui. Ses anciens camarades de classe décrivent le jeune Michel comme cynique, agressif et extrêmement instable mentalement. De nombreuses anecdotes existent sur son comportement erratique à la fin des années 1940.
Par exemple, un professeur l'a trouvé allongé par terre, la poitrine ouverte, une lame de rasoir à la main. Une autre fois, on l'a vu se faufiler dans les couloirs la nuit, poursuivant un camarade de classe armé d'un poignard. Un collègue, qui le connaissait déjà bien à l'époque, a affirmé qu'il avait frôlé la folie toute sa vie.
Après sa première tentative de suicide en 1948, Michel Foucault fut interné à l'hôpital Sainte-Anne. Un peu plus tard, il y travaillerait comme interne et vivrait l'expérience de l'autre côté. Cependant, lors de sa première rencontre avec l'institution psychiatrique, dont il décrira avec force les origines et les procédures dans son premier ouvrage « Folie et Société », Foucault endossa le rôle du patient.
La frontière tracée à un certain moment de l'histoire de la raison occidentale, séparant le fou du sain d'esprit, sera d'une grande importance pour l'œuvre de Foucault. Il ne franchit pas cette frontière uniquement en théorie. Dans un entretien accordé en 1978 au journaliste italien Duccio Trombadori, Foucault revient plus crûment que jamais sur l'imbrication de sa vie et de son œuvre.
Il n'existe pas de livre que j'aie écrit qui ne soit au moins en partie basé sur une expérience personnelle directe. J'ai eu une relation complexe et personnelle avec la folie et l'institution psychiatrique. J'ai eu une relation particulière avec la maladie et même avec la mort.
J'ai écrit sur la naissance de la clinique et l'introduction de la mort dans la connaissance médicale à une époque où ces sujets revêtaient une certaine importance pour moi. Il en va de même, pour d'autres raisons, pour la prison et la sexualité. La plupart de ses anciens camarades de classe s'accordent à dire que l'ouvrage fondateur « Folie et Société » est étroitement lié à l'histoire personnelle de Foucault.
Il se rebelle contre le terrorisme de la raison, contre la figure historiquement fluide de la normalité, qui diffame ce qui lui est différent comme étant malade. Le jeune Foucault s'enthousiasme pour la possibilité du philosophe fou, qui, avec ses mots sans abri, fait s'écrouler les maisons moisies du langage discursif. Sa résistance philosophique à la normalisation passe d'abord par la littérature.
Michel Foucault lit avec enthousiasme les auteurs de la transgression et les apologistes de l'expérience des limites : Georges Bataille, Maurice Blanchot, Demarquis de Sade, Pierre Klosowski et, bien sûr, Friedrich Nietzsche.
L'expérience, chez Nietzsche, Blanchot et Bataille, sert à arracher l'objet à lui-même, jusqu'à ce qu'il ne soit plus lui-même ou qu'il soit poussé vers son anéantissement ou sa dissolution. Une telle entreprise est une désubjectivation.
L'idée d'une expérience liminaire qui arrache l'objet à lui-même – c'est précisément ce qui m'importait dans ma lecture de Nietzsche, Bataille et Blanchot. C'est précisément cette idée qui m'a poussé à toujours comprendre mes livres, aussi ennuyeux ou érudits soient-ils, comme des expériences immédiates visant à m'arracher à moi-même, à m'empêcher d'être le même. Outre l'influence de son professeur et ami, le théoricien marxiste français Louis Althusser, ses contacts étroits avec le Parti communiste ont également été médiatisés par ces mêmes auteurs fous, un étrange paradoxe. Pour nous, s'intéresser à Nietzsche et Bataille ne signifiait pas nous éloigner du marxisme ou du communisme ; c'était plutôt le seul accès à ce que nous attendions du communisme.
Le rejet du monde dans lequel nous vivions ne trouvait certainement pas d'épanouissement dans la philosophie hégélienne. Nous cherchions d'autres façons de nous relier à cet autre monde que nous voyions incarné par le communisme.
C'est pourquoi, en 1950, sans grande connaissance de Marx, j'ai pu adhérer au Parti communiste français, par rejet de l'hégélianisme et par malaise face à l'existentialisme.
Être un communiste nietzschéen était, bien sûr, irréaliste et, si l'on peut dire, ridicule. Je le savais. Comme le suggèrent déjà ces phrases, Foucault n'était pas le seul, rue Dulles, à rejeter les courants intellectuels dominants que sont l'hégélianisme, la phénoménologie et l'existentialisme.
La génération structuraliste remettra bientôt en cause la philosophie de l'objet. Parfois, une guerre de tranchées sanglante est imminente dans le monde de l'esprit. Pour l'instant, cependant, Jean-Paul Sartre demeure une figure emblématique incontestée, et l'existentialisme est la philosophie dominante en France.
L'idéologie politique dominante parmi les intellectuels est le marxisme. Depuis 1948 au plus tard, le Parti communiste s'est solidement implanté à l'École normale. Les courants de pensée sont de plus en plus encombrés par les principes de l'idéologie orthodoxe.