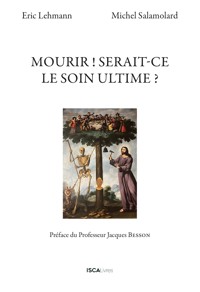
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Isca
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
« Voici un livre indispensable, une
disputatio entre deux amis, qui vont à l’essentiel, une initiative rare dans notre monde de la distraction, qui précisément nous détourne de l’essentiel.
Un échange en toute sincérité avec des divergences et des convergences entre le journaliste laïc et le prêtre catholique. C’est que le sujet est à l’ordre du jour des commissions d’éthique, des juristes et des politiques. Face au vieillissement de la population, des progrès de la médecine et des coûts de la santé, la question du libre arbitre et de la dignité de la vie mérite bien une
disputatio ! »
À PROPOS DES AUTEURS
Michel Salamolard, théologien de grand renom, est prêtre du diocèse de Sion. Humaniste, guide de haute montagne, écrivain, on lui doit de nombreux ouvrages traitant de théologie et de spiritualité mais aussi de questions de société.
Après une carrière dans les médias — il a notamment présidé la Radio-Télévision-Suisse, créé pour l’OSCE la Radio Télévision du Kosovo — la gestion d’entreprises et la sécurité,
Éric Lehmann, actuel président du tribunal arbitral d’une fédération sportive, consacre le reste de son temps à l’écriture. On lui doit plusieurs essais politiques, quelques romans et deux pièces de théâtre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eric Lehmann et Michel Salamolard
Préface du professeur Jacques Besson
Mourir ! Serait-cele soin ultime ?
© 2024, Eric Lehmann et Michel Salamolard.
Reproduction et traduction, même partielles, interdites.Tous droits réservés pour tous les pays.
ISBN 9782889820887
« La mort est un manque de savoir-vivre. »
Alphonse Allais
Présentation
Eric
L’ouvrage que vous tenez entre les mains est né d’un bref échange verbal entre un théologien, Michel Salamolard, et un écrivain, Eric Lehmann, auquel Canal 9, une télévision locale suisse, demandait s’il allait approuver dans les urnes le texte final de la nouvelle constitution cantonale valaisanne, une constitution rédigée en quatre ans par cent trente constituants et une dépense de quelque sept millions de francs suisses. Si, « au nom de Dieu tout puissant » l’ancien texte fondamental contenait quatre-vingt-dix articles, le nouveau en proposait près de deux cents.
Pour l’écrivain il fallait voter oui, même s’il relevait dans le « catalogue fondamental » quelques scories évitables et le risque, sinon, de remettre l’ouvrage sur le métier occasionnant sûrement la « ponte » d’une nouvelle constitution « diarrhéique ».
Pour le théologien, abbé de son état, il fallait voter non tant l’article 14 posait problème ; en voici sa teneur :
Art. 14 – droit à la vie, à la liberté personnelle et à une fin de vie digne : Tout être humain a droit à la vie, à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement, ainsi qu’à une fin de vie digne librement choisie.
Ainsi naquit cette nouvelle disputatio intellectuelle entre les deux, après celle qui nous vit débattre de la liturgie catholique dans l’essai Ciel mon Église ! Curé à ta mort qui m’en ouvrira la porte ?, paru aux Éditions Saint-Augustin.
Le professeur Jacques Besson, spécialiste des rapports entre la psychanalyse et la religion, préface cet ouvrage.
*
Michel
Sagesse des urnes ! Le projet présenté au vote populaire comportait trop de graves défauts, notamment son article 14, ouvrant large la porte au suicide assisté et à l’euthanasie, tandis que l’État se défaussait de sa responsabilité de protéger la vie de tous, notamment les plus faibles. Parmi les seniors, les personnes en proche fin de vie.
J’espère que le parlement du Valais tirera les meilleures conclusions possibles de ce vote.
En attendant, je m’efforcerai ici de compléter, de nuancer ou de disputer les propos d’Éric Lehmann sur des questions vertigineuses. Nous espérons tous deux nourrir ainsi la réflexion de nos lecteurs. Penser la mort, c’est penser la vie.
Préface
Voici un livre indispensable, une disputatio entre deux amis, qui vont à l’essentiel, une initiative rare dans notre monde de la distraction, qui précisément nous détourne de l’essentiel.
Un échange en toute sincérité avec des divergences et des convergences entre le journaliste laïc et le prêtre catholique. C’est que le sujet est à l’ordre du jour des commissions d’éthique, des juristes et des politiques. Face au vieillissement de la population, des progrès de la médecine et des coûts de la santé, la question du libre arbitre et de la dignité de la vie mérite bien une disputatio !
Mais qu’est-ce que le libre arbitre en psychiatrie ? Il y a la question du discernement, face aux différentes psychopathologies : troubles psychotiques, troubles graves de la personnalité, troubles dépressifs et bipolaires, etc. Pour le psychiatre, la question de la mort se pose à travers la question du suicide avant tout, qui polarise une posture médicale et de protection des patients. Le suicide philosophique n’est pas un problème médical, s’il existe… et il y a la psychogériatrie et le vaste questionnement de la conscience dans la démence et les pathologies neurodégénératives. Quelle limite aux soins en fin de vie ?
Pour la psychanalyse, la mort n’est pas représentable dans l’inconscient : tout n’est que négation. Angoisse de castration et fin de la jouissance, angoisse de séparation et fin des relations, angoisse de morcellement et finitude du corps. Tout au plus, un sommeil sans rêves.
Mais l’arrivée des neurosciences va bouleverser le paysage : c’est le mystère des expériences de mort imminente (EMI). Comment un cerveau qui ne reçoit plus d’oxygène, plus de glucose, dont l’électroencéphalogramme est plat, peut-il rapporter des expériences de sortie hors du corps, de revue de vie, de rencontre avec des proches décédés, de vision d’un tunnel avec une magnifique lumière et un être de lumière, source d’apaisement, transformant l’existence des sujets à leur retour dans la vie ? D’innombrables témoignages sont à disposition, posant une énigme pour la science matérialiste, qui ne peut qu’objecter évidemment que ces personnes ne sont pas vraiment décédées ou produire de vagues hypothèses neurologiques qui ne recouvrent pas ce mystère.
On retrouve alors la disputatio de nos deux auteurs : car qu’est-ce que la conscience ? Est-ce une production du cerveau humain ? ou bien le cerveau humain est-il capable d’accéder à un monde plus grand, une conscience universelle ? Notre laïcité est bien pauvre face au mystère du vivant. L’humain a un besoin de sens, qui, s’il est refoulé, produit une névrose de civilisation, dont la caractéristique est le vide existentiel, dont les symptômes sont la dépression, l’agression et l’addiction.
Cette volonté de sens est explorée actuellement par les neurosciences de la spiritualité, qui montrent notamment dans la méditation, mais aussi dans la prière, des circuits impliqués dans la cohérence et la résilience, circuits fondateurs de ce qu’il convient de nommer la santé spirituelle. Toutes les religions ont le même centre, une spiritualité en quête de sens et de liens. Ce sont les trois liens, lien à soi-même, lien à autrui et lien à la nature et à l’univers, qui donnent le sens à l’existence.
Ainsi, l’humilité scientifique nous fait accéder à la docte ignorance, qui nous donne notre dignité dans nos choix existentiels et nos valeurs humaines.
Le vaste tour d’horizon offert par nos deux auteurs sur l’ultime est un témoignage authentique et contemporain sur l’essentiel.
Leur disputatio est finalement un hymne à la vie et à la sagesse, dont notre monde a un urgent besoin. Je vous souhaite une joyeuse lecture !
Jacques BESSON, professeur honoraire, faculté de biologie et de médecine, université de Lausanne. Psychiatre psychothérapeute FMH.
Prologue
Eric
Vous vous souvenez peut-être, tirées des Misérables de Victor Hugo, les phrases suivantes :
Un jour il voyait des gens du pays très occupés à arracher des orties ; il regarda ce tas de plantes déracinées et déjà desséchées, et dit : « C’est mort. Cela serait pourtant bon si l’on savait s’en servir. Quand l’ortie est jeune, la feuille est un légume excellent ; quand elle vieillit, elle a des filaments et des fibres comme le chanvre et le lin. La toile d’ortie vaut la toile chanvre. Hachée, l’ortie est bonne pour la volaille ; broyée elle est bonne pour les bêtes à cornes. La graine de l’ortie mêlée au fourrage donne du luisant au poil des animaux ; la racine mêlée au sel produit une belle couleur jaune. C’est du reste un excellent foin qu’on peut faucher deux fois. Et que faut-il à l’ortie ? Peu de terre, nul soin, nulle culture. Seulement la graine tombe à mesure qu’elle mûrit, et c’est difficile à récolter. Avec quelque peine qu’on prendrait, l’ortie serait utile : on la néglige, elle devient nuisible. Alors on la tue. Que d’hommes ressemblent à l’ortie ! » Il ajouta, après un silence : « Mes amis retenez ceci ! il n’y a ni mauvaises herbes ni mauvais homme. Il n’y a que de mauvais cultivateurs. »
Oserons-nous la comparaison ?
*
Michel
Bien des années après Victor Hugo, un adolescent de 15 ans meurt d’un cancer foudroyant, en 2006, à Monza (Italie). Quelques années plus tard, il est déclaré bienheureux, bientôt saint, par le pape François. À cause de son amour pour Jésus et pour les pauvres. À cause de sa courte vie entièrement donnée, consacrée.
Comme Victor Hugo, Carlo aimait les comparaisons. Se trouvant un jour non dans un champ d’orties, mais devant sa photocopieuse, il dit en riant à ses amis présents : « De naissance, nous sommes tous des originaux, mais beaucoup meurent comme des copies. »
Et les jeunes gens de s’esclaffer tout en se promettant sans doute, in petto, de découvrir et de développer ce que chacun d’eux possédait de belle originalité à partager.
Oserons-nous prendre conscience de notre propre et précieuse originalité ? Non pas celle des apparences qui séparent, mais celle du cœur qui rapproche et rassemble.
La bourse ou la vie
Eric
Nous connaissons tous cette expression tout droit sortie du Moyen Âge durant lequel les bandits de grand chemin criaient leurs revendications comme aujourd’hui un braqueur vous mettrait un couteau sous la gorge en chuchotant : « Tu fais le con et je te zigouille. »
À l’époque, tu avais donc le choix : tu lui donnais ta bourse ou tu lui donnais ta vie. À dire vrai, le choix n’existait pas vraiment ; en admettant que tu lui eus refusé ta bourse, il y aurait eu peu de chance qu’il te laissât la bourse après t’avoir pris ta vie.
À mon âge, après avoir connu « mille vies », le temps est venu de me poser une question essentielle : la vie ou la mort ?
Ce matin, en me réveillant, je me suis livré à un petit calcul dont je vous donne ici les résultats « à la louche ». J’ai « vécu » quelque 28 105 jours ou encore 674 520 heures. Durant le même temps, j’ai roupillé, à raison de sept heures de moyenne par jour, 196 735 heures. En soustrayant mes heures de sommeil, je n’ai donc « vécu » que 477 785 heures.
Cela dit, en analysant avec circonspection ces chiffres, je me suis aussitôt posé des tas de questions sur la vie et sur cette « presque mort » que peut représenter le sommeil, même si mon sommeil paradoxal a connu quelques heures de béatitude lors de rêves que je préfère ne pas conter ici afin de ne point heurter vos sensibilités ou vos commentaires désabusés ou jaloux.
Dans le fond, si vous me pardonnez l’expression, c’est plutôt « con » la vie alors que la mort a cette profondeur philosophique qui nous réserve une égalité intellectuelle, corporelle, esthétique, sociale. (Je dis ça dans l’incertitude parfaite que revendiquerait un agnostique à qui l’on poserait la question ou à la certitude clamée par un athée. Mais je dis aussi ça en attendant que Michel Salamolard tente de me rassurer bientôt.)
Mais revenons à ma vie, ou à la vôtre.
De tout temps, l’homme a cherché, non pas à comprendre ce qu’il pouvait bien y « foutre » dans cette existence mais bien à y survivre comme des milliards d’individus ont tenté de le faire depuis des millénaires, en suivant peu ou prou les recommandations parentales :
Bois ton lait, c’est important ! Il serait temps que tu jettes ta lolette ! Ah, j’espère que tu vas bientôt cesser de pisser au lit. Fais tes devoirs ! Sois poli ! Tu ne peux pas frapper tes camarades. Mange ta soupe ! Prends ta douche ! Brosse-toi les dents ! Tu pourrais te changer. Va chez le coiffeur ! Tu vas faire quoi plus tard ? Et ton apprentissage ? Et tes études ? Serait temps que tu trouves du boulot ! Couvre-toi tu vas être malade ! Tu veux te marier ? Tu veux divorcer ? Tu veux avoir des enfants ? Tu devrais éviter de trop boire ! T’as rendez-vous chez le toubib ? T’as eu le Covid ?
Et ainsi de suite, dans un vaste mouvement fait de contraintes et, rarement, de libérations.
Bon, je confesse que tout ce qui précède n’est pas vraiment folichon alors que mes mille vies furent assez heureuses. Malheureusement, en m’observant dans le miroir de ma salle de bains ou dans celui de mes pensées, j’avoue que la fin du cycle de la vie ne m’enchante qu’à moitié. À tel point que je vais commencer à prolonger mes temps de sommeil, et peut-être même faire une petite sieste, en espérant que mon sommeil paradoxal m’offre quelques joyeux dérivatifs.
On m’avait dit la retraite bénie, j’ai pu constater qu’elle était souvent une bonne excuse pour les actifs « de sourire en coin » à votre endroit. D’un jour à l’autre, vous passez de « Vous êtes » à « vous étiez ».
Ça n’a l’air de rien ce simple changement de conjugaison « condescendante », mais il me rappelle bougrement les fameux vers de Corneille :
Marquise si mon visage a quelques traits un peu vieux. Souvenez-vous qu’à mon âge vous ne vaudrez guère mieux.
Tout sauf déchoir !
Il y a une trentaine d’années, c’est dans la bouche d’un célèbre avocat que j’entendis ces trois mots : « Tout sauf déchoir ». Dans la conversation qui suivit, il me dit la mort de ses proches, leurs souffrances psychiques, leurs maux profonds, leurs aliénations dégénératives, leurs séjours en mouroirs, en hôpitaux, en soins palliatifs à une époque, où Exit n’existait pas, où le « non déchoir » obligeait au suicide.
À ma question : « Et vous, en cas de déchéance ? », il eut cette réponse : « En aurai-je la raison ou le courage ? »
*
Michel
« Tout sauf déchoir ! » Des premiers propos d’Eric sur le sens de la vie et de la fin de vie, je retiens cette exclamation entendue par lui, il y a longtemps. De quelle déchéance s’agit-il ? De quelle chute dans quel cul-de-basse-fosse ? Dans les tragédies de Corneille, Le Cid par exemple, le pire des écroulements est celui d’une supériorité sociale. Un homme âgé perd un duel dans lequel il avait engagé son « honneur », la reconnaissance de son rang, de sa renommée.
Dans le cas cité par Eric, il s’agit plutôt de l’affaiblissement physique et mental dû au grand âge. Pertes de certaines compétences et facultés, perte d’autonomie, dépendance d’autrui pour les nécessités les plus élémentaires de la vie. Craintes anticipées de ne plus être considéré, d’être mal soigné, maltraité. Peur de douleurs impossibles à calmer. Horreur de devenir « objet » de soins.
Refus, en somme, de perdre sa dignité, comme si cette dernière n’était pas imperdable, mais simplement attachée momentanément à nous par les agrafes ténues de l’argent, du pouvoir, de la santé, de la jeunesse.
Ces craintes constituent le fonds de commerce des organisations d’aide au suicide. Elles s’efforcent de convaincre les quinquagénaires, les sexagénaires en pleine forme que, bientôt, leur fin de vie sera atroce, qu’ils perdront leur dignité en même temps que leur autonomie, bref, que pour rester digne, mieux vaut se suicider. En tout cas, ne pas se priver de cette option. L’acheter par avance en cotisant serait même la meilleure assurance vie !
À ce vent de panique, soufflé notamment par Exit, opposons quelques remarques de bon sens et de réalisme à propos de déchéance et de dépendance, ces deux spectres brandis par les marchands de suicide.
Commençons par la « déchéance », entendue au sens de perte de notre dignité humaine. Or, cette dernière est le cœur même de notre personne. Il ne s’agit pas de notre pouvoir social ni même de notre vertu, mais de ce qui fait de nous des humains, et non de simples animaux parmi d’autres : les fourmis, les chats, les éléphants, les singes, les abeilles…
Personne ne peut perdre sa dignité humaine foncière. Seule la mort la fait disparaître, du moins de notre monde visible. Un handicapé, un malade Alzheimer, un criminel, un sans-abri, un super-riche, un dictateur, une star des médias, un pauvre diable : tous ont même dignité humaine, imperdable.
Chez tous, l’expression de cette dignité est limitée, entravée (jamais supprimée). Les atteintes sont sans doute bien plus graves chez les bourreaux, qui piétinent leur dignité, que chez les victimes, qui en subissent les effets – avec une dignité souvent remarquable.
Autre chose que notre dignité est donc le respect de celle-ci par autrui, par la société. Ce respect ne va pas de soi, il varie beaucoup selon les rapports de force en présence, selon les apparences. De ce point de vue, mieux vaut être riche, en bonne santé et puissant plutôt que misérable, malade et faible…
Si, maintenant, on pense aux personnes affaiblies et en partie abîmées par le grand âge, il faut immédiatement souligner le développement spectaculaire des soins palliatifs. Il y a soixante ans à peine, ces soins n’existaient pas comme tels.
Depuis leur création en 1967, par Cicely Saunders, à Londres, ils se sont généralisés, améliorés, spécialisés. Des maisons ou des unités de soins palliatifs existent partout, en rapport évidemment avec les moyens économiques des différents pays. Et selon la volonté des gouvernements.
Les soins palliatifs peuvent et doivent encore être développés, améliorés en quantité et en qualité. Ils constituent la seule vraie réponse aux craintes évoquées par Éric à propos du vieillissement.
Le respect de la dignité de tous les patients, quel que soit leur état, est au centre des établissements et des équipes de soins palliatifs. Respect, bienveillance, maîtrise de la douleur, confort physique, psychique et spirituel du patient : tels sont les objectifs, servis par des moyens en constante progression.
La banalisation et la promotion active du suicide assisté ou de l’euthanasie freinent et empêchent le développement des soins palliatifs. On ne peut favoriser en même temps la vie et la mort de quiconque.
Quant à notre désir d’indépendance, il faut reconnaître son ambivalence. D’un côté, il peut nous pousser à nous affirmer, à ne pas devenir une charge pour autrui, à mettre en valeur nos capacités, à nous dépasser, à contribuer au bien commun.
D’un autre côté, il peut aussi nous replier sur nous-mêmes et sur nos intérêts particuliers, il peut nous séparer des autres, nous garder captifs d’une fausse image de nous-mêmes, nous empêcher de nous réaliser en tant qu’être de relation, capable de donner et de se donner.
D’un côté, notre volonté d’indépendance nous libère, d’un autre côté elle nous asservit. Paradoxalement, elle peut nous rendre hyper dépendants du regard d’autrui, de l’opinion publique, des médias, où nous cherchons de l’admiration, de la reconnaissance, de la soumission, de l’affection – réelle ou supposée.
Le besoin de paraître aux yeux d’autrui peut devenir l’une des drogues les plus addictives. Autrement dit, une dépendance des plus sournoises, qui ne dit pas son nom – qui ne sait même pas son nom, ne veut pas le savoir.
Qui connaît tous les succès, professionnels, économiques, sociaux, médiatiques n’est-il pas précisément dépendant, le sachant plus ou moins, de ses partenaires, de ses vrais ou faux amis, de ses employés, de ses employeurs, de ses clients, des journalistes, de la Bourse, de ses médecins, du marché ?
Parmi tant de dépendances inévitables, un tri essentiel mérite d’être opéré. Esquissons-le à grands coups de pinceau. Il y a, premièrement, les dépendances qui nous attachent à des choses (nature, argent, technique, etc.) et, d’autre part les dépendances qui nous attachent à des personnes humaines.
Dans la seconde catégorie, celle des personnes, il existe des dépendances qui nous limitent, et d’autres qui nous libèrent. Les premières (limitantes) nous viennent par exemple de nos supérieurs, de la police, de nos partenaires ou clients. Les secondes (libératrices) nous sont offertes par ceux et celles qui nous aiment vraiment.
Dépendre de la force d’autrui nous limite. C’est en partie utile et nécessaire, en partie oppressant. Dépendre de l’amour vrai d’autrui nous rend libres. C’est toujours bienfaisant, pour qui aime et qui est aimé, en réciprocité.
Les soins palliatifs s’efforcent de conjuguer toujours mieux les deux courants : celui de la force des techniques et des médicaments, d’une part ; celui de l’amour et du respect, d’autre part.
Concernant le moment particulier de la fin de vie, le choix n’est pas entre dépendre ou ne pas dépendre, mais entre une dépendance et une autre.
Le suicide assisté et l’euthanasie nous font dépendre d’autrui pour mourir prématurément. Les soins palliatifs nous donnent de dépendre des bons soins d’autrui pour vivre aussi bien que possible, avant de mourir de mort naturelle.
N’est-il pas contre-intuitif de se résoudre à mourir de mort violente, par suicide assisté ou par euthanasie ? Dans les deux cas, il s’agit bel et bien de mort violente au moyen d’un poison puissant. Quelle est alors l’expérience réelle vécue dans ses profondeurs invisibles par la personne qui meurt ainsi ? Nul ne le sait.
Détester et combattre la mort en général, sa propre mort surtout, n’est-ce pas le désir le plus profond de tous les hommes depuis toujours ? Le désir humain le plus créateur de progrès, d’amélioration et d’allongement de la vie ? Et le plus inducteur de curiosité concernant un éventuel au-delà ?
S’imaginer maîtriser la mort en choisissant – si on peut parler de choix – de se suicider ou d’être euthanasié, n’est-ce pas finalement la plus grande illusion ? Celle d’une liberté qui croit s’affirmer en se condamnant elle-même à disparaître… sans y parvenir autrement que par l’intervention d’un tiers. Dont le désintéressement peut être supposé, présumé, mais pas certifié, tellement sont possibles les ruses d’une pulsion de mort dans notre inconscient.
Ces premières remarques ne répondent pas à toutes les questions, évidemment. Elles posent plutôt de nouvelles interrogations. Qu’elles servent au moins d’introduction aux chapitres suivants.





























