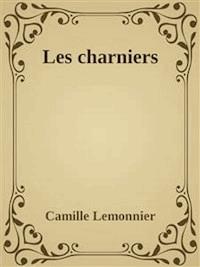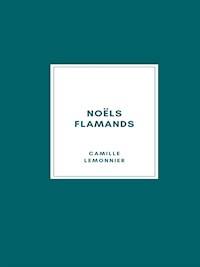
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
«Tout à coup, Lemonnier change de manière. Il ferme ses écrins, éteint ses feux. Le style se serre, la phrase n’a plus cette hâte fébrile, ces cahots, ces soulèvements joyeux qui l’emportent et la font jaillir, elle se dépouille également de sa grandesse fastueuse, de ses traînes éclatantes. L’artiste la tisse à nouveau, la teint de couleurs plus amorties, arrive soudain à une simplicité puissante, à un campé d’un naturel vraiment inouï. Les scènes de la vie nationale sont sur le chantier.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Camille Lemonnier
NOËLS FLAMANDS
© 2020 Librorium Editions
Tous Droits Réservés
UN MOT
Nous connaissons aussi peu la littérature de la Belgique, notre voisine, que celles de la Grèce ou du Portugal, et ce n’est certes pas peu dire !
Un écrivain belge ne nous intéresse que lorsqu’un succès éclatant l’a sacré parisien. Alors, parfois, notre public lettré se passionne pour lui et cette passion cherche à s’assouvir en fouillant dans le passé de l’écrivain.
C’est ainsi que peu après la publication du Mâle que j’avais lu avec une admiration enthousiaste pour cette belle langue si dix-neuvième siècle par ses néologismes et sa pure correction, j’entrevis l’auteur des Noëls flamands dans une reproduction de Fleur de Blé (Blœmentje) que fit alors la Revue littéraire et artistique.
Mis en appétit de la sorte, j’étais si gourmand de ces pages originales et colorées que je me hâtai de m’enquérir des œuvres de l’écrivain.
Me les procurer me fut difficile… Bien des volumes étaient introuvables et il fallait se contenter d’avis de critiques, de jugements de journaux.
Je recueillis ainsi un vieil article du Danube de Vienne, reproduit par le Courrier d’État de Bruxelles qui me renseigna un peu sur la personne et les débuts de M. Camille Lemonnier.
« Bien jeune encore, y lisait-on, l’auteur de ces contes a groupé autour de lui un centre d’artistes et d’écrivains fervents. Tout à la fois journaliste, romancier et critique d’art… les idées qu’il a défendues dans l’Art et qui peuvent se résumer par ces mots : modernité, nationalité, réalisme, il les a mises en pratique dans ses livres, surtout dans ses contes, caractéristiques comme un livre de Dickens ou de Auerbach. Ce sont des histoires populaires, dans lesquelles l’auteur fait défiler tout un monde de figures touchantes, naïves, drôles, fantasques même, ayant pour cadre les paysages, les mœurs et les coutumes du pays. Celui qui voudra connaître la Belgique la retrouvera dans ce livre, parce que, non seulement il y verra la réalité la plus minutieuse des faits, mais l’aspiration des âmes et les milieux de l’esprit. Il n’y avait qu’un réel et profond observateur qui pût rendre intéressants tant de petits détails en les présentant sous leur côté essentiel, et il fallait que l’observateur fût lui-même doublé d’un artiste.
« L’art de Camille Lemonnier est certainement un art très curieux et très complet, art d’étude, de recherche, de sagacité, simple à la fois et raffiné, qui met les moindres choses en relief et fait vivre ses romans comme des tableaux de vieux maîtres hollandais. Vous verrez chez lui dans la couleur locale, les fêtes patronales, les jouissances populaires, les Kermesses, l’aspect intime et familier des Flandres tel qu’il n’avait pas encore été exprimé. Les personnages se meuvent, on voit leurs moindres gestes, et ils sont comme étudiés à la loupe. Quant aux sujets ils sont très simples, comme si l’auteur voulait laisser toute la lumière aux figures des paysans, petits bourgeois, boutiquiers, gens du peuple. Il y a, du reste, nombre de situations comiques, à la manière de Jean Steen ; c’est le même esprit jovial, tendre, amoureux, naïf, dans une suite de peintures dont le fini rappelle la technique de ce grand peintre. Il y a peu d’histoires plus simples et plus intéressantes que son conte de Blœmentje(1), un petit chef-d’œuvre, et peu d’histoires plus amusantes que le Mariage en Brabant, une autre perle. Tout cela est local ; mais il faut lire la langue de l’écrivain, l’art merveilleux avec lequel il l’assouplit à ses sujets flamands, pour saisir sa véritable originalité. »
Bientôt la Vie littéraire, une petite revue qui succéda à la République des lettres et précéda, je crois, la Jeune France, fournit à mes archives ce joli jugement de M. J.-K. Huysmans :
« Tout à coup, Lemonnier change de manière. Il ferme ses écrins, éteint ses feux. Le style se serre, la phrase n’a plus cette hâte fébrile, ces cahots, ces soulèvements joyeux qui l’emportent et la font jaillir, elle se dépouille également de sa grandesse fastueuse, de ses traînes éclatantes. L’artiste la tisse à nouveau, la teint de couleurs plus amorties, arrive soudain à une simplicité puissante, à un campé d’un naturel vraiment inouï. Les scènes de la vie nationale sont sur le chantier. L’auteur va nous retracer l’existence des déshérités du Brabant, et alors défilent devant nous six nouvelles merveilleuses : La Saint Nicolas du batelier ; le Noël du petit joueur de violon ; un mariage dans le Brabant ; Blœmentje ; la Sainte-Catherine et le Thé de la tante Michel.
« Le coloriste endiablé que nous avons connu, le contemplateur enthousiaste des automnes dorés, se change en un observateur minutieux. L’émotion ressentie en face du paysage s’est reportée sur l’être animé, vibre maintenant plus intense et plus humaine. Le naturaliste, l’intimiste a fait craquer le masque du poète et du peintre. Un nouvel écrivain est devant nous, un écrivain sincère, franc, qui par un miracle d’art, va nous donner ce petit chef-d’œuvre : Blœmentje. Là est la vraie note, la note exquise de Lemonnier. C’est la simple histoire de la petite fille d’un boulanger, qui se meurt pendant la nuit de Saint-Nicolas. Il y a un moment quand le prêtre, fermant son bréviaire dit : Seigneur, mon Dieu, prenez pitié de ces pauvres gens ! où l’on étouffe et l’on étrangle. Dans une autre nouvelle, la dernière du livre, le Thé de la tante Michel, le dramatique est encore en dessous, discret et voilé, puis il se dégage, sans phrases et sans cris monte à fleur de peau, vous fait frissonner et vous donne la chair de poule ; au reste tout ce volume est vraiment extraordinaire. Les personnages, les Tobias, les Nelle, le petit Francisco qui rêve à des paradis de sucre, si étonnamment décrits, les Jans, les Cappelle, s’agitent, vivent d’une vie intense. Il faut les voir, les braves gens, campés debout et riant de tout cœur, ou bien penchés sur la poêle qui chante, l’œil émerillonné, épiant la lutte des fritures, la cuisson des schœsels ; il faut le voir, le vieux savetier Claes Nikker, rapetassant les bottes du village, causant avec l’un, avec l’autre, luttant de matoiserie et de ruse avec la famille Snip, discutant avec une opiniâtreté d’avare le mariage de sa nièce, pendant que les amoureux tremblent, des grands benêts qui s’adorent et osent tout juste se prendre la main ! Ce livre est, selon moi, le livre flamand par excellence. Il dégage un arôme curieux du pays belge. La vie flamande a eu son extracteur de subtile essence en Lemonnier qui a des points de contact avec Dickens, mais qui ne dérive de personne. Le premier par ordre de talents dans les Flandres, il a commencé à faire avec ses contes, pour la Belgique ce que Dickens et Thackeray ont fait pour l’Angleterre, Freytag pour l’Allemagne, Hildebrand pour la Hollande, Nicolas Gogol et Tourgueneff pour la Russie. »
Pourquoi donc ces contes si inconnus en France étaient-ils si populaires en Belgique ? Bien plus, je les trouvais traduits en flamand, en allemand, en italien, en espagnol même. C’est qu’à dire vrai, nous autres Français, sommes ou plutôt étions, car ce vice a l’air de disparaître depuis quelques années, d’épouvantables contemplateurs de notre nombril, et que les contes flamands de M. Camille Lemonnier étaient un vrai fruit du cru sain et de saveur franche, comme le disait M. Henri Taine.
« La double race wallonne et flamande, qui forme la Belgique actuelle, écrivait un critique, s’inscrit chez l’auteur des Contes : son large tempérament, merveilleusement ouvert aux plus fugitives nuances de l’observation, résume tout à la fois la placidité, la songerie, la gravité pensive des Flandres et la verve, la fougue, le penchant à la gaîté des populations wallonnes. Il offre l’un des plus rares exemples qui soient, d’un écrivain sorti d’une race complexe et reflétant tous les caractères de cette race, même les plus antithétiques. Camille Lemonnier n’est ni Flamand ni Wallon ; il est l’un et l’autre en même temps et cela seul expliquerait sa multiple personnalité, large à contenir un peuple tout entier. Ceux qui lui ont reproché l’excessive variété de son œuvre ne se sont pas rendu compte que cette variété lui venait de cette étonnante prédisposition qui le porte à examiner tantôt l’un tantôt l’autre des caractères inhérents à ses origines. Autant les Contes, le Coin de village sont choses flamandes, et flamandes au point que personne avant Camille Lemonnier n’est parvenu à dégager avec une telle netteté l’impression de la vie populaire des pays flamands, autant Le Mâle(2) nous restitue l’impression du caractère, des mœurs, du langage et du paysage wallon.
« Il y a mieux : ici même, la différence des milieux, d’une nouvelle à l’autre, s’accompagne d’un changement dans la composition, l’esprit, le sentiment et le style. On était dans les petites villes et les campagnes baignées d’eau de la Flandre : on est tout à coup transporté parmi la gaie et chantante rusticité wallonne. Les moindres nuances sont partout généralement saisies, jusque dans le langage. Vous remarquerez l’absence du tutoiement dans les contes flamands, l’habitude des comparaisons empruntées à la vie coutumière, le tour d’esprit naïf, les sentiments simples et au contraire chez le wallon la phrase plus sèche, le tour d’esprit glorieux, le goût de la hâblerie. On peut dire de l’auteur qu’il caractérise une double race ou plutôt tout un peuple, puisque celui-ci est composé d’hommes de mœurs et d’esprit différents et que les différences à chaque instant sont reflétées dans son œuvre. »
Un jour, enfin, l’occasion se présenta pour moi de lire ces contes et de les ranger dans ma bibliothèque de lettré.
C’était bien simple.
Il s’agissait de les éditer et après l’auteur si français de l’Hystérique, des Charniers, du Mâle, du Mort, de Thérèse Monique, de Happe-Chair, des Concubins, de faire connaître à mes compatriotes l’auteur si flamand de la Saint-Nicolas du Batelier, des Bons Amis et de Fleur-de-blé.
J’ai saisi l’occasion au vol et voici le livre qu’on peut mettre, je crois, aux mains de tout le monde, qualité rare de nos jours, surtout pour un livre écrit.
Albert SAVINE.
La plupart de ces contes ont été écrits en 1871 et en 1872. En les réunissant ici sous un titre différent de celui de l’édition de 1875, l’auteur ne fait que leur restituer le titre général que, dans sa pensée, il leur avait attribué d’abord. Attiré, depuis, par un champ d’observation moins limité, ce n’est pas sans peine qu’il a pu réintégrer un domaine d’art si éloigné de ses études actuelles. Il y a été décidé toutefois par le désir de donner à ces pages qui, pour lui, sont voisines des débuts, une forme plus soignée. Il est de ceux qui pensent que, sans toucher au fond, un écrivain a le devoir de toujours amender l’œuvre sortie de sa plume, en la rapprochant, le plus qu’il peut, du degré de perfection que requiert le progrès de son éducation littéraire. Les flandricismes abondent dans son livre : il n’a eu garde de les éliminer, estimant qu’en les atténuant, il eût altéré la marque d’origine qui, peut-être, est le meilleur de ses Contes. Il s’est uniquement borné à déblayer le récit de certaines négligences qui trahissaient trop manifestement la jeunesse du narrateur. Encore n’espère-t-il pas les avoir toutes fait disparaître.
Les Noëls sont sortis d’un commerce bienveillant avec les milieux décrits : l’auteur y a dépeint les mœurs tranquilles, la médiocrité des existences, un état d’humanité simple et cordiale, telle qu’elle se suscite, en Belgique, de l’étude d’un certain peuple demeuré fidèle à de traditionnelles coutumes. Si Le Mort, L’Hystérique et Happe-chair lui ont été suggérés par la nécessité de révéler la condition sociale sous un jour affligeant, mais véridique, le présent livre tempérera, il l’espère, par une douceur de demi-teinte ce qu’il y a de cruel dans ses ultérieures constatations.
C. L.
5 Mai 1887.
LA SAINT-NICOLAS DU BATELIER
À M. Victor Lefèvre.
I
— Nous voici au plus beau jour de l’année, Nelle, dit joyeusement un homme d’une soixantaine d’années, grand et solide, à une bonne femme fraîche et proprette qui descendait l’échelle du bateau, des copeaux dans les mains.
— Oui, Tobias, répondit la femme, c’est un beau jour pour les bateliers.
— Vous souvenez-vous, Nelle, du premier Saint-Nicolas que nous avons fêté ensemble après notre mariage ?
— Oui, Tobias, il y aura bientôt quarante ans.
— Le patron Hendrik Shippe descendit dans le bateau et me dit : « Tobias, mon garçon, puisque vous avez amené une femme dans votre bateau, il faudra fêter convenablement notre révéré saint. » Et il me mit dans la main une pièce de cinq francs. Alors je dis au patron : « Mynheer Shippe, je suis plus content de vos cinq francs que si j’avais une couronne sur la tête. » Puis je sortis sans rien dire à ma chère Nelle, je passai la planche et j’allai dans le village acheter de la crème, des œufs, de la farine, des pommes et du café. Qui fut bien contente quand je rentrai avec toutes ces bonnes choses et que je les mis sur la table, l’une à côté de l’autre, tandis que le feu brûlait gaîment dans le poêle ? Qui fut contente ? Dites-le un peu vous-même, Nelle.
— Ah ! Tobias ! nous sommes restés, ce soir-là, jusqu’à dix heures la main dans la main, comme les soirs où nous nous asseyions ensemble sur le bord de l’Escaut, au clair de la lune, avant notre mariage. Mais nous avons fait, cette fois-là, bien autre chose encore. Qu’est-ce que nous avons fait ? Dites-le un peu, Tobias.
— Oh ! oh ! de belles crêpes dorées aux pommes ; j’en ai encore l’odeur dans le nez. Et j’ai voulu connaître de vous la manière de les faire sauter, mais j’en ai fait sauter deux dans le feu, et la troisième est tombée dans la gueule du chat. Oui, oui, ma Nelle, je m’en souviens.
— Eh bien ! mon homme, il nous faut faire encore de belles crêpes aux pommes en mémoire de cette bonne soirée, et j’apporte des copeaux pour allumer le feu. Et un jour, comme nous-mêmes à présent, Riekje et Dolf se souviendront de la bonne fête de saint Nicolas.
Ainsi parlaient, dans le Guldenvisch, le batelier Tobias Jeffers et sa femme Nelle.
Le Guldenvisch, baptisé de ce nom à cause du joli poisson d’or qui brillait à l’arrière et à l’avant de sa carène, était le meilleur des bateaux de M. Hendrik Shippe et il l’avait confié à Tobias Jeffers, le meilleur de ses bateliers. Non, il n’y avait pas dans Termonde de plus coquet bateau ni de mieux fait pour supporter les grandes fatigues : c’était plaisir de le voir filer, dans l’eau où il enfonçait à plein ventre, chargé de grains, de bois, de pailles ou de denrées, avec sa grosse panse brune rechampie de filets rouges et bleus, sa quille ornée du long poisson d’or aux écailles arrondies, son pont luisant et son petit panache de fumée tirebouchonnant par le tuyau de fer verni au noir.
Ce jour-là, le Guldenvisch avait chômé comme tous les bateaux de l’Escaut : il était amarré à un gros câble, ne laissant voir, vers les sept heures du soir, que la lueur claire qui rougissait le bord de sa cheminée et ses lucarnes brillantes et rondes comme des yeux de cabillaud.
C’est qu’on se préparait dignement à fêter la Saint-Nicolas dans la petite chambre qui est sous le pont ; deux chandelles brûlaient dans des flambeaux de cuivre et le poêle de fonte ronflait comme l’eau qui se précipite des écluses, quand l’éclusier vient de les ouvrir.
La bonne Nelle poussa la porte et Tobias entra sur ses pas, l’œil empli des lointaines tendresses que sa mémoire venait d’évoquer.
— Maman Nelle, fit alors une voix jeune, je vois les fenêtres rondes qui s’allument partout, l’une après l’autre, sur l’eau noire.
— Oui, Riekje, répondit Nelle, mais ce n’est pas pour voir s’allumer les fenêtres sur l’eau que vous demeurez ainsi contre la vitre, mais bien pour savoir si Dolf le beau garçon ne va pas rentrer au bateau.
Riekje se mit à rire.
— Maman Nelle voit clair dans mon cœur, dit-elle en s’asseyant près du feu et en piquant l’aiguille dans un bonnet de nouveau-né qu’elle tenait à la main.
— Et qui ne verrait pas clair dans le cœur d’une femme amoureuse de son mari, Riekje ? reprit la vieille Nelle.
En même temps elle ouvrit le couvercle du poêle et bourra le pot, ce qui parut faire plaisir au petit creuset, car il se mit à pétiller comme les fusées qu’on avait tirées la veille sur la place du Marché à l’occasion de la nomination du nouveau bourgmestre. Nelle moucha ensuite les chandelles avec ses doigts, après avoir humecté ceux-ci de salive, et la flamme qui vacillait depuis quelques instants au bout de la mèche charbonneuse se redressa tout à coup joyeusement, éclairant la petite chambre d’une belle lumière tranquille.
Petite, la chambre l’était, à la vérité, figurant assez bien, à cause de son plafond de bois recourbé et de ses cloisons de planches, pareilles à des douves, la moitié d’un grand tonneau qu’on aurait coupé en deux. Une couche de goudron, luisante et brune, couvrait partout la paroi, et par places, avait noirci comme de l’ébène, principalement au dessus du poêle. Une table et deux chaises, un coffre qui servait de lit, et près du coffre, une caisse de bois blanc, avec deux planches en guise de rayon, formaient tout l’ameublement ; et la caisse contenait du linge, des bonnets, des mouchoirs, des jupes de femmes, des vestes d’hommes, pleins d’une odeur de poisson. Dans un coin, des filets pendaient pêle-mêle avec des cabans de toile goudronnée, des vareuses, des bottes, des chapeaux de cuir bouilli et d’énormes gants de peau de mouton. Des chapelets d’oignons s’enguirlandaient autour d’une image de la Vierge et une vingtaine de beaux saurets aux ventres cuivrés étaient enfilés par les ouïes à un cordon, sous un cartel émaillé.
Voilà ce que les deux chandelles éclairaient de leur lumière jaune en faisant danser les ombres sur le plafond ; mais il valait bien mieux regarder la brune Riekje assise près du feu, car c’était une belle jeune femme. Large d’épaules, le cou rond, les mains fortes, elle avait les joues pleines et hâlées, les yeux veloutés et bruns, la bouche épaisse et rouge, et ses noirs cheveux se tordaient six fois autour de son chignon, épais comme les grelins avec lesquels on hale les chalands le long des rivières. Bien que douce et timide, elle se laissait volontiers aller à des rêveries sombres ; mais quand son Dolf était près d’elle, la chair remontait de chaque côté de son amoureuse bouche et ses dents ressemblaient à la pale des rames quand elles sortent de l’eau et que le soleil luit dessus. Alors elle ne fronçait plus le sourcil, épais rideau sous lequel dormaient de tristes souvenirs, mais toutes sortes d’idées claires brillaient dans les plis de sa peau comme des ablettes scintillantes à travers les mailles du filet, et elle se tournait vers le beau garçon en frappant ses mains l’une dans l’autre.
La flamme qui passe par la porte du poêle rougit en ce moment ses joues comme deux tranches de saumon, et, par le coin de sa paupière, son œil profond, qu’elle fixe sur son ouvrage, luit, pareil à une braise dans les cendres. Mais deux choses luisent autant que ses yeux : c’est la pendeloque suspendue à la bélière d’or qui pique son oreille et l’anneau d’argent qu’elle porte à son doigt.
— Riekje, êtes-vous bien ? lui demande Nelle Jeffers de temps à autre. Vos pieds ont-ils chaud dans vos sabots doublés de paille ?
Et elle répond en souriant :
— Oui, maman Nelle, je suis comme une reine.
— Comme une reine, dites-vous, reprend Nelle. C’est tout à l’heure que vous serez comme une reine, ma bru, car vous allez manger les kœkebakken aux pommes de maman Nelle. Voici Dolf qui traverse la passerelle et qui nous apporte la farine, les œufs et la crème. Vous m’en direz des nouvelles, Riekje.
Et elle ouvrit la porte à quelqu’un dont les sabots venaient, en effet, de battre lourdement le pont du bateau.
II
Un homme à la large carrure, la figure ouverte et riante, parut dans la lueur rouge de la chambre, et sa tête touchait au plafond.
— Voilà, mère ! s’écria-t-il.
Il jeta son chapeau dans un coin et, avec mille précautions, extirpa de ses poches des sacs de papier qu’il déposait ensuite sur la table.
— Dolf, j’en étais sûre, vous avez oublié la pinte de lait s’écria maman Nelle quand il eut tout étalé.
Alors Dolf rentra la tête, tira longuement la langue et parut déconcerté comme si vraiment il lui fallait repasser la planche pour retourner à la boutique. Mais, en même temps, il clignait des yeux du côté de Riekje pour lui faire entendre que c’était un leurre. Et Nelle, qui n’avait pas vu cette grimace, abattit le poing de sa main droite dans la paume de sa main gauche en se lamentant.
— Qu’est-ce que nous allons faire sans lait, Dolf ? Vous verrez qu’il faudra que j’aille moi-même à la ville. Ayez donc de grands garçons, Tobias, pour qu’ils ne songent plus qu’à l’amour qu’ils ont dans la tête.
— Et si je fais sortir le lait de dessous la chaise de Riekje, est-ce que vous m’embrasserez, la mère ? dit le grand Dolf en riant de tout son cœur et en jetant un de ses bras autour du cou de la bonne Nelle, tandis qu’il tenait l’autre bras caché derrière son dos.
— Taisez-vous, méchant garçon, répliqua Nelle, demi fâchée demi riante ; comment est-il possible que Riekje ait du lait sous sa chaise ?
— Me baiserez-vous ? répétait le jovial garçon. Une… deux…
Alors elle se hâta de dire à Riekje :
— Allons, levez-vous, la belle fille, pour savoir si je baiserai votre garnement de mari.
Dolf se baissa vers Riekje, chercha longtemps sous sa chaise, feignant de ne pas trouver d’abord ; et doucement il lui chatouillait le mollet ; et enfin il leva triomphalement le pot à lait au bout de son bras. Et il criait de toutes ses forces, son poing sur la hanche :
— Qui sera baisé, la mère ? Qui sera baisé ?
Et tout le monde riait aux éclats de cette bonne farce.
— Dolf, embrassez Riekje ; les mouches aiment le miel, criait la bonne Nelle.
Le drille fit un cérémonieux salut à Riekje en rejetant le pied en arrière et appuyant la main sur son cœur, comme on fait chez les gens riches, et il lui dit :
— Âme de mon âme, me sera-t-il permis d’embrasser une aussi belle personne que vous ?
Puis, sans attendre la réponse, Dolf passa son bras autour de la taille de Riekje, et, la soulevant de sa chaise, il colla à son cou ses grosses lèvres de bon enfant. Mais Riekje, ayant tourné à demi la tête vers lui, ils s’embrassèrent sur la bouche un bon coup.
— Riekje, dit Dolf, en passant sa langue sur ses joues, d’une façon gourmande, un baiser comme cela vaut mieux que de la ryspap.
— Nelle, s’il vous plaît, faisons comme eux, dit Tobias. Je suis en joie de les voir heureux.
— Bien volontiers, notre homme, dit Nelle. N’avons-nous pas été comme eux dans notre bon temps ?
— Ah ! Nelle, c’est toujours le bon temps tant qu’on est deux et qu’on a une petite place sur la terre pour y faire son ménage en paix.
Et Tobias embrassa sa vieille femme sur les joues ; puis, à son tour, Nelle lui donna deux gros baisers qui claquèrent comme du bois sec qu’on casse pour ranimer le feu.
— Riekje, disait tout bas le beau Dolf, je vous aimerai toujours.
— Dolf, répondait Riekje, je mourrai avant de cesser de vous aimer.
— Riekje, je suis plus âgé que vous de deux ans. Quand vous en aviez dix, j’en avais douze et je crois que je vous aimais déjà, mais pas autant qu’aujourd’hui.
— Non, mon cher homme, vous ne me connaissez que depuis le dernier mois de mai. Tout le reste n’existe pas. Dites-moi, Dolf, que le reste n’existe pas. J’en ai besoin pour vous aimer sans honte.
Et Riekje se roulait contre la large poitrine de son mari en se rejetant un peu en arrière, et il était très facile de voir que la jeune femme serait bientôt mère.
— Allons, les enfants, cria maman Nelle, voici le moment de faire ma pâte.
Elle atteignit une casserole de fer dont l’émail reluisait, versa dedans la farine, les œufs et le lait, puis fouetta vigoureusement le tout, après avoir relevé ses manches sur ses bras bruns. Et quand elle eut bien battu la pâte, elle posa la casserole sur une chaise près du feu et la couvrit d’un linge, de peur que la pâte prît froid. Tobias, de son côté, saisit la poêle à frire, la graissa d’un peu d’oing et la mit tiédir un instant sur le feu, pour que la pâte y roussît partout également. Et, assis l’un près de l’autre sur le même banc, Riekje et Dolf, ayant pris des pommes dans un panier, les coupaient en rouelles, après avoir enlevé les cœurs et les pépins.
Alors Nelle sournoisement alla chercher une seconde casserole dans l’armoire et la posa sur le feu ; puis elle y mit de l’eau tiède, de la farine, du thym et du laurier. Dolf s’est bien aperçu que la casserole contient encore autre chose ; mais Nelle l’a si rapidement recouverte qu’il ne sait si c’est de la viande ou des choux. Et il demeure perplexe, ruminant des conjectures.
Petit à petit le contenu commence à bouillonner et une mince fumée brune s’échappe du couvercle qui danse sur les bords. Dolf maintenant allonge son nez du côté du poêle et il ouvre si fort ses narines qu’on logerait une noix dans chacune ; mais toujours l’odeur le déçoit.
Quand enfin maman Nelle va lever le couvercle pour voir si ce qu’il y a dessous cuit comme il faut, il se dresse sur la pointe des orteils et cherche à se glisser derrière son dos, en se faisant tout petit et puis tout long, pour paraître plus comique. Et Riekje rit derrière ses mains, en le regardant du coin de l’œil. Tout à coup Dolf pousse un grand cri pour surprendre sa mère, mais Nelle l’a vu venir, et au moment où il croit plonger son regard dans la casserole, elle rabat le couvercle et lui fait une belle révérence. Qui est bien attrapé ? C’est Dolf. Et cependant il s’écrie en riant :
— Cette fois-ci, je l’ai vu, mère. C’est le vieux chat de Slipper que vous avez mis à la casserole et vous l’avez engraissé avec des chandelles.
— Oui, répliqua Nelle, et après je ferai frire les souris à la poêle. Allez, méchant garçon, occupez-vous de dresser la table et laissez-moi tranquille.
Doucement Dolf se coule dans le réduit qui confine à la cabine, y choisit une chemise bien blanche et bien amidonnée, la passe par-dessus ses habits et reparaît en faisant voler les pans avec ses mains. Aussitôt qu’elle l’a aperçu, Nelle pose ses poings sur ses hanches et se prend à rire de si grand cœur que les larmes lui sortent des yeux et Riekje bat des mains en riant aussi. Tobias garde son sérieux, et, pendant que Dolf se promène dans la chambre en demandant à Nelle si elle ne veut pas le prendre à son service pour cuisinier, Tobias tire les assiettes de l’armoire et les frotte gravement avec un coin de la chemise blanche. Alors la bonne Nelle se laisse tomber sur une chaise et tape ses genoux du plat de ses mains en se renversant coup sur coup en avant et en arrière.
Au bout de quelque temps, la table se trouva mise ; les assiettes reluisaient, rondes et claires comme la lune dans l’eau ; et près des assiettes, les fourchettes d’étain avaient l’éclat de l’argent.
Nelle ouvrit une dernière fois la casserole, goûta la sauce et, levant la grande cuillère de fer-blanc en signe de commandement, elle cria :
— À table. Le plaisir va commencer.
On approcha le grand coffre de la table, car il n’y avait que deux chaises, et Dolf s’assit sur le coffre près de Riekje. Tobias prit une chaise et allongea ses jambes, en croisant ses mains sur son ventre, après avoir mis une chaise à côté de lui pour la bonne Nelle. Puis une grande fumée se répandit jusqu’au plafond de bois et la casserole apparut sur la table, avec un grésillement de neige fondant au soleil.
— C’est le chat de Slipper, je le savais bien, cria Dolf, quand Nelle l’eut décoiffée.
Chacun tendit alors son assiette, et Nelle, plongeant la louche dans la casserole, en tirait de la viande brune, coupée par morceaux, qu’elle versait sur les assiettes, avec beaucoup de sauce. Dolf regarda attentivement les morceaux que lui donnait Nelle, les flaira l’un après l’autre et au bout d’un instant, frappant des poings sur la table, s’écria :
— Dieu me pardonne, Riekje, ce sont des schœsels.
Et, en effet, c’étaient des tripes de bœuf accommodées à la manière flamande, avec le foie, le cœur et les poumons. Dolf d’abord piqua les plus gros quartiers à la pointe de sa fourchette, et pendant qu’il les avalait, il passait sa main sur son estomac pour montrer que c’était bon.
Et Tobias disait :
— Nelle est une fameuse cuisinière. Je sais bien que chez le roi Léopold on mange les schœsels au vin, mais Nelle les fait tout aussi bien à l’eau.
— Certes, c’est là une bonne fête de Saint-Nicolas, dit Dolf à sa femme en faisant claquer sa langue contre son palais. Nous nous souviendrons toujours que nous avons mangé des tripes à la Saint-Nicolas de la présente année.
Voici que la vieille Nelle se lève de table et installe la poêle à frire sur le feu. Mais elle a pris soin, avant tout, de jeter des margotins sur la flamme après avoir raclé les cendres avec le crochet. Alors la fonte recommence à ronfler et Nelle, tout à coup devenue sérieuse, découvre la pâte.
Celle-ci se soulève jusqu’au bord de la casserole, grasse, épaisse, odorante, avec de petites boursouflures qui la gonflent çà et là. Nelle immerge la cuillère à pot en cette belle nappe profonde, et quand elle l’en retire, de longs filets descendent de tous côtés. Maintenant la poêle siffle et pétille, car la pâte vient de couler sur le beurre bruni, autour des rondelles de pommes que Nelle y a disposées préalablement. Et la première crêpe, roussie sur les bords, bondit en l’air, lancée d’un adroit tour de bras. Dolf et Tobias frappent des mains et Riekje admire l’adresse de la vieille Nelle.
Vite une assiette ! Et la première kœkebakke s’étale dessus, avec la couleur de la sole frite, dorée et grésillante. À qui cette primeur de la poêle ? Elle sera pour Tobias ; mais Tobias la passe à Riekje, et la jeune femme l’ayant découpée en morceaux, en partage avec Dolf les bouchées.
Tobias les regarde manger l’un et l’autre d’un air satisfait et dit à Nelle :
— Allons, femme, je vois que les kœkebakken sont toujours aussi bonnes que la première fois que vous en avez faites pour moi.
Et en reconnaissance de cette bonne parole, une large crêpe juteuse s’abat devant lui, ronde comme les disques que les joueurs de palet lancent au but. Et Tobias s’écrie :
— Le soleil brille sur mon assiette comme quand, du pont, je le regarde briller dans l’eau.
La pâte ruisselle à flots dans la poêle, le beurre chuinte, le feu gronde, et les crêpes tombent à la ronde sur la table, comme une marée de tanches.
— À mon tour, mère, s’écrie Dolf, quand la casserole est près de se vider.
Nelle s’assied près de Tobias et mange deux crêpes qu’elle a gardées pour elle, parce qu’elles sont moins réussies que les autres. Déjà Dolf fait circuler la pâte dans la poêle, mais il ne l’étale pas en rond comme Nelle, car il a rêvé de cuire un bonhomme tel qu’il s’en voit à la vitrine des boulangers la veille de Saint-Nicolas. Oh ! oh ! la tête et le ventre sont visibles sans qu’il soit besoin de mettre ses lunettes. Restent les bras et les jambes. Dolf guide la cuillère d’une main prudente, le nez penché sur son ouvrage avec la peur de verser la pâte trop vite ou trop lentement. Tout à coup il pousse un cri victorieux et fait glisser sur l’assiette de Riekje cette caricature ; mais à peine a-t-elle touché la faïence qu’elle se casse en deux et devient une marmelade où il est impossible de distinguer quelque chose. Il recommence encore et recommencera tant que son bonhomme pourra se tenir droit sur ses jambes. Et pour le rendre plus vivant, il lui mettra alors dans la tête un quartier de pomme, en guise de visage.
— Garçon, dit Tobias à son fils, vous trouverez dans le coin aux copeaux une vieille bouteille de schiedam que j’ai rapportée de Hollande avec trois autres ; mais les trois autres ont été bues et il ne reste plus que celle-là. Vous la prendrez et vous l’apporterez sur la table.
Dolf fit comme son père avait dit et Nelle rangea les petits verres. Tobias ensuite déboucha la bouteille et remplit deux verres, un pour Dolf et un pour lui. Et chacun put voir que c’était, en effet, un bon vieux schiedam, car Tobias et son fils remuaient leur tête de haut en bas et faisaient résonner leur langue avec satisfaction.
— Ah ! ma bru, dit Nelle, ce sera un beau jour pour nous tous, dans deux ans, quand nous verrons sous la cheminée un petit sabot, avec des carottes et des navets dedans.
— Oui, Riekje, ce sera un beau jour pour nous tous, dit à son tour Dolf en pressant dans ses gros doigts la main de sa femme.
Et Riekje leva sur le bon garçon ses yeux où il y avait une larme, en lui disant tout bas :
— Dolf, vous êtes un cœur du bon Dieu.
Il s’assit près d’elle et lui nouant son bras autour des hanches :
— Ma Riekje, dit-il, je ne suis ni bon ni mauvais, mais je vous aime de tout mon cœur.
Et Riekje à son tour l’accola et dit :
— Mon cher Dolf, quand je pense au passé, je ne sais comment je puis encore prendre goût à la vie.
— Ce qui est passé est passé, Riekje, ma bien voulue, répondit Dolf.
— Ah ! Dolf, mon cher Dolf, il y a des jours où je songe qu’il vaudrait mieux être déjà là-haut afin de dire à madame la Vierge ce que vous avez fait pour moi.
— Riekje, je suis triste quand vous êtes triste. Vous voulez donc que je me fasse du chagrin ce soir à cause de vous ?
— Ah ! mon cher Dolf, je donnerais mon sang pour vous épargner un seul instant de chagrin.
— Alors, Riekje, montrez-moi vos belles dents blanches et regardez de mon côté en riant.
— Dolf, je ferai selon vote commandement, car mes tristesses et mes joies sont à vous. Riekje n’a que son cher Dolf sur la terre.
— Bien ça, Riekje, je veux être tout pour vous, votre père, votre mari et votre enfant. N’est-ce pas, Riekje, que je suis un peu aussi votre petit enfant ? Nous serons deux à aimer notre maman.
Riekje prit la tête de Dolf dans ses mains et l’embrassa sur les joues comme on boit une liqueur sucrée, en s’arrêtant par moments pour savourer la douceur de ce breuvage, puis en recommençant à boire de plus belle. Et la bouche collée à son oreille, elle murmura du bout des lèvres :
— Dolf, mon Dolf chéri, l’aimerez-vous au moins ?
Dolf leva la main gravement, et dit :
— Je prends le ciel à témoin de ce que je vais dire, Riekje. Je l’aimerai comme s’il était ma chair et mon sang.
— Notre garçon a eu la main heureuse, dit Nelle à son mari. Riekje est une douce femme : le jour où elle est entrée chez nous, elle y a amené la joie, Tobias.
— Nous sommes bien pauvres, Nelle, répondit Tobias, mais il n’y a pas de plus grande richesse pour de vieux parents comme nous que de voir, assis auprès de leur feu, des enfants amoureux.
— Et ceux-ci s’aiment, Tobias, comme nous nous sommes aimés.
— Vous étiez alors une fraîche et jolie fille de Deurne, avec des joues aussi rouges que la cerise, et votre nez était un joli petit coquillage comme on en voit sur le sable de la mer, Nelle. Quand vous alliez le dimanche à l’église avec votre grand bonnet à barbes et votre plaque de cuivre sur la tête, étant jeune fille, il n’y avait pas un homme qui ne se retournât sur vous.
— Mais je ne me retournais sur personne, car Tobias, le beau garçon aux cheveux noirs et à la barbe pointue, avec sa veste de velours vert, ses yeux brillants et ses grosses joues brunes, était mon prétendu.
— Ah ! Nelle, c’était une bonne chose dans ce temps qu’un serrement de main derrière la haie, et quelquefois je vous prenais un baiser, mais par surprise, quand vous détourniez la tête.
— C’est vrai, Tobias, mais à la fin je ne détournais plus la tête et vous m’embrassiez tout de même.
Et Riekje disait à Dolf :
— Il n’y a pas de plus grand bonheur sur la terre, mon Dolf, que de vieillir en s’aimant : d’abord on ne sent pas que les années deviennent plus courtes à mesure que la vie s’allonge ; et quand l’un meurt, l’autre meurt de suite après. Ainsi l’on n’a pas le temps de cesser de s’aimer.
— Oui, Riekje. Et si le vieux père meurt le premier, je dirai au fossoyeur : « Creusez une large tombe, homme de la mort, car notre mère y va descendre à son tour. »
— Ah ! cœur, s’écria Riekje, en serrant son mari dans ses bras, ainsi dirai-je pour moi au fossoyeur, si la mort m’enlève mon Dolf.
Le feu ronflait dans l’âtre, et les chandelles, tirant sur leur fin, grésillaient avec une lueur vacillante. Maintenant Nelle oubliait de moucher les mèches qui, écroulées par les champignons, faisaient dégoutter le suif en grosses larmes jaunes. Et dans la lumière rougeâtre qui s’élargissait en cercles comme de l’eau où une pierre est tombée, l’étroite et pauvre chambre avait l’air d’un petit paradis, car il y avait là des cœurs heureux.
Rude et couleur de saumon fumé, la tête de Tobias se détachait de la brune paroi avec ses pommettes saillantes, son menton couvert d’un bouquet de poils gris, sa bouche rasée et ses oreilles garnies d’une bélière d’or. Et près de lui se tenait assise la vieille Nelle. Elle tournait le dos aux chandelles, et par moments, quand elle remuait la tête, un reflet clair plaquait son front, l’or de ses pendants scintillait à ses oreilles, le bout de son nez s’allumait d’une paillette, et de l’ombre sortaient, comme les ailes d’un oiseau, les barbes de sa cape. Elle était vêtue d’un gros jupon de laine sur lequel dansaient les basques de sa jaquette à fleurs, plissées en tuyaux raides, mais le bras de Tobias, étant posé dessus, en dérangeait un peu la symétrie.
De l’autre côté de la chambre, Riekje et Dolf se tenaient les mains enlacées ; leurs visages l’un près de l’autre, ils s’étaient un peu écartés pour mieux se regarder sans être vus. Et quand ils faisaient un mouvement, la clarté des chandelles frappait le menton rasé de Dolf, la bouche pourprée de Riekje, leurs nuques ou leurs oreilles percées d’anneaux, comme le soleil allume sous les vagues le ventre des poissons. Sur les planches luisaient les chaudrons, les marmites et les pots, et dans les coins, l’ombre avait la douceur du velours.
— Qu’avez-vous, Riekje ? s’écria Dolf tout à coup, vos joues deviennent blanches comme les assiettes qui sont dans l’armoire et vos yeux se ferment. Ma Riekje, qu’avez-vous !
— Ah ! Dolf, répondit Riekje. Si c’était pour aujourd’hui ! J’ai souffert tout l’après-midi et voici que le mal augmente. Mon enfant ! mon enfant ! Si je meurs, aimez-le, Dolf, mon cher homme.
— Mère ! mère ! s’écria Dolf, le cœur me tourne.
Puis, il se couvrit la figure de ses larges mains et se mit à sangloter dedans, sans savoir pourquoi.
— Allons, Dolf, du courage, dit Tobias en lui frappant sur l’épaule. Nous avons tous passé par là !
— Riekje, la Riekje de mon cœur, disait de son côté la bonne Nelle en pleurant, il ne pouvait nous arriver un plus grand bonheur le jour de la Saint-Nicolas. Les pauvres gens sont plus joyeux d’un enfant qui leur vient que de tous les trésors de la terre, mais l’enfant est surtout bienvenu quand le ciel nous l’envoie le jour de Pâques ou le jour de la Saint-Nicolas.
— Dolf, dit Tobias, vous avez de meilleures jambes que moi. Il faudra courir jusque chez madame Puzzel ; nous veillerons sur Riekje. Alors Dolf pressa une dernière fois Riekje dans ses bras, et on l’entendit monter l’échelle en courant ; puis son pas fit danser la planche qui joignait le bateau à la rive.
— Il est déjà loin, dit Tobias.
III
Comme un grand oiseau, la nuit est étendue sur la ville ; mais il a neigé les jours précédents, et à travers les bonnes ténèbres, Dolf aperçoit la face pâle de la terre, pâle comme celle des trépassés. Il court le long du fleuve, à toutes jambes, comme quelqu’un qui, perdu sur les plages, écoute gronder derrière ses talons la mer rapide sans que, toutefois, le bruit que font ses sabots en retombant sur le sol, soit aussi pressé que les battements de son cœur dans sa poitrine. Au loin, dans le brouillard, les réverbères ressemblent à la procession des porteurs de cierges dans les enterrements : il ne sait comment cette idée lui est venue ; et elle lui fait peur, parce que derrière il voit la mort, encore une fois. Maintenant il heurte des formes silencieuses, marchant avec mystère, d’un pas diligent.
— Sans doute on les a appelés en hâte et ils se rendent au chevet des moribonds, pense-t-il.
Puis il se souvient que c’est la coutume en Flandres de mettre cette nuit-là dans la cheminée, à la place du foin, des carottes et des navets qu’y ont déposés les petits pour servir de nourriture à l’âne de saint Nicolas, des poupées, des chevaux de bois, des harmonicas, des violons ou simplement de grands hommes en spikelaus, selon la fortune de chacun.
— « Ah ! dit-il soulagé, ce sont des pères et des mères qui vont aux boutiques. » Cependant les tristes réverbères, pareils à des porteurs de cierges, à présent semblent se donner la chasse par les quais ; leurs petites flammes courent en tous sens, se croisent, ont l’air de gros papillons de nuit. – « J’ai la berlue, – ainsi dit-il ; sûrement il n’y a de papillons que dans ma tête.
Tout à coup il a entendu des voix. On crie, on appelle, on se lamente. Des torches vont et viennent le long de la rive, avec de rouges lueurs, que le vent secoue comme des lanières, parmi des tourbillons de fumée. Et dans le tremblement des feux, Dolf distingue des silhouettes qui se démènent, et d’autres se penchent sur le fleuve, sombre comme un puits.
Alors tout s’explique : les réverbères n’ont pas bougé de place ; mais il a été induit en erreur par les falots errants.
— Cherchons Dolf Jeffers, crient deux hommes. Il n’y a que lui qui soit capable d’en venir à bout.
— Voici Dolf Jeffers, répond aussitôt le brave garçon, que lui voulez-vous ?
Il les reconnaît à présent : ce sont ses amis, ses frères de misère et de peine, des bateliers comme lui. Tous l’entourent en gesticulant, et un vieux, ridé comme une plie sèche, frappe sur son épaule et dit :
— Dolf, au nom de Dieu ! Un chrétien se noie. Au secours ! Il n’est peut-être plus temps. Habits bas, Dolf !
Dolf regarde l’eau, les falots, la nuit qui est sur sa tête et les hommes qui le caressent de leurs mains.
— Compagnons, s’écrie-t-il, devant Dieu, je ne puis. Riekje est dans les maux et je ne suis pas maître de ma vie.
— Dolf ! Au secours ! crie encore le vieil homme.
Et de ses mains qui tremblent il lui montre ses habits ruisselants d’eau.
— J’ai trois enfants, Dolf, et pourtant j’ai déjà plongé deux fois, mais les bras ne vont plus.
Dolf se tourne vers les figures pâles qui font cercle autour de lui :
— Lâches, s’écrie-t-il. Il n’y en a donc pas un parmi vous qui veuille sauver un homme qui se noie ?
Mais la plupart courbent le front et haussent les épaules, comprenant qu’ils ont mérité cette injure.
— Dolf, crie de nouveau le vieux, aussi sûrement que la mort est la mort, je descendrai encore une fois, si vous n’y allez pas vous-même.
— God ! god ! Le voilà ! s’écrient en ce moment les gens qui promènent les falots sur l’eau. Nous avons vu ses pieds et sa tête. À l’aide !
Dolf jette au loin son habit et dit froidement au batelier :
— J’irai.
Et il dit encore :
— Qu’un de vous coure jusque chez madame Puzzel et la ramène sans tarder au Guldenvisch.
Puis il fait le signe de la croix et murmure entre ses dents :
— Jesus-Christus, qui êtes mort sur la croix pour racheter les hommes, ayez pitié de votre créature.
Il descend vers la rive, la poitrine nue, et la foule qui le suit tremble pour sa vie. Il regarde un instant le fleuve traître sur lequel les flambeaux égouttent des larmes de sang, ainsi qu’il regarderait sa propre mort. Et comme quand un gros poisson frappe l’eau de sa queue, le fleuve bouillonne.
— Le voilà ! répètent les mêmes voix.
Alors l’abîme s’ouvre.
— Riekje ! a crié Dolf.
Et comme une prison, le flot froid se referme sur lui. Des ondulations qui s’élargissent rident seules la noire étendue que la lumière des torches fait paraître plus noire encore. Un silence lourd règne parmi le groupe qui regarde de la rive. Quelques hommes entrent à mi-corps dans le fleuve qu’ils battent avec de longues gaules ; d’autres déroulent des câbles qui vont à la dérive ; trois d’entre eux se sont glissés dans un canot et rament sans bruit, en ayant soin de remuer les falots à ras de l’eau. Et l’homicide Escaut coule comme de l’éternité avec un murmure doux, en léchant la rive.
Deux fois Dolf remonte à la surface et deux fois il disparaît : on voit ses bras qui s’agitent et sa figure blanchit vaguement dans la nuit. Il fend de nouveau le gouffre glacé et plonge au plus profond. Subitement ses jambes s’immobilisent comme nouées avec les algues perfides par les rancuniers Esprits des eaux. Le noyé s’est accroché à lui et il comprend que, s’il ne parvient pas à se dégager, c’en est fait de l’un comme de l’autre. Ses membres sont plus étroitement scellés que s’ils étaient rivés dans un écrou. Alors une lutte horrible s’engage et ils descendent dans les boues du lit. Tous deux frappent, mordent et se déchirent, comme de mortels ennemis, dans les ténèbres roulantes. Dolf prend à la fin le dessus ; les bras qui le paralysaient cessent de l’étreindre et il sent flotter à présent le long de son corps une masse inerte. Une lassitude funeste comme le sommeil s’est emparée de lui, sa tête penche en avant et l’eau lui entre dans la bouche. Mais la lueur des falots perce l’épaisseur des flots ; il rassemble ses forces, entraînant après lui cette proie qu’il vient de disputer aux anguilles voraces ; et sa poitrine respire enfin l’air vital.
Une grande clameur s’élève alors.
— Hardi ! Dolf ! crie la foule, haletante, qui tend les bras par dessus le fleuve.
Des bateliers ont amassé du bois sur le bord et y ont mis le feu. La flamme monte en tournoyant et le ciel en est éclairé au loin.
— Par ici ! Dolf ! Courage ! Dolf ! cœur du bon Dieu, courage ! hurle encore la foule.
Dolf est sur le point d’atteindre la berge : il fend l’onde de toute la vigueur qui lui reste et pousse devant lui le corps inanimé. La rouge lumière du bûcher se répand comme une huile enflammée sur ses mains et sa figure, et brusquement à côté de la sienne éclaire la figure du noyé.
À peine a-t-il vu ce visage blême qu’il le repousse du poing au fond de l’eau et un cri de rage sort de sa poitrine : il vient de reconnaître l’homme qui a déshonoré sa Riekje et a fait fructifier ses entrailles. Dolf, le loyal garçon, a eu pitié de la pauvre fille de pêcheur délaissée et l’a prise pour femme devant Dieu et devant les hommes. Il le repousse donc ; mais le noyé, qui sent le fleuve se refermer encore une fois sur lui, enlace son sauveur dans ses bras plus durs que le fer. Alors tous deux disparaissent dans le noir de la mort.
Et Dolf entend une voix qui dit en lui :
— Meurs, Jacques Karnavash : il n’y a pas assez de place sur la terre pour toi et l’enfant de Riekje.
Et une autre voix répond à celle-là :
— Vis, Jacques Karnavash, car mieux vaudrait frapper ta mère d’un coup de maillet sur la tête.
IV
— Voilà Dolf qui nous ramène madame Puzzel, dit la vieille Nelle à Riekje, au bout d’une heure.
La passerelle balance, en effet, sous le pas de deux personnes, et des sabots cognent ensuite le pont, tandis qu’une voix crie :
— Tobias ! Tobias ! prenez la lanterne et éclairez madame Puzzel.
Tobias prend une des chandelles et pousse la porte en ayant soin d’abriter la chandelle avec sa main.
— Par ici, dit-il en même temps. Par ici !
La digne madame Tire-monde descend l’échelle et un jeune garçon descend après elle.
— Ah ! madame Puzzel, Riekje sera bien contente de vous voir. Entrez, dit Tobias. Bonjour, garçon. Tiens, c’est notre Lucas.
— Bonjour, Tobias, dit le jeune homme, Dolf est resté en chemin avec les camarades et j’ai fait la conduite à madame Puzzel.
— Entrez boire un verre, fils, dit Tobias. Vous irez retrouver Dolf ensuite.
Nelle s’avance à son tour et dit :
— Bonjour, madame Puzzel, comment va notre santé ? Voilà une chaise. Chauffez-vous.