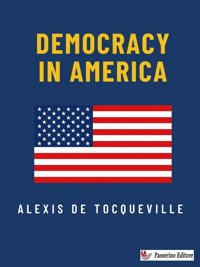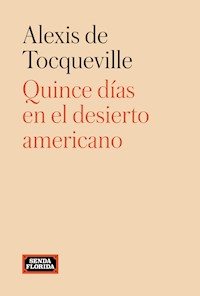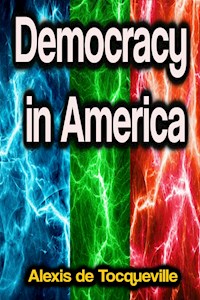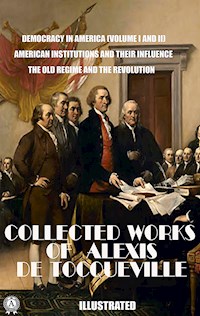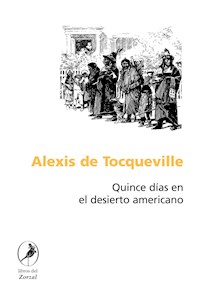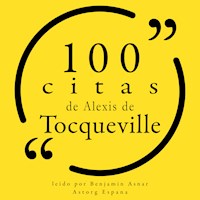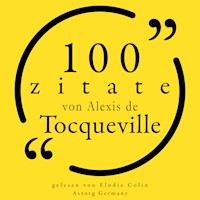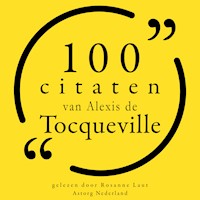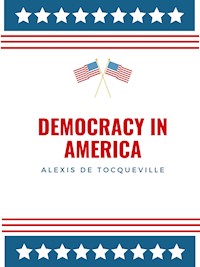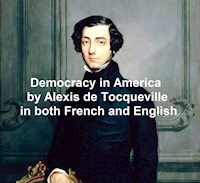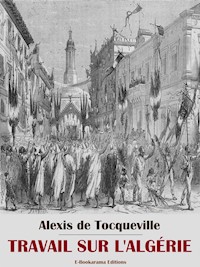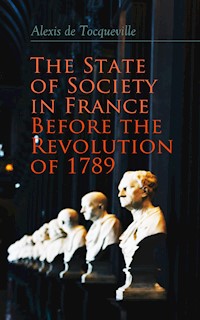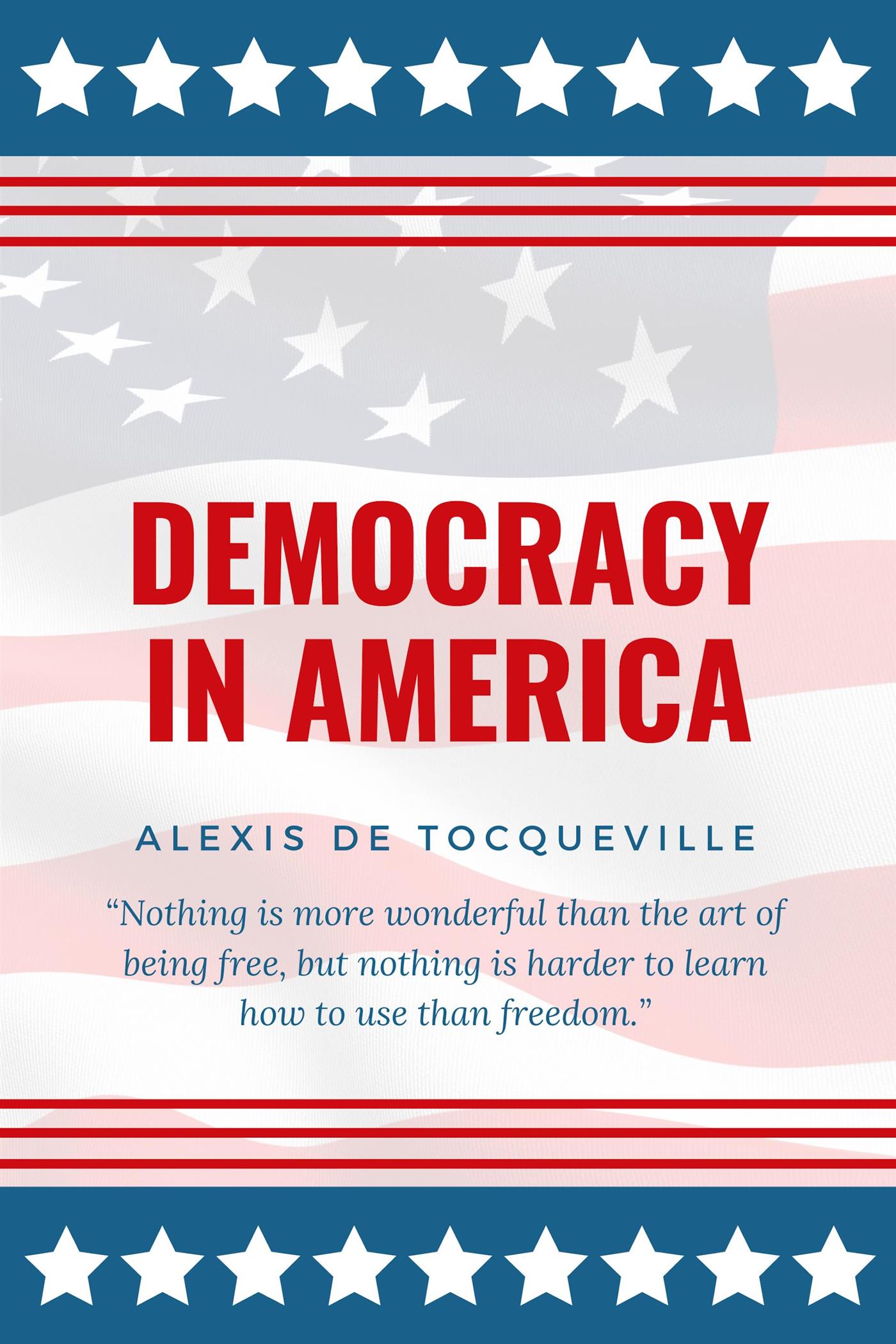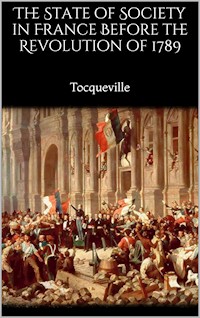Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
C'est lors de son voyage aux Etats-Unis que Tocqueville découvre l'importance de la religion dans une société démocratique. En France, la Révolution, qui tente au même moment de remplacer les formes religieuses par des formes séculières et idéologiques, lui semble un remède pire que le mal. Tocqueville n'aura alors de cesse de s'intéresser aux liens qui unissent dans le destin d'un peuple, le social et le politique d'un côté, le fait religieux de l'autre. Il n'aura de cesse d'étudier et de comparer les religions dans leur relation aux sociétés où elles se développent.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Notes sur le Coran et autres textes sur les religions
Notes sur le Coran et autres textes sur les religionsAvant-proposÉditions de référence et abréviationsNotes sur le texteI - L'islamII - L'hindouismeIII - Le christianismeIV - Le catholicismeBibliographieRepères chronologiquesPage de copyrightNotes sur le Coran et autres textes sur les religions
Alexis de Tocqueville
...
À Étienne Charpentier, bibliste - in memoriam -
Et Pierre Gibert, bibliste et tocquevillien émérite,
mes amis.
Avant-propos
Le texte que je présente aujourd'hui au lecteur fait suite à la biographie intellectuelle de Tocqueville publiée en 2005 pour le bicentenaire de sa naissance. Les textes de Tocqueville sur le Coran et l'hindouisme sont aujourd'hui difficiles à trouver, ils n'ont été publiés que dans le tome III, volume 1 des Œuvres complètes Gallimard, qui est aujourd'hui épuisé ; le texte sur les sectes n'a, lui, été publié que dans l'édition Vrin de Ladémocratie, en 2000. Les responsables de la collection et moi-même avons donc considéré qu'il était nécessaire de mettre à la disposition des lecteurs, sinon l'intégralité, du moins l'essentiel des textes les plus importants que Tocqueville a consacrés au fait religieux afin de sortir d'une vulgate tocquevillienne dans laquelle la glose a, trop souvent, pris le pas sur le texte lui-même aux dépens de la vérité qui était celle de l'auteur.
Tocqueville, beaucoup seront surpris de l'apprendre, fut essentiellement agnostique - au sens premier du terme [Le lecteur trouvera ici les pièces du dossier qui reste, au moins en partie, ouvert en ce qui concerne ses tout derniers jours.] - mais il était, dans le même temps, spiritualiste. « La religion que je professe », disait-il en parlant du catholicisme, alors même qu'il était très critique vis-à-vis du parti catholique, de la hiérarchie et de Pie IX, en particulier, et qu'il manifestait une réticence quasi viscérale envers les dogmes, ceux, notamment, du péché originel et de l'Immaculée Conception...
Ainsi Tocqueville fut-il un être paradoxal en matière de religion comme il le fut dans sa vie, son œuvre et son engagement politique.
Nous livrons donc ici, à l'intelligence de l'honnête homme du moment, les textes à partir desquels il portera son jugement ; quant au chercheur, il disposera des références qui lui permettront de se reporter au reste du corpus s'il désire approfondir de façon exhaustive la problématique tocquevillienne en ce qui concerne la question religieuse.
Tocqueville est, en effet, un analyste attentif du fait religieux dont il nous présente une conception très moderne, sociologique, mais comme toujours chez lui sans jargon. Il envisage donc le fait religieux aussi bien dans sa dimension sociétale et politique que morale et existentielle.
Pascalien sans la foi, sans nuit du Mémorial, il connaît le prix du doute ; il sait, pour l'avoir vécu, que c'est là un des principaux maux qui rongent l'individu et nuisent à la société. Ni celle-ci ni l'homme n'ont rien à attendre du matérialisme, incapables qu'ils sont d'assumer la mort de Dieu et le désenchantement du monde ; quant aux idéologies séculières de remplacement dont la Révolution a livré les prémices avec le culte rendu à la déesse Raison, et qui ont fait florès au XXe siècle qui vient de s'achever, n'est-ce pas un sinistre remède ?
Le jugement que Tocqueville porte sur l'hindouisme est sévère ; n'est-ce pas la nature même de cette religion qui a favorisé la soumission de l'Inde aux envahisseurs successifs ? Mais, en 1980 [Je fais allusion ici à une réunion qui eut lieu à Paris-IV Sorbonne, au séminaire de 3e cycle de Claude Bruaire, avec lequel j'entamais ma thèse de doctorat.], alors que des philosophes indiens et français confrontaient deux visions l'une historique, l'autre non, de l'Histoire, Indira Gandhi affirmait aux Occidentaux que son pays était prêt à entrer dans la modernité de plain-pied ; l'avenir lui a donné raison.
Les textes que Tocqueville a consacrés à l'islam sont plus nombreux et plus variés que les simples notes rédigées sur l'hindouisme, et cette fois le jugement porté est ambivalent [En ce qui concerne la question de l'Algérie, l'attitude de Tocqueville est constamment ambivalente comme l'ont souligné avec pertinence les trois principaux universitaires des États-Unis qui ont étudié cette question (Melvin Richter, Cheryl Welch et Jennifer Pitts - voir bibliographie infra). En France, en revanche, Tzvetan Todorov, Olivier Le Cour Grandmaison, Nourredine Saadi, par exemple, ont instruit un curieux procès - exclusivement à charge - contre Tocqueville, qui, tel l'âne de la fable, se voit chargé de tous les maux et assimilé à Bigeard et Aussarès (rien de moins !). Comme Todorov, qui ne retient que moins d'un tiers des textes de Tocqueville sur l'Algérie (ceux qui vont dans le sens de la thèse développée), Grandmaison recourt à un montage de citations tronquées et/ou décontextualisées ; l'un et l'autre font fi de la dimension diachronique (les jugements de Tocqueville sur la colonisation ne sont pas les mêmes en 1837, 1840-1841, 1846-1847, comme ceux que de Gaulle porte sur l'Algérie sont totalement différents en 1945, 1958, 1960-1961 et 1962), ce qui ôte à leur argumentation toute pertinence. Ils établissent également une identification totalement fallacieuse : Bugeaud/Tocqueville, alors que ce dernier dresse un réquisitoire sans concessions contre la conception de la colonisation du général qui conduit, pour Tocqueville à l'échec, en 1846-1847, et à la catastrophe pour la suite si rien ne change.
Pour se faire une idée exacte, objective et personnelle, le lecteur se reportera au texte authentique et complet de Tocqueville (O.C., III, 1 & V, 2).
Il pourra également lire le remarquable texte-testament - dénonçant « la simplification idéologique » - que Pierre Vidal-Naquet (anticolonialiste fervent, partisan très tôt de l'indépendance de l'Algérie et soucieux de dénoncer l'instrumentalisation des textes par des auteurs peu scrupuleux) a publié dans la revue Esprit (in Repères, Controverse, avec Gilbert Meynier, en décembre 2005 ; et à celui de Marc-Olivier Baruch : « L'effet poubelle », in Le banquet, n° 23, 2006/1 [http ://www.revue-lebanquet.com]. Le lecteur pourra en outre consulter l'article Tocqueville sur l'encyclopédie Wikipedia en français et en anglais [fr.wikipedia.org/wiki/] [en.wikipedia.org/wiki/], ainsi que la réponse que j'avais adressée à l'article de Grandmaison paru en juin 2001, dans Le monde diplomatique : «Quand Tocqueville légitimait les boucheries en Algérie ». Le journal ayant refusé de publier mon texte, ce qui prouve son sens aigu de l'éthique journalistique, j'en adressai deux versions, l'une à la revue Le Banquet, n° 16, 2001, l'autre à Res publica, qui parurent en décembre de la même année et que le lecteur peut consulter sur les sites : http :// www.revue-lebanquet.com/docs/a_0000292.html et http ://premiumwanadoo.com/lippi.christian/]. Alors même qu'un certain nombre de ses proches disent leur admiration pour cette religion, à laquelle quelques-uns ont envisagé de se convertir [Voir le détail infra.], Tocqueville qui a pris soin de lire le Coran, la plume à la main, porte un jugement très sévère à l'encontre de la religion musulmane. Mais au-delà d'une critique que certains peuvent considérer comme injuste, maladroite ou fausse, Tocqueville prend des positions claires quant au respect que les colonisateurs doivent aux musulmans et à l'islam.
Il dénonce sans restriction ce qui est de l'ordre du viol des consciences et des atteintes aux mœurs des personnes : « Deux fois la visite du médecin a été imposée aux musulmans et deux fois retirée sur leur plainte (les Arabes disaient que la liberté de conscience leur avait été assurée et que cette liberté était violée par les visites en question). Enfin, dit avec une joie fort imbécile le compte rendu, "les maisons murées des Maures s'ouvrent devant le médecin". Voilà un beau triomphe [O.C., III, 1, p. 175.]. »
Il condamne avec une très grande sévérité, devant la Chambre, la spoliation des biens des fondations religieuses musulmanes par l'administration française et insiste avec fermeté pour que les autorités françaises aident les musulmans à relever leurs écoles et leurs mosquées, à former et rémunérer convenablement leur « clergé [Bien que ce mot soit, Tocqueville le dit, impropre ; sur tous ces points, voir infra.] ».
Enfin, l'attitude de Tocqueville vis-à-vis du christianisme est également ambivalente. Il admire profondément le message des Évangiles et le renversement de valeurs opéré par le christianisme originel, qui est déjà porteur d'un système axiologique démocratique. Il y a bien là, pour lui, une part de mystère et de sacré, mais le mystère de l'incarnation semble lui demeurer étranger ; en ce sens, il n'a pas la foi, le Credo lui échappe.
Quant à sa position vis-à-vis du catholicisme, elle relève d'une sorte de dépit amoureux.
Il souhaiterait que la religion de ses pères puisse se mettre en phase avec le monde qui vient ; sa rencontre avec les prêtres catholiques des États-Unis et du Canada lui a prouvé qu'une telle évolution serait possible. En France, il se sent proche de la démarche de Lamennais et du premier Lacordaire, celui d'avant le ralliement aux positions vaticanes et la condamnation de Lamennais. On le voit tracer les contours de ce que serait un christianisme et/ou un catholicisme réconcilié (et non rallié) au monde moderne, qui resterait fermement attaché à la doctrine et surtout au message des Évangiles, qui prendrait de la distance par rapport au lourd appareil dogmatique. Enfin, le fait religieux étant par nature lié à l'état social et politique, au hicet nunc de la société, aurait à se réconcilier avec les mœurs du temps. La conception du religieux qui est la sienne suppose qu'une distinction essentielle soit établie entre ce qui est le fond du message et ce qui n'est qu'accessoire et lié au temps. Les mœurs évoluent, la vérité demeure au-delà des épiphénomènes, mais la religion s'incarne, in situ, dans un temps, une histoire et une société.
Éditions de référence et abréviations
Œuvres complètes d'Alexis de Tocqueville, publiées par Mme de Tocqueville (en fait par Gustave de Beaumont), 9 vol., Michel Lévy frères, 1864-1866 (les références à cette édition sont indiquées O.C., Bmt, et le numéro du volume en chiffres romains).
Édition des Œuvres complètes, Gallimard (commencée en 1951). C'est l'édition de référence de ce travail ; elle est désignée par le sigle O.C. ; elle est constituée de 18 tomes contenant d'un à trois volumes [Le tome XVII est actuellement en préparation par Françoise Mélonio, il devrait paraître dans les mois qui viennent et comportera deux ou trois volumes.] (29 volumes sont déjà parus). Les références indiquent en chiffres romains la tomaison et en chiffres arabes le volume dans la tomaison (O.C., XV, 1, par exemple).
On trouvera également D.A. I, D.A. II (De la démocratie en Amérique) ; A.R. I, A.R. II (L'Ancien Régime et la Révolution).
Archives départementales de la Manche, Archives Tocqueville, MI 516, AT 2791-2792, textes sur l'Inde, AT 2752-2753 & 3472, textes sur l'Algérie et l'islam, AT 2710-2714, notes de lecture.
Notes sur le texte
L'ensemble de l'ouvrage est composé en romain pour les textes et titres de Tocqueville et en italique quand il s'agit de mes analyses et commentaires ou des titres que j'ai introduits pour la clarté du propos.
Lorsque le texte comporte des variantes, j'ai le plus souvent choisi la forme qui m'a semblé la meilleure. Lorsque Tocqueville a fait figurer des notes en bas de page, je les ai reproduites en indiquant leur origine. J'ai également reporté les indications de pagination de lecture qui figurent dans les manuscrits. J'ai en outre modernisé et unifié l'orthographe.
Introduction
Le présent ouvrage n'a pas pour fonction de traiter de la religion de Tocqueville lui-même, c'est là l'affaire des biographies ; maints ouvrages et articles ont traité de cette question. Le propos n'est pas non plus de présenter une analyse approfondie de ce qu'on pourrait appeler « le christianisme de Tocqueville », ni de relever de façon exhaustive les relations qu'il entretint avec l'Église catholique.
Pour Tocqueville, la réflexion sur la démocratie moderne en contrepoint des autres systèmes politiques, comme l'étude historique qui conduit la France de l’Ancien Régime à la Révolution, suppose l'analyse du fait religieux notamment dans sa dimension sociologique et historique.
Lors de son voyage aux États-Unis, en compagnie de Beaumont [Tocqueville fit la connaissance de Gustave de Beaumont (1802-1866) au tribunal de Versailles où celui-ci était substitut ; l'amitié qui les lia aussitôt devait durer jusqu'au dernier jour, malgré un refroidissement qui dura plusieurs mois. Les deux magistrats appartenaient au même milieu légitimiste et leur évolution politique fut comparable. C'est avec Beaumont que Tocqueville effectua son voyage aux États-Unis, son second voyage en Angleterre et son premier voyage en Algérie. À la mort d'Alexis, c'est avec Beaumont que Marie de Tocqueville entreprit la première édition des œuvres inédites de Tocqueville, de 1861 à 1864.], Tocqueville a découvert avec surprise comment une société démocratique pouvait être très religieuse tout en établissant une séparation très nette entre les Églises et l'État.
La situation américaine contrastait singulièrement avec celle de la société française qui avait vu la montée progressive de l'incroyance, la remise en cause du fait religieux par une « révolution politique [procédant elle-même] à la manière d'une révolution religieuse ».
Un pan entier de la réflexion tocquevillienne porte donc sur les liaisons dynamiques, les interréactions [Cette réflexion est développée dans le chapitre 3 du Livre I de L'Ancien Régime et la Révolution, que Tocqueville publia en 1856 ; le titre complet de ce chapitre est : « Comment la Révolution française a été une révolution politique qui a procédé à la manière d'une révolution religieuse et pourquoi. »] entre le social et le politique d'un côté et le fait religieux de l'autre.
Pour Tocqueville, il n'est pas concevable, de penser une société dans son développement historique sans prendre en compte le rôle joué par le fait religieux dans cette société même, fût-ce la religiosité séculière de substitution d'un régime qui traque la religion pour mieux imposer une idéologie de remplacement qui se constitue, en tant que telle, comme « religieuse », ou comme un ersatz du religieux [Tocqueville a consacré un chapitre de L'Ancien Régime et la Révolution à l'analyse de ce processus pendant la Révolution de 1789 ; on pourrait rappeler l'approche eschatologique du texte de Marx, ou le caractère « religieux » de la pratique idéologico-politique de l’URSS, avec ses orthodoxes et ses schismatiques/déviationnistes, ses procès d'une nouvelle Inquisition qui peupla le Goulag, son culte rendu au Petit Père des peuples et son exhibition religieuse de la dépouille de Lénine, autre père fondateur dans le mausolée de la Place Rouge.].
Avant d'aller plus loin, il importe de mettre en garde le lecteur contre les dérives de la vulgate tocquevillienne, qui, comme toutes les autres, fausse les perspectives. Tocqueville a été victime de nombreuses « lectures » fantaisistes, partielles, parfois partiales ; il a été victime également d'une forme de « canonisation libérale [Cette expression est le titre de l'ouvrage publié par Claire Le Strat et Willy Pelletier aux éditions Syllapse.] ». Raymond Aron a eu l'immense mérite de relancer la lecture et l'analyse de Tocqueville, mais nul n'est, heureusement, responsable de ses épigones et Aron n'est pas comptable de certaines errances qui ont présenté l'auteur de La démocratie en Amérique comme le père spirituel du néolibéralisme, ou le responsable de bien d'autres turpitudes. Les travaux sérieux rétablissent la vérité, mais chacun sait que les vieilles erreurs ont la vie tenace, c'est le cas en ce qui concerne le lien unissant Tocqueville à la foi et à la religion. Tocqueville a perdu non seulement la foi de son enfance, mais toute foi religieuse, au sens vrai du terme, à seize ans, en 1821, pour ne jamais la retrouver [Tocqueville est mort à Cannes, le 16 avril 1859. Une discussion s'est ouverte pour savoir si Tocqueville a, ou non, retrouvé la foi dans les jours précédant sa mort. Il accepta de recevoir, le 6 avril, la communion avec sa femme après s'être confessé, démarche à laquelle il s'était violemment opposé quelques jours plus tôt. Beaumont qui était présent en ces jours-là affirme que Tocqueville est mort plein de doutes. Qu'en est-il exactement ? C’est là une chose qui relève du mystère de chacun au moment ultime. Le lecteur pourra consulter sur ce point :
Tocqueville un destin paradoxal, pp. 22 & 347-350, et ma communication : Foi, providence et religion chez Tocqueville, in Les actes du colloque : L'actualité de Tocqueville, Saint-Lô, 1990, Cahiers de philosophie politique et juridique de l'université de Caen, n° 19, pp. 117-134, 1991.]. Il n'est pas pour autant athée, encore moins athée militant, mais spiritualiste : il croit en l'existence de Dieu et en l'immortalité de l'âme. Il n'est pas éloigné, bien qu'il ne connaisse que médiocrement, et par raccroc, la philosophie de Kant, de souscrire aux postulats de la raison pratique.
Dans une lettre écrite, quelques mois avant sa mort, à Mme de Swetchine [Mme de Swetchine (1782-1857) émigrée russe et femme de lettres avait dû quitter Saint-Pétersbourg pour s'être convertie au catholicisme. Tocqueville avait fait sa connaissance sans doute en 1853 ; entre elle et lui s'établit une relation de confiance qui le poussa à des confidences que nous ne trouvons pas ailleurs. Leur correspondance, qui s'étend sur deux années : juillet 1855-juillet 1857, a été présentée dans Correspondance d'Alexis de Tocqueville et de Francisque de Corcelle - Correspondance d'Alexis de Tocqueville et de Madame Swetchine, édition de Pierre Gibert, avec la collaboration de Claude Bressolette et André Jardin, tome XV, vol. 2, des O.C., Gallimard, pp. 247-324. © Gallimard, 1983.], Alexis confesse comment, au terme d'une gigantesque crise existentielle, il a vu disparaître toutes ses certitudes ; dans une autre lettre adressée, celle-ci, à son ami le philosophe Bouchitté [Louis Bouchitté (1795-1861) philosophe catholique, ami de Tocqueville, avait publié un ouvrage sur les preuves de l'existence de Dieu.], il déplore le caractère vague et incertain de ses croyances.
Lettre à madame de Swetchine
Je ne sais si je vous ai jamais raconté un incident de ma jeunesse qui a laissé dans ma vie une profonde trace ; comment renfermé dans une sorte de solitude durant les années qui suivirent immédiatement l'enfance, livré à une curiosité insatiable qui ne trouvait que les livres d'une grande bibliothèque [En avril 1820, Hervé de Tocqueville avait fait venir près de lui, à Metz où il était préfet, son fils Alexis afin qu'il pût recevoir un véritable enseignement. Il découvrit alors dans la bibliothèque de la préfecture non seulement les livres des philosophes des Lumières, que son vieux précepteur jansénisant et ultra, l'abbé Lesueur, lui avait cachés, mais encore les trois volumes que Boissy d'Anglas avait consacrés à la mémoire de Malesherbes, l'illustre bisaïeul d'Alexis (Essai sur la vie, les opinions et les écrits de M. de Malesherbes adressé à mes enfants). Tocqueville découvrit ainsi que son illustre bisaïeul, avant d'être guillotiné sous la Terreur pour avoir défendu le roi devant le tribunal révolutionnaire, avait été l'ami et le protecteur des philosophes, que, sans lui, l'Émile n'aurait pas été publié et qu'il avait sauvé l'Encyclopédie en cachant sous son toit les exemplaires qu'il avait pour mission de détruire.] pour se satisfaire, j'ai entassé pêle-mêle dans mon esprit toutes sortes de notions et d'idées qui d'ordinaire appartiennent plutôt à un autre âge. Ma vie s'était écoulée jusque-là dans un intérieur plein de foi qui n'avait pas même laissé pénétrer le doute dans mon âme. Alors le doute y entra, ou plutôt s'y précipita avec une violence inouïe, non pas le doute de ceci ou de cela, mais le doute universel. J'éprouvais tout à coup la sensation dont parlent ceux qui ont assisté à un tremblement de terre, lorsque le sol s'agite sous leurs pieds, les murs autour d'eux, les plafonds sur leurs têtes, les meubles dans leurs mains, la nature entière devant leurs yeux.
Je fus saisi de la mélancolie la plus noire, pris d'un extrême dégoût de la vie sans la connaître, et comme accablé de trouble et de terreur à la vue du chemin qui me restait à faire dans le monde. Des passions violentes me tirèrent de cet état de désespoir [Tocqueville fait ici allusion à la liaison qu'il entame alors avec Rosalie Malye, le premier grand amour de sa vie, liaison qui débuta en 1821 et ne s'acheva qu'en 1828, un an après le mariage, quasi forcé, de Rosalie.] ; elles me détournèrent de la vue de ces ruines intellectuelles pour m'entraîner vers les objets sensibles ; mais de temps à autre, ces impressions de ma première jeunesse (J'avais seize ans alors) reprennent possession de moi [O.C., XV, 2, p. 315, lettre à Mme de Swetchine du 26 février 1857. Après la mort d'Alexis, sa femme n'eut de cesse que Beaumont et Falloux retrouvent et lui redonnent cette fameuse missive pour la détruire. Heureusement Clémentine de Beaumont avait pris soin de faire - en cachette - une copie de cette lettre.].
Lettre au philosophe Bouchitté
J'aurais eu un goût passionné pour les études philosophiques [...] [mais] j'en suis toujours arrivé à ce point de trouver que toutes les notions que me fournissaient sur ce point les sciences ne me menaient pas plus loin, et souvent me menaient moins loin que le point où j'étais arrivé du premier coup par un petit nombre d'idées très simples, et que tous les hommes, en effet, ont plus ou moins saisies. Ces idées conduisent aisément jusqu'à la croyance d'une cause première, qui reste tout à la fois évidente et inconcevable ; à des lois fixes que le monde physique laisse voir et qu'il faut supposer dans le monde moral ; à la providence de Dieu [Quand on étudie en détail l'ensemble du corpus tocquevillien, il apparaît clairement que cette croyance à la « Providence » est diffuse ; Tocqueville est bien éloigné du providentialisme de Bossuet ou des penseurs contre-révolutionnaires : Bonald et Joseph de Maistre, contrairement à ce que peut penser le lecteur. Il est vrai que Tocqueville a fait le nécessaire, dans l'introduction de la première Démocratie pour égarer son lecteur ; pour combattre l'idéologie maistrienne (qui est celle de sa famille politique originelle, les légitimistes proches des ultras), il a recours à une stratégie argumentative. Il retourne l'argumentation maistrienne en prouvant que les voies de la Providence à l'œuvre dans le développement de l'Histoire ont conduit la société de la féodalité à la démocratie. Respecter les desseins de la Providence revient donc à accepter la démocratie et à s'y rallier pour pouvoir agir sur elle. S'il insiste si fort sur la Providence, c'est parce que l'idéologie providentialiste est encore présente et prégnante sous la Restauration ; c'est lui-même qui l'affirme à son lecteur, vingt ans plus tard, lorsque, évoquant le rôle des physiocrates à la veille de la Révolution, il affirme que ceux-ci avaient :
« un [tel] goût naturel pour l'égalité des conditions et pour l'uniformité des règles... ] [qu']ils l'auraient appelée providentielle, s'il avait été de mode, alors comme aujourd'hui, de faire intervenir la Providence à tout propos » (O.C., II, 1, 4, p. 127).], par conséquent à sa justice ; à la responsabilité des actions de l'homme, auquel on a permis de connaître qu'il y a un bien et un mal, et, par conséquent, à une autre vie. Je vous avoue qu'en dehors de la révélation je n'ai jamais trouvé que la plus fine métaphysique me fournît sur tous ces points-là des notions plus claires que le plus gros bon sens [O.C., Bmt, t. VII, 1864, pp. 475-477, « Quarto », p. 1279.] …
Tocqueville vécut sans retrouver la foi mais il lui arriva à maintes reprises d'en éprouver du regret et d'évoquer ceux qui comme lui aimeraient retrouver la croyance assurée de leur enfance :
« Hélas ! [la voie de la foi] n'est pas ouverte à tous les esprits et beaucoup qui la cherchent sincèrement n'ont pas eu jusqu'ici le bonheur de la rencontrer [O.C. IX, p. 276, lettre à Gobineau du 24 janvier 1857 ;]. »
« Si vous connaissez une recette pour croire en Dieu, donnez-moi-la. [...] S'il ne suffisait que de le vouloir pour croire, il y a longtemps que je serais dévot [O.C., XV, 2, p. 29, lettre à Francisque Corcelle, août 1850. Claude-François-Philibert Tircuy de Corcelle (communément appelé Francisque) [1802-1892], ancien carbonaro entra à la Chambre avec Tocqueville en 1839.
En 1849, Tocqueville le nomma ambassadeur auprès du Vatican, lors de l'affaire de Rome. Cette nomination fut peu judicieuse parce que Corcelle, néoconverti, servit plus les intérêts de Pie IX - refusant de libéraliser son régime et de faire une large amnistie - que ceux de son ministre. L'amitié des deux hommes en souffrit un temps mais survécut néanmoins à cette défection.]. »
L'homme est naturellement religieux ; la foi - ou la pratique de la religion - éloigne de lui le doute qui constitue l'un des trois maux principaux auquel il se trouve confronté : « Je considère ce doute comme une des plus grandes misères de notre nature ; je le place immédiatement après les maladies et la mort », écrit Tocqueville à son ami Charles Stöffels [O.C., Bmt, VII, p. 83. La lecture de Pascal a sans doute renforcé chez Tocqueville sa forte propension au doute existentiel, thème récurrent dans son œuvre et sa correspondance, voir par exemple Voyage en Amérique, cahier portatif n° 3, O.C., V, 1, p. 183 : « Si j'étais chargé de classer les misères humaines, je le ferais dans cet ordre : l° Les maladies, 2° La mort, 3° Le doute. » Pendant son séjour à Metz, Tocqueville s'était lié d'amitié avec Charles (1809-1886) et surtout Eugène Stöffels avec lequel il entretint une correspondance régulière jusqu'à sa mort, en 1852. Eugène était né en 1805, la même année qu'Alexis.] .
La religion éloigne en outre l'homme du matérialisme philosophique [Tocqueville a bien vu également la forme nouvelle du matérialisme vulgaire qui allait s'emparer de la société des États-Unis, et de toutes les sociétés nées de la révolution industrielle.] qui constitue un mal absolu, un péché contre l'esprit puisqu'il abaisse l'homme en rompant le lien qui le rattache, fût-ce comme un manque, à la transcendance, et le ramène au niveau le plus bas de l'humanité puisque plus rien ne l'appelle à se surpasser :
« Il faut donc que les législateurs des démocraties et tous les hommes honnêtes et éclairés qui y vivent s'appliquent sans relâche à y soulever les âmes et à les tenir dressées vers le ciel. Il est nécessaire que tous ceux qui s'intéressent à l'avenir des sociétés démocratiques s'unissent, et que tous, de concert, fassent de continuels efforts pour répandre dans le sein de ces sociétés le goût de l'infini, le sentiment du grand et l'amour des plaisirs immatériels. [...]
Il y a bien des choses qui me blessent dans les matérialistes. Leurs doctrines me paraissent pernicieuses, et leur orgueil me révolte. Si leur système pouvait être de quelque utilité à l'homme, il me semble que ce serait en lui donnant une modeste idée de lui-même. Mais ils ne font pas voir qu'il en soit ainsi ; et quand ils croient avoir suffisamment établi qu'ils ne sont que des brutes, ils se montrent aussi fiers que s'ils avaient démontré qu'ils étaient des dieux. Le matérialisme est chez toutes les nations une maladie dangereuse de l'esprit humain ; mais il faut particulièrement le redouter chez un peuple démocratique [D.A., II, chap. 15.]. »
La religion est aussi nécessaire à la société qu'elle l'est au citoyen ; non seulement parce qu'elle relie les hommes entre eux comme elle relie à la croyance, mais encore parce qu'elle joue un rôle essentiel dans la régulation et le contrôle social.
Le fait religieux et la démocratie
[Le texte qui suit est emprunté au chapitre V de la première partie de la seconde Démocratie, qui porte pour titre : « Comment, aux États-Unis, la religion sait se servir des instincts démocratiques. »]
Tocqueville est un analyste particulièrement attentif à l'importance du fait religieux pour l'homme et la société, ce que lui a vivement reproché Marcel Gauchet dans son long article « Tocqueville, l'Amérique et nous [In Libre, Éditions Payot, 1980, n° 371, pp. 43-120, texte repris dans La condition politique, Gallimard, « Tel », 2005, pp. 305-384, et complété par une mise en perspective : Ladérive des continents, pp. 385-404, dans laquelle l'auteur entend se justifier en expliquant comment et pourquoi les faits ont résisté à son analyse.] » ; pour lui, à ce moment de son parcours, l'analyse des rapports du religieux et du politique constituait le « point aveugle de la vision tocquevillienne [Les conceptions, que Gauchet développe désormais, par exemple dans La religion dans la démocratie - parcours de la laïcité, remettent largement en cause la thèse qu'il défendait initialement. Il absout, d'une certaine façon, Tocqueville d'un crime... qu'il n'avait pas vraiment commis ; mieux (si l'on peut dire), Gauchet évoque un « renversement copernicien de la conscience religieuse », métaphore de son propre retournement copernicien puisqu'il se trouve désormais, bien qu'il ne le dise pas explicitement, sur des positions largement « tocquevilliennes » (voir à ce sujet Tocqueville moraliste, pp.433-435 et Lectures de Tocqueville, communication au colloque d'Anvers, décembre 2005, à paraître).] ».
Concernant la place du religieux dans la société, Tocqueville est aux antipodes de Nietzsche