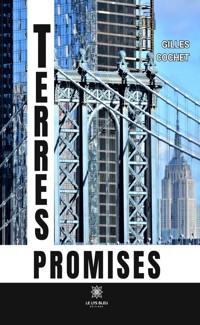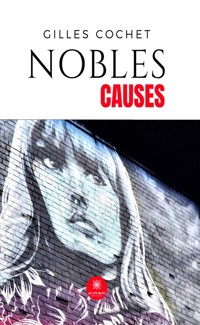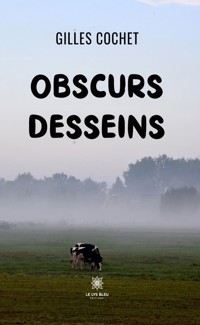
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Arthur découvre trois cadavres dans une ferme bretonne lors d’une visite professionnelle. L’enquête embarque le jeune homme dans une série de rebondissements. Il se retrouve confronté aux pratiques d’une multinationale prête à tout pour asseoir sa domination sur un marché en pleine expansion, celui du lithium. Supplétif de Scotland Yard et de la gendarmerie française, il contribue à la mise à mal des funestes projets de la firme anglaise. Londres et la Bretagne sont les décors de cette histoire menée tambour battant.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Gilles Cochet est un commercial de l’édition à la retraite. En tant que lecteur, il a engrangé moult influences. Après avoir rédigé quelques nouvelles sans lendemain, il a pris un texte de quelques pages et est parti à l’aventure. Avec quelques bribes de vécu, il a comblé les vides mémoriels et le mécanisme de création s’est enclenché. Ainsi est né ce captivant premier roman, Obscurs desseins.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gilles Cochet
Obscurs desseins
Roman
© Lys Bleu Éditions – Gilles Cochet
ISBN : 979-10-377-8465-0
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122- 5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122- 4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335- 2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Quand le sage montre la lune, l’imbécile regarde le doigt.
La veille
Je sors la voiture et roule. Je ralentis à l’approche d’un village, éclairé par des lampadaires disproportionnés. J’aperçois une silhouette se découpant dans la lumière, descendant quelques marches, ratant la dernière et s’affalant sur le sol asphalté. Quelques jurons plus tard, l’homme se relève, regarde dans ma direction et se dirige vers le parking, plus précisément vers ma voiture. Je reste figé, accroché au volant, le moteur tourne encore. Il me fait un signe, je baisse la vitre.
Il me parle, je ne comprends rien à ce qu’il me raconte, puis, distinctement : « Tous des cons ! »
— Pardon ?
— Ouais, tous des cons, je vous dis ! répète-t-il en postillonnant. N’allez pas là-dedans, des mauvaises personnes.
— Si vous le dites…
— Venez avec moi, vous allez voir…
— Je croyais qu’il ne fallait pas y aller…
— Juste pour voir. Vous me payez un coup ?
— Est-ce bien raisonnable ?
— Un de plus, un de moins, rien que pour les emm… De toute façon, ils ne vous connaissent pas alors…
Je n’ai rien de mieux à faire. Accompagner cet homme dans ses libations est un moindre mal, laisser de côté le temps d’une soirée les interrogations du moment m’aidera à évacuer des réponses que je sais insatisfaisantes.
— Vous venez ?
— J’arrive, on a tout le temps.
L’homme se dandine d’un pied sur l’autre, manifestement impatient d’y retourner. Je prends mon temps, tout en observant le bonhomme. Celui-ci ne paie pas de mine : veste en velours déchirée recouvrant en partie un bleu de travail très sale, bottes crottées, le tout dégageant une odeur nauséabonde, mélange fermenté d’alcool, de vieille crasse et d’excréments d’animaux. C’est mon compagnon d’un soir, enfin, nous verrons à l’usage.
— Vous n’êtes pas du coin ?
— Non, pas vraiment, je suis de passage, je prends l’air, je me promène.
— Vous n’avez pas de boulot ?
— J’ai un travail et je m’organise comme je veux, et vous, le travail, ça va ?
— Ouais, non. Du boulot, j’en ai, par-dessus la tête, trop, et ce n’est jamais assez…
— On rentre si ça ne vous fait rien, il fait un peu frais ici.
Il ne répond pas et pousse la porte du café.
Une chaleur moite m’enveloppe sitôt franchi le seuil. Je me fraie un passage au milieu de tables dispersées dans le bistrot et de chaises sur lesquelles sont assis des individus que je qualifierai de rustiques, qui me dévisagent, l’air peu engageant. Ils tournent leurs regards torves vers mon acolyte, déjà collé au bar. Celui-ci parcourt la pièce d’un œil malicieux et me fait signe d’un geste impatient. Il y a tout au plus une dizaine de personnes. Tout le monde nous regarde maintenant et je m’attends au pire.
— Tu vois, tous ces gars, ils n’ont rien d’autre à faire que de me casser du sucre sur le dos, de raconter des saloperies sur mon compte. À cet instant, ils se demandent qui tu peux être, d’où tu sors parce que, tout à l’heure, j’étais seul tandis que maintenant, ce n’est plus la même affaire.
— Ce qui veut dire ?
— … qu’ils ont la trouille !
— De moi ? Vous rigolez ?
— Pas très courageux, les gaillards, mais bon, on ne va pas se laisser abattre, on est là pour boire un coup, j’ai un peu soif, tout à coup, pas toi ?
— Si vous le dites...
— Vous l’avez déjà dit, ça.
— Quoi ?
— Ben ça : « si vous le dites ». Vous n’êtes pas contrariant comme garçon, ça me plaît, j’ai ma dose, de gens contrariants.
— Je ne vois pas pourquoi je serais désagréable avec vous, on ne se connaît pas.
— Tu vas me connaître, je te le dis, tu me plais bien, tu as l’air de quelqu’un de confiance. J’en ai gros sur la patate de tous ces commérages, il faut que quelqu’un m’écoute, pas un de ceux-là, non, un inconnu, comme toi. C’est comment ton p’tit nom ?
— Arthur, comme le roi.
— ?
— Le roi Arthur, ma mère m’appelle comme ça.
— Je ne comprends rien à ce que vous racontez. Chef, un demi ! Et vous, vous prenez quoi ?
— La même chose. Je vous écoute, vous vouliez me parler.
— J’ai tué mon père, enfin, c’est ce que tout le monde raconte, mais moi, je sais que ce n’est pas vrai même si avec lui, ce n’était pas simple. Un salopard comme il n’y en a pas deux, je sais, je parle de mon paternel, mais maintenant, c’est un saint puisqu’il est mort. Il faut respecter les morts, plus facile que de respecter les vivants, demandez à tous ces gens-là. De son vivant, personne ne pouvait le supporter et aujourd’hui, c’est un saint et c’est moi le salaud. Ils m’ont envoyé les flics. Dans un coin comme ici, la police à la maison et vous êtes coupable avant même d’ouvrir la bouche. Ce n’est pas de ma faute si ce soir-là, c’est lui qui conduisait, saoul comme un cochon, avec moi à côté, à la place du mort. Eh bien je suis toujours là et pas lui. Je suis sorti de la voiture plus vite, c’est tout, un peu sonné, du sang partout, mais je me suis traîné dans le fossé et puis après, plus rien. Je me suis réveillé avec les pompiers qui me portaient sur un brancard, juste le temps de jeter un œil et de voir la fumée, noire, épaisse qui s’échappait de la voiture, ou de ce qu’il en restait. Pas de trace du père, puisqu’il était déjà mort, c’est ce qu’on m’a dit après. Tout ce que je sais, c’est ce qu’on m’a raconté, mais personne ne me croit.
— Qu’est-ce qu’on vous a raconté ?
— Qu’ils avaient trouvé le corps à moitié brûlé, avec une partie qui était restée dans l’auto. Il n’avait pas pu sortir assez vite avant que la voiture prenne feu, salement amoché et ils ont tous trouvé ça bizarre. Bizarre, tu parles, bourré comme il était, avec un seul phare… Ce virage-là, il est vicieux, tout en dévers, avec la boue du champ d’à côté, hop ! Dans le talus, terminus, tout le monde descend, enfin... presque.
— Et ensuite… ?
— Ensuite, je suis allé à l’hôpital, pas longtemps. Ils m’ont recousu, là, voyez, juste au-dessus de l’œil, ça pissait le sang, comme un boxeur, l’arcade sourcilière c’est impressionnant, mais avec quelques points de suture, c’est fini.
— Et après, vous avez quitté l’hôpital et êtes rentré chez vous.
— Je n’ai pas de chez-moi, c’est chez mon père. Je suis resté deux jours en observation. Je voulais m’occuper de l’enterrement, je ne savais pas où il était. On me disait de ne pas m’inquiéter, que rien ne pressait, que je pouvais rester une journée ou deux de plus. Ils m’ont laissé sortir. Personne n’est venu me chercher, c’est un infirmier qui habite dans le coin qui m’a emmené à la ferme.
— Et votre père ?
— C’est là que c’est « bizarre ».
— Pourquoi ?
— L’infirmier dans la voiture m’a dit qu’ils l’avaient porté à la morgue, le médecin avait refusé le permis d’inhumer. Le vieux, ils l’avaient mis au frais... le début des emmerdements.
Où vas-tu ?
Dans quelle histoire t’es-tu fourré ?
Tu n’as pas assez de la tienne, c’est glauque et ce type, pas net.
Sors d’ici, rentre chez toi.
Et regarde ce bistrot, tu n’es pas à ta place, en plus tu n’aimes pas la bière.
Tu regardes ailleurs, tu fuis, une fois de plus.
Regarde-toi dans la glace de ce bar et que vois-tu ? Un homme fatigué, chiffonné par des nuits de gamberge stérile écoutant d’une oreille distraite les divagations d’un alcoolique. Tu n’échapperas pas au rôle qui t’est imparti. Tu refuses ce que tu vois venir et, dernière chose, tu n’as pas fini d’être seul.
— J’ai dit : des emmerdements.
— Oui, j’ai entendu. Lesquels ?
— J’avais l’impression que vous étiez ailleurs, je me trompe ?
— Non, c’est vrai. Il faut que j’y aille, j’en ai assez entendu pour ce soir, j’ai moi aussi mes propres emmerdements comme vous dites.
— Ça ne vous intéresse pas, ce que je vous raconte.
— Écoutez, ce n’est pas le problème. Vous me raconterez la suite une autre fois. Vous vous appelez comment ?
— Jo.
— Jo comment ?
— Jo, c’est tout. Si vous repassez par-là, faites-moi signe. Je n’habite pas loin, vous prenez à droite la route qui monte vers le bois. C’est la première maison à gauche, au bout du chemin, avant le bois.
— Je ne promets rien, on verra. À bientôt peut-être.
— Salut.
Le café est plus calme, il ne reste que quelques attardés, fatigués de travail et d’alcool.
L’air frais me fait du bien. Je reste quelques instants sur le pas de la porte, allume une cigarette. Je n’imagine pas un seul instant qu’il ait pu tuer son père, mais la police enquête apparemment. J’ai vraiment d’autres chats à fouetter, mais cette histoire m’intéresse. Je ne suis pas loin de chez moi, il est peut-être connu ce Jo, dans les communes voisines, je vais me renseigner.
Je prends le chemin du retour tranquillement, évaluant les possibles scénarios de cette histoire.
La maison gémit, trop vaste pour un homme seul, sinistre. Elle a raison, mais c’est provisoire. L’escalier en bois craque sous mes pas. Le bureau, à l’étage, se trouve en face. La lumière de l’ampoule suspendue au plafond éclaire à peine cette pièce sombre et peu avenante. C’est la seule qui pouvait faire office de lieu de travail, les autres pièces sont immenses. La lampe architecte vissée au bureau donne une lumière diffuse, propice à mon activité professionnelle. Une carte du monde est punaisée sur la cloison d’en face, simple séparation en bois derrière laquelle un couloir dessert les chambres. Plus exactement, la chambre dans laquelle un lit attend ses occupants. Il n’a vu que moi ce lit. La place ne manque pas. Un portant solitaire soutient mon seul costume et quelques chemises. Une commode d’un autre âge est le seul meuble, presque vide. Une valise traîne dans un coin. Le papier peint à motifs floraux donne à l’ensemble une touche bucolique. Je pose mon imperméable trempé dans la salle de bains. Il est préférable de ne pas s’attarder.
Je redescends d’un pas lourd et résigné, cherchant un peu de vie dans ce désert domestique. Le feu s’est éteint, l’humidité s’est réinstallée, elle n’a pas tort, c’est une vieille baraque, mal isolée, mais c’est tout ce j’ai trouvé. Et puis merde !
Je suis à la fenêtre et regarde la pluie, bruine que je devine sous le halo du lampadaire. Pas âme qui vive dans ce bourg tranquille.
Attendre le sommeil, hypnotisé par les éléments, mes yeux se ferment malgré moi.
J’ai quelques livres dans les cartons. Pas de lecture en cours, c’est rare, mais aujourd’hui, la réalité dépasse la fiction, nul besoin de l’imaginaire des autres, je construis le scénario. En quelques heures, deux histoires s’enchevêtrent, le détective qui sommeille en moi sent qu’il y a anguille sous roche et voit aussi les embêtements qui vont avec. Dans les moments difficiles, il faut se transcender, dépasser le cadre du prévisible et s’enfoncer dans les ténèbres d’un fait divers glauque et sordide. Voir plus malheureux que soi aide, paraît-il, à surmonter ses propres errements. Je ne suis que spectateur, non, voyeur, un malade qui cherche les sensations fortes, l’éloignant pour un temps de ses banales préoccupations domestiques.
Il faut que je dorme. Où sont mes cachets ? Pas de pilules, les lendemains sont laborieux. Je fais quoi, là, au juste ?
Sur le palier, j’hésite.
Au lit, me dis-je, et je m’écroule, terrassé.
Tu n’es pas à la hauteur.
Un détective ?
Un exalté, oui, voilà ce que tu es, prêt à…
Tu m’agaces, occupe-toi de tes affaires, ça pue.
Tu agiras comme bon te semble, comme d’habitude, tête baissée.
Je m’en lave les mains.
La voiture roule vite, trop vite sur cette départementale humide au revêtement incertain. La trajectoire du véhicule relève d’une sinusoïde aléatoire dont les courbes frôlent dangereusement le bas-côté, la course folle ne devrait pas tarder à se heurter aux talus qui enserrent la route dont le tracé fut dessiné il y a fort longtemps pour des attelages maîtrisés, et lents.
Un bruit de tôles froissées et de verre brisé stoppe l’auto, un arbre fort mal placé ayant eu raison de la folle mécanique. Dans l’obscurité jaillit une lueur, précédée d’un bruit de succion, une portière s’entrouvre, un individu se traîne en gémissant sur l’asphalte et s’immobilise. Le feu illumine la campagne environnante. La carcasse est maintenant la proie des flammes qui la dévorent, les vitres volent en éclats, le spectacle de ce feu de joie annonce une sombre histoire.
La lumière des flammes attire le regard d’un homme habitant à quelques centaines de mètres, qui prévient aussitôt les pompiers et la gendarmerie, sur place en quelques minutes.
Un blessé et un mort, le fils et le père sont connus dans le village pour leurs différends, vivant sous le même toit, par nécessité plus que par choix. La mère s’était suicidée, par pendaison, dans la grange attenante à l’habitation, imbibée d’alcool, comme chaque soir depuis qu’elle avait perdu un enfant, une fille, laissée seule, bébé, dans son couffin. Le père, saoul comme à son habitude, s’était endormi, assommé par l’eau de vie. L’enfant était morte, s’étouffant dans une toux épaisse, à deux mètres de son père.
Son fils, plus âgé, subissait les accès de colère éthyliques de son père, sans dire un mot. Il avait huit ans à la mort de sa sœur. Se retrouvant seul avec son père, il devint taciturne. Fréquentant l’école communale, il n’avait pas d’amis, les autres gamins fuyaient ce garçon : son mauvais air, comme tous disaient, sournois et taiseux, ne laissait présager rien de bon. L’école le rejeta comme un corps étranger, au fond de la classe, seul l’âge légal obligea l’institution à le garder ; à quatorze ans, son sort était scellé, il n’eut comme seul compagnon qu’un père ivrogne. Un chien accompagnait ce duo, pauvre bête, souffre-douleur l’espace de quelques années, un camion de livraison mit fin à ses souffrances, le chauffeur se demande encore aujourd’hui si l’animal ne s’était pas jeté sous le véhicule…
Le gagne-pain de ce tandem, une ferme : de quoi payer les bouteilles, ne suscitait pas les convoitises, tant s’en faut, tout à vau-l’eau, bétail et cultures trahissaient un laisser-aller dont les premiers à souffrir étaient les animaux, de la maltraitance animale par négligence. Les services vétérinaires menaçaient de leur enlever les bêtes et de fermer les bâtiments d’élevage, ils obtempéraient, dans un élan de propreté, puis le train-train reprenait, un cycle sans fin. Les années s’écoulaient, l’âpreté des rapports père-fils était connue de tous, le fils se répandait au comptoir du bistrot, éructant des anathèmes assassins sur la méchanceté de son père, son avarice et son ivrognerie, ce qui ne manquait de faire sourire, discrètement car le gaillard était susceptible, certains posaient la question de la pérennité d’une telle entreprise.
Aujourd’hui, il est de ces prophètes de malheur qui, levant le sourcil, parlent d’un air entendu de l’accident. Le café de campagne accouche de mille rumeurs, l’enquête criminelle suscite des vocations. L’après-midi avance tranquillement, beau temps calme sur la campagne, le parking devant l’église héberge quelques véhicules. De l’autre côté de la place, le café dont la porte ouverte laisse entendre quelques éclats de voix :
— Puisque je te dis que c’est lui ! Le vieux, il l’a laissé dans la voiture, exprès…
— Ça m’étonnerait, pas assez courageux, il en avait besoin de son père, pour l’assurance.
— Quelle assurance ?
— L’assurance-vie de la mère, un bon paquet d’après ce que je sais, c’est le père qui avait la signature, comment va-t-il faire maintenant ? Fainéant comme il est, il a besoin des sous pour vivre, pour picoler surtout.
— Tu as l’air bien renseigné, dit l’autre d’un air soupçonneux.
— Pas plus que toi et puis, qu’est-ce que tu en sais, toi ? La police enquête, on n’accuse pas les gens à la légère…
— Ce que j’en dis…
— Justement, tu parles trop et l’autre, il va finir par le savoir et gare à tes fesses, pas commode le Jo, tu sais bien. Il est toujours dehors et d’ici qu’il vienne te caresser les côtes… Bon, faut que j’y aille, j’ai une haie à tailler. Fais attention quand même, je ne blague pas, allez, salut tout le monde.
— Salut, à plus tard.
De l’autre côté du comptoir, une femme essuie des verres consciencieusement, les plaçant avec méthode sur des étagères agencées autour d’un miroir, que l’on devine sans tain, une porte à droite s’ouvre sur une pièce à l’arrière, une pancarte « Privé » accrochée à mi-hauteur renseigne le client, ainsi qu’un grognement invisible sous le bar.
— Silence, le chien ! Il a raison, Marcel. J’ai vu Jo hier. Je l’ai servi, même s’il était déjà bien fatigué. Il ne faut pas le chatouiller en ce moment, depuis qu’il est rentré de ses examens à l’hôpital, il tourne en rond, il est tout seul, le corps du père est à la morgue, refus du permis d’inhumer, on n’en sait pas plus, de là à lui faire porter le chapeau… La PJ est sur le coup, il y a un doute, accident ou autre chose ? Chacun son boulot, moi, je ne sais rien du tout, et je ne veux pas savoir. Si la police vient ici, et ils viendront, je dirai que Jo est un brave gars qui n’a pas eu de chance, c’est tout, le vieux, c’était, excuse-moi, un sale c… J’arrête là.
— Tu as raison, moins on en dit…
— Tu en prends un autre, c’est ma tournée…
— Tu crois ?
— Allez, Robert, c’est bon…
— Vite fait alors…
Robert s’en va, le pas mal assuré.
— Il n’était pas seul le Jo quand il est revenu boire un coup, dit une voix de l’autre côté du bar, c’est qui ce type ? Tu connais ?
— Non, jamais vu, pas quelqu’un d’ici. Bah, il lui a payé à boire, c’est tout.
— Mouais, je dis ça parce qu’on va avoir de la visite, si tu vois ce que je veux dire…
— Je vois bien.
Ainsi vont les conversations dans un café de campagne, deux jours après un accident mortel sur une route toute proche.
Jour J
J’ai mal dormi, une mauvaise nuit de plus.
Café, douche, costume-cravate, les formulaires dans la sacoche, tout est prêt, sauf la tête, ailleurs, encore et toujours. Je n’ai guère besoin d’elle, suis en mode automatique, relationnel a minima, pas de rendez-vous, prendre le quidam par surprise, chez lui, dans son élément. Il se sent fort, se méfie puis se dévoile, j’attaque sur l’air du : « Avec tout ce qui traîne, il vous faut des produits efficaces, j’ai ce qu’il vous faut. » Pas toujours gagnant, un peu simpliste, mais je n’ai trouvé que ça comme entrée en matière, je ne vais pas traîner dans ce job très longtemps, inutile de creuser.
Je prends la route, la même qu’hier soir, belle journée, les derniers bancs de brouillard se dissipent, seuls les vallons retiennent quelques écharpes blanches du plus bel effet. Réveil au volant, première cigarette, à gauche ? À droite ? Je continue, la route serpente entre les talus du bocage, avant d’atteindre le village, ah oui, le café, le type fatigué et moi aussi, cassé hier soir. Autre jour, autre occupation, à gauche, pourquoi pas, le manoir en face derrière sa grille, me fait de l’œil, un bon client, tu rêves, il a tout ce qu’il faut, tiens, une route à gauche, à peine goudronnée, voyons, carcasses de voiture, clôture en ruines, ici, on ne roule pas sur l’or, des pauvres, c’est bon pour moi. Que c’est sale ! Du hangar dépasse le museau d’un tracteur hors d’âge, l’outillage traîne dehors, mauvaises herbes et détritus, quelques poules déambulent, indifférentes. Accéder à la maison d’habitation va demander une grande dextérité si je ne veux pas finir la journée crotté jusqu’aux oreilles.
« Il y a quelqu’un ? » dis-je en élevant la voix, un peu seulement, le lieu se drapant d’une hostilité palpable, sans raison apparente.
Je n’aime pas cet endroit. On distingue le café de là où je suis, le regard embrasse la campagne alentour, nous sommes sur une colline, plein sud, vue agréable qui devrait être rassurante et qui ne l’est pas. Derrière le bâtiment de la ferme, quelques arbres annoncent l’orée d’un bois que j’avais aperçu avant d’emprunter le chemin.
J’avance avec précaution dans la cour empierrée, boueuse. Pas âme qui vive. Je continue mon exploration vers ce qui semble être l’habitation principale. Des jardinières ébréchées occupent les rebords des fenêtres de chaque côté de la porte, les carreaux crasseux empêchent toute vision de l’intérieur, la porte vermoulue tient sur ses gonds par la seule loi de la gravité, elle a été rapiécée, laissant passer l’air.
Misère !
C’est inhabité, personne ne peut vivre ici, il n’y a rien à gratter ici, me dis-je en tournant les talons. Après quelques pas, j’entends un bruit sourd suivi d’un juron provenant de la maison. Quelqu’un survit ici, tout est possible, pensé-je, pas mon problème, trop sordide à mon goût.
Je presse le pas, quelques mètres me séparent de la voiture…
— Vous cherchez quelqu’un ? Ah, mais, je vous reconnais, vous êtes le gars d’hier soir ! Vous ne perdez pas de temps, dites donc…
Interloqué, je me retourne.
Oh, non, pas lui ! Pas maintenant, un peu tôt pour écouter ses délires.
— Bonjour, vous habitez là…
— Il paraît. Pour le moment, en tout cas, je suis encore chez moi, vous vouliez me voir ?
— Je ne savais pas que c’était vous, je suis au boulot en fait, je vends…
— Je n’achète rien, pas de sous, plus un rond… Et vous vendez quoi ?
— Des produits phytosanitaires, mais vous n’avez besoin de rien… plus maintenant.
— Des produits qui nous empoisonnent, non merci, je ne dis pas ça pour vous, mais j’ai été volé, escroqué, avec ça aussi.
— Ah ?
— Ouais, quand j’étais gamin, ma mère est morte et c’est le vieux qui a touché l’argent de l’assurance, il a tout pris et… tout picolé, ce salaud, rien pour ma pomme ! Maintenant qu’il est mort, je ne peux pas toucher au peu qui reste et les flics me cherchent…
— Ils vous cherchent ?
— Me cherchent des poux dans la tête, je vous ai dit tout ça hier…
— Et même plus, vous avez raconté des trucs bizarres, vous étiez un peu… fatigué.
— Qu’est-ce que j’ai dit ? J’étais ivre, je sais, je parle trop, j’en ai gros sur la patate, c’est toujours moi qui prends, il faut que je parle, je n’ai personne ici avec qui causer, je suis seul. J’ai dit quoi ?
— Que vous aviez tué votre père, enfin, que vous l’aviez laissé « crever », c’est le mot, après l’accident.
— C’est sans doute vrai, puisque vous le dites, je ne sais plus trop, j’étais aussi saoul que lui, mais c’est lui qui conduisait, alors j’aurais pu y passer aussi quand on y pense.
— Si je comprends bien, la police vous soupçonne et vous a dit de rester à sa disposition. Vous m’avez dit aussi que le corps de votre père était au frais, à la morgue, pas de permis d’inhumer avant de savoir de quoi il est mort exactement. Vous êtes dessoulé ?
— À cette heure-ci, oui, pourquoi ?
— Vous l’avez tué ou pas, votre père ? Si vous avez les idées un peu plus claires, essayez de les rassembler, c’était quoi le plan ?
— Je n’ai jamais eu de plan. Si j’avais eu le courage, je l’aurais tué pour de vrai. Il est mort maintenant, c’est pareil. Je suis dans la m… de toute façon, plus d’argent, plus de courage, et les flics…
— Oui, les inspecteurs vont débarquer c’est sûr, mais vous n’avez rien fait, rien à craindre, n’est-ce pas ?
— Hein ? Quoi ?
— J’ai dit : vous ne l’avez pas tué donc vous n’avez rien à craindre, je me trompe ?
— Non, non, j’ai voulu, mais je n’ai pas pu. Il est mort, c’est tout pareil…
— Pour la police, ce n’est pas « tout pareil », pas vraiment… Pour eux, c’est : COMMENT est-il mort ?
— Qu’est-ce que ça change ? C’est pareil…
— Arrêtez avec ce mot ! Agaçant ! Vous êtes bouché ou quoi ? Vous savez quoi ? Il y a marqué le mot COUPABLE en gros caractères sur votre front. Un mec de la PJ vous cuisine dix minutes et vous serez presque fier de lui annoncer que oui, vous avez tué votre père. Et hop, après les aveux, au trou pour un certain temps, c’est ça que vous voulez ?
— Qu’est-ce que ça peut vous faire ? Vous êtes qui pour me dire tout ça ? Je vous ai parlé hier soir, je vous reparle aujourd’hui, ça ne fait pas de nous des copains de bordée. Foutez-moi le camp ! Allez fourguer vos saloperies ailleurs ! Dégagez, j’vous dis…
— Calmez-vous, je m’en vais, débrouillez-vous. Ce que j’en dis…
— Je m’en fiche.
— Au revoir.
— Adieu.
Je tombe sur ce type, le dernier que je souhaitais rencontrer aujourd’hui.
Tu parles, le premier, oui !
Quoi ?
Tu as pris ce chemin par hasard ?
Ben… oui…
Mon œil, tu savais. Il te l’avait dit, où il habitait, ne me dis pas…
Ah, ça va ! C’est quoi ton problème ?
Moi, rien, no problem, tu t’ennuies dans ce boulot. Je comprends, remarque, mais tu ne trouves rien de mieux à faire que de jouer au détective. Prends des leçons de peinture, je ne sais pas, c’est joli l’aquarelle.
La ferme !
Cool, je te laisse à tes investigations.
C’est ça, fiche-moi la paix.
Police judiciaire, Rennes. 22 boulevard de la Tour d’Auvergne.
— Il l’a tué son père ou il ne l’a pas tué ? Faudrait savoir. On le met en garde à vue, on le cuisine un peu. S’il a quelque chose à avouer, il finira par lâcher le morceau.
— Ça, mon vieux, je n’en suis pas si sûr que toi. C’est un gars de la campagne, un taiseux comme on dit. Et puis, qu’est-ce qu’on a ? Des rumeurs de mésentente, une enfance épouvantable, une sœur morte en bas âge par négligence du père, morte prématurément, alcool à tous les étages. C’est certain, il a toutes les raisons de le supprimer, son vieux, mais bon, si on va par-là, tu as une moitié de l’humanité qui a toutes les raisons de supprimer l’autre.
— Mouais, l’accident est suspect : elle a pris feu très vite, cette auto. D’après le témoin qui a entendu le choc, il a regardé par sa fenêtre, vingt, trente secondes après, le véhicule flambait déjà. C’est plutôt rare de nos jours, tu ne crois pas ?
— Et ?
— Je dis que la bagnole était trafiquée, comme qui dirait, prête à s’embraser…
— Avec lui dedans ? Dans l’état où il était ? Gonflé, le gars ! Il pouvait y rester lui aussi. S’il avait voulu trucider son paternel, un accident de chasse aurait été plus crédible. On a trouvé quelque chose sur la voiture ?
— La scientifique regarde, examen non terminé.
— Si tu y tiens, on peut toujours convoquer le gars, l’air de rien, et discuter avec lui. Il faut aller le chercher dans son coin de cambrousse par contre, plus de moyen de transport, et le ramener chez lui si ça ne donne rien. Qui veut y aller ? Personne. Bon, Éric, c’est toi qui t’y colles, tu t’en occupes. En rentrant ici, pour commencer, mets-le en confiance, je prendrai le relais.
Une mort suspecte attire l’attention de la gendarmerie du secteur qui appelle pour enquête complémentaire, c’est la procédure dans les suspicions d’homicide. Rien de folichon. Dans la ruralité profonde, voir arriver la PJ est chose rare. Les portes se ferment, les visages aussi, la parole se fait rare.
Quarante-cinq minutes de route, cinq minutes de départementale, et trois minutes de… n’importe quoi, le tout fait atterrir l’inspecteur Éric Dumoulin et son adjoint Thierry Le Person dans une cour de ferme que nous connaissons déjà.
L’inspecteur se tourne vers son collègue :
— C’est un peu chez toi ici, non ? dit-il d’un ton goguenard.
— Ça ne va pas, non…
— Tu n’es pas né dans le département ?
— À cinquante kilomètres, au bord de la mer, non mais, tu as vu le coin ? Et la baraque ? Nom de D…, qu’est-ce qu’on fout ici ?
— On vient chercher un type accusé… non, soupçonné d’avoir trucidé son père, un certain Joseph Le Cam. Fais gaffe à tes chaussures…
— Tu es sûr que c’est là ? Il n’y a personne ici…
— J’ai l’adresse : « Le bois de la lande, 22 Coëtlogon », j’ai mis le GPS, il a trouvé. Bingo, droit au but, c’est ma devise. Allez, on y va. Va voir derrière, je passe par devant, on ne sait jamais.
— Il est dangereux ?
— Je ne crois pas, mais on ne sait jamais, dans un moment de folie, la peur fait faire des choses…
Derrière la fenêtre, Jo observe la scène. Il a vu arriver la voiture, immatriculée dans le département d’à côté, il sait. Deux gars, un costaud et un petit, sec et nerveux, sont sortis de la voiture. Petite conversation entre les deux, le costaud se dirige vers la porte d’entrée, l’autre longe la cour et se dirige sur le côté, à gauche de la maison. Où va-t-il, celui-là, se demande Jo, il n’y a rien, pas de porte à l’arrière, juste la remise avec quelques outils, il finira par revenir.
C’est le bordel ici, rien de propre, les bouteilles traînent près de la cheminée, les assiettes sales s’empilent dans l’évier, la télé est allumée, il s’est endormi devant hier soir, les bottes aux pieds, écroulé dans le fauteuil défoncé, trop cuit pour se traîner jusqu’à son lit, dans la pièce du fond.
Ils n’ont pas perdu de temps.
On frappe à la porte.
« Entrez, c’est ouvert », grommelle Jo en s’asseyant sur le banc crasseux, assise incertaine longeant la table de chêne sans âge sur laquelle s’empilent les journaux, prospectus et autres factures. Le courrier non ouvert s’étale au milieu de restes de repas, non datés, enveloppes souillées, taches de café et de vin mêlées.
Ils auraient pu prévenir, se dit-il. Oui, mais comment ? Plus de téléphone et il y a longtemps qu’il n’ouvre plus le courrier. L’inspecteur entre, marque un arrêt :
— On peut allumer ? On ne voit rien ici.
— À droite de la porte…
— Merci, voilà qui est mieux. Vous êtes Joseph Le Cam ? demande le policier d’un ton neutre.
— Ben oui, je ne vois personne d’autre. J’habite ici, et vous, vous êtes qui ? répond l’intéressé d’un air las.
— Lieutenant Éric Dumoulin, Police judiciaire, et mon collègue…
— Il n’y a pas de porte derrière, il va être obligé de refaire le tour votre collègue, coupe Joseph.
— Je disais, mon collègue : lieutenant Thierry Le Person… Le voilà, tu peux rentrer Thierry, M. Le Cam est là, on fait la causette, n’est-ce pas ?
— Si vous le dites…
Le Person parcourt la pièce du regard sans faire de commentaire, notant au passage la présence d’une arme, un fusil de chasse appuyé contre le mur du fond, sous un râtelier sur lequel sont disposées des boîtes de cartouches, neuves, trop propres dans un tel environnement. La chasse est ouverte ?
— Monsieur Le Cam.
— Bonjour monsieur.
— Vous connaissez le motif de notre visite, je suppose, reprend Dumoulin.
— Vous allez me le dire, c’est en rapport avec la mort du père ?
— C’est ça. Il va falloir nous suivre, M. Le Cam…
— Vous m’arrêtez ?
— Non, monsieur, on ne vous arrête pas, mais on doit procéder à quelques éclaircissements sur les circonstances du décès de votre père. Vous prenez quelques affaires, il se peut que vous passiez la nuit à Rennes.
— Je n’ai pas d’argent pour dormir là-bas.
— Ne vous inquiétez pas, c’est la police qui invite.
— Dans ce cas, vous me laissez cinq minutes, le temps que je me change et que je me débarbouille.
— Prenez votre temps.
Jo se lève de son banc, péniblement, et se dirige vers la chambre du fond. À aucun moment, il n’envisage d’inviter les inspecteurs à s’asseoir, encore moins à boire quelque chose. Trinquer avec ces gars-là, jamais, qu’ils aillent au diable, mais là, c’était bigrement compliqué de les envoyer promener. Il faut suivre, ils sont deux, surtout le grand, le chef, pas commode, et l’autre, avec son regard de fouine, l’air de rien, qui avait bien vu le fusil et les cartouches, achetées la veille. Pas malin non plus, acheter des cartouches quand tout le monde pense… pense quoi ? Je fais ce que je veux. Si je veux me faire sauter le caisson, c’est mon affaire, ça n’étonnerait personne, c’est comme qui dirait une tradition familiale.
J’ai la tête qui cogne ce matin.
Je prends le minimum, un coup de gant sur le museau, les bottes à la remise, un pantalon et une chemise propres. Heureusement que la voisine repasse le linge, dommage qu’elle ne fasse pas le reste, mais depuis que le vieux y est passé, elle ne veut plus, je vois bien qu’elle a peur de moi, qu’est-ce que j’y peux ?
Qu’est-ce qu’ils font les deux à côté ? Ils causent, toujours pas assis, ils pourraient, c’est gratuit.
J’ai tout ce qu’il faut, le petit sac, la toilette, ouais. Je dormirais bien, moi, mais ils ne vont pas aimer.
Dans l’autre pièce, les deux inspecteurs tournent en rond dans la pièce encombrée.
— Quel foutoir ! Et l’odeur, bon sang, il ne se lave jamais ce type, je ne savais pas que ça existait encore ce genre de gourbis.
— Ouais, répond Dumoulin, on ne peut pas dire que le gars est soigneux, c’est sûr. Bon, qu’est-ce qu’il fait ? Hé, M. Le Cam ! dit-il en avançant vers la porte de la chambre, vous êtes prêt ?
— J’arrive, j’arrive, répond une voix derrière la porte qui s’ouvre aussitôt, laissant apparaître un Jo tout neuf, ou presque, un sac de sport à la main. Voilà, c’est bon, on peut y aller.
— C’est parti.
Les deux policiers sortent en premier, Jo donne un tour de clé au verrou et met celle-ci sous un cache-pot ébréché sur le rebord de la fenêtre.
— Ça ne craint rien, de laisser la clé comme ça ? C’est le premier endroit où je chercherais si j’avais à rentrer chez vous…
— Y’a rien à voler… C’est pour la voisine, elle vient de temps en temps… pour le ménage, vous avez dû voir qu’il y en avait besoin.
— Pas de problème. Montez à l’arrière, donnez-moi votre sac, on le met dans le coffre, c’est la procédure, on vous le redonne en arrivant, ne vous inquiétez pas.
— Oh, je ne m’en fais pas, si mes affaires ne sont pas en sécurité ici, elles ne le seront nulle part, répond Jo, en s’asseyant sur la banquette arrière. Jolie voiture que vous avez là.
Peu de voitures circulent, un véhicule qui remonte vers le bois, encore moins. Ils sont passés à côté du café, virage à gauche, comme notre assureur. De la fenêtre du bar, on distingue le chemin qui mène chez Jo. Deux autos dans la même journée, chez le vieux gars, bizarre, deux types dans la deuxième, la police peut-être ?
Être au courant de ce qui se passe dans la commune est une question de survie dans un bistrot de campagne. Ici, on vient boire un coup, voire deux, et surtout on vient aux nouvelles. Et là, il y a du grain à moudre chez Jo.
Je vais téléphoner à Catherine sa voisine, pour qu’elle passe voir. Elle fait le ménage, enfin, elle le faisait, elle a peur, m’a-t-elle dit. Elle est curieuse, comme nous tous, elle va y aller. La clé doit être sur la fenêtre, rien de changé depuis le vieux.
« Allô, Catherine ? C’est Françoise, du café. Dis donc, Jo a eu de la visite aujourd’hui ? Ce matin, assez tôt, et puis là… attends une seconde, voilà l’autre voiture qui redescend, Jo est à l’arrière, bon sang, les flics qui l’embarquent ! Tu peux aller voir chez lui ? Pour quoi faire ? Ben, je ne sais pas, moi, il a peut-être laissé un mot… Vas-y, qu’est-ce que tu risques ? Il n’y a plus personne. C’est bon, c’est ça, pour le ménage, tu passes quand tu veux, j’ai reçu le pain, je t’en ai mis un de côté. À plus tard. »
Le ménage, tu parles, c’est un camion-benne qu’il faudrait, à la déchèterie… Son taudis, quelle misère !
L’autre voiture n’est pas redescendue, il a dû repartir par le bois, il n’a jamais eu autant de visites le Jo, mais celle-là, il s’en serait bien passé.
Je suis reparti par le bois. Inutile d’alimenter les conversations du bar, la patronne essuie ses verres en regardant par la fenêtre.
Quel pays !
Je vais faire quoi maintenant ? À cette heure, il n’y a personne chez les gens : la femme à l’usine, l’homme au volant de son tracteur. La condition humaine ici-bas n’a rien de folichon. Le travail ne manque pas, trop sans doute, un horizon se recrée chaque jour, pluie ou brouillard donnent au bocage une allure fantomatique, le vert se teinte, délavé par l’humidité omniprésente.
Le chemin d’accès à la vallée a été goudronné. Je n’ai personne à voir de ce côté. Je connais cet endroit, la maison près de la rivière, ah, la voilà… Quel décor ! La lisière de la forêt est à quelques mètres de la pelouse qui enserre la bâtisse. Un véhicule est garé devant la porte du garage, la cheminée laisse échapper une fumée blanche. Habiter ici est possible, un choix ? Une contrainte ? Une jeune femme sort, ferme à clé la porte d’entrée, jette un œil aux alentours, son regard s’arrête sur ma voiture qui avance lentement, je change de vitesse, accélère, elle m’observe puis se dirige vers son auto, s’y engouffre. Je passe mon chemin, une femme se rend à son travail, simple scène matinale. La route nouvellement viabilisée poursuit sa sinueuse errance entre talus et rivières, les ruisseaux ont grossi suite aux pluies continues des dernières semaines, certains prennent leurs aises dans ce fond de vallon saturé d’eau, les gerbes provoquées par mon passage témoignant d’une liberté aquatique indéniable. Je quitte l’humide vallée. Quelques lacets me hissent au sec, lisière d’un bosquet de bouleaux et de hêtres, arbres jeunes, bois tombé, enchevêtrement sans nom.
La nature n’a pas de maître.
Ce n’est pas ici que je vais trouver de quoi alimenter mon compte en banque.
Le dédale de chemins d’exploitation et de routes vicinales est fort heureusement présent sur mon GPS, aide précieuse. Je quitte ce coin de campagne pour en rejoindre un autre, habité par un client potentiel, déjà inscrit dans les fichiers. Je l’avais visité il y a quelques mois, improbable contact. Il a vraiment beaucoup plu et de gros nuages noirs n’annoncent rien de bon. J’ai laissé l’imperméable à la maison et pas de parapluie dans l’auto. J’espère qu’il est chez lui, le jeune marié. Elle était belle son épouse, une métisse. Et la mère qui me regardait d’un sale œil la dernière fois que je suis passé, pas commode la belle-mère apparemment. Quelques kilomètres de départementale me laissent le temps de repenser à mon vieux garçon de ce matin, pas facile non plus. Il semble être dans de sales draps. Je retournerai faire un tour au bistrot, pour causer.
Tu recommences !
Tu n’as pas mieux à faire ?
Je te signale un léger détail : un courrier de la banque t’attend et un autre est en route, de ton propriétaire, deux mois de loyer de retard.
À peine arrivé… monsieur joue au détective.
Monsieur n’a rien vendu depuis trois jours.
Monsieur…
Oh, ça suffit la petite musique !
Je sais, je sais que c’est la poisse, que c’est un boulot de m… que l’autre folle me ment.
Eh ! Attention, il me fait quoi, lui, avec sa camionnette ? Et la pluie qui recommence, c’est le déluge. Nous y voilà. Un torrent d’eau boueuse traverse la cour de la ferme, une ravine s’est formée, que s’est-il passé ici ?
La porte de l’habitation est ouverte, un volet claque, malmené par le vent qui se lève. La pluie cesse, j’avance ma Renault dans ce qui fut une cour empierrée.
Il semblerait que ce jour soit placé sous le signe de la désolation. Il est où notre homme ?
Je descends prudemment, pas de chien en vue.
Le vent redouble, m’obligeant à fermer la portière.
Personne.
Le volet continue sa valse assourdissante, j’y mets fin, l’accroche glisse avec l’humidité, un bout de fil plastique me permet une réparation de fortune.
La porte s’agite quelque peu.
« Il y a quelqu’un ? »
L’eau a inondé les lieux, c’est ouvert depuis un certain temps, une odeur de moisi flotte dans l’air. L’obscurité de la pièce rend l’atmosphère pesante. Je cherche un interrupteur, à droite, je le vois, j’allume.
Deux heures qu’il attend.
Jo commence à trouver le temps long. Il a soif, il l’a dit, on lui a montré la fontaine à eau.
— Pas ça, vous n’avez pas autre chose ?
— Eh, dis, ce n’est pas marqué « bistrot », dit le gars en faction derrière le comptoir d’accueil, mimant l’écriture sur son front, non mais, il se croit où le paysan ?
Jo bougonne, il a vraiment soif. Tant pis, allons pour le château La Pompe, appellation contrôlée. Il n’a pas envie de rire, le Jo.
Qu’est-ce que la police va lui demander ? Il ne sait pas. Avec ces gars-là, on est toujours coupable de quelque chose et il sait qu’il n’est pas clair, à commencer par son état ce soir-là. La mémoire est défaillante, il peut jouer là-dessus : quand je suis saoul, je ne me souviens plus de rien, enfin, de presque rien.
C’est le presque qui le chiffonne.
Les deux inspecteurs l’ont posé là et sont rentrés dans les bureaux. Une porte permet d’accéder à un long couloir sur lequel s’ouvrent de multiples portes, bureaux vitrés ou aveugles, la sortie de secours ferme le tout.
— Il doit être mûr, je vais le chercher ?
— Vas-y, il y a des affaires plus urgentes, ça devrait être réglé ce soir.
L’inspecteur Le Person remonte le couloir d’un pas tranquille quand la porte d’accès s’ouvre brutalement.
— Votre gars, le paysan, il est parti. Il a dit qu’il avait assez attendu et qu’il avait autre chose à faire que de faire le poireau chez les flics. Il a pris son sac et il s’est tiré.
— Mais ? Tu l’as laissé filer ?
— Est-ce que je sais, moi, qui c’est ce type ? Ça fait deux heures qu’il est assis sagement sur sa chaise, il m’a demandé à boire un coup, je lui ai montré la fontaine, il voulait boire autre chose. Va savoir, il est au bistrot du coin…
— Il n’y a pas de bistrot dans le coin, tu le sais, et merde… Éric, on a un problème, notre « suspect » s’est fait la malle…
— C’est quoi, cette connerie ? On ne peut rien te confier. Pas fichu de surveiller un gars de la campagne. Allez, on y va, il faut le retrouver, il ne doit pas être bien loin, comme si on avait que ça à faire.
Jo en a marre. Il a bu un peu d’eau, s’est assis puis s’est relevé. C’est décidé, je m’en vais.
— Je pars. J’ai du travail à la ferme. Dites à vos gars qu’on ne fait pas poireauter Jo Le Cam pour rien. Bonjour chez vous.
— Monsieur…
— Salut.
Un étage à descendre, le voici dans la rue. Une avenue bordée d’arbres, couloir de bus, voie cyclable et un trottoir accueillent Jo, un peu perturbé par son audace toute neuve.
Non mais, ce n’est pas correct de faire attendre les gens sans rien leur dire. Je rentre chez moi, ils savent où me trouver. La gare, il faut que je trouve la gare, celle des autocars.
Je vais marcher un peu et demander, et la police qui ne va pas être contente ; s’éloigner du quartier me semble plus prudent. Jo ne connaît pas la ville, Jo a l’air perdu. Son aspect rustique le sauve.
— Vous cherchez quelque chose ? s’enquiert une dame.
— Oui, la gare des autocars ?
— La gare routière, vous voulez dire ?
— Oui, pour rentrer chez moi.
— Je comprends. Vous avez de la chance, ce n’est pas à côté, mais c’est direct. Vous allez marcher tout droit et tourner à gauche avant le pont de chemin de fer. Ensuite, c’est tout droit jusqu’à la gare des trains, les bus sont derrière. Vous allez où ?
— Vers Loudéac…
— Il y a sûrement un autocar, comme vous dites. Bon courage.
— Merci madame.
— À votre service.
Sympathique et serviable, cette dame, allez, en route, se dit Jo, son sac à la main. Il rajuste sa casquette et d’un pas alerte entame la remontée de l’avenue.
Quelques minutes plus tard, les deux policiers déboulent sur la rue, un peu tard pour apercevoir Jo qui vient de prendre à gauche vers la gare, comme mentionné par la citadine. Les deux hommes sont furieux et vexés de s’être fait avoir par un cul-terreux.
— Il est capable de rentrer chez lui cet idiot…
— Idiot, idiot, pas tant que ça. Il nous fait le numéro du bouseux primaire, plus futé que nous sur ce coup-là. On fait quoi maintenant ?
— On se calme, ce n’est pas l’ennemi public numéro un. Tu envoies quelqu’un à la gare, aux gares routière et ferroviaire, vérifier s’il y a un bus pour… pour où déjà ?
— Loudéac.
— Et le train ?
— Pas de ligne dans ce coin.
— Simple. Tu envoies Max, ça l’occupera.
— Et s’il ne prend pas le bus ?
— Nous retournerons faire un tour à la campagne, et boire un coup au bistrot du village, histoire de… Moins simple qu’il n’y paraît, ça sent l’embrouille.
Jo remonte le boulevard qui longe la voie ferrée. Il rentre à la maison, il verra sur place ce qu’il doit faire. Les flics y seront peut-être déjà.
Je ne me suis pas présenté ; le type qui vend des produits phytosanitaires, celui qui joue au détective, qui suinte l’ennui par tous les pores, il s’appelle Arthur, Arthur Simon.
Arthur pousse un cri.
Jo marche dans la ville.
Arthur plonge dans l’horreur, sort de la maison précipitamment et vomit ses tripes…
Jo voit passer une voiture de police sur le boulevard, sirène hurlante. Pour lui ?
Arthur s’éponge le front. Il recommence à pleuvoir.
Jo s’arrête, la voiture s’éloigne. Fausse alerte.
Arthur se retourne vers la maison, la lumière vacillante d’une ampoule nue que le vent fait bouger dessine des ombres mouvantes.
Jo reprend sa marche en avant, plus décidé que jamais à prendre ce car. Il approche. Il lit : « Gare routière ».
Arthur reprend ses esprits et marche sous une pluie battante.
Jo est arrivé, regarde les panneaux et voit : « Loudéac 16 h 53. Quai 7. » Il est 16 h 40. Il regarde, le bus est là, il approche et monte.
Arthur est rentré et fixe la scène.
« Un billet pour Plémet, s’il vous plaît. » Jo paie, prend le billet et va s’asseoir.
Arthur tremble. Il prend son téléphone et compose le 17.
Il est 16 h 53, Jo quitte la ville.
Max, policier de son état, arrive à la gare à 16 h 55 et ne peut que constater l’absence du bus de Loudéac. Celui-ci n’est plus à quai. Il ne peut en aucun cas procéder à l’arrêt du véhicule, qui ne doit pas être loin, et doit en référer à ses supérieurs, ça sent l’engueulade.
Le 17 sonne occupé. C’est possible ça ? Je ne vais pas rester une minute de plus ici.
Nouvelle tentative.
— Allô ? Allô ! La gendarmerie ? Bonjour. Je m’appelle Arthur Simon. Il faut que vous veniez au plus vite. C’est un vrai massacre. Quoi ? Oui, des gens ! Oui, morts, vraiment. Écoutez, il y a du sang partout, c’est une horreur… Qui je suis ? Arthur Simon, je suis commercial, j’étais en visite chez monsieur… Ogier, oui… je suis seul. Où est-ce ? La Basse Ville, commune de Saint-Jacut… Je ne touche à rien ? Non, ça ne risque pas, non, je ne bouge pas. Dans combien de temps ? Un quart d’heure… Dépêchez-vous, c’est pénible, oui, je me calme, je SUIS calme, je raccroche, oui, c’est bon, à tout de suite….
Max remonte dans son véhicule de service. Quand il faut y aller, il faut y… aller. Quelle connerie ! S’il a pris ce bus, on le cueillera chez lui. S’il ne l’a pas pris, on lancera un avis de recherche. Vu le gars, ce ne sera pas long. Il remonte les quais, ça bouchonne. Le gyrophare aidant, il prend la ligne de bus, passe le feu, tourne à gauche sur le boulevard et ne tarde pas à franchir les portes sécurisées de la PJ. C’est marrant, se dit Max à cet instant. Nous sécurisons les accès véhicules et un type sort de chez nous comme du café du coin. Va savoir…
Branle-bas à la gendarmerie de Merdrignac
— Il avait l’air secoué le gars au téléphone, on y va. Jérôme, allez-y avec Sandrine et Charles… Il est où Charles ?
— Je suis là, chef.
— Toutes les précautions d’usage… Une fois sur place, si tout ceci se vérifie, ne touchez à rien, rappelez-moi et on lance la procédure. Les cadavres, si cadavres il y a, ne bougeront plus. Allez, en route ! Eh, Charles !
— Oui ?
— Laisse tomber tes copains localiers, pour la presse, on aura assez de boulot par la suite…
— Merde, Max, ce n’est pas possible… Il fallait le suivre ce bus, et l’arrêter.
— Mais je n’ai pas le droit…
— Pas le droit ? Vous êtes con ou quoi ? Vous travaillez dans la police, pas à l’Armée du salut. Un type s’est fait la malle, a quitté nos locaux sans autorisation alors qu’il y était convoqué pour une affaire d’homicide ! Un meurtre, Max, pas un vol de sac à main ! Et vous voulez une autorisation écrite en trois exemplaires pour avoir le droit de vérifier les occupants d’un car ? Je rêve ! C’est bon, Max, retournez taper les rapports, on vous appellera.
— Chez Ogier ? Ce n’est pas le type qui a été chercher une femme en Afrique ?
— À Madagascar. Elle est venue, puis repartie. Je ne sais plus trop. Il n’était pas très bien, son voisin nous avait appelés un jour. Il tournait en rond dans sa cour, un peu perdu.
— Tu dis qu’elle était repartie, la fille ? Elle ne serait pas revenue ?
— Aucune idée. Après le coup de téléphone du voisin, on avait appelé les pompiers, il avait fait un séjour en observation à l’hôpital, le voisin s’était occupé de ses bêtes, deux ou trois jours puis il était revenu. À peine merci, il n’est pas près de le revoir.
— Qui ça ?
— Le voisin !