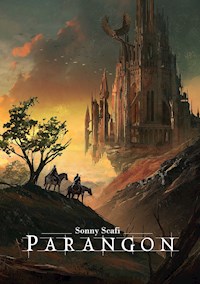Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Französisch
« Sa colère chevillée au corps et la sombre présence, celles-là mêmes qui l'avaient poussé jusque dans ce champ de neige écarlate, se lovaient toujours dans les recoins de son âme : omniprésentes en même temps qu'impuissantes et inutiles devant la douleur et les corps mutilés. Minuscules face aux râles des mourants. Insignifiantes face à l'anonymat des cadavres qui jonchaient la plaine. Il touchait à présent du doigt la supercherie : quand elle s'empare de votre esprit, la colère prétend vous métamorphoser en titan, en démiurge, alors qu'elle ne fait de vous qu'un pantin. » On ne nait pas monstre, on le devient.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 564
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À mes parents,
Proche est l’hiver et haute la montagne Mon périple commence à travers fagne Foulant cette terre ayant vu grandir Le moins que rien qui brûle de saisir
D’où me vient la sourde impression Que m’est dissimulée la trame Que le récit est incomplet Que l’insondable parangon, Dieu, ne pourrait soigner nos âmes Même si un jour il essayait ?
Personne ne détient la Vérité Dans un Livre ou dans le creux de sa main Qui suis-je pour les dieux venir défier ? Le néant qui écrira son destin.
TABLE
ARC I
ARC II
ARC III
ARC IV
ARC V
ARC VI
Arc I
Anghewyr
Il se réveilla en sursaut alors que le soleil se levait à l’horizon. Ses vêtements étaient déchirés et même si l’hiver n’était pas particulièrement rude, il était transi de froid. Il avait dormi au pied d’un arbre, au milieu de… nulle part. Il se redressa : chacun de ses membres le faisait souffrir. Son regard parcourut la végétation autour de lui : il n’y trouvait que des arbres et, un peu plus loin, un étroit chemin de terre. Rien ne lui semblait un tant soit peu familier.
En se redressant, il s’aperçut que ses bras et ses mains étaient couverts de… protubérances, d’environ un pouce de long. Il plissa les yeux : on aurait dit des insectes. Leur carapace ovale était striée d’un vert qui tirait sur le bleu, hérissée de petites pointes et tachetée de jaune. Un peu à la façon des escargots, ils étaient accrochés à sa peau et l’on ne pouvait voir ni leur tête ni leurs pattes. Il serra le poing puis secoua le bras : ils restaient accrochés de manière indolore, comme des coquillages à leur rocher. Il appuya alors sur l’un des insectes, qui tomba comme un fruit mûr. Il ne restait plus, à son emplacement, qu’un petit hématome. Au sol, la carapace se déchira sous la pression des nouveau-nés et plusieurs petites phalènes s’extirpèrent péniblement de leur chrysalide. Leurs ailes, étroites et longues, avaient le dos d’un jaune très pâle, orné de lignes sombres et marqué d’une petite tache rouge vif. Elles s’envolèrent pour aller se cacher dans un recoin de la forêt, à l’abri de la lumière.
Il détacha une seconde chrysalide, qui cette fois-ci lui résista un peu, et eut confirmation de ses soupçons. En plus de l’hématome à son emplacement, il y avait une petite piqûre de laquelle s’échappait un mince filet carmin : les phalènes se nourrissaient de son sang pour se reproduire. Elles devaient en même temps avoir des vertus analgésiques, car il continuait à ne ressentir aucune douleur. Saisi de dégoût, il arracha les chrysalides par de grands gestes et vérifia s’il en était libéré sur chaque parcelle de son corps.
Si ces papillons suceurs de sang avaient pu se reproduire, depuis combien de temps était-il là ? Depuis combien de temps vivait-il dans ce bois ? Son corps était couvert de crasse et ses vêtements n’étaient plus que des guenilles. Annwyl et l’abbaye Angana ne semblaient plus qu’un lointain souvenir. Il tenta de se rappeler les jours précédents, mais la confusion régnait dans son esprit. Peu à peu, des éclats du passé récent refirent surface. Il voyait des gens s’enfuir. Les couleurs étaient ternes et sombres… Non, en fait, il ne parvenait plus à distinguer les couleurs. Faisait-il nuit ?
Il passa sa main sur son front : sa tête le faisait souffrir. Soudain, des sensations jaillirent de son esprit : des odeurs, de lointains échos, un plaisir brûlant… Quand ces sensations se dissipèrent, il ne restait plus qu’un immense abîme de ténèbres. L’existence tout entière avait été vidée de son sens ; son âme, si jamais il en avait eu une, lui avait été arrachée. Ce néant, sans début ni fin, semblait d’une manière ou d’une autre le fixer. Une terreur panique s’empara de son esprit, oblitérant sa volonté et sa raison.
Déjà par le passé, ce néant l’avait frôlé et il avait été obligé d’y plonger furtivement son regard intérieur : il n’avait trouvé aucun sens, aucune chaleur, aucune raison de vivre. Rien qu’un vide glacial. Il ne se souvenait plus où ni quand, mais rien ne pouvait lui faire oublier l’effroi qui l’avait alors empli. Il s’efforça de contrôler sa respiration et pria pour qu’une étincelle d’humanité revienne en lui, que son âme lui soit rendue, ou bien simplement que le néant finisse par s’ennuyer et aille hanter quelqu’un d’autre.
Il n’y eut point de miracle. Le néant, toujours présent, continuait de le fixer ; inexorablement, il continuait de déconstruire les raisons mêmes de toute existence, et partant, de la sienne. De son côté, il n’avait aucune réponse à offrir ni solution à formuler ; il ne trouvait aucun motif valable pour justifier sa présence en ce monde. Privée ainsi du moindre sens, sa vie aurait bien pu s’interrompre là, à cet instant, que cela n’aurait eu pour lui guère d’importance. À choisir, il aurait même préféré qu’elle s’arrête. Mais son cœur continuait de battre, encore et toujours, en dépit de toutes ces réflexions, comme un muscle devenu fou.
Il se demanda si son tourment avait pour source la bête en lui, ou bien la mort de ses parents d’adoption. Si son histoire avait été différente, il ne serait sûrement pas dans cet état au beau milieu d’une forêt inconnue. Il préféra, pour une fois, ne pas se mentir : ces questions, abstraites et étranges, avaient toujours été présentes dans un coin reculé de son esprit.
L’insondable néant demeurait, là. Et avec lui, la douleur qui lui dévorait l’esprit.
Il se pinça les lèvres et souffla. Il aurait voulu que les larmes lui montassent aux yeux, jusqu’à sangloter. Il aurait été humain. Il avait envie de placer sa tête entre ses mains, d’attendre que le temps fasse son office et que ses problèmes s’éloignent peu à peu, comme il l’avait déjà fait par le passé. Mais le néant, froid et profond, refusait obstinément de déserter son esprit.
Son regard parcourut de nouveau la végétation autour de lui. S’il restait ici, il risquait de ne pas passer la nuit. Ce constat ne l’effraya pas. Avec difficulté, il finit par se lever et effectua quelques pas. Ses jambes supportaient à peine son poids. Un soudain mal de ventre le plia en deux : il ne se rappelait pas son dernier repas et était littéralement affamé. Il posa son regard sur son corps et réalisa qu’il était d’une maigreur cadavérique. On pouvait voir distinctement chacune de ses côtes et ses bras et ses jambes étaient si fins que ses articulations semblaient difformes.
Il dressa l’oreille et entendit le murmure d’un petit cours d’eau non loin. S’il le suivait, il finirait bien par tomber sur des habitations. Il se mit en marche et traina son corps meurtri jusqu’à arriver à une cascade le contraignant à faire un détour. Plutôt que de la contourner, il s’approcha et contempla l’abîme qui s’offrait à lui. La végétation était dense et la rosée du matin la rendait glissante. Le terrain était en léger dévers et semblait inviter à l’envol. Les chutes d’eau étaient hautes et en contrebas, les rochers affleuraient au milieu des embruns.
Il fit les deux pas qui le séparaient encore du bord du gouffre ; la pointe de ses pieds était dans le vide. Il se pencha en avant et regarda en bas. Il était si maigre qu’un coup de vent risquait de l’emporter à tout moment. Il sentit la bête s’agiter en lui : elle n’aimait pas ça, car s’il se brisait le cou, même elle ne pourrait rien. C’était étrange. Lui qui d’ordinaire était terrorisé par bien des choses et souffrait de vertiges, il n’avait plus peur. La douleur muette, engendrée par le néant insondable, par l’impossible quête de sens et la futilité de l’existence, était plus que jamais assourdissante et avait éteint tout instinct de survie en lui.
À ce moment précis, il ne craignait plus la mort, il ne craignait plus son destin. Il ne craignait plus rien.
Paradoxalement, en cet instant de détresse ultime, son esprit lâcha prise et devint plus lucide et conscient qu’il ne l’avait jamais été. Il réalisa tout à coup l’origine de son mal : ses questions existentielles engendraient des attentes illimitées, auxquelles son corps et son esprit ne pouvaient apporter que des réponses issues du monde réel, matériel, des réponses nécessairement limitées. Par conséquent, face à l’infini de ses désirs et de ses aspirations, tout ce qu’il faisait et ferait, tout ce qu’il était et serait, tendait inévitablement vers le néant implacable.
Dans ces conditions, même son instinct de survie était inhibé, car perdre la vie était plus à présent un soulagement qu’une perte réelle.
Il savait pertinemment qu’il n’avait pas percé le sens de la vie ni expliqué toute forme de tendance autodestructrice ; il ne doutait point qu’il existât d’autres voies menant au suicide. On lui avait conté, par exemple, l’histoire de cette jeune fille, mariée trop jeune et contre sa volonté, qui avait, par fatalisme, mis fin à ses jours. Toutefois, il avait la certitude de toucher du doigt la source de son propre mal et, il le sentait, du mal de toute une humanité.
Mais comprendre l’origine de son mal n’était pas suffisant pour le faire disparaitre. La solution la plus simple, la plus expéditive, restait là, face à lui. Elle lui tendait les bras. Le vent souffla sur son équilibre précaire et il vacilla, aux portes de l’Autre Monde.
Les croassements d’un couple de corbeaux vinrent interrompre sa méditation. Il leva les yeux un instant puis les replongea vers l’abîme devant lui, pour retrouver la noirceur du néant. Les corbeaux croassèrent de plus belle. Il fronça les sourcils et fixa les volatiles effrontés. Qu’est-ce que vous me voulez ? D’autres croassements lui répondirent. Il secoua la tête : ces maudits oiseaux le distrayaient dans sa quête morbide. Le couple s’envola en droite ligne vers lui : par réflexe, il fit quelques pas en arrière pour les éviter. Les oiseaux vinrent atterrir à ses pieds. Il les ignora, baissa la tête et ferma les yeux pour se replonger dans sa contemplation du néant. Il sentit alors quelque chose se poser sur sa tête. Ses yeux s’entrouvrirent, il fit la moue et attendit, blasé, que le volatile daigne s’envoler. Comme ce dernier appréciait la vue, il dut agiter ses bras pour le faire fuir – pas bien loin.
Lorsqu’il voulut replonger son regard intérieur dans le néant, celui-ci avait disparu. La faim tordait de nouveau son ventre. Il pencha prudemment la tête pour voir le contrebas de la cascade et, pris de vertige, recula d’un coup. Un instant auparavant, il avait regardé les rochers sans vraiment les voir. Le couple de corbeaux continuait de croasser gaiement. Lui avait l’impression de sortir d’une transe. L’expression sur son visage s’adoucit.
« Tu pourrais mettre ce monde à feu et à sang. »
Il se figea. La voix avait sonné comme un grondement dans sa tête. La sombre présence tournoyait dans les replis de sa conscience ; elle était prête à jaillir. Il savait d’expérience qu’elle pouvait remplir tout son être. Malgré la frénésie, la douleur et les remords, elle avait le pouvoir de faire fuir le terrible néant qui guettait. Ce soulagement n’était jamais que temporaire et il fallait renouveler régulièrement le traitement. La frénésie, la douleur et les remords devenaient alors une habitude qui pouvait vous emporter à tout moment.
Alors qu’il se faisait cette réflexion, le couple de corbeaux se posa sur ses épaules, l’un à gauche, l’autre à droite, ignorant tout de ses tourments. Quelle chance ils ont de ne pas avoir à penser. Les oiseaux se mirent à croasser comme s’ils se chamaillaient et une douce sensation l’envahit, une vague paisible qui le nettoya de toutes ses peurs. L’espace d’un instant, il entrevit un autre monde, fait d’une douceur et d’une chaleur infinies, qui prenaient tant de place que le néant ne pouvait plus exister. Un monde qui lui échappait déjà.
Une larme coula sur sa joue maigre.
« Pleure tant que tu veux, tu ne briseras jamais mes chaines. »
Les corbeaux s’étaient envolés.
Il reprit sa marche, lente et incertaine.
Peu après que le soleil eut atteint son zénith, il finit par trouver un petit village, guère plus qu’un hameau. Il préféra d’abord redoubler de prudence, car les villageois avaient peutêtre déjà eu maille à partir avec une « bête » les jours précédents. La première habitante qu’il rencontra était une adolescente d’une quinzaine d’années, affairée près d’un petit enclos qui accueillait un couple de porcs. La jeune fille le fixa avec un certain étonnement, mais ne prit pas ses jambes à son cou.
L’hospitalité lui fut offerte, généreusement. On le nourrit et lui donna des vêtements propres. Sa maigreur faisait peur à voir et la mère rajouta un bout de gras afin d’enrichir le bouillon du soir. Il passa deux nuits dans la ferme puis repartit, après avoir remercié ses hôtes.
Il reprit le chemin d’Anghewyr pour y trouver Amargein, son ancien maître. Cette mission était devenue sa seule boussole, sa planche de salut, dans un océan d’incertitudes. Le mage saurait quoi faire, il l’aiderait à se débarrasser de la sombre présence, à trouver un sens qui ferait fuir le néant. Cette pensée lui donna un peu de courage et il pressa le pas.
Le soleil rougeoyait à l’horizon lorsque ses paupières se fermèrent une première fois contre sa volonté. Il les rouvrit et gravit un petit promontoire, par-delà lequel s’étalait à perte de vue une immense étendue d’eau. La mer… ici ? Il en avait déjà entendu parler, mais ne l’avait jamais vue. À ses pieds, la végétation était sauvage : les herbes vertes montaient jusqu’à ses mollets et les fleurs des champs multipliaient les couleurs de manière anarchique. Il leva les yeux et découvrit, au bout du promontoire, un escalier si long qu’il allait se perdre dans les nuages. Il s’y lança sans même réfléchir, certain qu’il était la seule voie possible. À mesure qu’il montait les premières marches, son cœur et son humeur se faisaient plus légers : il naquit en lui une allégresse qu’il pensait perdue à tout jamais. Le doute et l’amertume semblaient s’être enfin effacés de son âme. Il souriait paisiblement comme son pas agile avalait les marches de pierre avec entrain, sans qu’aucune fatigue se manifeste.
Soudain, une pointe d’angoisse lui transperça le ventre. Il se trouvait à une hauteur considérable au-dessus de l’eau et avait la sensation de perdre l’équilibre, comme si le vide exerçait sur lui une attraction irrésistible. De peur, il arrêta sa course et s’accroupit sur les marches en s’appuyant sur ses mains, pour être sûr de ne pas tomber. L’escalier était assez large pour l’empêcher de regarder en bas et il n’y avait pas un brin de vent. Il reprit son ascension en fixant son regard sur chacune des marches, mais à présent qu’il en avait conscience, le vide ne quittait plus son esprit. Il réalisa alors que la taille de l’escalier s’était réduite : très grandes au départ, les marches ne faisaient même plus la largeur de ses épaules. Par ailleurs, la pierre solide avait laissé place à un bois sec qui craquait à chaque pas. Il se remit en position accroupie, tétanisé par la peur, et ne progressa plus qu’en rampant de marche en marche, le souffle court, avec l’espoir d’atteindre le plus vite possible le haut de l’escalier. Toutes les dix-sept marches, celui-ci faisait à présent des virages en angle droit. Il jeta un coup d’œil en l’air : il lui sembla apercevoir une personne, quelques étages au-dessus, qui se déplaçait sans crainte et avec une facilité déconcertante. Un peu vexé, il se redressa et reprit son ascension d’un pas rapide, à défaut d’être assuré. Il avait l’impression de connaitre la personne et voulait la rattraper.
Un virage à gauche se présenta à lui et l’immobilisa : les trois dernières marches étaient manquantes. L’autre a bien réussi… Il s’avança jusqu’au bord avec prudence et agrippa la marche qui se présentait à mi-hauteur. Il se hissa sur l’escalier, ses jambes gambillant un instant dans le vide. Il avait franchi des murets ou grimpé aux arbres maintes fois par le passé lors de ces maraudages avec les gars de Teilan et pourtant ses forces lui paraissaient maintenant à peine suffisantes.
Aussitôt eut-il repris son ascension que l’escalier tournait encore à gauche. Il lui manquait cette fois quatre marches. Le ventre noué, il s’avança de nouveau jusqu’au bord, en faisant bien attention de ne pas regarder en bas. Il allongea le bras : ses doigts étaient trop courts de quelques pouces. Rien de dramatique, il fallait qu’il saute, mais ce bond, ridiculement petit, devenait tout à coup un effort surhumain.
Ses jambes s’infléchirent et poussèrent misérablement, juste assez pour qu’il puisse appuyer ses deux avant-bras sur la première marche disponible. Le reste de son corps se balançant dans le vide lui fit soudain prendre conscience que l’escalier était construit sur les murmures du vent. Au moment où il se fit cette réflexion, les marches craquèrent, prêtes à céder. Par réflexe, il s’accrocha à la marche suivante, mais son geste fut inutile : l’escalier tout entier s’effondra et il se sentit tomber dans l’abîme.
Le soleil se levait à l’horizon et ses rayons perçaient déjà le feuillage des arbres. Le dormeur était recroquevillé en boule au pied d’un arbre. La lumière vint effleurer ses paupières, qui s’ouvrirent lentement. Cela ne suffit pas à le ramener à la réalité : la sensation de tomber était encore trop vivace. Il était transi de froid et ses membres étaient engourdis de fatigue. Pourquoi n’avait-il pas demandé l’hospitalité dans un village ?
Bien que la végétation fût différente, la forêt autour lui semblait identique à toutes celles qu’il avait traversées jusqu’à présent. Ses yeux regardaient mais son esprit ne voyait plus, ni les arbres, ni les animaux, ni les villages, ni les hommes et les femmes. Tous défilaient devant lui, sans jamais exister. La réalité avait disparu, occultée par les brumes de ses tourments. De même, sa vie à Teilan n’était plus qu’un souvenir lointain et confus, dont il venait à douter de la véracité. Il n’y avait plus rien, rien qu’Anghewyr : seule la cité royale pouvait l’aider.
Il se remit en route et en chemin, vola de la nourriture et des vêtements propres afin d’avoir l’air présentable. Il arpentait à présent une grande route de terre où le trafic allait bon train : les charrettes se suivaient dans les deux sens. Lorsqu’il croisait des hommes en armes, son regard se rivait au sol. À plusieurs reprises, il avait demandé sa direction aux habitants des hameaux qu’il traversait. Ils avaient tous eu le même geste signifiant « tout droit ». Il connaissait déjà la réponse, mais continuait de poser la question, pour se rassurer.
Lorsqu’il posa le pied sur les premiers pavés, son pas et son souffle s’accélérèrent. Et lorsqu’il vit au loin se dessiner les immenses remparts de la Citadelle, comme un guerrier géant toisant la seigneurie tout entière, son cœur tressaillit et l’espoir l’envahit. Anghewyr, Amargein, l’école, ses anciens compagnons et amis. Son ancienne vie. Le cauchemar allait prendre fin. Ses jambes ne ressentaient plus la fatigue et le portaient un peu plus vite.
Absence
La lourde charrette qu’il suivait était tirée par un bœuf et procédait à allure lente. Tandis qu’il approchait de l’enceinte extérieure, son regard parcourait les alentours. Quelques maisons ont poussé depuis la dernière fois, pensa-t-il, ce qui lui fit aussitôt réaliser qu’il reconnaissait les lieux. Souvent lorsqu’il s’y attendait le moins, de nouveaux souvenirs émergeaient à la surface de son esprit, des bribes de son passé qu’il redécouvrait comme on exhume les vestiges d’une civilisation éteinte, et qu’il tentait alors de reconstituer de manière cohérente. Cela n’avait rien d’évident, car il avait les pires difficultés pour « dater » ces souvenirs, qui s’enchevêtraient de manière chaotique dans sa mémoire.
La charrette n’était plus qu’à quelques chainées des murs. Comme toutes les villes fortifiées, on ne pouvait franchir l’enceinte extérieure d’Anghewyr que par les grandes portes, surveillées jour et nuit par des hommes en armes. La surveillance pouvait sembler superflue, car on voyait mal quelles forces armées pouvaient s’enfoncer aussi profondément dans les seigneuries et venir frapper en leur cœur. Certains affirmaient que Malric était devenu paranoïaque et craignait une attaque de l’intérieur, de la part des seigneuries mêmes. Iudhael les avait certes unifiées – par la force – mais leurs querelles intestines remontaient si loin dans les brumes du temps que l’émergence d’un nouveau prétendant et d’un nouveau conflit n’aurait surpris personne. Malric le savait. Il était même convaincu que ce n’était qu’une question de temps. À tel point qu’il épiait, grâce à un réseau d’agents dirigés par son maître-espion, dont personne ne connaissait l’identité, les moindres faits et gestes de ses vassaux dans les seigneuries qu’il jugeait les plus dangereuses ou les plus enclines à la rébellion.
Branwal voyait s’approcher les portes d’Anghewyr avec une tension croissante. Il avait l’impression de revenir à ses racines, de retrouver son statut, celui qu’il n’aurait jamais dû quitter. Bien qu’il n’en mesurât pas l’étendue, l’espoir de retrouver sa place, son rôle dans le monde, son identité véritable, cet espoir l’avait tout entier avalé. Il avait à présent l’impression qu’une partie de lui s’était toujours considérée comme étrangère à Teilan. Même si, après quelques années, les jeunes gars du village l’avaient intégré en leur sein, il y en avait toujours eu un pour lui rappeler, par quelques remarques imbéciles, qu’il n’était pas vraiment comme eux. Aussi, dans un coin reculé de son inconscient, avait-il développé l’idée, subjective, qu’il n’était pas à sa place dans la vie qu’il menait, que son identité profonde ne serait jamais pleinement reconnue ni acceptée. La défiance à peine voilée, parfois même l’animosité d’une minorité des gens de Teilan, avait alimenté ce malaise latent qui apparaissait subitement au grand jour, comme une évidence qu’il ne pouvait plus longtemps ignorer.
Il franchit les portes d’Anghewyr juste derrière la charrette, en se faisant discret. Par un ancien réflexe qu’il pensait avoir oublié, son regard évita de croiser celui des gardes et la sensation qu’il éprouva fit jaillir une nouvelle salve de souvenirs, courte et désagréable, dans son esprit. Custen… ? Non. Lorsqu’il releva les yeux, la charrette se trouvait sur une large route pavée, bordée de maisons anciennes, mais bien entretenues.
Peu à peu, les lieux se rappelaient à sa mémoire : il était arrivé à Anghewyr par la porte sud, l’une des plus grandes de la cité. C’était étonnant si l’on considérait qu’il aurait plutôt dû arriver par l’est ; ça l’était moins compte tenu de son voyage chaotique. La grande rue qu’il remontait était une artère fréquentée et populaire de la Ville Basse. À l’ouest se trouvaient les faubourgs les plus pauvres d’Anghewyr, en particulier le tristement renommé « quartier des fourchons » qui l’avait vu grandir. Par extension – et par mépris, on qualifiait parfois de « fourchon », terme hautement péjoratif, n’importe quel habitant de ces faubourgs.
À mesure que l’on approchait du quartier est de la cité, les maisons de la Ville Basse devenaient de plus en plus cossues. La Ville Haute était séparée de la plèbe par le fleuve Ylawar à l’ouest et au sud, ainsi que par le second mur d’enceinte. Il était plus ancien que le troisième et n’avait été ni rehaussé ni élargi, mais suffisait amplement à tenir à l’écart la populace bruyante et sale, que la noblesse d’Anghewyr ne croisait en définitive que lors d’évènements exceptionnels comme les tournois.
Son espoir était attisé par les quelques souvenirs qu’il redécouvrait parfois à la vue d’un coin de ruelle. En arrivant sur la grand-place sud, l’émotion l’arrêta net dans son élan : c’était ici – ici qu’il avait vécu un moment crucial de son existence, qui le porterait à devenir élève du mage. Il chercha du regard des visages connus pour s’épancher et partager son incroyable destin. D’autant plus qu’un visage connu réveillerait sa mémoire engourdie. C’était, pensait-il, le prolongement logique et évident de son retour aux sources.
Il observa pendant un long moment les allées et venues de la place. Le marché avait été remballé depuis longtemps et le soleil était bas dans le ciel. Les tavernes en revanche commençaient à se remplir. Il réalisa, avec son regard d’étranger, à quel point cette grand-place était une frontière invisible entre deux mondes, au sein même de la Ville Basse. Bien que l’architecture fût peu ou prou identique, les commerces sur la face ouest étaient un peu moins chers et un peu plus bruyants… un peu plus « fourchons » auraient ajouté certains. À l’opposé, les tavernes du côté est de la place étaient mieux décorées et mieux entretenues ; mais aussi plus propices à une discussion posée. Pourquoi avait-on un tel clivage, une séparation au sein d’une même place alors qu’il aurait suffi, à n’importe lequel des habitants, de la traverser pour briser cette loi sociale ? En effet, rien n’interdisait à un client d’aller dans le commerce de son choix – à condition qu’il demeure dans la Ville Basse. Évidemment, la question se posait surtout pour les hommes des quartiers pauvres : ceux des quartiers riches, en général, n’avaient aucune envie de se mêler aux gens de milieux inférieurs. Elle ne se posait pas non plus pour les femmes qui devaient rester cloîtrées entre quatre murs : les seules femmes dont on tolérait la présence dans les tavernes étaient des coureuses de rempart, de fait ou de réputation.
La première raison qui retenait les fourchons de déferler dans les tavernes et autres commerces d’en face était purement économique : lorsque le prix d’une chopine de bière engloutie en quelques gorgées représentait une demi-journée de travail, il y avait de quoi dissuader les plus aventureux. L’autre raison, plus obscure, était au moins aussi déterminante : on n’allait simplement pas chez « les autres ». Ceux qui franchissaient cette ligne invisible, en général parce que leur petite affaire avait prospéré – voire qu’ils avaient pris logement dans les quartiers est – étaient passés à l’ennemi et faisaient bien de ne plus remettre les pieds dans leur ancien quartier. Ces fourchons qui avaient réussi et traçaient leur chemin dans la société d’Anghewyr étaient souvent surnommés avec mépris les « fourchons de maison ».
Sur la grand-place, Branwal fit le tour des tavernes à l’ouest (la chouette rieuse, la grenouille qui a soif, le bateleur) puis à l’est (la licorne, les trois couronnes, le dragon farci) en regardant à travers les carreaux. Il passa devant la seule échoppe encore ouverte : celle d’un marchand ambulant qui vantait les vertus d’un remède miracle. Il avait arrêté sa charrette dans un coin de la place et, malgré l’heure, semblait être en passe de convaincre une poignée de badauds d’abandonner quelques pièces de cuivre. Il ne devait pas avoir beaucoup consommé de son fortifiant, car même debout sur sa charrette il apparaissait petit et chétif.
Branwal détourna les yeux de cette distraction pour poursuivre ses recherches, mais son regard ne rencontra aucun visage familier. Sa déception fut de courte durée.
Évidemment que je ne reconnais personne. J’ai passé trop de temps à la taverne d’en bas ! Je ne suis plus au village, je suis revenu à Anghewyr, la plus grande cité des seigneuries. Je pourrais bien passer tous les jours sur cette grand-place, que j’y rencontrerais chaque fois de nouveaux visages.
Il continua d’essayer d’accrocher le regard des passants, prêt à des retrouvailles impromptues, à de joyeuses accolades, à rattraper le temps perdu. Mais dans le meilleur des cas les badauds l’ignoraient, dans le pire ils s’éloignaient prudemment en le regardant du coin de l’œil, d’un air soupçonneux. Il se rendit à l’évidence sans se décourager : il fallait qu’il poursuive ses recherches ailleurs.
Des souvenirs flous de ses enseignements lui étaient revenus, car on oubliait difficilement le lieu une fois qu’on l’avait vu… l’immense basilique d’Anghewyr. Bien que le soleil fût sur le point de se coucher, il décida de poursuivre ses recherches jusqu’à ce que la nuit tombe. Il la passerait peutêtre sous un abri de fortune, mais cela n’avait plus d’importance, car ce serait la dernière. De toute façon, il n’avait pas l’argent pour se payer une nuitée en auberge et il valait mieux ne pas compter sur l’hospitalité des gens à Anghewyr. Il prit la direction nord-est et s’enfonça dans le quartier des marchands fortunés de la Ville Basse, en suivant plus son instinct que son sens de l’orientation. Les petites rues pavées se ressemblaient toutes, mais il ne craignait pas de se perdre. Il traversa l’un des ponts enjambant l’Ylawar et après quelques virages, hésitations et changements de direction, un sourire illumina son visage : par-dessus les toitures des riches demeures s’élevait la « flèche d’Anghewyr » qui toisait toute la ville. Même la Citadelle, plus massive et plus menaçante aussi, ne pouvait rivaliser de hauteur. Il poursuivit son chemin sans la quitter des yeux. Il se rappelait avoir été élève dans le plus beau monument de la ville et, comme à l’époque, il en tirait une fierté certaine, qui renforçait l’espoir de retrouver « sa place » dans ce monde.
En arrivant sur la grand-place est, il s’arrêta pour l’observer et la trouva changée. Il n’aurait pu dire de quoi il s’agissait de manière précise, car ses souvenirs ne l’étaient pas, mais une désagréable sensation s’empara de lui. Les mêmes maisons se côtoyaient ; les mêmes pavés couvraient la place, avec en son centre, la majestueuse basilique d’Anghewyr et son immense flèche. Pourtant, l’atmosphère dans la place lui parut bien plus froide et austère que dans ses souvenirs.
Il est déjà tard, la plupart des habitants sont déjà rentrés chez eux.
Son jeune âge ne lui permettait pas de comprendre que sa mémoire faisait non seulement un tri dans les souvenirs à conserver, avec des choix qui échappaient parfois à toute explication rationnelle, mais qu’en plus elle les modifiait, en les idéalisant le plus souvent, à la guise de l’inconscient.
Le pas assuré, il traversa la place et monta deux à deux les marches menant à la basilique. Cette fois-ci, ses souvenirs ne le trahissaient pas : le portail principal, qui supportait la flèche, était un peu plus grand que les autres et donnait accès à la faculté et à la bibliothèque ; le portail de gauche, aux tribunaux ; celui de droite, à l’école d’Ethelnor, son école. La façade de chaque aile était composée de trois portes – celle au centre était la plus grande – surmontées de grands arcs brisés en tiers-point, ornés de voussures à sept rouleaux, mettant en scène des divinités à forme humaine : Turus et Astar protégeant les pèlerins contre les démons, Heylwan éclairant les hommes ou Angana leur apportant le feu. Le tympan de chacune des trois portes principales représentait toujours exclusivement Aergat en position de domination paisible ; audessus encore se trouvait une rosace, d’un diamètre proportionnel au portail. C’était toute la basilique qui était finement ouvragée : chaque colonne, chaque corniche, chaque modillon était prétexte à des frises et chutes feuillagées, à des statues et statuettes divines, à des gargouilles et engoulants. En outre, la couleur des pierres utilisées, du grès, variait de l’ocre au brun, en passant par différentes teintes de rouge : de loin, l’ensemble était à peu près homogène, mais lorsque les visiteurs approchaient, ce camaïeu donnait l’impression, à certains endroits, d’avoir en façade une bibliothèque pour géants, où chaque pierre était un immense livre.
Sans y réfléchir, il fit ce qu’il avait l’habitude de faire, alors qu’il était encore gamin : il se planta en face du grand hall central, leva la tête et, dans la lumière mélancolique du soleil couchant, fixa l’immense flèche un long moment, jusqu’à avoir l’impression de perdre l’équilibre. Elle s’élevait si haut dans le ciel qu’il se demandait chaque fois comment des hommes avaient pu construire une telle merveille. Lorsqu’un corbeau planait près de sa pointe, il rêvait de pouvoir lui aussi s’envoler et se poser sur son sommet. D’en haut, les humains et leurs problèmes devaient sembler minuscules et dérisoires. À force de scruter l’immense ouvrage, il éprouvait d’ailleurs cette sensation d’être petit, infiniment petit, au point de devenir insignifiant. Et loin de l’affliger, cela l’apaisait d’une manière qu’il ne trouvait nulle part ailleurs. Il sourit, heureux de reprendre une vieille habitude, de retrouver le chemin dont on l’avait éloigné.
Pour pénétrer dans les ailes, les visiteurs devaient emprunter les portes inscrites dans la porte principale, qui n’était ouverte que pour des occasions particulières. Il arriva devant celle de l’aile droite le cœur battant et reconnut le heurtoir fait d’une tête de dragon tenant dans sa gueule un marteau de forme circulaire. Il le fit retomber deux fois sur le contre-heurtoir et attendit, en vain, qu’on vienne lui ouvrir. La cloche de la basilique s’était mise à retentir lorsqu’il tenta de pousser la lourde porte en bois : elle était verrouillée.
Anghewyr était entre chien et loup et la lumière déclinait rapidement. Une énième fois, son regard prospecta la place à la recherche d’un informateur, voire d’un visage familier, mais elle était presque déserte. Il se décida à faire le tour de la basilique et une nouvelle salve de souvenirs afflua : les arcsboutants superposés, reposant sur leur culée, offraient de nombreux coins et recoins aux adolescents qui s’y réunissaient souvent en fin de journée, pour discuter ou marivauder.
Cette fois-ci, il y rencontra un arat, un civil assistant du Culte, à la mine renfrognée. Il portait une longue robe noire et austère. Lorsque Branwal l’interpella d’un « excusez-moi » cordial, il le regarda, l’air agacé d’avoir été dérangé dans ses activités de la plus haute importance :
— Excusez-moi, répéta le jeune opportun. L’école est-elle fermée à cette heure ?
— L’école ? demanda de manière lapidaire l’arat qui ne comprenait pas.
— Ethelnor, précisa Branwal en montrant de la main l’aile de la basilique.
Il se souvenait qu’Amargein avait ses quartiers, modestes, au sein de la basilique et que même après avoir repris des élèves, il offrait refuge aux voyageurs et aux moins fortunés. L’arat le jaugea du regard, pour voir si l’importun ne se moquait pas de lui, mais il semblait tout à fait sérieux.
— Eh bien mon gars, ça doit faire un bout de temps que tu n’es pas venu à Anghewyr, toi ! Ce charlatan de Shanahan s’en est allé depuis belle lurette. Il a pris sa retraite quelque part, loin d’ici, et son école a enfin fermé. Depuis, c’est le Culte, l’Aergataeth, qui occupe l’aile de droite de la basilique. Sais-tu que c’est le plus grand lieu de culte dédié à Aergat de toutes les seigneuries ? Et bientôt…
L’arat partit dans une tirade exaltée, mais déjà Branwal n’écoutait plus. Il était abasourdi et perdu : Amargein ne vivait plus à Anghewyr et l’école d’Ethelnor n’était plus… Une partie de lui-même, de son âme, venait de lui être arrachée. Son regard errait sur ce qui l’entourait, dans une quête absurde de sens. Dans un sursaut de volonté, il interrompit l’arat pour lui demander s’il savait où se trouvait la retraite du mage. Le dévot s’étonna de la sottise de son interlocuteur qui, alors même qu’on lui montrait la lumière, s’obstinait à poursuivre la trace d’un obscur charlatan :
— Et comment je saurais où il se trouve, celui-là ? Étant donné la faillite de sa minable école, il est sans doute parti se cacher de honte. À l’âge qu’il avait, il est sans doute mort maintenant.
Il fit un geste agacé de la main et abandonna le jeune imbécile à sa recherche insensée.
Branwal déglutit avec difficulté, le souffle court et l’esprit embrumé. Dans sa mémoire, Amargein avait toujours été associé à Anghewyr et vice versa. Il continua de faire le tour de la basilique, comme il l’avait fait sur la grand-place sud. Plutôt qu’un éclaireur en reconnaissance, il était à présent un navire à la dérive se laissant porter par les courants. L’espoir de rencontrer un visage familier s’était transformé en un besoin impérieux et toujours aussi improbable.
Perdu dans ses pérégrinations erratiques, Branwal fut rattrapé par la nuit, qui lui commanda de trouver un abri. Il espérait encore retrouver la trace d’anciens élèves et préféra par conséquent ne pas trop s’éloigner de la basilique. Le problème, dans ce quartier riche, était que personne ne lui offrirait l’hospitalité. Aussi se mit-il en quête d’une auberge, plus précisément d’une auberge avec une écurie.
Le ciel s’était couvert et empêchait de voir la moindre étoile. L’air était humide. Il n’allait pas tarder à pleuvoir. Branwal se tenait discrètement dans l’ombre d’une haute maison à la charpente apparente et observait du coin de l’œil les entrées et les sorties d’une auberge qu’il avait connue. Il attendait que l’agitation de la soirée retombât afin de pénétrer en catimini dans l’écurie et d’y passer la nuit au chaud et au sec, en compagnie des chevaux. La pluie commençait à tomber dru lorsqu’il mit son plan à exécution. Il s’endormit comme une masse.
Aux premiers rayons du soleil qui pénétrèrent dans l’écurie, ses yeux s’ouvrirent : il fallait quitter les lieux avant tout le monde s’il voulait éviter d’être rossé par le propriétaire. À pas de loups, il quitta l’écurie en emportant la couverture qui lui avait tenu chaud. La pluie avait cessé, mais le fond de l’air était déjà celui de l’hiver. L’eau de la fontaine, qui servit à le désaltérer et à ses ablutions, était glaciale.
Il reprit ses recherches toute la matinée et questionna des dizaines de personnes : sur l’école, sur Shanahan, sur les anciens élèves… Malgré la réticence qu’inspiraient son apparence et son odeur, il obtint des réponses : si le mage n’avait pas laissé un souvenir impérissable, l’école et ses élèves, quant à eux, semblaient à peine avoir existé. Chaque expression perplexe, chaque haussement d’épaules faisait grandir en lui une désillusion amère, par-delà laquelle il n’osait regarder, de peur d’y trouver le néant implacable. Il n’eut ainsi pas de mal à abandonner cette quête, pour se consacrer à la recherche de ses anciennes connaissances du quartier des fourchons. Chez les gens sans le sou, les relations sont plus sincères, se convainquit-il.
D’un pas décidé, il traversa de nouveau l’Ylawar et le quartier commerçant par la rue des bateliers jusqu’à la grandplace sud. Une nouvelle fois, il y parcourut du regard les visages, avec le même résultat, puis il s’enfonça dans les quartiers les plus pauvres de la ville. Les ruelles étaient plus étroites, plus sombres, et n’étaient que rarement pavées. Comme il avait beaucoup plu la nuit précédente, le « quartier des fourchons » s’était transformé en bourbier, d’autant plus rapidement que personne ne venait jeter quelques ballots de paille ou planche de bois afin de rendre la route praticable. Et le timide soleil hivernal n’y changerait rien.
L’eau eut tôt fait de coloniser ses souliers, mais ne ralentit pas son pas. Il s’arrêtait à certaines intersections pour tenter d’exhumer des souvenirs enfouis. Les regards qui se posaient sur lui étaient différents. Il ne provoquait plus le dégoût, mais, avec sa couverture sentant l’écurie sur le dos, il n’en demeurait pas moins objet de dédain.
Branwal se trouvait dans la rue des balayeurs, derrière la grand-place sud. Assis sous un porche, tête baissée, les bras posés sur ses genoux, il ne savait plus par où continuer ses recherches. Au fond de lui, il ressassait de très sombres pensées. Des mots prononcés un peu fort le sortirent de sa torpeur : il releva la tête et comprit vite le manège.
De jeunes fourchons – le plus âgé n’avait pas vingt ans – descendaient bruyamment la rue. Ils furent attirés par un autre groupe de jeunes gens, deux garçons et deux filles ; il ne leur fallut qu’un regard pour comprendre que ceux-là n’étaient pas du quartier. Ils avaient cet instinct animal qui leur permettait de sentir la différence – et la peur – comme on renifle un effluve. La méthode était classique et Branwal la connaissait par cœur. Il y avait plus ou moins participé, une ou deux fois : il fallait se montrer cynique et impitoyable si vous ne vouliez pas devenir à votre tour souffre-douleur, le dernier maillon d’une chaine alimentaire infernale.
Le groupe des « étrangers » était composé d’enfants de commerçants de la Ville Basse. Ils habitaient non loin, par-delà la place, et s’ils n’allaient jamais dans le cœur du quartier des fourchons, il leur arrivait de fréquenter la rue des balayeurs, qui n’était qu’à quelques pas de la grand-place. L’un des fourchons, si long et si maigre qu’on aurait dit une branche d’arbre, leur lança quelques mots agressifs. Branwal n’entendit pas la conversation, mais elle n’avait vraisemblablement aucun intérêt puisqu’elle n’était qu’un prétexte à l’agression. Il réclamait sans doute quelque chose sans importance – un renseignement peut-être – que les jeunes gens ne pouvaient lui fournir. La branche s’agitait sous l’effet de sa propre colère et frustration et ses compagnons, décontractés et sûrs d’eux, regardaient le spectacle avec une certaine hilarité. La situation ne tarda pas à dégénérer : l’échalas gifla l’un des deux garçons à la première occasion. Il aurait voulu susciter la jalousie, être puissant, admiré, désiré, mais chaque jour qui passait lui rappelait qu’il n’était qu’un minable fourchon parmi d’autres, sans originalité ni avenir. À ses yeux, ces jeunes « autres » n’avaient plus d’existence propre, ils étaient réduits à être les représentants de cette organisation humaine qui l’humiliait chaque jour et qui l’avait rendu prisonnier de son propre corps. Il ne pensait plus qu’à se venger et à les humilier en retour : les femelles, évidemment, qui refusaient régulièrement ses avances insistantes, mais également les mâles qui, malgré leur manque patent de virilité, possédaient ce que lui n’aurait sans doute jamais et qu’il désirait tant. D’ailleurs, il n’avait pas frappé le jeune garçon du poing : il l’avait giflé, comme il aurait giflé une femme, pour l’humilier devant les filles.
Dans cette course à la domination et au pouvoir, la composante sexuelle était fondamentale et souvent vécue de manière inconsciente, tant par les dominants que par les dominés. Ainsi, quand un fourchon avait un aïeul « d’en face », c’était tout le temps une grand-mère ou une arrière-grandmère, jamais un grand-père. Pourquoi ? Parce que jamais ces fourchons n’auraient admis qu’une de leurs femelles se soit fait trousser par un mâle concurrent. En revanche, ils devisaient avec plaisir de leur fourchon de grand-père qui était parvenu à baiser l’une d’en face, ce qui prouvait, aux autres et à euxmêmes, la haute virilité de la lignée mâle dont ils étaient issus.
À l’inverse, chez les riches commerçants, il ne pouvait guère y avoir de plus grande infortune qu’un enfant s’amourachant d’un de ces sales fourchons, fût-il un brave gars ou une brave fille. C’était particulièrement vrai pour ces dernières qui, lorsqu’elles étaient belles et richement dotées, pouvaient espérer un mariage avec un noble sans le sou, ouvrant alors les portes de la Ville Haute à la famille. Aussi, les femmes des riches commerçants consacraient leur vie à organiser des rencontres « fortuites » entre leur tendron et les nobles de tous âges qui venaient dépenser leur or dans la Ville Basse. Et dès que l’occasion se présentait, elles n’hésitaient pas à pousser leurs filles à se déniaiser.
Branwal observait la situation du coin de l’œil : les pauvres gamins « d’en face », terrifiés, n’osaient plus bouger. La rue était peu fréquentée à cette heure et les rares passants baissaient le regard et accéléraient le pas. L’agresseur, incontrôlable, semblait prêt à sortir un poignard de sa chemise d’un moment à l’autre et transpercer les deux couples en plein jour. Branwal secoua la tête. Il connaissait le mécanisme – il avait connu les deux côtés de la barrière. Les jeunes gens de bonne famille, traumatisés par leur expérience, trouveraient à l’avenir une satisfaction certaine à chacune des interventions violentes de la Garde Royale dans le quartier. Les gardes allaient rarement plus loin que la rue des balayeurs, mais le cas échéant, ils ne faisaient pas le voyage pour rien. Ils ressortaient le panier à salade plein de corps meurtris ou sans vie. Ces derniers n’étaient pas forcément les plus à plaindre, car les survivants finissaient tués par le travail forcé. Ces interventions violentes et aveugles ne pouvaient qu’être injustes et étaient ressenties comme telles par les fourchons. L’humiliation brûlait alors les ponts avec le monde d’en face et réclamait vengeance. Le cercle infernal était ainsi bouclé.
Branwal soupira et secoua la tête.
Il avait pourtant rencontré des gens de bonne volonté, de braves gens, partout où il avait vécu, et malgré son jeune âge, rares étaient ceux qui pouvaient vanter une expérience du monde égale à la sienne. Alors, comment était-ce possible ? Comment pouvait-on en arriver là, si tant de gens de bonne volonté existaient ? Sans doute parce que même chez ces gens, il existait un ressentiment prêt à jaillir de sa boite dans certaines circonstances.
Cette réflexion lui arracha une esquisse de sourire qui s’évanouit aussitôt. Le groupe de fourchons, branche en tête, continuait de s’amuser avec les jeunes gens « d’en face ». Il ne savait pas comment cela allait se finir, mais n’avait pas envie de le savoir. Il se leva, mit sa couverte puante sur le dos et tourna les talons. Aussitôt, il entendit derrière lui :
— Hé, où tu cours le clodo ?
— Il pue d’ici.
Il continua de marcher en feignant de ne rien entendre.
— Hé, on te parle !
Le gars qui l’avait interpellé était toujours le même. Il l’avait rattrapé en quelques pas et s’était planté devant lui. Branwal, qui se tenait voûté, dut lever la tête, car son adversaire était plus grand que lui. Rapidement, il fut encerclé par les autres membres du groupe. Ces derniers se doutaient bien que leur proie ne possédait rien de valeur, mais ils ne cherchaient pas à voler ou à s’enrichir.
Le mendiant avait commis une erreur de débutant, une erreur qu’il avait déjà vu commettre par de jeunes biens nés, dont il s’était alors moqué : il avait donné l’impression qu’il fuyait, donc qu’il avait peur. Face à de tels animaux, il fallait être capable de les fixer sans sourciller – le moindre regard fuyant et vous étiez perdu – et dans le même temps n’avoir aucune agressivité, sauf à vouloir vous retrouver dans une bataille de pugilat à dix contre un, à supposer qu’aucun des dix ne fût muni d’un poignard…
Lui qui était un natif du quartier, qui avait grandi à Melangell et avait été traité de fourchon plus souvent qu’à son tour – non sans en retirer une certaine fierté, il se retrouvait à présent dans la position de n’importe quel étranger. Même quand il n’avait été qu’un gamin au visage crasseux et au ventre vide, il se savait appartenir à un petit monde – le quartier des fourchons – dont il connaissait les moindres recoins, les dangers et les visages familiers. Puis il avait été déraciné et replanté ailleurs, dans un univers complètement différent, avec une école et un maître. Il s’était adapté, tant bien que mal, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau arraché et déraciné, pour des raisons qui lui échappaient encore.
L’évidence lui apparut alors au grand jour : où qu’il allât, il n’était qu’un étranger. Où qu’il regardât, il ne voyait que de l’absence.
Épine
Il avait soutenu leur regard, sans peur ni agressivité, et avait feint de ne pas comprendre la situation : il avait pris quelques coups de pied et quelques crachats, puis les jeunes coqs avaient fini par aller ergoter ailleurs. Peu avant, alors qu’ils agressaient minablement les autres adolescents de bonne famille, le mal s’était éveillé en Arwylo, la masse noire s’était agitée au creux de son ventre. Cela faisait plusieurs jours qu’il n’avait pas eu de « crise », mais les réveils pouvaient être violents.
Il avait lutté pour contenir l’explosion. Outre que ce fut plus sage, il savait ne pas pouvoir l’emporter sur les fourchons. Ils étaient nombreux, une petite dizaine, l’encerclaient et savaient sans doute se battre. Il suffisait que l’un d’entre eux ait un poignard pour qu’il finisse vidé de son sang sur le pavé de la rue des balayeurs.
Il portait à présent un regard plus lucide sur sa capacité à se battre lorsqu’il était possédé, car sa rage l’avait déjà poussé à sous-estimer son adversaire : avec le coup de poignard du mercenaire, à Teilan, il avait cru voir sa mort arriver. Il l’aurait sans doute croisée sans l’intervention providentielle des villageois en colère. Mais plus que tout, il redoutait la Garde Royale. Sa crainte prenait naissance dans son enfance dans le quartier et était devenue quasi instinctive, comme une proie craignant son prédateur naturel. S’il venait à être capturé, Aergat seul savait où et comment il finirait – la mine, la galère, la torture. Une mort rapide, même douloureuse, était préférable.
Il s’était enfoncé dans le quartier des fourchons avant d’être pris de légers spasmes. Le sang avait coulé de son nez. Lorsqu’il regarda autour de lui, la rue lui rappela des souvenirs lointains et imprécis : sans être une ruelle, elle était néanmoins étroite et bordée de vieilles maisons dont la charpente de bois ployait sous le poids des ans. Les couleurs avaient pourtant été vives à une époque – le vert, le jaune, le bleu, l’ocre – mais il n’en restait que des teintes de gris et des peintures écaillées.
Il s’était de nouveau assis sous un porche. Il mourait de faim et risquait fort de passer une nuit de plus dans la rue. Il aurait pu demander de l’aide, mais ce repli sur soi apparaissait comme la juste conséquence de son espoir déçu. S’il n’était pas allé jusqu’à imaginer un retour en grande pompe, il avait espéré un accueil chaleureux ; il avait espéré retrouver le statut qu’il méritait ; il avait espéré retrouver ses pouvoirs latents. Rien de tout cela n’arriverait, car il n’était plus rien : ni à Teilan, ni dans le quartier des fourchons, ni dans sa défunte école. Il n’avait plus d’existence.
Il regardait les passants. Les pantalons, qu’ils furent marron, verts, ocre, étaient rapiécés ; les chemises grossièrement taillées. Les vestes aussi, mais elles étaient assez épaisses pour tenir chaud en ce début d’hiver. Chacun des badauds semblait avoir un but, une destination. Personne ne flânait ni ne profitait de l’éclaircie. Il entendait des bruits de sabots sur le pavé de la rue d’à côté, les cris d’un homme appelant son commis, un seau d’eau jeté depuis une fenêtre. La vie procédait sur le même rythme invariable.
La bête était là, tapie dans l’ombre de ses pensées. Elle attendait son heure, implacable. Pourtant, elle ne décidait rien. Arwylo ne le savait pas encore ; il ne le réaliserait que des années plus tard, sur un navire en route pour le Sud Profond. Elle profitait de ses pulsions, de ses révoltes, mais elle n’avait en définitive aucun pouvoir : ce que l’esprit décidait, elle ne pouvait que l’accepter. Heureusement pour les démons qui rampaient dans le cœur de chacun, rares étaient ceux qui domptaient la force de leur esprit. Au contraire, ils étaient légions ceux qui se croyaient forts, mais croulaient une vie durant sous le poids de leurs émotions : la vanité et la colère étaient sans doute les portes d’entrée les plus larges et les plus sûres. Face au néant, au vide infini de l’existence et à la terreur qu’il suscitait, la bête se savait être une solution, même inconsciente. Il fallait à tout prix, coûte que coûte, remplir ce vide : la colère et la destruction, le pouvoir et la richesse étaient autant de réponses immédiates et lacunaires, et pourtant indispensables lorsque l’esprit était englouti par les vagues qu’il avait lui-même créées.
Les jours s’écoulaient lentement ; les décades rapidement. Comme le commun des mortels, il put à loisir goûter à cet amer paradoxe. Il se retrouva à vagabonder dans les quartiers pauvres : sur les quais du port fluvial, il pourrait trouver un peu de travail en tant que journalier. Il fit en sorte de se laver et de chasser l’odeur qui le poursuivait comme son ombre avant de se présenter. La besogne était rude et au début certains marchands refusèrent de l’embaucher, car bien qu’assez grand, ils l’estimaient trop frêle. Puis, peu à peu, il devint un membre à part entière de l’armée de réservistes sans le sou qui venait quotidiennement frapper à la porte des riches commerçants – lorsque les navires se faisaient plus rares, le travail l’était aussi. Toutefois, grâce à sa maigre rétribution, il recommença à manger normalement. Il dormait, clandestinement, dans les entrepôts ou dans les écuries, comme il l’avait déjà fait auparavant.
Puis survint sa première « crise ». Personne n’était au courant, mais il ne pouvait pas cacher éternellement ses symptômes, d’autant moins qu’ils surgissaient souvent de manière erratique et violente. Certains ordres qu’on lui aboyait à la figure lui passaient au-dessus de la tête ; d’autres allumaient en lui les pires feux de l’enfer. Dans ces cas-là, il prétextait un malaise, un mal de ventre et s’absentait un moment. Son comportement devint suspect et des rumeurs commencèrent à circuler parmi les coltineurs et les déchargeurs qui, comme les marins, étaient particulièrement superstitieux. Il n’en fallut pas beaucoup plus pour que certains d’entre eux refusent de travailler avec lui et pour qu’il retrouve les ponts et les chaussées d’Anghewyr.
Au début, il volait. Il n’était pas particulièrement doué et ne faisait pas preuve d’une grande habileté ni d’une belle imagination, mais en grandissant dans le quartier des fourchons, il était allé à bonne école. De temps en temps, il se sentait défait et se résignait à tendre la main. Il n’était pas habitué à mendier ; son orgueil n’aimait pas ça. Ce qu’il détestait par-dessus tout, c’était l’expression satisfaite des bigots qui, pour quelques piécettes de cuivre jetées d’un geste auguste et ostensible, soulageaient leur conscience comme ils soulageaient leur vessie. Quand il se faisait cette réflexion, il sentait s’agiter le magma noir : celui-ci aurait voulu exploser, posséder son hôte et se délecter d’exister jusqu’à s’abreuver de sang. Mais comme Arwylo ne mangeait presque rien, il était épuisé du matin au soir et lorsqu’il faisait un vrai repas, son corps ne pouvait plus le digérer correctement et le faisait souffrir une nuit durant.
Par ailleurs, les autres mendiants de la cité ne lui avaient pas réservé un accueil bienveillant, car la concurrence était rude. Le peu que l’autre avait, on cherchait à le lui prendre. Aussi, son seul compagnon d’errance, celui qui ne le quittait jamais, demeurait le néant insondable. Il n’osait pas, il valait mieux ne pas le regarder. La dernière fois qu’il l’avait fait, au sommet de cette cascade, il l’avait tout entier enveloppé d’un voile de mort. Il se refusait, pour l’instant, à remplir le vide de cette énergie noire, mais la tentation était immense.
Ce jour-là, Arwylo était assis sous un pont. Sa couverture puante sur le dos, il se leva péniblement et erra, le pas court et incertain, dans les rues du faubourg ouest, le quartier des fourchons. Certaines rues, maisons ou enseignes lui rappelaient des souvenirs, toujours flous et confus. Il traina ses guêtres une partie de la matinée, sans but apparent, et finit par s’arrêter à hauteur des portes d’une large bâtisse, en partie délabrée. Le heurtoir circulaire, fait de métal noir, attira son attention. Il était très ordinaire et lissé par les nombreuses mains qui l’avaient actionné. Arwylo le reconnut immédiatement. Mécaniquement, il tendit le bras : dès l’instant où il frappa à la porte, il regretta son geste.
L’attente fut courte. Une jeune femme vint lui ouvrir. Elle portait un chemisier blanc lacé jusqu’au cou et un fichu sur la tête tenant ses cheveux bruns. Elle s’essuya les mains sur le tablier blanc qui protégeait la robe gris-noir qui lui tombait jusqu’aux pieds. Elle devait être occupée en cuisine.
Quelle heure est-il ? se demanda Arwylo. Il leva les yeux pour voir la position du soleil dans le ciel. On était peu avant midi, le déjeuner n’était pas loin.
— Oui, c’est pour quoi ? demanda la jeune femme en finissant de s’essuyer les mains.
Elle vit tout de suite qu’elle n’avait pas affaire à un commis ou à un commerçant et sembla un peu gênée, ce qu’Arwylo mit sur le compte de son odeur. Elle se reprit aussitôt :
— Vous voulez manger ?
Arwylo n’osa rien dire et fit « non » de la tête.
— Bougez pas, je vais vous chercher quelque chose, insistat-elle.
Elle revint peu après avec un bout de pain plongé dans une écuelle de gruau et tendit le tout. Le premier réflexe d’Arwylo fut de refuser, mais à la vue de la nourriture son estomac prit le dessus sur son orgueil et il s’empara du précieux trésor.
— Vous pouvez laisser l’écuelle devant la porte quand vous aurez term… (La jeune femme s’interrompit en voyant le mendiant engloutir le gruau.) Ou bien je peux finir ma phrase et reprendre l’écuelle.
En avalant autant de nourriture aussi vite, ses tripes le feraient souffrir et il finirait accroupi une partie de la nuit, mais il n’avait pas pu résister. Arwylo la remercia d’un hochement de tête et tendit l’écuelle vide. Il resta planté devant elle ; il n’avait toujours pas prononcé un mot. La jeune femme proposa, hésitante :
— Vous en voulez une autre ?
Elle revint peu après avec une nouvelle écuelle de gruau et un nouveau bout de pain. Comme la première fois, Arwylo hésita avant de s’en saisir, mais pour une autre raison. Il la regarda dans les yeux et la remercia. La jeune femme déglutit sans mot dire.
— Cordilia ? demanda le mendiant.
— Finissez votre écuelle, je vais vous la chercher.
Arwylo la remercia et se mit à manger sur un rythme plus raisonnable. La jeune femme disparut derrière la double porte en bois délabré. Elle traversa le couloir d’un pas rapide, en passant devant le cellier, la cuisine, le petit réfectoire, et arriva sur la cour intérieure. Une petite femme voûtée coupait du bois à l’aide d’une hachette.
— Laissez donc, dit la jeune femme, je demanderai à mon frère de s’en occuper lorsqu’il passera.
— Oh, vous savez, je peux le faire, répondit Cordilia en s’essuyant le front.
Elle avait les cheveux grisonnants et les traits tirés. Sans pour autant être d’une nature fragile, elle donnait l’impression d’avoir une santé précaire.
— Il y a un jeune mendiant à la porte. (La jeune femme hésita.) Je lui ai servi une écuelle de gruau. Deux, en fait, ajoutat-elle gênée.
— Modwenna, nous avons déjà beaucoup à faire avec les orphelins, répondit Cordilia en plantant sa hachette sur une bûche. On ne peut pas nourrir en plus tous les mendiants de la cité.
— Je sais, je suis désolée, s’excusa la jeune femme.
En voyant son désarroi, Cordilia posa une main apaisante sur son bras :
— Ne t’excuse pas, tu as bien fait, répondit-elle compatissante.
— C’est que… évidemment, il est sale et sent mauvais, mais… il est vraiment jeune… il doit avoir vingt ans à peine…
Sa gorge serrée l’obligea à s’interrompre. Elle se mordit la lèvre et ajouta :
— Et il est maigre… (Des larmes commencèrent à rouler sur ses joues.) Cordilia, je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi maigre…
Elle mit la main sur sa bouche, ferma les yeux et se laissa aller à un sanglot.
— Allons, Modwenna, il ne faut pas vous mettre dans des états pareils, répondit Cordilia en prenant la jeune femme dans ses bras.
Elle lui tapota le dos et la consola jusqu’à ce que ses larmes cessent.
— Je suis désolée, reprit Modwenna, je ne devrais pas faire autant de sensiblerie.
— La compassion est une qualité, pas un défaut.
La jeune femme hocha la tête en essuyant ses larmes. Elle poussa un soupir décrétant la fin de son effusion.
— Il vous a demandé. Je pense que c’est un ancien de l’orphelinat.
— Je vois. Peut-être est-ce aussi cela qui t’a bouleversée.
Cordilia prit Modwenna par le bras, comme si elle la prenait sous son aile, et ensemble elles traversèrent l’orphelinat jusqu’à la double porte d’entrée. Le jeune mendiant n’avait pas bougé : il attendait, les yeux baissés, l’écuelle vide entre les mains. Il la tendit et remercia d’un petit signe de la tête. Cordilia l’observa : il lui rappelait en effet l’un des jeunes orphelins qu’elle avait recueillis, mais elle en avait vu passer tellement qu’elle ne pouvait se souvenir de tous les visages ni de tous les prénoms. Celui-là avait une vingtaine d’années, autrement dit l’eau avait coulé sous les ponts depuis son départ de Melangell.
— Nous nous connaissons, n’est-ce pas ? demanda-t-elle. Rappelle-moi ton prénom.
Le jeune mendiant ouvrit la bouche, mais se ravisa. Pourquoi avait-il ouvert cette porte ?
Sans doute parce que je crevais de faim… et d’indifférence.