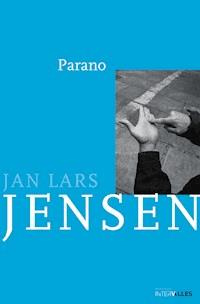
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions Intervalles
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
La descente aux enfers d'un auteur
Unique au plan clinique et littéraire,
Parano raconte la plongée subite dans la folie d’un écrivain à l’approche de la sortie de son précédent livre aux États-Unis. Avec l’humour, la distance, la clairvoyance d’un homme totalement « guéri », et comme revenu d’un autre monde. À lire avec précaution.
Un livre d'une grande force, marqué par les indices autobiographiques
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
- "Ce voyage au bout de la folie, raconté avec beaucoup de talent, est un document unique"
(Magazine Psychologies)
- "Jan Lars jensen décrit sa descente aux enfers avec une sincérité saisissante... parvenant, avec les mots justes, à captiver son lecteur et à le plonger dans le délire et la folie."
(Aurélie Sarrot, Metro)
EXTRAIT
Allongé dans mon lit, j’attendais mon tueur. Je ne doutais pas qu’il viendrait durant la nuit mais fus déconcerté par la manière dont il choisit de révéler sa présence.
« Elle descend de la montagne à cheval... » Debout dehors, il chantait, sans se montrer, et je l’écoutai répéter ce refrain à maintes et maintes reprises.
« Elle descend de la montagne à... »
De sa part, le chant me parut un choix pervers, une cruelle plaisanterie. Peut-être, pour se préparer à cet instant, avait-il bu. Peut-être avaitil besoin d’être ivre pour accomplir son travail. Ou bien il ne savait pas dans quelle chambre je me trouvais. Oui, ce devait être cela. Il voulait que je me mette à la fenêtre. C’était ce qu’il avait trouvé pour que je montre mon visage et qu’il sache où tirer, dans quelle pièce faire irruption.
Il voulait que je le contemple, là, dehors, en train de chantonner.
« Elle descend de la... »
J’attendis. La gorge sèche.
La chanson cessa.
Qu’est-ce que ça voulait dire ? Était-il entré ?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Je dédie ce livre à ma femme Michelle et à Michael Kandel, deux êtres au-dessus du lot.
Certains noms et caractéristiques ont été changés.
Certains dialogues ont été reconstruits d’après des périodes
de trouble, et sont à considérer comme pure fiction.
L’ordre de certains événements pendant lesquels
j’étais en proie à des hallucinations peut être incorrect.
Demeurent beaucoup d’erreurs factuelles. Si un épisode paraît démesurément
dramatique ou pauvrement décrit, si mes choix de mots semblent à côté de la plaque,
il ne faut probablement voir là que
les effets secondaires d’une lourde médication.
À lire avec précaution.
PREMIÈRE PARTIE
La chansonnette du tireur d’élite
NUIT N° 2
ALLONGÉ DANS MON LIT, j’attendais mon tueur. Je ne doutais pas qu’il viendrait durant la nuit mais fus déconcerté par la manière dont il choisit de révéler sa présence.
« Elle descend de la montagne à cheval… » Debout dehors, il chantait, sans se montrer, et je l’écoutai répéter ce refrain à maintes et maintes reprises.
« Elle descend de la montagne à… »
De sa part, le chant me parut un choix pervers, une cruelle plaisanterie. Peut-être, pour se préparer à cet instant, avait-il bu. Peut-être avait-il besoin d’être ivre pour accomplir son travail. Ou bien il ne savait pas dans quelle chambre je me trouvais. Oui, ce devait être cela. Il voulait que je me mette à la fenêtre. C’était ce qu’il avait trouvé pour que je montre mon visage et qu’il sache où tirer, dans quelle pièce faire irruption.
Il voulait que je le contemple, là, dehors, en train de chantonner.
« Elle descend de la… »
J’attendis. La gorge sèche.
La chanson cessa.
Qu’est-ce que ça voulait dire ? Était-il entré ?
Une pensée terrible me traversa. S’il allait choisir la mauvaise chambre ? Si, dans le projet de m’abattre, il allait se tromper et tuer quelqu’un d’autre ? Sous les draps, c’est difficile de distinguer un homme d’un autre. Et si, dans ses efforts pour me trouver, il allait tuer plusieurs innocents ?
Je me levai et sortis de ma chambre. Le couloir était désert. Je m’en assurai en regardant dans les deux directions puis, résolument, marchai jusqu’au cube de verre qui brillait au bout du couloir. Une femme en blanc y était assise et, sans perdre de temps, je me penchai pour lui parler à travers l’hygiaphone.
– Il y a quelqu’un dehors qui va entrer, dis-je. Il va essayer de me tuer.
L’infirmière me regarda.
– Comment savez-vous qu’il y quelqu’un dehors qui veut vous tuer ?
– Je l’ai entendu, dis-je, chanter.
– Hé ! L’touriste ! – Un autre patient s’était approché, très maigre, avec une crête de cheveux bouffants décolorés. – Touriste ! Mais non, c’était moi ! J’étais dans la salle des fumeurs. J’ai chanté.
La salle des fumeurs était de l’autre côté de la cloison de ma chambre.
– C’est cela ! dis-je.
– Mais si, mon p’tit touriste, je te l’ jure, c’est moi que t’as entendu !
Je me tournai vers l’infirmière.
– Je vais me mettre là, de manière à ce qu’il puisse viser facilement.
L’infirmière soupira.
– Très bien.
Le jeune homme maigre me regarda marcher jusqu’au milieu du couloir et m’asseoir par terre, dos au mur.
Pour la sécurité des autres malades et du personnel soignant, c’était le meilleur endroit où je pouvais me mettre. On me voyait d’assez loin et, quel que soit le côté par lequel mon tueur apparaîtrait, il pourrait m’abattre, en minimisant le risque qu’une balle traverse la cloison et aille se loger dans une autre chambre. Je m’assis et attendis. Je ne pouvais mieux faire.
Une patiente sortit de sa chambre et se rendit en traînant les pieds jusqu’au poste des infirmières. Elle passa devant moi sans me regarder. Ses pantoufles ne quittaient pas le sol tandis qu’elle se déplaçait – avec une lenteur… Vite ! Ôtez-vous de là ! Et si l’assassin arrivait maintenant ? À l’hygiaphone, la femme dit « … n’arrête pas de vrombir et de vrombir et ne s’éteint pas… ». La tête tournée tantôt à gauche, tantôt à droite, afin de surveiller les deux côtés du couloir, je rongeai mon frein en l’adjurant intérieurement de partir. Enfin, elle fut reconduite à sa chambre où elle consentit à entrer, parlant toujours. Une infirmière se dirigea vers la sortie de secours.
Je criai :
– S’il vous plaît, n’approchez pas de cette porte !
L’infirmière revint vers moi.
– Je vérifiais que le pavillon était bien fermé. Et c’est bien le cas. Les accès sont fermés.
– Vous m’obligeriez, dis-je, en ne vous approchant pas des issues !
– Vous êtes assis ici depuis près de deux heures, répondit-elle. Personne n’est venu, personne ne viendra. Si vous nous laissiez un peu tranquilles et retourniez gentiment dans votre chambre ?
À contrecœur je me levai et fis comme il m’était demandé.
Ma chambre était petite. Dans une pièce de telles dimensions, très peu meublée, les possibilités n’étaient pas nombreuses. Le plancher peut-être.
Je m’allongeai sur le carrelage, les pieds sous la fenêtre, le visage dans la lumière du lampadaire. De cette façon, lorsque le tireur arriverait à la fenêtre, il verrait tout de suite que c’était moi et le tir serait des plus faciles.
ADMISSION
AINSI S’ÉTAIT DÉROULÉE ma deuxième nuit à l’hôpital. J’étais arrivé la veille en me disant : Et voilà, je vais enfin savoir ce que c’est que d’avoir droit à un lavage d’estomac.
Ayant facilement des haut-le-cœur, j’avais toujours redouté d’avoir à subir cette intervention. Petit, j’en avais eu la description – on vous descend un tube dans la gorge, relié à une machine qui, avec un bruit de moteur, aspire le contenu de votre estomac, remplit un sachet dont tout le monde peut admirer le contenu – et j’avais toujours pris soin de ne pas avaler des clés, une boîte d’allumettes ou tout autre petit truc nécessitant ce traitement. Mais là, c’était différent. C’était une nuit à part, pour la Terre, pour l’ensemble de l’humanité, une nuit historique, la fin du monde en un mot, et j’étais prêt à subir les désagréments, souffrances et humiliations qui allaient de pair. C’était bien normal puisque tout était ma faute.
Le mari de ma collègue de travail, Klaus, m’avait conduit à l’hôpital. En dépit du fait que nous nous connaissions à peine, il m’avait brièvement embrassé avant de me remettre entre les mains des infirmières aux urgences. J’admettais avoir avalé une vingtaine de somnifères. Ma femme Michelle était en larmes. Comment était-elle déjà là ? Ne l’ayant pas vue arriver, sa présence me surprenait. Je ne savais pas non plus comment interpréter ses larmes. On me confia très vite à un médecin à qui, de mon mieux, j’expliquai mon acte. Il paraissait avoir autre chose à faire mais m’accorda toute son attention.
Et il devait mieux connaître que moi les médicaments que j’avais avalés car il ne me prescrivit pas de lavage d’estomac, seulement un fauteuil roulant. De fait, je me sentais plutôt dans le coton.
Une grande partie de l’hôpital, les urgences et les couloirs qui y menaient, endroits que je connaissais pour m’être foulé la cheville et être venu voir des proches, obéissaient à un code couleur vert et rose que j’avais toujours associé à l’Exposition universelle de 1986 et aux travaux de rénovation auxquels elle avait donné lieu. Un peu comme les coupes éparses sur des tables après un réveillon, ces couleurs étaient restées dans beaucoup de lieux publics, mais, au fur et à mesure que mon fauteuil était roulé dans les couloirs, en même temps que l’écho des urgences, le vert et le rose s’effaçaient. J’étais arrivé dans une aile plus ancienne, marquée par des portes coupe-feu orange et une vitre donnant dans un bureau.
Il en sortit une infimière tenant un écritoire à pince. Elle voulut savoir si j’avais toujours envie de me suicider.
– Non, répondis-je.
– Pourquoi avez-vous fait cette tentative ?
– Je suis écrivain, dis-je, et j’ai provoqué la fin du monde.
– Oh, vraiment ? s’exclama-t-elle l’air ravi, comme si ma déclaration était le genre de propos qui justifiait sa vocation pour cette branche de la médecine.
« On a beaucoup de patients de même type, expliqua-t-elle, des récidivistes. Vous, ça a l’air un tout petit peu moins banal. »
– Si au moins je peux rompre votre routine…
En me disant quelque chose qui se voulait rassurant, Michelle m’embrassa et partit. Les portes s’ouvrirent, l’infirmière me roula à l’intérieur. Longtemps auparavant, j’étais déjà venu en visite, mais à cet instant je n’en avais aucun souvenir.
Je ne présentai aucune résistance. Étant là où je devais être, j’acceptais d’avance tout ce qui pouvait survenir. Il faisait d’ailleurs, me semblait-il, de plus en plus sombre. Au bout d’un unique couloir qui partait du lieu d’admission, je fus roulé dans une chambre à deux lits.
– Voilà, dit l’infirmière, une seule chose à faire maintenant : se reposer. Voulez-vous retirer votre blouson ? Elle m’aida à le faire et je m’affalai sur le lit.
« C’est cela, couchez-vous. »
Il n’y avait rien d’autre à faire, en effet. Lorsqu’elle accrocha mon blouson dans la penderie, j’étais certainement déjà en plein sommeil.
ON SAIT QU’IL S’EST PASSÉ QUELQUE CHOSE dans sa vie quand on se réveille dans un hôpital psychiatrique. Il y a l’avant et l’après cet instant. Ce qui me concernait serait désormais rapporté à cette aune.
La chambre était claire. L’autre lit vide. Allongé tout habillé, je me demandais quoi faire.
– Allez, debout les braves, Jan !
Nouvelle infirmière. Brune à cheveux courts. Ou était-ce une femme de ménage ? Non, non, elle portait un uniforme vert pâle. C’était bien une infirmière.
– Allez, Jan, c’est l’heure de se lever.
Nous n’avions même pas été présentés. Je me laissai tomber du lit et titubai derrière elle. Le sol brillait, la fenêtre laissait passer des flots de lumière. Elle me précédait, se retournant de temps à autre.
– Vous allez prendre votre petit déjeuner. Par ici, Jan, venez.
Je la suivis le long du couloir, passant devant des portes de chambres puis des douches. Dans une buanderie, des étagères métalliques contenaient des piles de serviettes de bain. Puis la pièce principale. Les doubles portes franchies la veille étaient dans l’angle opposé, à côté du poste vitré. Plusieurs autres infirmières s’y tenaient, surveillant ainsi l’entrée, la pièce commune et le couloir desservant les chambres. Il y avait des bruits de chaises, de couverts, mais pour la plupart, les patients avaient déjà pris leur petit déjeuner. Une télévision était allumée. La pièce commune avait de nombreuses fenêtres et, sans avoir la notion de l’heure, je pensais qu’on était encore le matin.
– Tenez, mettez-vous donc là.
Elle posa devant moi un objet épais en plastique dont elle souleva le couvercle. Mon petit déjeuner.
– Que voulez-vous sur vos tartines ? Du beurre de cacahuète ? De la confiture, ou du miel ?
Je n’en savais rien.
– Le jus d’orange et le lait sont là, dit-elle.
J’entendis la porte d’un réfrigérateur. Elle rapportait un verre de jus de fruit. Franchement, elle devait avoir mieux à faire. Le système de santé tirait le diable par la queue, c’est du moins ce que j’avais cru comprendre.
Resté seul, je grignotai un morceau de toast en évitant de regarder du côté des autres malades. À ma droite, des gens travaillaient dans le bureau vitré, toutes des infirmières en uniforme blanc. Je n’avais pas l’impression d’être surveillé. Après avoir mangé un peu, je déposai mon plateau sur une table roulante.
Ce service était dans la partie la plus ancienne de l’hôpital. Le code couleur de l’Expo 86 n’en franchissait pas le seuil. Il était construit en briques, avait un sol carrelé, des tapis marron. L’heure était indiquée par deux grandes horloges. Des plantes vertes flanquaient les deux autres portes. Dehors, on voyait une allée de ciment et une cour fermée. J’étais souvent passé en voiture le long de cette enceinte mais n’y avais jamais prêté attention. Comment la pièce était-elle orientée ? Je n’aurais pas pu dire dans quelle direction étaient les urgences.
La porte donnait dans une pièce que je n’avais pas remarquée et dont sortit un homme de grande taille, en costume. Il vint poser sa main sur mon épaule.
– Voulez-vous bien me suivre ?
Je le suivis jusqu’à un petit cabinet aménagé dans un coin de l’espace vitré, dissimulé aux regards par des rideaux de polyester bleus. Il s’assit devant moi et se présenta.
– Je suis le docteur Brophy. Vous êtes Jan. C’est un prénom hollandais ?
– Danois.
– Parlons des raisons de votre présence ici. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là ?
– J’ai fait une tentative de suicide.
– Pourquoi avez-vous fait cela ?
Je restai silencieux.
– Vous avez dit à l’infirmière que vous pensiez avoir causé la fin du monde.
Je secouai la tête.
– Vous ne voulez pas en parler ?
– Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de vous le dire.
– Tout ce que vous direz ici conservera la plus stricte confidentialité, je vous le promets.
Je me frottai le front.
– Vous pourriez répéter votre nom de famille ?
Il le répéta.
– Brophy.
– Brophy…, dis-je. J’étais en classe avec un Brophy… Mark Brophy.
– C’est mon neveu.
– Qu’est-ce qu’il devient ?
– Il s’est installé à Winnipeg. Il est devenu physiothérapeute. Il est marié, il a deux enfants.
– Ah, bien !
À l’école primaire, son neveu et moi avions passé plusieurs années ensemble et il m’avait frappé comme quelqu’un de très marqué par son éducation chrétienne. En allait-il de même pour son oncle ? Quelque chose dans sa coupe de cheveux et son costume suggérait que oui. La couleur de sa cravate aussi. Plus tard, je trouverais étrange qu’un chrétien pratiquant choisisse le métier de psychiatre. Mon idée de ces deux systèmes étant qu’en théorie et dans la pratique, ils ne pouvaient qu’entrer en conflit. Mais, ce matin-là, j’essayai plutôt de deviner jusqu’à quel point il pourrait encaisser mes confidences et si je pouvais lui raconter comment, athée au départ, j’en étais arrivé à trouver sur le papier les preuves mathématiques de l’existence de Dieu et que j’étais l’agent de sa réincarnation en Shiva.
Je déclarai :
– Vous êtes croyant.
– Oui.
– Vous est-il jamais venu à l’esprit que toutes les religions, l’hindouisme, le christianisme, l’islam, étaient des composantes d’une seule et même chose ? Que toutes touchent à la même vérité ? Qu’elles sont peut-être des manières différentes de décrire un grand esprit cosmique dont nous participerions tous ?
– Euh…, dit-il, je suppose qu’il y a plusieurs niveaux de religion.
– Mais formant un tout.
– Mais quel est le rapport avec vous ?
Le rapport était un livre. J’essayai d’expliquer la chaîne d’événements qu’il allait déclencher et qui culminerait avec la fin du monde.
– Vous avez dit votre livre ?
– Oui.
– Un roman ?
– Oui.
– Mais comment les gens vont-ils avoir connaissance de ce livre ?
– Il sera publié par Harcourt Brace en avril.
– Oh, vous êtes sérieux ?
– Oui.
Il fronça les sourcils.
– Puis-je avoir une feuille de papier et un crayon ? demandai-je.
Avec un diagramme, tout serait clair. De nombreuses entités concouraient à la catastrophe que j’avais déclenchée – Harcourt Brace, la Russie, les États-Unis, l’éditeur du Writer’s Digest, le magazine des auteurs qui luttent pour se faire connaître, et l’Inde, bien sûr. J’encadrai leurs noms, les reliai avec des flèches et des mentions pour expliquer les interactions, l’enchaînement des faits. En bas du schéma, je m’inscrivis, moi et mon livre. Je pensais avoir prévu assez de place pour pouvoir tout noter mais dus écrire plus petit et terminai dans un coin de la page.
Ayant fini, je tendis la feuille au psychiatre. Je l’observai tandis qu’il la regardait. Allais-je devoir lui réexpliquer le cheminement des faits ? Devrais-je les expliquer en détail ?
Il leva un sourcil et me rendit mon schéma plus vite que je ne m’y attendais.
Ses mains se rejoignirent par le bout des doigts. Il mit un moment à formuler sa réponse.
– Ici, nous n’aimons pas beaucoup prédire ce qui va avoir ou ne pas avoir lieu dans le futur. Je ne sais pas si ce que vous avez décrit arrivera ou pas – je suis incapable de le dire. Mais ici, les gens qui arrivent vivent toutes sortes de situations et notre rôle est de les aider à mieux y faire face. À mieux appréhender leur existence et ses facteurs de stress.
Ce n’était pas le genre de réaction à laquelle je m’étais attendu. Je me tus, acquiesçai à tout. J’avais été trop loin dans les confidences.
NOTRE RENCONTRE TERMINÉE, sans la moindre indication de ce qu’on attendait de moi et n’ayant plus envie de parler, j’allai m’asseoir sur une chaise, réfléchir aux malades que je souhaitais éviter. La plupart étaient assis dans la grande pièce qui faisait office de salon. Plusieurs étaient des femmes d’un certain âge qui paraissaient tranquilles et sédentaires. Elles me semblaient tolérables. Aucun problème, aussi longtemps qu’elles ne m’adresseraient pas la parole. Mais l’une d’elles bavardait à tout rompre. Je jetai un coup d’œil par-dessus mon épaule lorsqu’elle aborda une infirmière.
– Alors, comment ça va aujourd’hui, Ruth ? demanda l’infirmière.
Ruth était en train de dire : « Peu importe que ce soit le jour ou la nuit, qu’il y ait de la circulation ou pas, qu’il y ait beaucoup de gens sur le passage clouté, il faudrait écrire aux autorités car c’est un réel, réel danger, j’ai vu des enfants traverser et ils n’attendent pas, ils sont impatients… »
Elle était haute comme trois pommes et ses cheveux gris lui tombaient dans les yeux. Vêtue d’un tablier et de pantoufles, elle traînait les pieds en marchant, à la recherche d’une occasion comme celle-ci : quelqu’un pour l’écouter. L’infirmière attendit la fin du flot de paroles.
– Ce n’est qu’une question de temps avant que quelqu’un se fasse renverser et je vais avoir cela sur la conscience parce que j’avais vu que ça allait arriver et que je n’ai rien fait et vraiment on devrait…
– D’accord, Ruth, mais il ne faut plus vous inquiéter pour cela maintenant. OK ? Si vous vous asseyiez et essayiez de vous détendre ?
L’infirmière partit vaquer à ses autres tâches. Ruth continua sa déambulation, parlant toujours. Toujours sur le même sujet, malgré le départ de son interlocutrice. Quelqu’un serait-il d’accord pour l’écouter ? J’étais content qu’elle se déplace lentement ; cela me donnait le temps de me lever et de changer de chaise lorsqu’elle s’approchait.
Puis j’entendis une voix connue. Regardant par-dessus mon épaule, je vis Michelle au poste des infirmières, à qui on indiquait où je me trouvais. Voir ma femme fut un choc. Je ne m’étais pas attendu à la revoir un jour. Elle m’étreignit et posa un sac de toile de nylon noir. On l’avait reçu en cadeau de mariage.
– Papa et maman t’embrassent. Ils pensent à toi.
– Oh, merci.
– Comment te sens-tu ?
– Beaucoup mieux, dis-je, vraiment beaucoup mieux. Je ne savais plus ce que je faisais, hier soir.
– Je suis contente que tu me dises ça. Tu as bien dormi ?
– Oui.
– Et par rapport à… tu en es où ?
– Je laisse faire. La situation n’est pas aussi grave que ce que je pensais.
– Ah, tant mieux.
– Non, franchement je pense que je vais bien.
– Je t’ai apporté quelques petites choses. Des vêtements surtout, ton peignoir, ta brosse à dents. De quoi écrire, si tu veux noter deux ou trois choses. Par contre, j’ai dû laisser ton rasoir électrique aux infimières.
Elle cherchait quelque chose dans le sac.
– Papa et maman t’ont fait porter cela.
Elle sortit un bocal à conserve rempli d’un sirop grenat. Je me frottai le front tandis qu’elle l’ouvrait.
– Je vais chercher un verre, dit-elle.
Je demeurai le regard fixé sur ce bocal et son lourd et odorant liquide. Michelle revint de la cuisine avec une tasse en polystyrène et j’eus soudain l’impression d’être vidé de mon sang. Je la regardai remplir la tasse.
– Tiens, dit-elle en me la tendant.
Je la pris, la plaçai avec précaution sur la table devant moi, observai la mousse à sa surface.
– Si ça peut te soulager, dis-je.
– Hein… ?
– Je t’en prie, dis-je en fermant les yeux, ne me demande pas ça.
– Qu’est-ce que tu as ? C’est du jus de raisin. Papa et maman ont pensé te…
– Je comprends que vous – toi et eux – vouliez faire cela. Je le comprends très bien mais, je t’en prie, je ne veux pas que ce soit toi. De grâce.
– Mais qu’est-ce que tu racontes, Jan ?
– Il vaut peut-être mieux me laisser en vie.
– Te laisser en vie ?
– Je… je peux être utile à l’avenir, au gouvernement. Comme monnaie d’échange. Je peux être amené à leur servir de monnaie d’échange…
– De monnaie d’échange ? Comment cela ?
Je regardai la tasse et son sirop rouge.
– Poison, dis-je.
Elle me regarda, la bouche ouverte.
– C’est du jus de raisin fait maison. Bois-en un peu.
Nous nous assîmes.
– Regarde, je vais en boire, dit-elle en allongeant la main vers la tasse.
– Non ! criai-je en lui attrapant l’avant-bras. Je t’en supplie, ne bois pas !
Elle eut un mouvement de recul. Ses yeux s’emplirent de larmes. La tasse demeura entre nous.
– C’est du jus de raisin. On a pensé que ça te ferait plaisir de boire quelque chose de chez nous.
Je fixai le bocal. De fait, à notre mariage, nous avions bu du jus de raisin, vendangé et mis en bouteille sur la propriété de ses parents. Ce breuvage apparaissait sur la table dans les grandes occasions. Mais ici, à l’hôpital ? Un bocal de chez nous ? Il avait pu être rescellé. Le jus qui était épais avait un goût très riche, parfait pour masquer une substance chimique. Je comprenais que Michelle et ses parents puissent souhaiter me voir mort. C’était logique : ils avaient organisé cela, au lendemain de ma tentative de suicide, se rendant compte de l’enchaînement d’événements que j’avais déclenché, qui allait se terminer par une conflagration de grande ampleur. Étant mes proches, ils allaient devoir affronter la colère de la société dans laquelle ils vivaient puis celle de l’opinion publique internationale. Du coup, ils pensaient que ma mort désamorcerait une partie de la rage publique. C’était bien compréhensible. Mais, entre le comprendre et les laisser faire… Conscient des ramifications cosmiques, je n’étais pas certain que leur acte fût approprié. Ma mort pouvait avoir toutes sortes de répercussions. Que faire ? Des dilemmes de cette sorte me hantaient depuis deux jours et j’hésitai sur la conduite à suivre. Je regardai la tasse. Michelle avait les yeux rouges et elle sortit du sac un Kleenex pour les tamponner. Je pouvais la laisser décider. Oui, je le lui devais.
– D’accord, dis-je, si tu veux vraiment que je boive cela, je vais le faire.
Je saisis la tasse, l’immobilisai à mes lèvres un instant, la bus, jusqu’au bout.
– Ah, c’est bien, dit-elle. Encore ?
– Je vais aller m’allonger.
– Tu es toujours fatigué ?
Je fis oui de la tête.
– N’oublie pas le sac.
Empoisonné, je soulevai le sac, jouant mon rôle jusqu’au bout, et me dirigeai vers ma chambre. Là, ne prenant pas la peine de me changer, je me couchai, plaçant mes mains en croix sur ma poitrine. Bonne position pour quelqu’un qui allait passer dans l’autre monde. Combien de temps le poison qui se diffusait dans mon corps mettrait-il à atteindre les fonctions vitales ? Par quoi commencerait-il ? Est-ce que cela ferait mal ? Aurais-je une attaque qui me laisserait roulé en boule, le visage figé en un rictus ? J’acceptai mon destin mais m’inquiétai pour Michelle et les siens. Avec un peu de chance, ils ne seraient pas accusés de m’avoir tué. Le poison allait peut-être me plonger en léthargie. Je sentis que je m’assoupissais…
Plusieurs heures plus tard, je me réveillai. Non empoisonné. Je m’assis.
Ce n’était peut-être que du jus de raisin.
Se pouvait-il que Michelle ne veuille pas ma mort ? Que sa famille et elle ne se rendissent pas compte des raisons qu’ils avaient de la souhaiter ? Enfin, qu’ils n’en aient pas encore pris conscience…?
Je regardai le sac. Trouvai ma brosse à dents, des vêtements de rechange, mon peignoir. Comme Michelle m’en avait prévenu, le personnel médical avait retenu mon rasoir, qui était électrique et ne pouvait pas me servir à me supprimer, mais devait être révisé. Curieusement, si j’avais voulu me raser, je pouvais obtenir un rasoir jetable au poste des infirmières, étrange objet pour un service psychiatrique. Je n’aurais eu aucun mal à sortir la lame de son manche en plastique, mais ce que j’avais déclaré au médecin et aux infirmières était exact, je ne désirais plus mettre fin à mes jours. De pareilles décisions n’étaient plus de mon ressort.
Je pris le bloc-notes et le Bic. Avec lesquels je devais consigner mes pensées.
J’allai les poser sur la petite table de chevet et commençai à marcher de long en large, me demandant quoi écrire.
Fallait-il les prévenir ? Essayer de les avertir pour qu’ils se préparent au désastre ?
Je commençai. J’écrivis la prise de conscience qui avait été la mienne avant mon admission ainsi que le conseil désespéré que je souhaitais donner à l’humanité.
Lorsque ce fut fini, je relus. J’eus alors le même problème que pendant mon entretien avec le psychiatre. Mes pensées – et par conséquent ces écrits – étaient dangereux. Je ne pouvais savoir ce qu’ils pouvaient conduire autrui à penser et à faire. Avais-je le droit de coucher sur le papier mes révélations capitales ? Qu’est-ce qui pouvait résulter de ces notes ? Que ferait-on de ces informations ? Déclencheraient-elles des dérèglements planétaires ? Prenais-je le risque d’aggraver encore une situation déjà catastrophique ?
Je devais me débarrasser de cette page.
Je souris. Il ne fallait pas que l’on sache que j’étais troublé par mes propres écrits. J’étais seul dans la pièce mais ne doutais pas qu’une caméra fût cachée quelque part. J’essayai discrètement de trouver où elle était. Je ne voulais pas qu’ils se rendent compte que je la cherchais. Il valait mieux que l’on ne sache pas que j’avais conscience qu’il y en avait une. Quel que soit l’endroit où on l’avait cachée.
La salle de bains serait plus sûre.
Discrètement je déchirai la page et la portai dans mon étroit cabinet de toilette. Même dans un hôpital, il ne leur était pas possible de placer là une caméra. C’eût été aller trop loin dans l’invasion de la vie privée. La porte fermée, je me mis à déchirer la feuille en morceaux de plus en plus petits, me préparant à les jeter dans la cuvette des toilettes.
Sauf que. Sauf que l’hôpital avait certainement prévu cette éventualité. Non, on ne pouvait filmer les patients aux toilettes mais on avait certainement l’habitude que ces derniers évacuent des documents importants par la chasse d’eau. C’était déjà suffisamment ennuyeux à l’égard de la plomberie pour que l’architecte ait prévu une sorte de trappe de sécurité aisément accessible par les mêmes services d’entretien que ceux qui effectuaient la révision de mon rasoir. Mes morceaux de papier seraient récupérés, séchés, recollés bout à bout. On saurait alors ce qui était si important pour que je m’en débarrasse de cette manière. Là se trouvait certainement leur source d’information la plus fiable. Entreprenant alors de trier mes confettis, je sélectionnai les plus noircis par l’encre. Je n’avais pas besoin de tout avaler, seulement les passages clés de la mosaïque de mes pensées. Je les mangeai. Le reste fut dispersé par la chasse d’eau. Je la tirai et ressortis dans la chambre avec, du moins m’y appliquai-je, l’air de quelqu’un qui venait de se vider agréablement les boyaux.
Restait le bloc-notes.
Pas besoin d’être un grand lecteur de roman d’espionnage pour savoir qu’en posant un calque sur la page suivante et en le noircissant au crayon, on voit se révéler le texte de la page précédente.
Je retournai m’asseoir à la tablette.
Bon, me dis-je, que s’attend-on à lire sous la plume d’un homme hospitalisé pour tentative de suicide ?
Qu’il est bon de vivre ! J’écrivis en appuyant très fort afin de masquer l’empreinte des lettres précédentes.
J’avais trouvé la moins mauvaise solution. Mais tout de même, il ne fallait pas que je recommence.
Toutefois de semblables écrits existaient ailleurs. En regardant mon bloc, je me souvins alors où j’avais laissé les mêmes éléments d’information. Des wagonnets de plateaux de plastique bleus avaient été roulés dans la salle à manger quand je m’y rendis pour dîner, sans une once d’appétit, en pleine digestion de ma feuille de notes et l’esprit obnubilé par ma messagerie électronique.
JE FUS ÉTONNÉ de revoir Michelle à l’hôpital. Chaque fois qu’elle me quittait, je pensais : c’est la dernière fois que je la vois. Elle va finir par comprendre (non seulement elle, mais sa famille et au bout du compte l’ensemble de nos relations) et se rendre à l’évidence qu’elle serait davantage en sécurité ailleurs. Mais elle revenait toujours et j’étais terrassé de joie en l’apercevant. Je ne croyais plus qu’elle souhaitait ma mort. Le jus de raisin avait été un malentendu dont j’étais responsable et il était indéniable que ma tentative de suicide l’avait affectée. Je pouvais compter sur elle.
– Est-ce que je peux te demander quelque chose ? dis-je. C’est très, très, très important.
– Qu’est-ce que c’est ?
– Il faut que tu consultes ma messagerie électronique.
– Je l’ai déjà fait.
– Non, je ne parle pas de ma boîte de réception mais de ma boîte d’envoi.
Elle n’était pas familière de l’ordinateur. Quand nous recevions des e-mails de notre famille ou de nos amis, elle les lisait par-dessus mon épaule et n’aurait jamais utilisé l’ordinateur pour quoi que ce soit d’autre, ne serait-ce qu’un jeu. En 1998, pour elle, la messagerie demeurait un mystère.
– As-tu une feuille de papier ? demandai-je.
– On peut prendre ton bloc.
– Non, je préférerais ne pas l’utiliser.
Elle trouva une feuille dans son sac.
« 1°)… écrivis-je, appuyer sur le bouton rond de l’ordinateur. »
Je décrivis chaque étape du processus. Ce qui était d’ordinaire si simple nécessitait une page entière d’instructions et, moi-même, j’étais rebuté par leur aspect sur la feuille.
« James, dis-je. »
Nous étions amis depuis le jardin d’enfants et pouvions lui faire confiance. Il était à l’aise avec les ordinateurs.
« Fais-toi aider par James. »
– Mais je ne comprends pas, dit Michelle. Pourquoi est-il si important que nous allions dans ta boîte de… ?
– Dans ma boîte d’envoi. Je me suis envoyé un e-mail à moi-même. Juste avant de prendre mon service à la bibliothèque. Je t’en supplie, je t’en supplie, fais ça pour moi, il faut que tu supprimes ce message. Non ! Imprimes-en un exemplaire d’abord. Ensuite seulement tu l’effaces.
Je rajoutai des instructions sur le papier.
– Imprimes-en un exemplaire mais promets-moi, promets-moi de ne pas le lire.
Je lui dis de mettre l’exemplaire sous enveloppe cachetée et de le donner à sa sœur Shannon.
– Dis-lui de le cacher et de ne surtout pas le regarder. Dans un endroit où personne ne puisse le trouver. Mais où elle puisse le retrouver si nécessaire. Parce que ça peut s’avérer utile à l’avenir.
J’avais rédigé cet e-mail peu avant de quitter la maison pour aller travailler, sachant qu’après ma mort, tandis que le monde s’enfoncerait lentement, moi, auteur du livre et du drame à venir, je serais un jour l’objet d’un intérêt considérable. Le message contenait des suggestions pour reconstruire la civilisation ainsi que des preuves de l’existence d’un esprit cosmique universel. J’avais espéré en le rédigeant qu’il aiderait les populations à traverser leurs épreuves. Maintenant, je n’en étais plus sûr. De quel droit voulais-je influer sur le cours du monde ? Qui étais-je, en définitive, dans cette affaire ? Je ne pouvais me fier à moi-même. Je ne pouvais avoir confiance dans mes dernières actions et voulais donc que ce message soit détruit avant que quiconque ne s’introduise dans ma messagerie et ne le découvre. En conserver un exemplaire papier était par contre utile. Aux signes avant-coureurs de l’apocalypse, Shannon pourrait le produire et fournir ainsi les preuves de ma redoutable prescience. Les autorités constateraient la réalité de mes capacités de prédiction. Elles prendraient alors mes avertissements au sérieux et, en déployant des trésors de diplomatie au plus haut niveau, éviteraient à la dernière minute que la catastrophe ne se produise.
– Je me sens beaucoup mieux, dis-je au Docteur Brophy.
Michelle et moi, après qu’elle eut rangé la feuille d’instructions dans son sac à main, nous étions rendus ensemble à la consultation et je m’efforçais d’avoir l’air détendu et en possession de toutes mes facultés mentales.
– Je pense que j’étais un peu dépassé par ce qui m’arrivait, je manquais de sommeil, j’étais surmené.
– Et vos soucis ? demanda-t-il.
J’admis avoir encore quelques inquiétudes quant à la sortie de mon livre.
– Vous avez fait une hyperanxiété à ce sujet, dit le psychiatre. Vous avez perdu de vue que c’est une vraie belle réussite que d’être publié et vous vous punissez alors que vous devriez être en train de fêter cela. Vous, dit-il en se tournant vers Michelle, devez lui rappeler qu’il vient d’accomplir ce qu’il y a de plus formidable. Enfin, être publié ! Et en plus un roman ! Et par un grand éditeur américain ! Moi, en tout cas, je suis impressionné. J’ai envie de…
Se penchant en avant, il fit un mouvement en direction de mes pieds.
De m’embrasser les pieds ? M’embrasser les pieds ? Je souris, mais au fond de moi-même trouvai cette idée plutôt embarrassante. Quand ce que j’avais pressenti deviendrait vrai, quand la violence s’emparerait du monde jusqu’à l’entraîner vers son anéantissement, le docteur Brophy se souviendrait de moi et comprendrait que j’étais l’instrument de la fin des temps. Il se souviendrait alors d’avoir fait le geste de s’agenouiller devant moi et, même s’il l’avait esquissé brièvement et pour rire, il serait un jour mal vu pour ce geste. Que penserait-il de moi dans les semaines à venir ? Me verrait-il comme le Diable descendu sur Terre, sorti tout droit du livre de l’Apocalypse ?
– Combien de temps, dis-je comme l’entretien touchait à sa fin, estimez-vous nécesaire que je reste encore ici ?
– Pas trop longtemps, je pense. Cela va essentiellement dépendre de votre capacité à vous reposer et à retrouver un rythme de sommeil normal.
Je voulais sortir le plus rapidement possible. Je ne voulais pas m’enfuir parce que cela ferait de la peine à Michelle et qu’il ne fallait pas qu’elle ait à supporter un tel retour à la maison. Mais ce n’est pas à l’hôpital que je pouvais être utile. Je ne pouvais rien y faire. Je ne pouvais pas y arrêter ce que j’avais déclenché. Il n’y avait pas d’ordinateur. Non, il fallait que j’obtienne un certificat de sortie pour reprendre les choses où je les avais laissées et essayer de corriger ce qui pouvait encore l’être ! Avant que Michelle s’en aille, je lui rappelai sa mission, mais, quelques instants plus tard, fus assailli de doutes. N’avais-je pas laissé sur Internet un second e-mail, sur un autre compte ? C’était fort possible. J’avais un souvenir si confus de cette période…
Mes e-mails ainsi que la fin du monde m’obsédaient. En recommençant à écrire dans mon bloc-notes, je ne les évoquai pas, persuadé que, très discrètement, le personnel lirait mes écrits. J’étais seul à pouvoir trouver une solution et m’y employai toute la journée. Au début, j’étais soulagé de voir arriver le moment de se coucher car les conversations représentaient un vrai risque, mais allongé dans mon lit, mes pensées restaient fixées sur ces messages et les dangers auxquels ils m’exposaient.
Serais-je éliminé de nuit ? J’écoutai. Pas de tireur d’élite chanteur ce soir. Le temps s’était dégradé. Le vent s’était levé et secouait les vitres. De grands arbres oscillaient le long d’un bâtiment de verre.
À l’intérieur : un homme. Qui hurlait. Des coups de pied dans le mur. « Fumiers, fumiers ! Je vous interdis de me toucher ! » Des obscénités. Le vacarme venait d’une autre chambre.
J’avais eu des troubles du sommeil les jours qui avaient précédé ma dernière journée de travail et mon admission ici. Au cours de nuits interminables où je m’étais tourné et retourné dans tous les sens, en proie à l’angoisse de la fin du monde que j’entrevoyais, j’avais perdu ma capacité à m’endormir. Un peu plus loin dans le couloir, il continuait à crier. Qu’est-ce qu’on lui faisait ? Le psychiatre avait évoqué le sommeil comme une condition de ma guérison. Je savais qu’il fallait que j’y arrive, à ce simple fait de m’endormir comme je l’avais réussi des milliers de fois. Mais cet autre qui continuait à taper sur tout, à pleurer et à gémir…
J’eus l’impression que cela durait des heures. Je finis par me lever et sortir dans le couloir. Les hurlements s’accentuaient au fur et à mesure que je me rapprochai du poste des infirmières. Un membre de l’équipe médicale dut entrer au même instant car j’entrevis la pièce, différente de la mienne, sans lit, sans mobilier, recouverte d’épais matelas bleus sur le sol et les murs, un peu comme des tapis de trampoline. N’avais-je pas aussi vu des sangles, un anneau… ?
J’allai voir l’infirmière de garde.
– Euh, bonsoir.
Elle eut l’air mécontente de me voir.
– Qu’est-ce qu’il a ? demandai-je. Pourquoi crie-t-il ?
– Jan, enfin, secret professionnel.
– Mais est-il… Qu’est-ce qu’on lui fait dans cette pièce ?
– Retournez vous coucher.
– Je n’arrive pas à dormir. Je me demandais si vous pourriez me donner quelque chose.
Elle fronça les sourcils.
– Je vais appeler le médecin de garde et on va voir.
J’allai m’asseoir dans le salon et attendis. Les baies vitrées reflétaient les allées et venues de l’intérieur du pavillon, déformées par les secousses du vent sur les vitres. À l’intérieur aussi, les hurlements continuaient. Une voix d’homme derrière moi demanda : « Ça va durer longtemps ? »
Un policier en uniforme, debout devant le poste, discutait avec l’infirmière. Je n’entendais pas ce qu’elle lui disait.
– On aimerait en finir, dit-il d’un ton sec. On ne va pas passer la nuit ici.
Un flic ?
Je regardai de nouveau les bourrasques. Je ne voyais pas grand-chose, à part les mouvements des branches sous les réverbères.
L’infirmière m’appela.
– Vous pouvez prendre ceci, dit-elle.
Reconnaissant, je pris la pilule, une toute petite, bleue. En retournant dans le couloir, je vis tout un attroupement de policiers. Dix ? Douze ? Tous en uniforme, debout en cercle en train de discuter. Que faisaient-ils là ? À cause du brailleur ? Ce devait être à cause de lui.
Je poursuivis mon chemin, passai devant eux. Ils ne me remarquèrent pas tout de suite. Puis une femme, de petite taille, les cheveux bouclés écrasés sous la coiffe réglementaire, m’aperçut. Elle me regarda. Me fixa. Intensément. Alors que j’avançais, elle me dévisagea longtemps. Lorsque j’eus dépassé leur groupe et jeté un coup d’œil par-dessus mon épaule, je vis qu’elle s’était retournée aussi et me fixait toujours. Une nouvelle ? Une spécialiste des visages, entraînée à mémoriser les physionomies, à toutes fins utiles ? Ou alors elle s’entraînait à avoir l’air altier des membres de la police montée ou à mémoriser un visage ou alors le mien lui disait quelque chose, était déjà apparu dans les dépêches des commissariats, ou alors…
Pourquoi elle tenait à me faire perdre contenance, je n’aurais su le dire. Quelles qu’en fussent les raisons, son coup d’œil ruina tous mes espoirs de sommeil et de guérison rapide. La pilule s’en fut se dissoudre dans mon estomac ; sa substance se dilua dans mon sang, y remplit sa mission et je demeurai éveillé.
Je restai ainsi jusqu’à la fin des cris. Dehors la tempête continua, faisant trembler le vieux pavillon sous toutes ses coutures. Je ne dormais pas. Mon blouson était accroché à un ceintre.
C’était le blouson que je portais le jour de mon admission. Celui que j’avais porté pour ma dernière journée à la bibliothèque ! Je me levai et me dirigeai vers lui. Plongeai ma main dans une poche, cherchai. J’avais été étonné qu’on ne me fouillât pas au moment de m’admettre.
C’était un blouson en laine et, prises dans les fibres poilues, se trouvaient plusieurs pilules blanches. Pour que ce soit plus commode durant cette dernière journée de travail, pour pouvoir les prendre sans avoir à me rendre au vestiaire, j’en avais mis dans mes poches. Et elles y étaient toujours ! Là, au moment où j’avais besoin d’elles ! Dans ma chambre d’hôpital. Comme cela tombait bien ! Dans le cabinet de toilette, je remplis un verre d’eau, essayai de ne plus penser aux yeux de cette femme, aux policiers, au hurleur, à la chambre aux sangles.
Mais pourquoi m’avait-elle regardé de cette façon-là ?
MA VIE AU JOUR LE JOUR
J’AI LE MALHEUR d’avoir compris de quoi j’étais l’instrument et si je le couche maintenant sur le papier, c’est dans l’espoir que l’humanité pourra en faire quelque chose. J’ai écrit un roman dont le titre est Shiva 3000. Shiva, déesse indienne de la destruction – la puissance destructrice – est celle dont, sans l’avoir désiré, j’ai causé l’avènement…
Ma culpabilité me plonge dans un état d’extrême confusion. Le regret me taraude ainsi que la peur pour ceux que j’aime et que je n’ai pas souhaité inquiéter plus tôt que nécessaire. Si je pouvais émettre un souhait, ce serait de vivre assez longtemps pour voir si mes prédictions se réalisent. Dans l’immédiat, j’en suis réduit à attendre mon exécution (je sais maintenant que les prophètes sont assassinés parce que les gens craignent avant tout ceux qui mettent en danger leur univers matériel)…
Je rendis la feuille de papier imprimée au docteur Brophy. Nous étions à nouveau dans son petit bureau.
– Vous reconnaissez ce papier ? me demanda-t-il.
– C’est l’e-mail que je me suis adressé à moi-même le jour où j’ai été hospitalisé. Celui de ma messagerie Hotmail.
– Votre femme a pensé qu’il était utile que je le lise, dit-il. Aujourd’hui, comment réagissez-vous à cet écrit ?
– Mal, dis-je avec sincérité. – Je l’avais seulement parcouru des yeux mais cela avait suffit pour que je sente mon estomac se contracter.
– Je l’ai écrit dans un sale état, je n’avais pas dormi pendant des nuits…
À mon grand soulagement, il rangea la page dans mon dossier.
Il était déjà suffisamment grave qu’il l’ait lue et j’avais craint qu’il n’en souhaitât une exégèse, ligne à ligne. Je ne voulais pas qu’il en apprît davantage sur moi-même et sur ce qui m’était apparu. En regardant le docteur Brophy, je continuais à penser à l’intrusion de la police la nuit précédente. À mon arrivée, j’avais eu moins peur de parler. Maintenant, j’éprouvais une vraie gêne. La manière dont ce psychiatre me dévisageait me déplaisait. Pourquoi me regardait-on de cette manière ? Le policier d’abord, lui ensuite. Que me cachaient-ils ?
– Êtes-vous toujours inquiet de ce qui pourrait arriver à cause du livre ?
J’étais terrifié. Mais pour obtenir un certificat de sortie, je devais donner l’impression d’avoir la tête sur les épaules. Il ne fallait pas que je dise que je continuais de penser ce que j’avais écrit. D’un autre côté, si j’avais l’air trop équilibré, on ne me croirait jamais.
– Eh bien, dis-je, je ne peux pas dire que je n’ai plus aucune inquiétude. Cela me fait quelque chose. Oui. Par contre, je ne crois plus un mot de ce que j’ai écrit. Je ne crois pas que nous nous trouvions au commencement de la fin du monde, ni que j’en sois l’instrument.
Il n’essaya pas de mettre mes propos en doute, se contenta de m’écouter. Je n’avais aucune idée de ce qu’il pensait.
– Et votre sommeil ? Comment s’est passée la nuit dernière ?
– Très bien, dis-je. Vu que j’ai trouvé mes somnifères. Il y a eu un peu de… d’agitation au cours de la nuit, des cris.
– Oui, les infirmières m’ont dit qu’il y avait eu du mouvement.
– J’ai eu du mal à m’endormir. Je crois que j’ai toujours ce problème.
– Je vais modifier votre ordonnance.
Le docteur Brophy n’était pas toujours sur place. En moins de trois jours, j’avais repéré le fonctionnement du service. Il arrivait le matin, restait une heure ou deux pour faire le tour de ses patients, les voyant dans son bureau ou dans leur chambre. À son arrivée, ils reprenaient du poil de la bête, parlaient de lui, de ce qu’il leur avait dit ou de ce qu’eux comptaient lui dire. Il était toujours en costume et l’atmosphère était toujours plus intense lorsqu’il était là. Quel patient allait-il voir ensuite ? Qu’avait-il dit ? Quand c’était mon tour, l’entretien se déroulait toujours de la même manière : d’abord il s’enquérait de mon état mental, de la qualité de mon sommeil, puis on discutait de la manière de guérir.
– Un psychisme ne se répare pas comme une jambe, me dit-il. Il ne suffit pas de plâtrer et d’attendre que ça passe.
J’aurais tout donné pour qu’il me donne des conseils, des trucs. Je savais – je me rendais bien compte – que je n’allais pas bien et désirais ardemment guérir.
Si se faire plâtrer la tête avait représenté une possibilité, je me serais exécuté avec joie. Je buvais ses paroles, réellement désireux de guérir, en même temps que je travaillais à l’obtention de mon certificat de sortie. Je vais guérir. Ce que je raconte sur mon équilibre retrouvé sera bientôt vrai, même si ça ne l’est pas tout à fait encore. Attentif à ses paroles, je guettais d’éventuels indices de la date de ma sortie. Il était rassurant mais pas très précis.
– Vous avez besoin de vous remettre à vivre normalement, suggéra-t-il. Vous devriez essayer de parler un peu aux autres, de vous ouvrir un tout petit peu.
Lorsque je sortis de son bureau, des accords de guitare électrique faisaient vibrer le salon. Une patiente regardait des vidéoclips de hard rock avec le volume au plus haut. Elle était toute seule, les autres ayant fui la zone de damnation par le son. Parler un peu aux autres. S’obliger à des pensées NOR-MALES. Au moins fallait-il que je sois vu en train de faire la conversation.
La femme était un peu voûtée et assise de côté de manière à ne pas voir l’écran. Mais la musique allait se loger naturellement dans sa tête qui marquait la mesure, quoique légèrement à contretemps. Pourquoi ne regardait-elle pas l’écran ?
– Vous regardez cette émission ?
– J’aime la musique rock.
– Vous voulez que je vous trouve une autre chaîne musicale ?
– C’est de la musique satanique ?
Je vérifiai. C’était le groupe Slayer.
– Euh, oui, dis-je, mais…
– Je ne suis pas satanique.
– Je n’ai pas dit…
– Je ne suis pas satanique, je ne suis pas satanique !
– Mais non, bien sûr, je…
Une infirmière fut sur nous avant que j’aie eu le temps d’arranger les choses, éteignant la télévision et consolant la femme qui continuait à proclamer son non-satanisme en se balançant d’avant en arrière, sans regarder personne. Je m’éclipsai de la scène.
Je divisai les malades en deux groupes. Les gens meurtris, comme la fan de Slayer non-satanique, étaient les plus nombreux. La plupart étaient des femmes, brisées par leur maladie et qui n’auraient pu faire de mal à personne en dehors d’elles-mêmes. Lors de mon admission, c’était à elles que l’infirmière avait fait allusion en disant qu’elle voyait essentiellement la même catégorie de patients. Des habitués. Je pensais que Ruth, la patiente qui traînait les pieds, faisait partie de cette catégorie. J’avais l’impression qu’elle ne s’était pas arrêtée de parler depuis que j’avais fait sa connaissance.





























