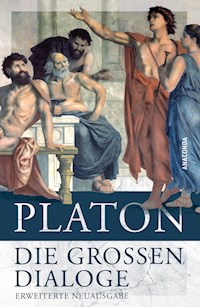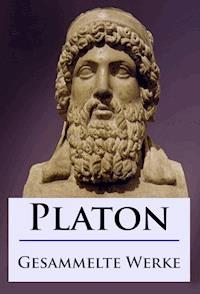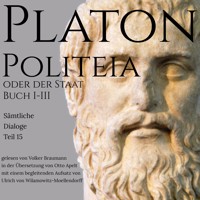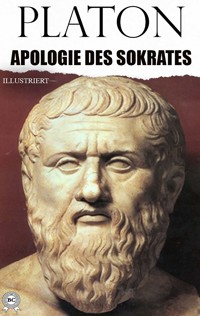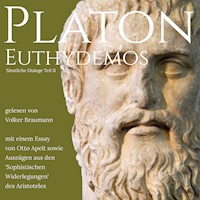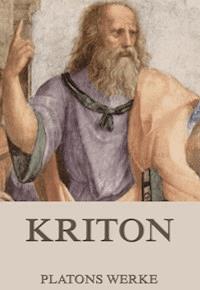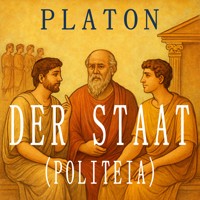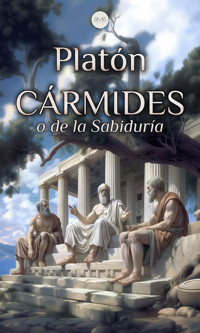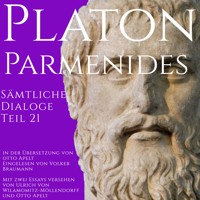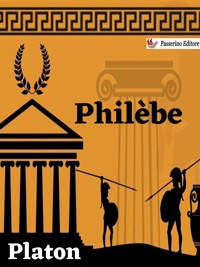
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Passerino
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Philèbe est un dialogue écrit par
Platon, qui explore la nature de la vie bonne et la relation entre la raison et le plaisir. Dans le dialogue, Socrate discute avec deux interlocuteurs, Philèbe et Protarque, sur la question de savoir si le plaisir est le bien suprême ou si la vie bonne consiste en quelque chose de plus élevé que le simple plaisir.
Platon (428/427 av. J.-C. - 348/347 av. J.-C.) était un philosophe et mathématicien grec de l'Antiquité, considéré comme l'un des penseurs les plus influents de l'histoire de la philosophie occidentale. Il était un élève de Socrate et le fondateur de l'Académie de Platon, l'une des premières institutions d'enseignement supérieur en Occident.
Platon a écrit de nombreux dialogues philosophiques, dans lesquels il utilise la méthode socratique pour explorer des questions fondamentales de la philosophie, telles que la nature de la réalité, de la connaissance, de la justice et de la moralité. Il a également développé sa propre philosophie, qui a influencé de manière significative la pensée occidentale.
Traduction, notices et notes par
Émile Chambry.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Platon
Philèbe
ou Du Plaisir
The sky is the limit
table des matières
Notice sur le « Philèbe »
Philèbe
Notice sur le « Philèbe »
Nous tombons, au début du Philèbe, sur une conversation qui vient de finir entre Socrate et Philèbe, où ils ont affronté leurs idées respectives sur ce qui doit être le but de la vie humaine, sur le souverain bien. Philèbe a soutenu qu’il consiste dans le plaisir, Socrate, dans la sagesse et l’intelligence. Comme Philèbe est buté à son idée, Socrate s’adresse à Protarque, ami de Philèbe, moins entêté que lui, pour continuer la discussion. Socrate et Protarque conviennent de ne pas l’abandonner avant d’avoir reconnu si c’est le plaisir ou la sagesse qui est la fin que nous devons nous proposer, ou si c’est dans un autre genre de vie qu’il faut chercher le vrai bien de l’homme.
La méthode à suivre
Pour en juger, il faut au préalable étudier la nature du plaisir et la nature de la science et de la sagesse. Tout en étant un, le plaisir est multiple, c’est-à-dire qu’il comprend plusieurs espèces, et il en est de même de la science. Les éristiques, il est vrai, nient que ce qui est un puisse être multiple ; mais leurs arguties ne méritent pas qu’on s’y arrête. Toutes les choses qui existent sont issues de l’un et du multiple, et la nature a uni en elles le fini et l’infini. Il y a dans chacune une idée qu’il faut chercher d’abord : c’est le genre, τδ έυ ; puis dénombrer les espèces (πολλά) contenues dans le genre, pour arriver enfin aux individus qui sont une infinité (άπειρα). C’est ainsi que la voix, qui est une, comprend plusieurs espèces de sons, le grave, l’aigu, le moyen, et que ceux-ci à leur tour se décomposent en un grand nombre d’éléments. Cette manière de procéder est ce que nous appelons aujourd’hui la méthode analytique. Si, inversement, on remonte des individus à l’idée, c’est la synthèse. Dans la synthèse, comme dans l’analyse, il faut que les énumérations soient complètes, si l’on ne veut pas s’exposer à de graves erreurs. Ce n’est pas la première fois Platon explique sa méthode. Il en avait déjà maintes fois exposé les principes, par exemple dans la République (454 a sqq. et 534 b sqq.), mais surtout dans le Phèdre (265 d-e), dans le Parménide (129 b sqq.), dans le Sophiste, (253 d-e) et dans le Politique (262 b et 285 a). En particulier, les célèbres dichotomies du Sophiste et du Politique nous font voir avec quelle minutie on appliquait à l’école de Platon les principes relatifs à l’analyse des espèces.
Les trois caractères du souverain bien
C’est suivant cette méthode qu’il faut chercher si le plaisir et la sagesse comportent des espèces, quel en est le nombre, quelle en est la nature. Mais Protarque ayant déclaré qu’une telle analyse est au-dessus de ses forces, Socrate confesse qu’elle n’est pas nécessaire, s’il est vrai, comme il l’a entendu dire, que le souverain bien ne réside ni dans le plaisir ni dans la sagesse, mais dans un autre genre de vie. En ce cas, le plaisir ne pourrait plus prétendré à la première place, et il n’y aurait plus besoin de le diviser en espèces.
Ainsi, après avoir expliqué tout au long sa méthode, Platon renonce aussitôt à l’appliquer. Il y a de quoi s’en étonner, d’autant plus qu’il la reprendra plus loin et en fera la stricte application au plaisir et à la science. Il a oublié de nous dire que cette application n’était que différée. C’est une négligence qui peut à peine s’excuser par la liberté d’allure de la conversation.
Si nous renonçons à analyser, du moins pour le moment, les différentes espèces du plaisir et de la science, entendons-nous, dit Socrate, sur les trois points suivants. Le bien, en lui-même, doit être parfait, se suffire à lui-même et être désirable pour tout le monde. On s’est étonné aussi que Platon se contente d’affirmer, sans autres preuves, que le bien doive réunir ces trois conditions. Il a sans doute considéré que la chose était évidente par elle-même. Aristote a fait de même, et, bien qu’il ne soit pas d’accord avec son maître sur la nature du souverain bien, il admet, lui aussi, que le bien doit être parfait, souhaitable par lui-même, et non en vue d’autre chose, et qu’il doit se suffire à lui seul. (Éthique à Nicomaque, I, 6, § 12.)
Ces trois conditions sont-elles remplies par le plaisir ou par la sagesse ? Pour nous en rendre compte, considérons-les en eux-mêmes, en les séparant de tout ce qui n’est pas eux et, en particulier, l’un de l’autre. Suppose maintenant, dit Socrate à Protarque, que tu n’aies ni mémoire, ni raison, ni intelligence : tu seras hors d’état de te rappeler un plaisir passé, d’anticiper aucun plaisir futur, de sentir même un plaisir présent, puisque tu n’en auras même pas conscience. Quant à la sagesse, si parfaite qu’elle soit, qui en voudrait, s’il était condamné à ne jamais goûter aucun plaisir ?
Les trois genres d’être et la cause
Ainsi, ni le plaisir, ni l’intelligence ne sont le bien. C’est dans le mélange des deux que nous le trouverons. Reste à savoir auquel des deux appartient la prééminence dans la combinaison. Pour en juger, il faut les rattacher aux grands principes auxquels toutes choses doivent leur naissance. Il y a dans l’univers deux éléments, l’infini ou indéterminé, et le fini ou déterminé, et un troisième, formé du mélange de l’un et de l’autre, et, au-dessus d’eux, un quatrième, la cause créatrice. Appartient à l’infini tout ce qui admet le plus ou le moins, comme le plus chaud et le plus froid, qui ne peuvent être limités sans périr. Appartient au fini tout ce qui admet le nombre et la mesure, comme l’égal, le double, et à la classe mixte tout ce qui vient à l’existence sous l’effet de la mesure et du fini. Quant à la cause, elle est ce qui donne l’existence à toutes choses.
Ces quatre principes métaphysiques sont, s’il faut en croire les témoignages des critiques anciens, un emprunt fait à Philolaos. C’est par ces quatre principes que Philolaos expliquait l’origine du monde. Platon les applique non seulement à la nature, mais encore à la vie des êtres animés. Il entend les trois premiers exactement comme Philolaos, mais le quatrième, la cause, diffère chez lui de la cause suprême, créatrice du monde, que le pythagoricien appelle έυ πρώτου, l’un suprême. La cause, dans le Philèbe, est simplement l’idée du bien, source de toute perfection. Mais il faut dire que l’authenticité de ces textes est aujourd’hui fortement contestée.
Le but de cette classification était de déterminer le degré d’excellence du plaisir et de la sagesse. Il est clair que la vie mélangée fait partie du troisième genre, formé de tous les infinis liés par le fini, et que le plaisir fait partie de l’infini. Quant à l’intelligence, c’est elle qui gouverne le monde ; car on ne peut admettre qu’il soit l’œuvre du hasard. Or comme nous avons pris à l’univers les éléments matériels dont notre corps est composé, nous lui avons pris aussi l’âme qui les régit, et l’intelligence inséparable de l’âme. Comme c’est la cause qui a créé l’âme, c’est de la cause qu’elle relève et l’intelligence avec elle. De là on peut conclure que dans le mélange qui constitue la vie heureuse, l’intelligence joue un rôle bien autrement relevé et important que le plaisir, qui est du genre infini, lequel n’a jamais ni commencement, ni milieu, ni fin.
Les diverses espèces de plaisir et de douleur
Il nous faut examiner maintenant en quoi chacun d’eux se rencontre et par quelles affections ils sont produits. Commençons par le plaisir, et la douleur, qui en est inséparable. Le plaisir et la douleur, nous l’avons vu, naissent dans le genre mixte, c’est-à-dire dans les êtres animés, formés de l’union de l’infini et du fini. Lorsque, dans cette union, l’harmonie est détruite, il y a douleur ; lorsqu’elle se rétablit, plaisir. Par exemple, la faim, qui est un vide, est une douleur, et le manger, qui produit la réplétion, un plaisir. Il faut rattacher à cette classe l’attente de ces sortes de sensations par l’âme elle-même, attente de plaisirs à venir, agréable et confiante, attente de chagrins, qui provoque la crainte et la douleur. Quand il n’y a ni dissolution, ni rétablissement, on ne ressent ni joie ni peine. C’est l’état du sage, c’est l’état de la divinité, qui n’est accessible ni au plaisir ni à la douleur.
Une deuxième espèce de plaisir et de douleur, celle de l’âme seule, doit entièrement sa naissance à la mémoire. Recherchons donc ce qu’est la mémoire et auparavant ce qu’est la sensation sur laquelle elle s’exerce. Parmi les affections que notre corps éprouve, les unes s’éteignent dans le corps même sans parvenir à l’âme, qui se trouve alors dans l’état d’insensibilité ; les autres vont du corps à l’âme et y causent une sorte d’ébranlement propre à chacun et commun à l’un et à l’autre. Cet ébranlement est la sensation. La mémoire est la conservation de la sensation. Mais il faut distinguer la réminiscence de la mémoire : la mémoire est spontanée et vague, la réminiscence est l’acte volontaire de l’âme, qui ressaisit seule et par elle-même ce qu’elle a éprouvé autrefois avec le corps.
C’est par la mémoire que s’explique le désir. La faim et la soif, par exemple, sont des désirs. Quand nous disons de quelqu’un qu’il a soif, cela revient à dire : il est vide et il désire d’être rempli par la boisson. On désire donc le contraire de ce que le corps éprouve, puisque, étant vide, on désire être rempli. Or quand un homme est vide pour la première fois, qu’est-ce qui peut avoir en lui l’idée de la réplétion ? Ce n’est pas le corps, puisqu’il est vide. Il faut donc que ce soit l’âme et que l’idée lui en soit fournie par la mémoire. D’où il suit qu’il n’y a point de désir corporel, et que tous les désirs appartiennent à l’âme. Si, quand on souffre par le désir, on se souvient du plaisir dont l’arrivée ferait cesser la souffrance, on éprouve à la fois de la joie et de la peine. Si, au contraire, on n’a pas d’espoir d’arriver à la réplétion, on éprouve alors la double sensation de peine.
Y a-t-il des plaisirs faux ? – Non, dit Protarque, le plaisir est toujours le plaisir. – Sans doute, mais de même qu’une opinion, quoique toujours réelle, peut être fausse, le plaisir peut l’être aussi. Comme on peut se tromper sur l’objet de son opinion et s’en faire une idée fausse, on peut se tromper aussi sur la chose dont on s’afflige ou dont on se réjouit, et c’est ce qui fait qu’un plaisir peut être faux. Ces plaisirs faux, qui reposent sur des images inexactes que nous portons en nous, sont particulièrement fréquents en ce qui regarde l’avenir et les espérances que nous fondons sur lui. Et ce que nous disons de la fausseté des plaisirs peut se dire aussi de la crainte, de la colère et des autres passions semblables.
On peut démontrer encore d’une autre manière la fausseté de certains plaisirs et de certaines douleurs. Quand l’âme désire et que le corps souffre ou jouit, les plaisirs et les peines existent simultanément. De même qu’à voir les objets de trop loin et de trop près, on s’abuse sur leur taille et on en forme de faux jugements, de même, par le fait que les plaisirs et les peines semblent changer selon l’éloignement ou la proximité, les plaisirs vis-à-vis des douleurs paraissent plus grands et les douleurs à l’inverse. Les uns et les autres paraissent plus grands ou plus petits qu’ils ne sont. Si on en retranche ce qui paraît, mais n’est pas, personne ne peut prétendre que cette apparence retranchée soit vraie. Il y a donc de la fausseté dans une partie de ces plaisirs et de ces douleurs.
Il se peut aussi que, notre âme n’éprouvant pas de changement, il n’y ait en nous ni plaisir, ni peine. On objectera que les choses étant dans un perpétuel mouvement, notre âme aussi doit changer sans cesse. C’est vrai, mais il y a des changements si faibles que nous n’en avons pas conscience et qu’ils sont pour nous comme s’ils n’étaient pas.
Mais l’absence de douleur n’est pas le plaisir, comme le croient certaines gens d’humeur chagrine qui nient l’existence du plaisir. Platon fait ici allusion à Antisthène et aux Cyniques qui, par horreur du plaisir et de ses conséquences, le réduisaient à l’absence de douleur. Platon rejette leur doctrine, mais il y puise des arguments contre les sensualistes outrés. Si l’on veut, dit-il, connaître la nature d’une espèce quelconque, il faut prendre ce qu’il y a de plus grand dans cette espèce, par exemple, dans l’espèce de la dureté, ce qu’il y a de plus dur, pour mieux juger de sa nature. Si nous considérons l’espèce du plaisir, les plus grands plaisirs sont ceux qui viennent à la suite des désirs les plus violents et qui par conséquent se payent par les douleurs les plus vives. En outre, ils appartiennent plus à la vie de débauche qu’à la vie réglée et sage ; car le sage est retenu par la maxime : Rien de trop, tandis que le débauché se livre au plaisir jusqu’à en perdre sa raison et sa réputation. Les plus grands plaisirs, comme les plus grandes douleurs, sont donc attachés à une sorte de méchanceté de l’âme et du corps.
Il y a des mélanges de plaisirs et de douleurs, dont les uns regardent le corps et se font dans le corps même, dont les autres se font dans l’âme seule, ou dans les deux, lorsque, dans le rétablissement ou dans l’altération de la constitution, on éprouve en même temps deux sensations contraires. Il y a dans ces sortes de mélanges tantôt une dose égale de peine et de plaisir, et tantôt prédominance de l’une ou de l’autre.
Il y a des mélanges de douleur que l’âme seule éprouve. Ils sont causés par les passions, comme la colère, la crainte, le désir, le deuil, l’amour, la jalousie, l’envie, soit dans la vie réelle, soit dans les représentations que nous en donne le théâtre tragique ou comique. Protarque s’étonne d’entendre nommer la comédie parmi les sources des plaisirs et des douleurs mélangés. Le double sentiment qu’elle fait naître en nous est en effet assez délicat à expliquer. Voici comment Socrate en fait l’analyse. L’envie est par elle-même un mal et une douleur ; c’est aussi un plaisir, puisque l’envieux rit du mal d’autrui. Ce mal, dans la comédie, consiste dans l’ignorance de soi-même. On s’ignore soi-même quand on se croit plus riche, plus fort et plus beau, et surtout plus vertueux qu’on n’est. Ceux qui s’illusionnent ainsi peuvent être puissants ; alors ils sont odieux. Ils peuvent être faibles et incapables de se venger ; alors ils sont ridicules. Il n’y a pas d’injustice ni d’envie à se réjouir des maux de ses ennemis ; mais c’est une chose injuste de se réjouir des maux de ses amis, au lieu de s’en affliger. Or l’ignorance de nos amis est un mal et nous avons du plaisir à en rire. Donc, en mêlant le plaisir à l’envie, nous mêlons le plaisir à la douleur, car nous avons reconnu que l’envie est une douleur de l’âme et le rire un plaisir, et que nous éprouvons l’une et l’autre dans la comédie, et non seulement au théâtre, mais dans la vie.
Après les plaisirs mélangés, abordons les plaisirs purs. Ce sont ceux qui viennent des figures, des couleurs, des sons et des odeurs. Mais il ne s’agit pas ici de figures d’êtres vivants ni de peintures, mais des figures idéales de la géométrie, de certaines couleurs et de sons qui ont le même caractère de pureté. Les odeurs sont d’un genre moins divin, mais elles nous procurent aussi des plaisirs qui sont ni précédés ni suivis d’aucune douleur. À ces plaisirs purs ajoutons enfin ceux de la science, s’ils ne sont pas joints à la soif de savoir, qui est une souffrance ; mais ces plaisirs sont à peu près inaccessibles à la foule.
Quels sont parmi tous ces plaisirs les plus vrais et les plus beaux ? Ce sont évidemment les plus purs, et non les plus grands. Il en est du plaisir comme, par exemple, de la blancheur. Un peu de blanc sans mélange est plus vrai et plus beau que beaucoup de blanc mélangé.
On a dit que le plaisir est toujours en voie de génération et jamais en état d’existence. Il y a en effet des choses qui n’existent qu’en vue d’une autre, et d’autres qui existent par elles-mêmes et pour elles-mêmes. Le plaisir, étant toujours en voie de génération, a lieu en vue d’un être. Or l’être appartenant à la classe du bien, le plaisir doit être mis dans une autre classe, et n’est donc pas un bien.
Enfin prétendre que le plaisir est le seul bien de l’âme, c’est avouer que le courage, la tempérance et les autres qualités de l’âme ne sont pas des biens, c’est affirmer que jouir, c’est être bon et souffrir être méchant. C’est donc abolir toute morale et toute vertu.
Les différentes espèces de science
Passons maintenant à l’examen des sciences. Elles se divisent en deux classes, dont l’une a pour objet les arts mécaniques et l’autre l’éducation et la culture. Dans les arts mécaniques, il faut distinguer les arts directeurs, l’art de compter, de mesurer, de peser, qui se rattachent davantage à la science, et les arts inférieurs qui s’appuient sur la conjecture et la routine ; c’est dans ces derniers que se rangent la musique, la médecine, l’agriculture, l’art militaire. L’architecture leur est supérieure en justesse, parce qu’elle use d’un grand nombre de mesures et d’instruments. Les sciences précises elles-mêmes sont plus ou moins pures, selon qu’elles sont appliquées par le vulgaire à des usages pratiques, ou traitées par les philosophes, qui n’opèrent que sur des quantités abstraites et idéales. Platon se borne ici à de brèves indications. Pour bien voir la différence capitale qu’il établit entre les sciences, arithmétique, géométrie, astronomie, selon qu’elles travaillent sur des objets concrets et s’appliquent à ce qui naît, ou qu’elles ne considèrent que des mouvements, des chiffres, des figures idéales, il faut se reporter au livre VII de la République, 521 d, 525-526 a, 527 a-b, 511 c.
Au-dessus de toutes les sciences, il faut placer la dialectique, parce que seule elle poursuit l’essence immuable des choses et qu’il n’y a science véritable que de ce qui est éternel et immuable. Les autres sciences, attachées à ce qui est transitoire et changeant, méritent à peine d’être appelées des sciences. Platon reprend ici encore des idées qu’il a plus amplement développées dans la République (511 c).
La vie mélangée
L’intelligence, ouvrière de la science, est évidemment supérieure au plaisir et a beaucoup plus que lui part au bien. Malgré cela, elle ne suffit pas au bonheur de l’homme. Il ne peut le trouver que dans le mélange du plaisir avec l’intelligence ou la sagesse. La méthode la plus sûre pour faire ce mélange, c’est de mêler d’abord les portions les plus vraies du plaisir et de la science. Nous prendrons en premier lieu la dialectique et les sciences les plus pures. Mais ces sciences, accessibles à peu de personnes, sont de peu d’usage dans la vie du commun des hommes, et nous avons besoin de mille choses que les sciences et les arts vulgaires peuvent seuls nous fournir. Aussi sommes-nous obligés de laisser entrer toutes les sciences dans notre mélange.
Quant aux plaisirs, laissons entrer d’abord ceux qui sont purs et vrais, ensuite les plaisirs nécessaires. Nous avons admis toutes les sciences, parce qu’elles sont toutes indispensables ; mais il n’en est pas de même des plaisirs : nous n’accepterons que ceux qui s’accordent avec la sagesse, qui doit toujours dominer dans le mélange. Nous rejetterons donc les plus grands et les plus violents, parce qu’il troublent l’âme et détruisent la sagesse ; mais nous donnerons accès à ceux qui vont avec la santé et la tempérance et ceux qui forment le cortège de la vertu, et nous fermerons la porte à ceux qui accompagnent le vice et la folie.
Les conditions essentielles pour que notre composé soit bon, c’est qu’il soit réglé sur la vérité, qu’il ait de la mesure et de la proportion, et par suite de la beauté. Voyons maintenant lequel des deux, du plaisir et de la sagesse, est le plus proche parent du souverain bien et des trois choses qui le conditionnent, la vérité, la mesure et la beauté. Si nous considérons d’abord la vérité, rien n’en est plus éloigné que le plaisir, qui est la chose du monde la plus menteuse. L’intelligence, au contraire, est, ou bien la même chose que la vérité, ou la chose qui lui ressemble le plus. Quant à la mesure, rien n’est plus démesuré que le plaisir ; rien, au contraire, n’est plus mesuré que l’intelligence et la science. Enfin la beauté est un apanage de la sagesse qu’on n’a jamais nié, tandis que très souvent la honte et le ridicule accompagnent le plaisir.
Ainsi le plaisir n’est ni le premier, ni le second des biens. Le premier rang, dans la vie heureuse, appartient à la mesure, le deuxième à la proportion, au beau, au parfait, à ce qui se suffit à soi-même. Au troisième rang vient l’intelligence ; au quatrième, les sciences, les arts et les opinions vraies, enfin au cinquième les plaisirs exempts de douleurs qui accompagnent, les uns les connaissances, les autres les sensations.
La discussion finie, Socrate la résume. Philèbe, dit-il, soutenait que le bien, c’est le plaisir sous toutes ses formes ; moi, que l’intelligence est, pour la vie humaine, beaucoup plus avantageuse que le plaisir. J’ai ajouté que, s’il était prouvé qu’aucun des deux ne suffit au bonheur, et que la vie heureuse résulte d’une troisième chose, je soutiendrais l’intelligence contre le plaisir pour lui assurer le second prix. Nous avons alors montré que ni l’intelligence ni le plaisir ne sont suffisants par eux-mêmes, et un troisième compétiteur s’étant montré supérieur à chacun de ces deux-là, nous l’avons adopté. Puis nous avons démontré que l’intelligence a beaucoup plus d’affinité que le plaisir avec l’essence du vainqueur. Cependant la plupart des hommes donnent le premier rang au plaisir, et cèdent, comme les bêtes, à l’attrait du plaisir. Ils pensent que les appétits des bêtes sont des garants plus sûrs que les discours inspirés par une muse philosophe.
La valeur philosophique du « Philèbe »
Le Philèbe est d’abord une réfutation de la doctrine des sensualistes qui faisaient consister le bien dans le plaisir et ravalaient ainsi l’homme au rang des bêtes asservies à leurs appétits. À cette doctrine Socrate oppose la sienne, celle d’une morale tout humaine, d’où le plaisir n’est pas exclu, mais où il est strictement subordonné à la raison et à la science, morale très noble, qui donne l’empire aux plus hautes facultés de l’homme et réfrène les instincts grossiers et violents de sa nature. Pour fixer au plaisir et à la science la place exacte à laquelle ils ont droit dans l’idéal de bonheur qu’il nous propose, Platon s’est livré à une analyse approfondie du plaisir et de la sagesse. Conformément à la méthode de division qu’il a exposée au début de l’ouvrage, il a poursuivi cette analyse jusqu’à l’épuisement de toutes les espèces, de tous les caractères et de tous les degrés de l’un et l’autre. Mais avant d’aborder l’analyse psychologique, il fonde d’abord sa préférence pour la sagesse sur des raisons métaphysiques. Admettant avec les pythagoriciens que le monde est formé d’infini et de fini, et d’un mélange de fini et d’infini qui se produit sous l’empire d’une cause créatrice, il range le plaisir dans la classe inférieure, celle de l’infini, et la sagesse dans celle de la cause créatrice qui dirige l’univers. Puis il définit la douleur et le plaisir, qui résultent, selon lui, d’une rupture et d’un rétablissement de l’équilibre des éléments dont nous sommes composés ; après quoi, il passe en revue les plaisirs et les douleurs qui naissent dans le corps seul, dans l’âme seule, dans l’un et l’autre ensemble ; il les distingue selon leur vérité, leur fausseté, leur pureté, et, chemin faisant, il projette la lumière sur la sensation, sur la mémoire, sur le désir qu’il attribue à l’âme seule, sur le double sentiment que provoquent les spectacles du théâtre, en particulier sur le ridicule dans la comédie. À l’intérêt de ces belles analyses et des aperçus dont elles sont semées s’ajoute celui des allusions aux doctrines contemporaines, notamment à celle d’Antisthène, le philosophe chagrin qui nie l’existence du plaisir. Il le combat, tout en utilisant ses arguments en faveur de sa propre théorie. Et à cette occasion, il recourt encore une fois à la métaphysique pour démontrer par un argument nouveau l’infériorité du plaisir, qu’il rattache au genre de la génération ou devenir, et la supériorité de la science, qui a l’être pour objet. C’est d’après leur affinité plus ou moins grande avec l’être ou la génération qu’il classe les diverses sortes de sciences, et qu’il divise les mêmes sciences en deux espèces, selon qu’elles sont théoriques ou pratiques, qu’elles visent à atteindre l’être ou l’Idée, ou qu’elles se réduisent à des routines propres à la satisfaction des besoins ordinaires de la vie. C’est ainsi qu’il les avait déjà divisées au VII e livre de la République lorsqu’à propos de l’éducation du futur dialecticien, il distingue deux manières de traiter l’arithmétique, la géométrie, l’astronomie.
Après avoir reconnu ainsi toutes les variétés du plaisir et toutes les espèces de sciences, il compose son mélange, en y faisant entrer toutes les sciences, car elles sont toutes indispensables à l’homme, et tous les plaisirs purs et nécessaires. Mais ce dosage est une œuvre délicate qui doit être réglée sur la vérité, la mesure et la beauté.
Platon nous laisse ainsi entendre en finissant que le bonheur comporte bien des conditions difficiles à réaliser et qu’il n’est accessible qu’aux esprits modérés, doués d’une raison solide et d’un discernement délicat.
Valeur littéraire du « Philèbe »
C’est par la finesse et la perfection de ses analyses que le Philèbe est une œuvre de premier ordre. Il n’a pas en effet les agréments qui rendent la lecture du Banquet, du Phédon, du Phèdre si attrayante. D’abord il n’y a au début aucune de ces indications de lieu ni de temps, aucun de ces détails anecdotiques, aucune de ces descriptions qui donnent un charme si vif aux premières pages du Protagoras, du Lysis, du Charmide et des ouvrages que j’ai déjà cités. La cause en est que, comme dans le Cratyle, nous sommes immédiatement introduits au milieu d’une conversation. Cette manière de commencer ne manque d’ailleurs pas de piquant : elle nous change de la manière ordinaire de Platon, et elle est vive et dramatique.
Le Philèbe ne brille pas non plus par la peinture des caractères. Sans doute on y retrouve toujours la figure de Socrate et la courtoisie, la bonne humeur, les saillies, la subtilité, l’amour de la vérité, le zèle pour instruire la jeunesse qui sont les marques distinctives de son caractère. Mais ses deux interlocuteurs ne sont que de bien pâles esquisses à côté des Charmide, des Lysis, des Phèdre, et autres, qui font à Socrate un cortège si séduisant de jeunesse, de modestie, de curiosité, de respect et d’amour pour le maître qui les enseigne. Philèbe est un inconnu, sans doute un jeune homme riche, qui s’est mis à l’école des sophistes et qui, borné et têtu, ne démord plus de l’idée qu’ils ont mise dans son esprit. Protarque, fils de Callias, l’hôte attitré des sophistes, a l’esprit plus ouvert et plus souple. Il a pris les leçons de Gorgias, et il donne, comme lui, la première place à l’art de la rhétorique ; mais il aime la vérité, il est modeste, et il plaît par son ingénuité. Se voyant dans l’incapacité de répondre à une question de Socrate, il a recours à Philèbe, qui refuse de venir à son aide ; alors il avoue naïvement qu’il est embarrassé et il prie Socrate de répondre lui-même. Mais en dépit de quelques traits isolés qui sont à son honneur, Protarque n’a pas de personnalité bien marquée.
Cependant le Philèbe ne laisse pas d’être un dialogue animé et vivant. La discussion philosophique y est coupée à chaque instant de détails imprévus et naturels qui lui donnent l’aspect d’une conversation familière entre gens d’esprit. Ici c’est une menace badine qui rappelle celle du début de la République : « Ne vois-tu pas combien nous sommes et que nous sommes tous jeunes, Socrate ? Ne crains-tu pas que nous nous joignions à Philèbe pour tomber sur toi, si tu nous insultes ? » (16 a.) Là, c’est une réplique vive et plaisante : « Tu élèves bien haut ta déesse, Socrate. – Comme toi la tienne, camarade. » (28 a.) Tantôt c’est une plainte de Socrate : « Grands dieux, Protarque, quels longs discours il nous reste à faire et des discours vraiment difficiles cette fois ! » (23 b.) Tantôt c’est un appel aux dieux, auxquels Socrate demande l’inspiration (25 b) et tantôt une conclusion faite sous une forme de proclamation urbi et orbi : « Tu proclameras partout, Protarque, aux absents par des messagers, aux présents par des discours, que le plaisir n’est pas le premier des biens. » (66 a.)
La grande difficulté dans un ouvrage composé par questions et par réponses est d’éviter la monotonie. Le répondant, qui se contente le plus souvent d’un simple acquiescement, est limité dans le choix de ses formules et il est bien forcé de se répéter. Mais le questionneur a plus de ressources, et la fertile imagination de Platon a jeté beaucoup de variété dans ses interrogations. Tantôt il pose une question nette et simple, qui attend une réponse du même genre. Tantôt, au contraire, il donne à ses questions un air énigmatique, qui force l’auditeur à demander des éclaircissements. Pour réveiller la curiosité qui pourrait languir, il invite lui-même son interlocuteur à lui prêter une grande attention, ou il interrompt un développement général pour en appeler à son témoignage (21 a). Au lieu de s’adresser à Protarque, il interpelle les plaisirs eux-mêmes ou la sagesse sur leurs sentiments réciproques : « Mes amis, dit-il aux plaisirs, n’aimeriez-vous pas mieux habiter avec toute la sagesse que sans elle ? » etc. (63 b). Il serait facile d’accumuler des exemples de cette variété ; ce qui est le plus étonnant dans ces divers procédés, c’est qu’on n’y sent jamais l’artifice, si originaux qu’ils soient, tant ils viennent naturellement et sont bien accommodés à la situation. C’est ainsi que le sujet, très intéressant par lui-même, car la question du souverain bien n’a pas cessé d’être actuelle, est devenu encore plus captivant par le choix des détails et la variété de l’exposition, qui donnent au Philèbe l’air d’une véritable conversation, mais d’une conversation entre des esprits supérieurs.
La date du « Philèbe »
Cette conversation est censée avoir eu lieu du vivant de Socrate, mais aucune indication ne permet de préciser à quelle époque.
Nous sommes réduits à la même indigence de renseignements sur la date de la composition. On peut cepeendant déterminer avec assez de vraisemblance la position chronologique de ce dialogue par l’étude de son contenu. Ce que Platon dit, au début du Philèbe, de la méthode philosophique rappelle, en le complétant, ce qu’il en a déjà dit dans la République (454 a sqq. et 534 b sqq.), dans le Phèdre (265 d), dans le Parménide (129 b sqq.), dans le Sophiste (253 d) et dans le Politique (262 a, 285 a). Le développement complet de la méthode sous ses deux formes analytique et synthétique, avec des exemples qui les illustrent et les expliquent, semble bien indiquer, sans parler d’autres rapprochements qu’on pourrait faire, que le Philèbe a été composé le dernier de ces ouvrages.
D’autre part, il y a de nombreux points de contact entre le Philèbe et le Timée. On trouve dans les deux ouvrage les mêmes idées sur l’âme et le corps de l’homme formés des mêmes éléments que l’âme et le corps de l’univers, sur l’origine de la douleur et du plaisir, résultant d’une altération ou d’un rétablissement de l’ordre naturel, sur l’existence de sensations qui n’arrivent pas jusqu’à l’âme, sur la pureté des plaisirs de la vue et de l’odorat, sur la génération de l’être, etc. Ces rapprochements conduisent à placer le Philèbe entre le Politique et le Timée, à moins que le Philèbe et le Timée n’aient été composés dans le même temps. Quant à préciser la date, il y faut renoncer, faute d’indices extérieurs à la discussion philosophique.
La traduction du Philèbe a été faite sur le texte de Burnet, Platonis Opera, tome II, Oxford, 1910.
Philèbe
ou Du Plaisir
Personnages du dialogue :
Socrate, Protarque, Philèbe.
I. – Vois donc, Protarque, ce qu’est la thèse de Philèbe, dont tu vas te charger à présent, et ce qu’est la nôtre, contre laquelle tu vas argumenter, si elle est contraire à ta façon de penser. Veux-tu que nous les résumions l’une et l’autre ?
Protarque
Très volontiers.