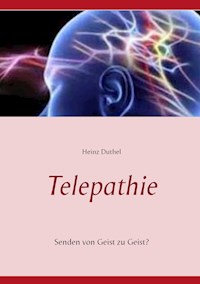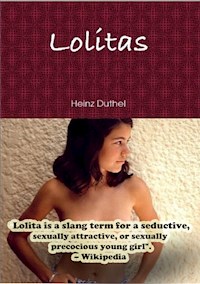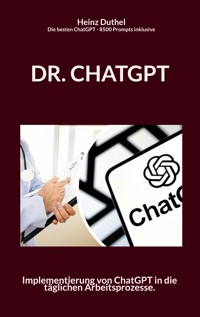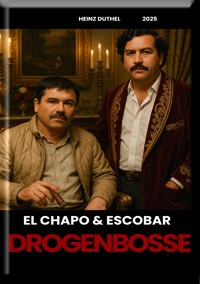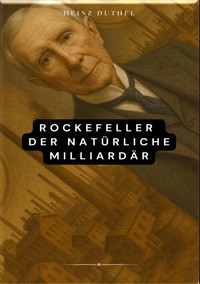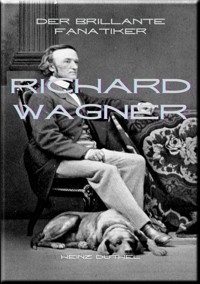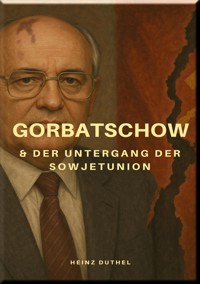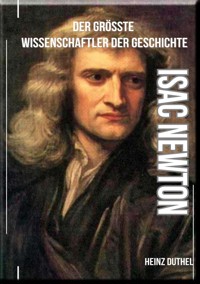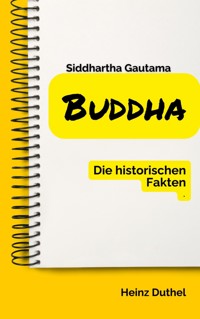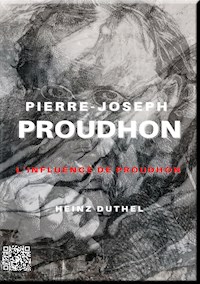
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
PIERRE-JOSEPH PROUDHON est né le 15 janvier 1809, et a ainsi grandi à l'ombre de deux grands événements, la révolution française et la révolution industrielle ; les deux, il les ressentait profondément ; le premier d'entre eux, il comprit. Il est né à Battant, faubourg de Besançon, chef-lieu du Comté Libre de Bourgogne, et son intense patriotisme local est resté une force vive dans sa vie et dans sa pensée jusqu'au jour de sa mort. Son " petit pays ", la Franche-Comté, ne faisait partie de la France que depuis cent cinquante ans lorsque Proudhon naquit ; Besançon était une véritable capitale locale, et quelques-unes des graines du fédéralisme de Proudhon, de son aversion pour Paris et de la centralisation, ont été semées dans ces premières années. C'était un citoyen d'aucune cité, un enfant d'aucun département ; et, qu'il défende l'indépendance intellectuelle du Comté de Bourgogne contre les prétentions du Duché de Bourgogne, ou qu'il attende avec délice la reconstitution des trente nationalités submergées qu'il croyait exister en France, il se battait, non seulement pour un principe général, mais pour les souvenirs et les fidélités de sa jeunesse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 743
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Philosophie politique Pierre Joseph Proudhon
On ne peut pas donner et garder en même temps.
Heinz Duthel
Copyright © 2011 – 2022 Heinz Duthel
Tous les droits sont réservés.
DÉVOUEMENT
"Celui qui met la main sur moi pour me gouverner est un usurpateur et un tyran, et je le déclare mon ennemi." (1849)
Qu'est-ce que le roi ? — Le serviteur du peuple.
Ce fut une révélation soudaine : le voile fut déchiré, un épais bandage tomba de tous les yeux. Le peuple se mit à raisonner ainsi :
Si le roi est notre serviteur, il doit nous faire rapport ;
S'il doit nous faire rapport, il est soumis à un contrôle ;
S'il peut être contrôlé, il est responsable ;
S'il est responsable, il est punissable ;
S'il est punissable, il doit être puni selon ses mérites ;
S'il doit être puni selon ses mérites, il peut être puni de mort.
REMERCIEMENTS
À mon professeur et meilleur ami, le Dr Joachim Koch. Université de Ratisbonne. Éditeur de www.philosophers-today.com
Bien que finalement éclipsé par Karl Marx, qui l'a rejeté comme un socialiste bourgeois pour ses opinions pro-marché (16 ), Proudhon a eu une influence immédiate et durable sur le mouvement anarchiste, et, plus récemment, dans les lendemains de mai 1968 et après la fin de la guerre froide.
Il fut d'abord utilisé comme référence, étonnamment, dans le Cercle Proudhon, une association de droite formée en 1911 par George Valois et Edouard Berth. Tous deux avaient été réunis par le syndicaliste Georges Sorel. Mais ils tendraient vers une synthèse du socialisme et du nationalisme, mêlant le mutualisme de Proudhon au nationalisme intégriste de Charles Maurras. En 1925, George Valois fonde le Faisceau, la première ligue fasciste qui tire son nom du fascisme de Mussolini.
En plus d'être considéré comme un anarchiste philosophique, il a également été considéré par certains comme un précurseur du fascisme. (17 ) L'historien du fascisme, en particulier des fascistes français, Zeev Sternhell, a noté cette utilisation de Proudhon par l'extrême droite. Dans La naissance de l'idéologie fasciste, il déclare que :
"l'Action française...considérait dès sa création l'auteur de La philosophie de la misère comme l'un de ses maîtres. (18 ) Il occupait une place d'honneur dans la rubrique hebdomadaire du journal du mouvement intitulée, précisément, " Nos Maîtres.' Proudhon devait cette place dans L'Action française à ce que les Maurrassiens considéraient comme son antirépublicanisme, son antisémitisme, sa haine de Rousseau, son dédain pour la Révolution française, la démocratie et le parlementarisme : et son champion de la nation, de la famille, la tradition et la monarchie."
Mais l'héritage de Proudhon ne s'est pas limité à l'instrumentation de sa pensée par la droite révolutionnaire. Il a également influencé les non-conformistes des années 1930, (19) ainsi que l'anarchisme classique. Dans les années 1960, il devient la principale influence de l'autogestion (autogestion ouvrière) en France, inspirant le syndicat CFDT, créé en 1964, et le Parti socialiste unifié (PSU), fondé en 1960 et dirigé jusqu'en 1967 par Édouard Dépreux. En particulier, l'autogestion a influencé l'expérience d'autogestion des LIP à Besançon.
La pensée de Proudhon a connu un certain renouveau depuis la fin de la guerre froide et la chute du « socialisme réel » dans le bloc de l'Est. Il peut être vaguement lié aux tentatives modernes de démocratie directe. Le Groupe Proudhon, lié à la Fédération Anarchiste, a publié une revue de 1981 à 1983 puis depuis 1994. (La première période correspond à l'élection en 1981 du candidat socialiste François Mitterrand et au tournant économique libéral de 1983 pris par le gouvernement socialiste.) Il est résolument antifasciste et apparenté à la Section Carrément Anti Le Pen qui s'oppose à Jean-Marie Le Pen). (20 ) Les anarchistes anglophones ont également tenté de maintenir vivante la tradition proudhonienne et d'engager un dialogue avec les idées de Proudhon : le mutualisme de Kevin Carson est consciemment proudhonien, et Shawn P. Wilbur a continué à faciliter la traduction en anglais de Proudhon. textes et de réfléchir sur leur signification pour le projet anarchiste contemporain.
Pierre-Joseph Proudhon (15 janvier 1809 à Besançon - 19 janvier 1865 à Passy) était un homme politique français, philosophe mutualiste et socialiste. Il était membre du Parlement français et il a été le premier à se déclarer anarchiste. Il est considéré comme l'un des écrivains et organisateurs anarchistes les plus influents. Après les événements de 1848, il commença à se dire fédéraliste. (1 )
Proudhon était un imprimeur qui apprit seul le latin afin de mieux imprimer des livres dans cette langue. Son affirmation la plus connue est que Property is Theft !, contenue dans son premier ouvrage majeur, What is Property ? Ou, une enquête sur le principe du droit et du gouvernement (Qu'est-ce que la propriété ?
Recherche sur le principe du droit et du gouvernement), publié en 1840.
La publication du livre a attiré l'attention des autorités françaises. Il a également attiré l'attention de Karl Marx, qui a commencé une correspondance avec son auteur. Les deux s'influencent mutuellement : ils se rencontrent à Paris alors que Marx y est exilé. Leur amitié a finalement pris fin lorsque Marx a répondu au système des contradictions économiques ou à la philosophie de la pauvreté de Proudhon avec le titre provocateur La pauvreté de la philosophie.
Le différend est devenu l'une des sources de la scission entre les ailes anarchiste et marxiste de l'Association internationale des travailleurs. Certains, comme Edmund Wilson , ont soutenu que l'attaque de Marx contre Proudhon avait son origine dans la défense par ce dernier de Karl Grün , que Marx détestait amèrement mais qui avait préparé des traductions de l'œuvre de Proudhon.
Proudhon a favorisé les associations ou coopératives ouvrières, ainsi que la propriété individuelle ouvrière/paysanne, plutôt que la nationalisation des terres et des lieux de travail. Il considérait que la révolution sociale pouvait être réalisée de manière pacifique.
Dans Les Confessions d'un Révolutionnaire, Proudhon affirmait que, l'Anarchie c'est l'Ordre, phrase qui inspirera bien plus tard, aux yeux de certains, le symbole anarchiste encerclé-A, aujourd'hui « l'un des graffitis les plus répandus dans le paysage urbain ». (2 )
Il a tenté en vain de créer une banque nationale, financée par ce qui est devenu une tentative avortée d'impôt sur le revenu des capitalistes et des actionnaires. Similaire à certains égards à une coopérative de crédit, elle aurait accordé des prêts sans intérêt.
Proudhon est né à Besançon, France; son père était tonnelier brasseur. Enfant, il gardait des vaches et poursuivait d'autres activités similaires et simples. Mais il n'était pas entièrement autodidacte ; à 16 ans, il entre au collège de sa ville, bien que sa famille soit si pauvre qu'il ne puisse pas acheter les livres nécessaires. Il a dû les emprunter à ses camarades afin de copier les leçons. À 19 ans, il devient compositeur de travail; plus tard, il devint correcteur de presse, corrigeant des ouvrages ecclésiastiques et acquérant ainsi une connaissance très compétente de la théologie. De cette manière aussi il en vint à apprendre l'hébreu, et à le comparer avec le grec, le latin et le français ; et c'est la première preuve de son audace intellectuelle que, fort de celle-ci, il écrit un Essai de grammaire générale. Comme Proudhon ne savait rien des vrais principes de la philologie, son traité n'avait aucune valeur (citation nécessaire). En 1838, il obtient la pension Suard, une bourse de 1500 francs par an pendant trois ans, pour l'encouragement des jeunes gens d'avenir, qui était dans le don de l'Académie de Besançon.
Intérêt pour la politique
En 1839, il écrit un traité L'Utilité de la célébration du dimanche, qui contient les germes de ses idées révolutionnaires. Vers cette époque, il se rendit à Paris, en France, où il mena une vie pauvre, ascétique et studieuse, mais se familiarisa avec les idées socialistes qui fomentaient alors dans la capitale. En 1840, il publie son premier ouvrage Qu'est-ce que la propriété (ou "What Is Property"). Sa célèbre réponse à cette question, « La propriété, c'est le vol », ne plaisait naturellement pas à l'Académie de Besançon, et il était question de lui retirer sa pension ; mais il l'a gardé pour la période régulière.
Son troisième mémoire sur la propriété était une lettre au fouriériste, M. Considérant ; il a été jugé pour cela à Besançon mais a été acquitté. En 1846, il publie le Système des contradictions économiques ou Philosophie de la misère (ou "Le système des contradictions économiques, ou la philosophie de la pauvreté"). Pendant quelque temps, Proudhon dirigea une petite imprimerie à Besançon, mais sans succès ; par la suite, il s'est lié en tant que sorte de directeur avec une entreprise commerciale à Lyon, en France. En 1847, il quitte ce travail et s'installe finalement à Paris, où il devient désormais célèbre en tant que leader de l'innovation. Cette année-là, il est également devenu franc-maçon (4 )
Révolution de 1848
Proudhon a été surpris par les Révolutions de 1848 en France. Il participa au soulèvement de février et à la composition de ce qu'il appela « la première proclamation républicaine » de la nouvelle république. Mais il avait des appréhensions vis-à-vis du nouveau gouvernement provisoire, dirigé par Dupont de l'Eure (1767-1855), qui, depuis la Révolution française en 1789, avait été un homme politique de longue date, bien que souvent dans l'opposition. Outre Dupont de l'Eure, le gouvernement provisoire était dominé par des libéraux comme Lamartine (Affaires étrangères), Ledru-Rollin (Intérieur), Crémieux (Justice), Burdeau (Guerre), etc., car il poursuivait la réforme politique au dépens de la réforme socio-économique, que Proudhon considérait comme fondamentale. Comme lors de la Révolution de juillet 1830, le Parti républicain-socialiste avait mis en place un contre-gouvernement à l'Hôtel de Ville, comprenant Louis Blanc, Armand Marrast, Ferdinand Flocon et l'ouvrier Albert.
Proudhon publie sa propre perspective de réforme qui s'achève en 1849, Solution du problème social ("Solution du problème social"), dans laquelle il expose un programme de coopération financière mutuelle entre les travailleurs. Il pensait que cela transférerait le contrôle des relations économiques des capitalistes et des financiers aux travailleurs. La partie centrale de son plan était la création d'une banque pour fournir des crédits à un taux d'intérêt très bas et l'émission de "billets de change" qui circuleraient à la place de l'argent basé sur l'or.
Pendant la Seconde République française (1848-1852), Proudhon a eu son plus grand impact public à travers le journalisme. Il s'engage dans quatre journaux : Le Représentant du Peuple (février 1848 - août 1848) ; Le Peuple (septembre 1848 - juin 1849) ; La Voix du Peuple (septembre 1849 - mai 1850) ; Le Peuple de 1850 (juin 1850 - octobre 1850). Son style d'écriture polémique, combiné à sa perception de lui-même comme un outsider politique, a produit un journalisme cynique et combatif qui a séduit de nombreux travailleurs français mais en a aliéné d'autres. Il a critiqué à plusieurs reprises les politiques du gouvernement et a promu la réforme du crédit et des changes. À cette fin, il tenta de créer une banque populaire ( Banque du peuple ) au début de 1849, mais malgré plus de 13 000 personnes s'inscrivant (pour la plupart des travailleurs), les recettes étaient limitées à 18 000 FF et l'ensemble de l'entreprise était essentiellement mort-né.
Proudhon s'est présenté à l'assemblée constituante en avril 1848, mais n'a pas été élu, bien que son nom apparaisse sur les bulletins de vote à Paris, Lyon, Besançon et Lille, France. Il remporte cependant plus tard, aux élections complémentaires du 4 juin, et est député lors des débats sur les Ateliers nationaux, créés par le décret du 25 février 1848 du républicain Louis Blanc. Les Ateliers devaient donner du travail aux chômeurs. Proudhon n'a jamais été enthousiasmé par de tels ateliers, les percevant comme des institutions essentiellement caritatives qui ne résolvaient pas les problèmes du système économique. Pourtant, il était contre leur élimination à moins qu'une alternative ne puisse être trouvée pour les travailleurs qui comptaient sur les ateliers pour leur subsistance.
En 1848, la fermeture des Ateliers Nationaux provoque l'Insurrection des Journées de Juin, et la violence choque Proudhon. Visitant personnellement les barricades, il pensa plus tard que sa présence à la Bastille à cette époque était "l'un des actes les plus honorables de ma vie". Mais en général, lors des événements tumultueux de 1848, Proudhon s'opposa à l'insurrection en prêchant la conciliation pacifique, une position qui était en accord avec sa position de toute une vie contre la violence. Il désapprouve les révoltes et les manifestations de février, mai et juin 1848, bien que sympathique aux injustices sociales et psychologiques que les insurgés ont été contraints d'endurer.
Proudhon meurt le 19 janvier 1865, et est inhumé à Paris, au cimetière du Montparnasse (2e division, près de l'allée Lenoir, dans le tombeau de la famille Proudhon).
Philosophie politique
Proudhon fut le premier à se qualifier d'anarchiste. Dans Qu'est-ce que la propriété, publié en 1840, il définit l'anarchie comme « l'absence d'un maître, d'un souverain », et dans L'Idée générale de la Révolution (1851) il prône une « société sans autorité ». Il a étendu cette analyse au-delà des institutions politiques, argumentant dans Qu'est-ce que la propriété ? que "propriétaire" était "synonyme" de "souverain". Pour Proudhon :
"Le "capital"... dans le domaine politique est analogue au "gouvernement"... L'idée économique du capitalisme, la politique de gouvernement ou d'autorité, et l'idée théologique de l'Église sont trois idées identiques, liées de diverses manières . Attaquer l'un d'eux équivaut à les attaquer tous. . . Ce que le capital fait au travail, et l'État à la liberté, l'Église le fait à l'esprit. Cette trinité de l'absolutisme est aussi funeste en pratique qu'en philosophie. Le moyen le plus efficace pour opprimer le peuple serait d'asservir simultanément son corps, sa volonté et sa raison. (5 ) ”
Proudhon dans ses premiers travaux a analysé la nature et les problèmes de l'économie capitaliste. Bien que profondément critique du capitalisme, il s'est également opposé à ces socialistes contemporains qui idolâtraient l'association. Dans une séquence de commentaires, extraits de Qu'est-ce que la propriété ? (1840) à travers la Théorie de la propriété publiée à titre posthume (1863-1864), il déclare tour à tour que "la propriété c'est le vol", "la propriété c'est l'impossible", "la propriété c'est le despotisme" et "la propriété c'est la liberté" . Lorsqu'il a dit que "la propriété, c'est du vol", il faisait référence au propriétaire terrien ou au capitaliste qui, selon lui, "volait" les bénéfices des ouvriers. Pour Proudhon, l'employé du capitaliste était « subordonné, exploité : sa condition permanente est celle de l'obéissance ». (6 )
En affirmant que la propriété est liberté, il se référait non seulement au produit du travail d'un individu, mais à la maison du paysan ou de l'artisan et aux outils de son métier et au revenu qu'il recevait en vendant ses biens. Pour Proudhon, la seule source légitime de propriété est le travail. Ce que l'on produit est sa propriété et tout ce qui est au-delà ne l'est pas. Il prône l'autogestion ouvrière et est partisan de la propriété privée des moyens de production. Il a vigoureusement rejeté la propriété des produits du travail par la société, arguant dans Qu'est-ce que la propriété ? que si "la propriété du produit (...) n'emporte pas avec elle la propriété des moyens de production" (7 ) (...) Le droit au produit est exclusif (...) le droit aux moyens est commun" et l'appliqua à la terre (« la terre est (... ) une chose commune » (8 ) et aux lieux de travail (« tout capital accumulé étant propriété sociale, nul ne peut en être le propriétaire exclusif » (9 ). que la « société » soit propriétaire des moyens de production ou de la terre, mais plutôt que « l'utilisateur » en soit propriétaire (sous la tutelle de la société, avec « l'organisation de sociétés régulatrices » afin de « réguler le marché ». (10 ) Proudhon se disait socialiste, mais il s'oppose à la propriété étatique des biens du capital au profit de la propriété par les travailleurs eux-mêmes dans les associations, ce qui fait de lui l'un des premiers théoriciens du socialisme libertaire. siècle et au XXe siècle, de l'autogestion ouvrière (autogestion).
Cette propriété d'usage, il l'appelait « possession », et ce mutualisme du système économique. Proudhon avait de nombreux arguments contre le droit à la terre et au capital, y compris des raisons fondées sur la moralité, l'économie, la politique et la liberté individuelle. L'un de ces arguments était qu'il permettait le profit, qui à son tour conduisait à l'instabilité sociale et à la guerre en créant des cycles d'endettement qui finissaient par vaincre la capacité du travail à les rembourser. Une autre était qu'elle produisait du « despotisme » et transformait les ouvriers en salariés soumis à l'autorité d'un patron.
Dans Qu'est-ce que la propriété ? Proudhon a écrit:
La propriété, agissant par exclusion et par empiétement, tandis que la population augmentait, a été le principe vital et la cause définitive de toutes les révolutions. Les guerres de religion et les guerres de conquête, lorsqu'elles se sont arrêtées avant l'extermination des races, n'ont été que des troubles accidentels, bientôt réparés par la progression mathématique de la vie des nations. La chute et la mort des sociétés sont dues au pouvoir d'accumulation que possède la propriété.
Joseph Déjacque a attaqué le soutien de Proudhon aux notions de patriarcat, ce que les anarchistes de la fin du XXe siècle appelleraient le sexisme, comme étant tout à fait en contradiction avec les principes anarchistes.
Vers la fin de sa vie, Proudhon a modifié certaines de ses vues antérieures. Dans Le principe de la fédération (1863), il modifia sa position anti-étatique antérieure, plaidant pour "l'équilibrage de l'autorité par la liberté" et avança une "théorie du gouvernement fédéral" décentralisée. Il a également défini différemment l'anarchie comme « le gouvernement de chacun par soi-même », ce qui signifiait « que les fonctions politiques ont été réduites à des fonctions industrielles, et que l'ordre social ne résulte que de transactions et d'échanges ». Ce travail l'a également vu qualifier son système économique de "fédération agro-industrielle", arguant qu'il fournirait "des dispositions fédérales spécifiques visant à protéger les citoyens des États fédérés du féodalisme capitaliste et financier, à la fois en leur sein et de l'extérieur" et arrêtez donc la réintroduction du « travail salarié ». En effet, "le droit politique doit être étayé par le droit économique".
Dans la théorie de la propriété publiée à titre posthume, il a soutenu que "la propriété est le seul pouvoir qui peut agir comme un contrepoids à l'État". Ainsi, « Proudhon pourrait retenir l'idée de la propriété comme vol, et en même temps en proposer une nouvelle définition comme liberté. de la société et un rempart contre le pouvoir toujours envahissant de l'État. (11 )
Il a continué à s'opposer à la fois à la propriété capitaliste et à la propriété d'État. Dans Théorie de la propriété, il soutient : « Maintenant, en 1840, j'ai catégoriquement rejeté la notion de propriété... tant pour le groupe que pour l'individu », mais énonce ensuite sa nouvelle théorie de la propriété : « La propriété est la plus grande force révolutionnaire qui existe, avec une capacité inégalée de s'opposer à l'autorité... » et « la fonction principale de la propriété privée dans le système politique sera de faire contrepoids au pouvoir de l'État et, ce faisant, d'assurer la liberté de l'individu ». ." Cependant, il a continué à s'opposer aux concentrations de richesse et de propriété, plaidant pour la propriété à petite échelle associée aux paysans et aux artisans. Il s'oppose toujours à la propriété privée de la terre : « Ce que je ne peux pas accepter, concernant la terre, c'est que le travail effectué donne droit à la propriété de ce qui a été travaillé. En outre, il croyait toujours que cette "propriété" devrait être plus équitablement répartie et limitée en taille à celle effectivement utilisée par les individus, les familles et les associations de travailleurs. (12) Il soutenait le droit d'héritage, et le défendait « comme l'un des fondements de la famille et de la société ». (13 ) Cependant, il a refusé d'étendre cela au-delà des biens personnels en arguant que « (sous le droit d'association, la transmission de la richesse ne s'applique pas aux instruments de travail». (14 )
En conséquence de son opposition au profit, au travail salarié, à l'exploitation ouvrière, à la propriété de la terre et du capital, ainsi qu'à la propriété d'État, Proudhon a rejeté à la fois le capitalisme et le communisme. Il a adopté le terme mutualisme pour sa marque d'anarchisme, qui impliquait le contrôle des moyens de production par les travailleurs. Dans sa vision, les artisans indépendants, les paysans et les coopératives commercialiseraient leurs produits sur le marché. Pour Proudhon, les usines et autres grands lieux de travail seraient dirigés par des "associations ouvrières" fonctionnant selon des principes directement démocratiques. L'État serait aboli ; au lieu de cela, la société serait organisée par une fédération de «communes libres» (une commune est une municipalité locale en français). En 1863, Proudhon disait : « Toutes mes idées économiques développées depuis vingt-cinq ans peuvent se résumer dans ces mots : fédération agro-industrielle. Toutes mes idées politiques se résument à une formule semblable : fédération politique ou décentralisation.
Proudhon s'oppose à la perception d'intérêts et de fermages, mais ne cherche pas à les abolir par la loi : « Je proteste que lorsque j'ai critiqué... l'ensemble des institutions dont la propriété est la pierre angulaire, je n'ai jamais voulu interdire ou supprimer, en décret souverain, rente foncière et intérêt du capital. Je pense que toutes ces manifestations de l'activité humaine doivent rester libres et volontaires pour tous : je ne demande pour elles aucune modification, restriction ou suppression, autre que celles qui résultent naturellement et nécessairement de la mondialisation. du principe de réciprocité que je propose." (15 )
Proudhon était un révolutionnaire, mais sa révolution ne signifiait pas un bouleversement violent ou une guerre civile, mais plutôt la transformation de la société. Cette transformation était essentiellement de nature morale et exigeait la plus haute éthique de la part de ceux qui recherchaient le changement. C'est la réforme monétaire, conjuguée à l'organisation d'une banque de crédit et d' associations ouvrières, que Proudhon propose d'utiliser comme levier pour opérer une nouvelle organisation de la société. Il n'a pas suggéré comment les institutions monétaires feraient face au problème de l'inflation et à la nécessité d'une allocation efficace des ressources rares.
Il a fait peu de critiques publiques de Marx ou du marxisme, parce que de son vivant Marx était un penseur relativement mineur ; ce n'est qu'après la mort de Proudhon que le marxisme est devenu un grand mouvement. Il a cependant critiqué les socialistes autoritaires de son époque. Cela incluait le socialiste d'État Louis Blanc, dont Proudhon disait : « Permettez-moi de dire à M. Blanc : vous ne désirez ni le catholicisme, ni la monarchie, ni la noblesse, mais vous devez avoir un Dieu, une religion, une dictature, une censure, une hiérarchie, distinctions et rangs. Pour ma part, je renie votre Dieu, votre autorité, votre souveraineté, votre État judiciaire et toutes vos mystifications représentatives. C'était le livre de Proudhon Qu'est-ce que la propriété ? qui a convaincu le jeune Karl Marx que la propriété privée devait être abolie.
Dans l'un de ses premiers ouvrages, La Sainte Famille, Marx disait : « Non seulement Proudhon écrit dans l'intérêt des prolétaires, mais il est lui-même un prolétaire, un ouvrier. Son œuvre est un manifeste scientifique du prolétariat français. Marx, cependant, n'était pas d'accord avec l'anarchisme de Proudhon et a publié plus tard des critiques vicieuses de Proudhon. Marx a écrit La Pauvreté de la Philosophie comme une réfutation de La Philosophie de la Pauvreté de Proudhon. Dans son socialisme, Proudhon a été suivi par Mikhaïl Bakounine.
Héritage
Bien que finalement éclipsé par Karl Marx, qui l'a rejeté comme un socialiste bourgeois pour ses opinions pro-marché (16 ), Proudhon a eu une influence immédiate et durable sur le mouvement anarchiste, et, plus récemment, dans les lendemains de mai 1968 et après la fin de la guerre froide.
Il fut d'abord utilisé comme référence, étonnamment, dans le Cercle Proudhon, une association de droite formée en 1911 par George Valois et Edouard Berth. Tous deux avaient été réunis par le syndicaliste Georges Sorel. Mais ils tendraient vers une synthèse du socialisme et du nationalisme, mêlant le mutualisme de Proudhon au nationalisme intégriste de Charles Maurras. En 1925, George Valois fonde le Faisceau, la première ligue fasciste qui tire son nom du fasci de Mussolini.
En plus d'être considéré comme un anarchiste philosophique, il a également été considéré par certains comme un précurseur du fascisme. (17 ) L'historien du fascisme, en particulier des fascistes français, Zeev Sternhell, a noté cette utilisation de Proudhon par l'extrême droite. Dans La naissance de l'idéologie fasciste, il déclare que :
"l'Action française...considérait dès sa création l'auteur de La philosophie de la misère comme l'un de ses maîtres. (18 ) Il occupait une place d'honneur dans la rubrique hebdomadaire du journal du mouvement intitulée, précisément, " Nos Maîtres.' Proudhon devait cette place dans L'Action française à ce que les Maurrassiens considéraient comme son antirépublicanisme, son antisémitisme, sa haine de Rousseau, son dédain pour la Révolution française, la démocratie et le parlementarisme : et son champion de la nation, de la famille, la tradition et la monarchie."
Mais l'héritage de Proudhon ne s'est pas limité à l'instrumentation de sa pensée par la droite révolutionnaire. Il a également influencé les non-conformistes des années 1930, (19) ainsi que l'anarchisme classique. Dans les années 1960, il devient la principale influence de l'autogestion (autogestion ouvrière) en France, inspirant le syndicat CFDT, créé en 1964, et le Parti socialiste unifié (PSU), fondé en 1960 et dirigé jusqu'en 1967 par Édouard Dépreux. En particulier, l'autogestion a influencé l'expérience d'autogestion des LIP à Besançon.
La pensée de Proudhon a connu un certain renouveau depuis la fin de la guerre froide et la chute du « socialisme réel » dans le bloc de l'Est. Il peut être vaguement lié aux tentatives modernes de démocratie directe. Le Groupe Proudhon, lié à la Fédération Anarchiste, a publié une revue de 1981 à 1983 puis depuis 1994. (La première période correspond à l'élection en 1981 du candidat socialiste François Mitterrand et au tournant économique libéral de 1983 pris par le gouvernement socialiste.) Il est résolument antifasciste et apparenté à la Section Carrément Anti Le Pen qui s'oppose à Jean-Marie Le Pen). (20 ) Les anarchistes anglophones ont également tenté de maintenir vivante la tradition proudhonienne et d'engager un dialogue avec les idées de Proudhon : le mutualisme de Kevin Carson est consciemment proudhonien, et Shawn P. Wilbur a continué à faciliter la traduction en anglais de Proudhon. textes et de réfléchir sur leur signification pour le projet anarchiste contemporain.
Critiques et racisme présumé
Stewart Edwards, l'éditeur des Écrits choisis de Pierre-Joseph Proudhon, remarque : « Les journaux de Proudhon (Carnets, éd. P. Haubtmann, Marcel Rivière, Paris 1960 à ce jour) révèlent qu'il avait des sentiments presque paranoïaques de haine contre les Juifs, courant en Europe à l'époque. En 1847, il envisage de publier un article contre la race juive, qu'il dit "détester". L'article proposé aurait "appelé à l'expulsion des Juifs de France... Le Juif est l'ennemi". de la race humaine. Cette race doit être renvoyée en Asie, ou exterminée. H. Heine, A. Weil et d'autres ne sont que des espions secrets. Rothschild, Crémieux, Marx, Fould, mauvais colériques, envieux, amers etc., etc., qui nous haïssent." (Carnets, vol. 2, p. 337 : n° VI, 178)
J. Salwyn Schapiro a écrit en 1945 :
Proudhon avait la tendance, inévitable chez l'antisémite, de voir dans les juifs la source première des malheurs de la nation, et de les associer à des personnes et à des groupes qu'il détestait... L'antisémitisme, toujours et partout, l'épreuve décisive du racisme, avec sa division de l'humanité en races créatrices et stériles, conduit Proudhon à considérer le nègre comme le plus bas dans la hiérarchie raciale. Pendant la guerre civile américaine, il a favorisé le Sud qui, a-t-il insisté, n'avait pas entièrement tort de maintenir l'esclavage. Les Nègres, selon Proudhon, étaient une race inférieure, un exemple de l'existence d'inégalités entre les races de l'humanité... Son livre La Guerre et la paix, paru en 1861, était un hymne à la guerre, entonné d'une manière plus clé passionnée que tout ce que produisent les fascistes de notre temps... Presque chaque page de La Guerre et la paix contient une glorification de la guerre comme idéal et comme institution... Son éloge hystérique de la guerre, comme son ardent championnat de la la dictature de Louis Napoléon, comme son soutien indéfectible à la classe moyenne, faisait partie intégrante de sa philosophie sociale... Dans le puissant polémiste du milieu du XIXe siècle, il est désormais possible de discerner un signe avant-coureur du grand mal mondial du fascisme . Une énigme irritante pour sa propre génération, ses enseignements compris à tort comme de l'anarchie par ses disciples, la place de Proudhon dans l'histoire intellectuelle est destinée à prendre une importance nouvelle et plus grande. Elle viendra avec la réévaluation du XIXe siècle, comme prélude à la révolution mondiale que l'on appelle aujourd'hui la seconde guerre mondiale. (21 )
Selon George Woodcock, certaines positions prises par Proudhon "s'accordent étrangement avec son anarchisme avoué". Par exemple, il propose que chaque citoyen accomplisse un ou deux ans de service dans la milice. (22 ) La proposition est apparue dans le Programme Révolutionnaire, un manifeste électoral publié par Proudhon après qu'il ait été invité à briguer un poste dans le gouvernement provisoire. Le texte se lit comme suit : « 7° 'L'armée. – Abolition immédiate de la conscription et des remplacements ; obligation pour tout citoyen de faire, pendant un ou deux ans, le service militaire ; application de l'armée aux services administratifs et travaux d « utilité publique ». (« Le service militaire par tous les citoyens est proposé comme une alternative à la conscription et à la pratique du « remplacement », par laquelle ceux qui pourraient éviter un tel service. ») La critique de Woodcock est compréhensible. Or, dans le même document, Proudhon décrit la « forme de gouvernement » qu'il propose comme « une centralisation analogue à celle de l'État, mais dans laquelle personne n'obéit, personne n'est dépendant, et chacun est libre et souverain ». (23 )
Albert Meltzer dit que bien que Proudhon ait utilisé le terme "anarchiste", il n'en était pas un, et qu'il ne s'est jamais engagé dans "une activité ou une lutte anarchiste, en effet Proudhon s'est engagé dans une activité parlementaire". (24 )
Devis
L'essai de Proudhon sur Qu'est-ce que le gouvernement ? est assez connu :
Être GOUVERNÉ, c'est être surveillé, inspecté, espionné, dirigé, guidé par la loi, numéroté, réglementé, enrôlé, endoctriné, prêché, contrôlé, vérifié, estimé, valorisé, censuré, commandé, par des créatures qui n'ont ni le droit ni la sagesse ni la vertu de le faire. Être GOUVERNÉ, c'est être à chaque opération, à chaque transaction notée, enregistrée, comptée, taxée, timbrée, mesurée, numérotée, taxée, licenciée, autorisée, admonestée, empêchée, interdite, réformée, corrigée, punie. C'est, sous prétexte d'utilité publique, et au nom de l'intérêt général, être placé (d ) sous contribution, foré, escroqué, exploité, accaparé, extorqué, pressé, mystifié, volé ; puis, à la moindre résistance, le premier mot de plainte, être réprimé, verbalisé, vilipendé, harcelé, traqué, abusé, matraqué, désarmé, ligoté, étouffé, emprisonné, jugé, condamné, fusillé, déporté, sacrifié, vendu, trahi; et pour couronner le tout, moqué, ridiculisé, ridiculisé, outragé, déshonoré. C'est le gouvernement; c'est sa justice; c'est sa moralité. (P.-J. Proudhon, General Idea of the Revolution in the Nineteenth Century, traduit par John Beverly Robinson (Londres : Freedom Press, 1923), pp. 293-294.)
Une autre citation célèbre était son « dialogue avec un philistin » dans Qu'est-ce que la propriété ? :
"Pourquoi, comment pouvez-vous poser une telle question? Vous êtes un républicain."
« Républicain ! Oui ; mais ce mot n'indique rien. Res publica ; c'est-à-dire la chose publique. Or, quiconque s'intéresse aux affaires publiques – quelle que soit la forme de gouvernement – peut se dire républicain. Même les rois sont républicains. "
"Eh bien! Vous êtes un démocrate?"
"Non."
"Quoi! "vous auriez une monarchie?"
"Non."
« Un constitutionnaliste ?
"Dieu pardonne."
« Alors vous êtes un aristocrate ?
"Pas du tout!"
« Vous voulez une forme mixte de gouvernement ?
"Encore moins."
« Alors qu'est-ce que tu es ?
"Je suis un anarchiste."
« Oh ! je vous comprends ; vous parlez de façon satirique. C'est un coup porté au gouvernement.
— Pas du tout. Je viens de vous faire ma profession de foi sérieuse et mûrement réfléchie. Bien qu'ami intime de l'ordre, je suis (dans toute la force du terme) un anarchiste. Écoutez-moi.
Aussi:
"Celui qui met la main sur moi pour me gouverner est un usurpateur et un tyran, et je le déclare mon ennemi." (1849)
Qu'est-ce que la propriété ?
Le Système des contradictions économiques ou Philosophie de la pauvreté est un ouvrage publié en 1847 par Pierre-Joseph Proudhon. Il a inspiré Karl Marx pour écrire la réplique La misère de la philosophie.
Qu'est-ce que la propriété ? : ou une enquête sur le principe du droit et du gouvernement propriété et sa relation avec la philosophie anarchiste par l'anarchiste et mutualiste français Pierre-Joseph Proudhon, publié pour la première fois en 1840.
Dans le livre, Proudhon a notamment déclaré que « la propriété, c'est du vol ». Proudhon croyait que la conception commune de la propriété regroupait deux composantes distinctes qui, une fois identifiées, démontraient la différence entre la propriété utilisée pour favoriser la tyrannie et la propriété utilisée pour protéger la liberté. Il a fait valoir que le résultat du travail d'un individu qui est actuellement occupé ou utilisé est une forme légitime de propriété. Ainsi, il s'est opposé à ce que la terre inutilisée soit considérée comme une propriété, estimant que la terre ne peut être légitimement possédée que par usage ou occupation (qu'il a appelé «possession»). Dans le prolongement de sa conviction que la propriété légitime (possession) était le résultat du travail et de l'occupation, il s'est opposé à des institutions telles que les intérêts sur les prêts et les loyers.
Le propriétaire, le voleur, le héros, le souverain — car tous ces titres sont synonymes — impose sa volonté comme loi, et ne souffre ni contradiction ni contrôle ; c'est-à-dire qu'il prétend être à la fois le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif . . . [et ainsi] la propriété engendre le despotisme. . . C'est si clairement l'essence de la propriété que, pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler ce qu'elle est et d'observer ce qui se passe autour de soi. La propriété est le droit d'user et d'abuser. . . si les biens sont des biens, pourquoi les propriétaires ne seraient-ils pas des rois, et des rois despotiques, des rois en proportion de leurs facultés bonitaires ? Et si chaque propriétaire est seigneur souverain dans la sphère de sa propriété, roi absolu dans son propre domaine, comment un gouvernement de propriétaires pourrait-il être autre chose que chaos et confusion ?
Proudhon opposait le prétendu droit de propriété aux droits (qu'il considérait comme valables) de liberté, d'égalité et de sûreté, en disant : « La liberté et la sûreté des riches ne souffrent pas de la liberté et de la sûreté des pauvres ; loin de là, ils se renforcent et se soutiennent mutuellement. Le droit de propriété du riche, au contraire, doit être continuellement défendu contre le désir de propriété du pauvre. Il soutenait en outre que le droit de propriété contredisait ces autres droits : « Alors, si nous sommes associés au nom de la liberté, de l'égalité et de la sécurité, nous ne sommes pas associés au nom de la propriété ; alors si la propriété est un droit naturel, ce droit naturel le droit n'est pas social, mais antisocial. La propriété et la société sont des institutions totalement inconciliables.
Bien que Proudhon rejette le droit de propriété en soi, il soutient également que l'état de possession tel qu'il est (ou était) ne pourrait être justifié même en supposant ce droit. Ici, il feint d'intenter une action en justice contre la société, dans un style moqueur de la rhétorique juridique :
En écrivant ce mémoire contre la propriété, j'introduis contre la société universelle une action pétitionnaire : je prouve que ceux qui ne possèdent pas aujourd'hui sont propriétaires au même titre que ceux qui possèdent ; mais, au lieu d'en inférer que la propriété doit être partagée par tous, j'exige, au nom de la sécurité générale, son entière abolition. Si je n'obtiens pas gain de cause, il ne nous reste plus (la classe prolétarienne et moi-même) qu'à nous égorger : nous ne pouvons rien demander de plus à la justice des nations ; car, comme le dit le code de procédure (art 26) dans son style énergique, le demandeur qui a été débouté en action petitoire, est forclos de ce fait d'exercer une action possessoire. Si, au contraire, j'ai gain de cause, nous devons alors commencer une action possessoire, [une reprise légale] afin que nous puissions être rétablis dans la jouissance de la richesse dont nous sommes privés par la propriété. J'espère que nous ne serons pas forcés à cette extrémité ; mais ces deux actions ne peuvent être poursuivies à la fois, une telle démarche étant interdite par le même code de procédure.
—Pierre-Joseph Proudhon, Qu'est-ce que la propriété ?
Proudhon prétend que son traité « prouvera hors de tout doute que la propriété, pour être juste et possible, doit nécessairement avoir l'égalité pour sa condition ». Il a utilisé le terme mutualisme pour décrire sa vision d'une économie dans laquelle les individus et les associations démocratiques de travailleurs pourraient échanger leurs produits sur le marché sous la contrainte de l'égalité.
Certains anarchistes contemporains utilisent les termes propriété personnelle (ou propriété possessive) et propriété privée pour signifier les distinctions que Proudhon a avancées en ce qui concerne la propriété du produit du travail et la propriété de la terre. En ce sens, la propriété privée ferait référence à la propriété revendiquée de terres ou de biens inutilisés, et la propriété personnelle ferait référence au produit du travail actuellement utilisé. Cette différenciation est une composante importante de la critique anarchiste du capitalisme.
L'IDÉE D'UNE INSURRECTION.
Si on me demandait de répondre à la question suivante : qu'est-ce que l'esclavage ? et je devrais répondre en un mot, c'est un meurtre, mon sens serait compris tout de suite. Aucun argument étendu ne serait nécessaire pour montrer que le pouvoir d'ôter à un homme sa pensée, sa volonté, sa personnalité, est un pouvoir de vie et de mort ; et qu'asservir un homme, c'est le tuer. Pourquoi donc à cette autre question : Qu'est-ce que la propriété ? ne puis-je pas répondre de même : c'est du vol, sans la certitude d'être mal compris ; la seconde proposition n'étant autre chose qu'une transformation de la première ?
Je m'engage à discuter du principe vital de notre gouvernement et de nos institutions, la propriété : je suis dans mon droit. Je peux me tromper sur la conclusion qui résultera de mes investigations : j'ai raison. Je pense qu'il vaut mieux placer la dernière pensée de mon livre en premier : suis-je toujours dans mon droit.
Un tel auteur enseigne que la propriété est un droit civil, né de l'occupation et sanctionné par la loi ; un autre soutient que c'est un droit naturel, né du travail, — et ces deux doctrines, tout opposées qu'elles puissent paraître, sont encouragées et applaudies. Je soutiens que ni le travail, ni l'occupation, ni la loi ne peuvent créer la propriété ; que c'est un effet sans cause : suis-je blâmable ?
Mais des murmures s'élèvent !
La propriété est un vol! C'est le cri de guerre de '93 ! C'est le signal des révolutions !
Lecteur, calmez-vous : je ne suis pas un agent de discorde, aucun tison de sédition. J'anticipe l'histoire de quelques jours ; Je dévoile une vérité dont on essaierait en vain d'arrêter le développement ; J'écris le préambule de notre future constitution. Cette proposition qui vous paraît blasphématoire — la propriété est un vol — serait, si nos préjugés nous permettaient de l'envisager, reconnue comme le paratonnerre qui nous protège de la foudre prochaine ; mais trop d'intérêts s'y opposent ! . . . Hélas! la philosophie ne changera pas le cours des événements : le destin s'accomplira indépendamment de la prophétie. D'ailleurs, la justice ne doit-elle pas être rendue et notre éducation terminée ?
La propriété est un vol! . . . Quelle révolution dans les idées humaines ! Propriétaire et voleur ont été de tout temps des expressions aussi contradictoires que les êtres qu'ils désignent sont hostiles ; toutes les langues ont perpétué cette opposition. Sur quelle autorité vous risquez-vous donc à attaquer le consentement universel et à démentir le genre humain ? Qui es-tu pour interroger le jugement des nations et des âges ?
Quelle conséquence pour vous, lecteur, est mon obscure individualité ? Je vis, comme vous, dans un siècle où la raison ne se soumet qu'au fait et à l'évidence. Mon nom, comme le vôtre, est chercheur de vérité.1 Ma mission est écrite dans ces paroles de la loi : Parlez sans haine et sans peur ; dis ce que tu sais ! Le travail de notre race est de construire le temple de la science, et cette science comprend l'homme et la nature. Maintenant, la vérité se révèle à tous ; aujourd'hui à Newton et Pascal, demain au berger de la vallée et au compagnon de la boutique. Chacun apporte sa pierre à l'édifice ; et, sa tâche accomplie, disparaît. L'éternité nous précède, l'éternité nous suit : entre deux infinis, de quoi compte un pauvre mortel pour que le siècle s'informe de lui ?
Ignore donc, lecteur, mon titre et mon caractère, et n'écoute que mes arguments. C'est conformément au consentement universel que je m'engage à corriger l'erreur universelle ; de l'opinion du genre humain, j'en appelle à sa foi. Ayez le courage de me suivre; et, si votre volonté est libre, si votre conscience est libre, si votre esprit peut unir deux propositions et en déduire une troisième, mes idées deviendront inévitablement les vôtres. En commençant par vous dire mon dernier mot, mon but était de vous avertir, non de vous défier ; car je suis certain que, si vous me lisez, vous serez forcé d'y consentir. Les choses dont je vais parler sont si simples et si claires que vous vous étonnerez de ne pas les avoir aperçues auparavant, et vous direz : « J'ai négligé de penser. D'autres vous offrent le spectacle du génie lui arrachant les secrets de la nature et dévoilant devant vous ses sublimes messages ; vous n'y trouverez qu'une série d'expériences sur la justice et le droit, une sorte de vérification des poids et mesures de votre conscience. Les opérations seront conduites sous vos yeux ; et tu pèseras le résultat.
Néanmoins, je ne construis aucun système. Je demande la fin des privilèges, l'abolition de l'esclavage, l'égalité des droits et le règne de la loi. Justice, rien d'autre; c'est l'alpha et l'oméga de mon propos : à d'autres je laisse le soin de gouverner le monde.
Un jour, je me suis demandé : pourquoi y a-t-il tant de chagrin et de misère dans la société ? L'homme doit-il toujours être misérable ? Et non satisfaits des explications données par les réformateurs, — ceux-ci attribuant la détresse générale à la lâcheté et à l'incapacité gouvernementales, celles aux conspirateurs et aux émeutes, d'autres encore à l'ignorance et à la corruption générale, — et las des querelles interminables de la tribune et de la presse. , j'ai cherché à approfondir la question moi-même. J'ai consulté les maîtres de la science ; J'ai lu cent volumes de philosophie, de droit, d'économie politique et d'histoire : plût à Dieu que j'eusse vécu dans un siècle où tant de lectures m'aient été inutiles ! Je me suis efforcé d'obtenir des renseignements exacts, comparant des doctrines, répondant à des objections, construisant sans cesse des équations et des réductions à partir d'arguments, et pesant des milliers de syllogismes dans les balances de la logique la plus rigoureuse. Dans ce travail laborieux, j'ai recueilli de nombreux faits intéressants que je partagerai avec mes amis et le public dès que j'en aurai le loisir. Mais je dois dire que je reconnus tout de suite que nous n'avions jamais compris le sens de ces mots si communs et pourtant si sacrés : Justice, équité, liberté ; que sur chacun de ces principes nos idées ont été tout à fait obscures ; et, en effet, que cette ignorance était la seule cause, et de la misère qui nous dévore, et de toutes les calamités qui ont jamais affligé le genre humain.
Mon esprit s'effraya de ce résultat étrange : je doutais de ma raison. Quoi! dis-je, ce que l'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendu, ni la perspicacité pénétré, vous l'avez découvert ! Misérable, ne prends pas les visions de ton cerveau malade pour les vérités de la science ! Ne savez-vous pas (de grands philosophes l'ont dit) qu'en matière de morale pratique l'erreur universelle est une contradiction ?
Je résolus alors d'éprouver mes arguments ; et en entrant dans ce nouveau travail, je cherchais une réponse aux questions suivantes : Est-il possible que l'humanité ait été si longtemps et si universellement trompée dans l'application des principes moraux ? Comment et pourquoi pourrait-il se tromper ? Comment son erreur, étant universelle, peut-elle être corrigée ?
Ces questions, dont la solution dépendait de la certitude de mes conclusions, n'opposèrent pas longtemps de résistance à l'analyse. On verra, au chapitre V de cet ouvrage, qu'en morale, comme dans toutes les autres branches du savoir, les erreurs les plus graves sont les dogmes de la science ; que, même dans les œuvres de justice, se tromper est un privilège qui ennoblit l'homme ; et que tout mérite philosophique qui m'est attaché est infiniment petit. Nommer une chose est facile : la difficulté est de la discerner avant son apparition. En exprimant la dernière étape d'une idée, — une idée qui imprègne tous les esprits, et qui demain sera proclamée par un autre si je ne l'énonce pas aujourd'hui, — je ne peux prétendre à aucun mérite, si ce n'est celui de la priorité d'énonciation. . Faisons-nous l'éloge de l'homme qui aperçoit le premier l'aube ?
Oui : tous les hommes croient et répètent que l'égalité des conditions est identique à l'égalité des droits ; que la propriété et le vol sont des termes synonymes ; que tout avantage social accordé, ou plutôt usurpé, au nom d'un talent ou d'un service supérieur, est iniquité et extorsion. Tous les hommes dans leur cœur, dis-je, témoignent de ces vérités ; il suffit de leur faire comprendre.
Avant d'aborder directement la question qui m'est posée, je dois dire un mot du chemin que je vais parcourir. Quand Pascal a abordé un problème géométrique, il a inventé une méthode de résolution ; pour résoudre un problème de philosophie, il faut également une méthode. Eh bien, de combien les problèmes dont traite la philosophie dépassent-ils par la gravité de leurs résultats ceux dont traite la géométrie ! Combien plus impérieusement, alors, demandent-ils pour leur solution une analyse profonde et rigoureuse !
C'est un fait placé à jamais hors de doute, disent les psychologues modernes, que toute perception reçue par l'esprit est déterminée par certaines lois générales qui gouvernent l'esprit ; se moule, pour ainsi dire, dans certains types préexistants à notre entendement, et qui en constituent la condition originelle. Ainsi, disent-ils, si l'esprit n'a pas d'idées innées, il a au moins des formes innées. Ainsi, par exemple, tout phénomène est nécessairement conçu par nous comme se produisant dans le temps et dans l'espace, ce qui nous oblige à inférer une cause de son apparition ; tout ce qui existe implique les idées de substance, de mode, de rapport, de nombre, etc. ; en un mot, on ne forme aucune idée qui ne se rapporte à quelqu'un des principes généraux de la raison, indépendamment desquels rien n'existe.
Ces axiomes de l'entendement, ajoutent les psychologues, ces types fondamentaux, par lesquels se forment inévitablement tous nos jugements et toutes nos idées, et que nos sensations ne servent qu'à éclairer, sont connus dans les écoles sous le nom de catégories. Leur existence primordiale dans l'esprit est aujourd'hui démontrée ; il suffit de les systématiser et de les cataloguer. Aristote en a reconnu dix ; Kant en porta le nombre à quinze ; M. Cousin l'a réduit à trois, à deux, à un ; et la gloire indiscutable de ce professeur sera due à ce que, s'il n'a pas découvert la véritable théorie des catégories, il a, du moins, vu plus clairement que personne l'immense importance de cette question, — la plus grande et la plus importante. peut-être le seul dont la métaphysique ait à s'occuper.
J'avoue que je ne crois pas à l'innéité, non seulement des idées, mais aussi des formes ou des lois de notre entendement ; et je tiens la métaphysique de Reid et de Kant encore plus éloignée de la vérité que celle d'Aristote. Cependant, comme je ne veux pas entrer ici dans une discussion de l'esprit, tâche qui exigerait beaucoup de travail et n'intéresserait pas le public, j'admettrai l'hypothèse que nos idées les plus générales et les plus nécessaires, telles que le temps , espace, substance et cause — existent à l'origine dans l'esprit ; ou, du moins, découlent immédiatement de sa constitution.
Mais c'est un fait psychologique non moins vrai, et auquel les philosophes ont trop peu prêté attention, que l'habitude, comme une seconde nature, a le pouvoir de fixer dans l'esprit de nouvelles formes catégorielles dérivées des apparences qui nous impressionnent, et par eux généralement dépouillés de réalité objective, mais dont l'influence sur nos jugements n'est pas moins déterminante que celle des catégories originelles. Aussi raisonnons-nous d'après les lois éternelles et absolues de notre esprit, et en même temps d'après les règles secondaires, ordinairement défectueuses, qui nous sont suggérées par l'observation imparfaite. C'est la source la plus féconde de faux préjugés, et la cause permanente et souvent invincible d'une multitude d'erreurs. Le préjugé résultant de ces préjugés est si fort que souvent, même lorsque nous luttons contre un principe que notre esprit juge faux, qui répugne à notre raison, et que notre conscience désapprouve, nous le défendons sans le savoir, nous raisonnons conformément avec lui, et nous lui obéissons en l'attaquant. Enfermé dans un cercle, notre esprit tourne sur lui-même, jusqu'à ce qu'une nouvelle observation, créant en nous de nouvelles idées, fasse apparaître un principe extérieur qui nous délivre du fantôme dont notre imagination est possédée.
Ainsi, nous savons aujourd'hui que, par les lois d'un magnétisme universel dont la cause est encore inconnue, deux corps (aucun obstacle n'intervenant) tendent à s'unir par une force motrice accélérée que nous appelons gravitation. C'est la gravitation qui fait tomber à terre les corps sans appui, qui leur donne du poids et qui nous attache à la terre sur laquelle nous vivons. L'ignorance de cette cause était le seul obstacle qui empêchait les anciens de croire aux antipodes. « Ne vois-tu pas, dit saint Augustin après Lactance, que s'il y avait des hommes sous nos pieds, leur tête serait tournée vers le bas, et qu'ils tomberaient dans le ciel ? L'évêque d'Hippone, qui pensait la terre plate parce qu'elle paraissait ainsi à l'œil, supposait en conséquence que, si l'on reliait par des lignes droites le zénith au nadir en différents endroits, ces lignes seraient parallèles entre elles ; et dans la direction de ces lignes, il traçait chaque mouvement de haut en bas. De là il a naturellement conclu que les étoiles roulaient des torches placées dans la voûte du ciel ; que, laissés à eux-mêmes, ils tomberaient à terre dans une pluie de feu ; que la terre était une vaste plaine, formant la partie inférieure du monde, etc. Si on lui avait demandé par quoi le monde lui-même était soutenu, il aurait répondu qu'il ne le savait pas, mais qu'à Dieu rien n'est impossible. Telles étaient les idées de saint Augustin à l'égard de l'espace et du mouvement, idées fixées en lui par un préjugé tiré d'une apparence, et qui étaient devenues chez lui une règle générale et catégorique de jugement. De la raison pour laquelle les corps tombent, son esprit ne savait rien ; il pouvait seulement dire qu'un corps tombe parce qu'il tombe.
Chez nous l'idée de chute est plus complexe : aux idées générales d'espace et de mouvement qu'elle implique, nous ajoutons celle d'attraction ou de direction vers un centre, qui nous donne l'idée supérieure de cause. Mais si la physique a bien corrigé notre jugement à cet égard, nous nous servons encore du préjugé de saint Augustin ; et quand nous disons qu'une chose est tombée, nous ne voulons pas dire simplement et en général qu'il y a eu un effet de gravitation, mais spécialement et en particulier que c'est vers la terre, et de haut en bas, que ce mouvement a pris lieu. Notre esprit est éclairé en vain ; l'imagination l'emporte, et notre langue reste à jamais incorrigible. Descendre du ciel est une expression aussi incorrecte que monter au ciel ; et pourtant cette expression vivra tant que les hommes utiliseront le langage.
Toutes ces phrases — de haut en bas ; descendre du ciel; tomber des nuages, etc. — sont désormais inoffensives, car nous savons les rectifier en pratique ; mais daignons considérer un instant combien elles ont retardé les progrès de la science. Si, en effet, il importe peu à la statistique, à la mécanique, à l'hydrodynamique et à la balistique, que la véritable cause de la chute des corps soit connue, et que nos idées sur les mouvements généraux dans l'espace soient exactes, il est tout autrement quand on entreprend d'expliquer le système de l'univers, la cause des marées, la forme de la terre et sa position dans le ciel : pour comprendre ces choses, il faut sortir du cercle des apparences. De tous temps il y a eu des mécaniciens ingénieux, d'excellents architectes, d'habiles artilleurs : toute erreur dans laquelle il leur était possible de tomber sur la rotondité de la terre et la gravitation, ne retardait en rien le développement de leur art ; la solidité de leurs constructions et la justesse de leur tir n'en étaient pas affectées. Mais tôt ou tard ils furent contraints de se débattre avec des phénomènes que le parallélisme supposé de toutes les perpendiculaires érigées à la surface de la terre rendait inexplicables : alors s'engagea aussi une lutte entre les préjugés, qui pendant des siècles avaient suffi à la pratique quotidienne, et les opinions sans précédent qui le témoignage des yeux semblait contredire.
Ainsi, d'une part, les jugements les plus faux, qu'ils soient fondés sur des faits isolés ou sur les seules apparences, embrassent toujours des vérités dont la sphère, grande ou petite, laisse place à un certain nombre d'inférences, au-delà desquelles on tombe dans l'absurdité. Les idées de saint Augustin, par exemple, contenaient les vérités suivantes : que les corps tombent vers la terre, qu'ils tombent en ligne droite, que le soleil ou la terre se meut, que le ciel ou la terre tourne, etc. Ces faits généraux ont toujours été vrais ; notre science n'y a rien ajouté. Mais, d'autre part, comme il faut rendre compte de tout, on est obligé de chercher des principes de plus en plus compréhensifs : c'est pourquoi on a dû abandonner successivement, d'abord l'opinion que le monde était plat, puis la théorie qui le considère comme le centre stationnaire de l'univers, etc.
Si nous passons maintenant de la nature physique au monde moral, nous nous trouvons encore soumis aux mêmes tromperies de l'apparence, aux mêmes influences de la spontanéité et de l'habitude. Mais le trait distinctif de cette seconde division de nos connaissances est, d'une part, le bien ou le mal que nous tirons de nos opinions ; et, d'autre part, l'obstination avec laquelle nous défendons le préjugé qui nous tourmente et nous tue.
Quelle que soit la théorie que nous embrassions en ce qui concerne la forme de la terre et la cause de son poids, la physique du globe n'en souffre pas ; et, quant à nous, notre économie sociale ne peut en tirer ni profit ni dommage. Mais c'est en nous et par nous que les lois de notre nature morale opèrent ; or, ces lois ne peuvent être exécutées sans notre aide délibérée, et, par conséquent, si nous ne les connaissons pas. Si donc notre science des lois morales est fausse, il est évident qu'en voulant notre propre bien, nous accomplissons notre propre mal ; s'il n'est qu'incomplet, il peut suffire un temps à notre progrès social, mais à la longue il nous conduira dans une mauvaise voie et nous précipitera finalement dans un abîme de calamités.
C'est alors que nous devons exercer nos jugements les plus élevés ; et, soit dit à notre gloire, elles ne manquent jamais : mais alors aussi commence une lutte acharnée entre les vieux préjugés et les idées nouvelles. Jours de conflagration et d'angoisse ! On nous raconte le temps où, avec les mêmes croyances, avec les mêmes institutions, tout le monde semblait heureux : pourquoi se plaindre de ces croyances ; pourquoi bannir ces institutions ? Nous sommes lents à admettre que cet âge heureux servait précisément à développer le principe du mal qui sommeillait dans la société ; nous accusons les hommes et les dieux, les puissances de la terre et les forces de la nature. Au lieu de chercher la cause du mal dans son esprit et dans son cœur, l'homme blâme ses maîtres, ses rivaux, ses voisins et lui-même ; les nations s'arment, s'entre-tuent et s'exterminent , jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli par la vaste dépopulation, et que la paix renaît des cendres des combattants. Ainsi répugne l'humanité à toucher aux coutumes de ses ancêtres, et à changer les lois élaborées par les fondateurs des communautés, et confirmées par la fidèle observance des âges.
Nihil motum ex antiquo probabile est : Méfiez-vous de toutes les innovations, écrivait Tite-Live. Sans doute il vaudrait mieux que l'homme ne soit pas obligé de changer : mais quoi ! parce qu'il est né ignorant, parce qu'il n'existe qu'à condition de s'instruire graduellement, doit-il abjurer la lumière, abdiquer sa raison et s'abandonner à la fortune ? La parfaite santé vaut mieux que la convalescence : le malade doit-il donc refuser de guérir ? Réforme, réforme ! cria, depuis des siècles, Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Réforme, réforme ! criaient nos pères, il y a cinquante ans ; et pendant longtemps nous crierons : réformez, réformez !
Voyant la misère de mon âge, je me suis dit : Parmi les principes qui soutiennent la société, il y en a un qu'elle ne comprend pas, que son ignorance a vicié, et qui cause tout le mal qui existe. Ce principe est le plus ancien de tous ; car c'est le propre des révolutions d'abattre les principes les plus modernes et de respecter ceux qui sont anciens. Or le mal dont nous souffrons est antérieur à toutes les révolutions. Ce principe, affaibli par notre ignorance, est honoré et chéri ; car s'il n'était pas chéri, il ne ferait de mal à personne, il serait sans influence.
Mais ce principe, juste dans sa finalité, mais incompris : ce principe, aussi vieux que l'humanité, qu'est-ce que c'est ? Cela peut-il être religieux ?
Tous les hommes croient en Dieu : ce dogme appartient à la fois à leur conscience et à leur esprit. Pour l'humanité, Dieu est un fait aussi primitif, une idée aussi inévitable, un principe aussi nécessaire que le sont les idées catégoriques de cause, de substance, de temps et d'espace à notre entendement. Dieu nous est prouvé par la conscience avant toute inférence de l'esprit ; de même que le soleil nous est prouvé par le témoignage des sens avant tous les arguments de la physique. Nous découvrons des phénomènes et des lois par l'observation et l'expérience ; seul ce sens plus profond nous révèle l'existence. L'humanité croit que Dieu est; mais, en croyant en Dieu, que croit-il ? En un mot, qu'est-ce que Dieu ?
La nature de cette notion de Divinité, — cette notion primitive, universelle, née dans la race, — l'esprit humain n'a pas encore sondé. A chaque pas que nous faisons dans notre investigation de la nature et des causes, l'idée de Dieu s'étend et s'exalte ; plus la science avance, plus Dieu semble grandir et s'élargir. L'anthropomorphisme et l'idolâtrie constituaient nécessairement la foi de l'esprit dans sa jeunesse, la théologie de l'enfance et la poésie. Erreur anodine, s'ils n'avaient pas essayé d'en faire une règle de conduite, et s'ils avaient été assez sages pour respecter la liberté de pensée. Mais ayant fait Dieu à son image, l'homme a voulu se l'approprier davantage encore ; non content de défigurer le Tout-Puissant, il le traitait comme son patrimoine, ses biens, ses possessions. Dieu, représenté sous des formes monstrueuses, est devenu dans le monde entier la propriété de l'homme et de l'État. Telle fut l'origine de la corruption des mœurs par la religion, et la source des querelles pieuses et des guerres saintes. Dieu merci! nous avons appris à permettre à chacun ses propres croyances ; nous cherchons des lois morales hors du domaine de la religion. Au lieu de légiférer sur la nature et les attributs de Dieu, les dogmes de la théologie et le destin de nos âmes, nous attendons sagement que la science nous dise ce qu'il faut rejeter et ce qu'il faut accepter. Dieu, l'âme, la religion, — objets éternels de notre inlassable pensée et de nos plus fatales aberrations, problèmes terribles dont la solution, à jamais tentée, à jamais reste inachevée, — sur toutes ces questions nous pouvons encore nous tromper, mais du moins notre erreur est-elle sans danger. Avec la liberté dans la religion et la séparation du pouvoir spirituel du pouvoir temporel, l'influence des idées religieuses sur le progrès de la société est purement négative ; aucune loi, aucune institution politique ou civile n'étant fondée sur la religion. La négligence des devoirs imposés par la religion peut accroître la corruption générale, mais ce n'en est pas la cause première ; ce n'est qu'un auxiliaire ou un résultat. Il est universellement admis, et surtout dans la matière qui retient maintenant notre attention, que la cause de l'inégalité des conditions entre les hommes - du paupérisme, de la misère universelle et des embarras gouvernementaux - ne peut plus être attribuée à la religion : il faut aller plus loin en arrière, et creuser encore plus profondément.
Mais qu'y a-t-il dans l'homme de plus ancien et de plus profond que le sentiment religieux ?
Il y a l'homme lui-même ; c'est-à-dire volonté et conscience, libre arbitre et loi, éternellement antagonistes. L'homme est en guerre contre lui-même : pourquoi ?
"L'homme", disent les théologiens, "a transgressé au commencement; notre race est coupable d'une offense ancienne. Pour cette transgression l'humanité est tombée; l'erreur et l'ignorance sont devenues sa nourriture. Lisez l'histoire, vous trouverez la preuve universelle de cette nécessité pour mal dans la misère permanente des nations. L'homme souffre et souffrira toujours ; sa maladie est héréditaire et constitutionnelle. Utilisez des palliatifs, employez des émollients ; il n'y a pas de remède.