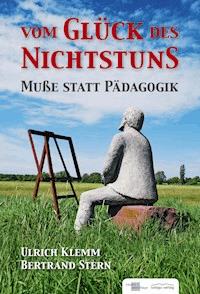Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondation Ipsen BookLab
- Kategorie: Bildung
- Serie: National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine
- Sprache: Französisch
Les femmes sont sous-représentées dans les carrières en sciences, technologie, ingénierie, mathématiques et médecine (STEMM) et de nombreuses histoires personnelles témoignent des effets néfastes des préjugés, du harcèlement et de la discrimination dans le milieu scientifique. Malgré des progrès, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer le recrutement, la pérennité et l’avancement des femmes dans les STEMM.
Pratiques prometteuses pour remédier à la sous-représentation des femmes dans les domaines des sciences, de l’ingénierie et de la médecine est une approche intentionnelle et fondée sur des preuves visant à mettre en place des programmes, des interventions et des politiques qui peuvent rapidement avoir un impact positif dans les organisations académiques.
Le changement positif est possible. Ce rapport, basé sur des données probantes collectées par des autorités mondiales, propose des solutions concrètes pour améliorer les opportunités de carrière des femmes dans les STEMM.
À PROPOS DE L'AUTEURLes rapports d’étude consensuels publiés par les
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine exposent le consensus fondé sur des preuves d’un comité d’auteures et auteurs ayant une expertise reconnue sur l’énoncé des tâches de l’étude. Les rapports contiennent généralement des résultats, conclusions et recommandations qui se fondent sur les informations recueillies par le Comité et qui résultent des délibérations du Comité. Chaque rapport a été soumis à l’examen rigoureux et indépendant de confrères et est représentatif de la position des National Academies sur la déclaration de mission.
Les trois académies travaillent conjointement en tant que National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine afin de fournir des analyses et des conseils indépendants et objectifs à la nation et de mener d’autres activités pour résoudre des problèmes complexes et éclairer les décisions de politique publique. Les National Academies encouragent également l’éducation et la recherche, reconnaissent les contributions exceptionnelles à l’enrichissement des connaissances et améliorent la compréhension du public en matière de science, d’ingénierie et de médecine.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Titre
LES NATIONAL ACADEMIES PRESS 500 Fifth Street, NW Washington, DC 20001
Cette activité a été soutenue par des contrats conclus entre la National Academy of Sciences et les National Institutes of Health (prix # 10004234), la Fondation nationale des sciences (prix # 10003816) et L’Oréal USA. Les opinions, résultats, conclusions ou recommandations exprimés dans cette publication ne reflètent pas nécessairement les points de vue des organisations, ou agences, qui ont apporté leur concours à ce projet.
Numéro international normalisé du livre -13 : 978-0-309-49824-1
Numéro international normalisé du livre -10 : 0-309-49824-4
Identifiant numérique d’objet : https://doi.org/ 10.17226/ 25585
Numéro de contrôle de la Bibliothèque du Congrès : 2020933491
Des exemplaires supplémentaires de cette publication sont disponibles à la vente auprès des National Academies Press, 500 Fifth Street, NW, Keck 360, Washington, DC 20001 ; (800) 624-6242 ou (202) 334-3313 ; http://www.nap.edu.
Copyright 2020 des National Academy of Sciences. Tous droits réservés.
Achevé d’imprimer aux États-Unis d’Amérique
Citation suggérée : National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2020. Promising Practices for Addressing the Underrepresentation of Women in Science, Engineering, and Medicine. Washington, DC : The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/25585.
La National Academy of Sciences – Académie nationales des Sciences – a été créée en 1863 par une loi du Congrès signée par le président Lincoln, en tant qu’institution privée et non gouvernementale chargée de conseiller la Nation sur les questions liées aux sciences et à la technologie. Les membres sont élus par leurs pairs pour leurs remarquables contributions à la recherche. Le Dr Marcia McNutt en est la présidente.
La National Academy of Engineering – Académie nationale d’Ingénierie – a été créée en 1964 sous l’égide de la National Academy of Sciences afin de mettre les pratiques de l’ingénierie au service la Nation. Les membres sont élus par leurs pairs pour leurs remarquables contributions à l’ingénierie. Le Dr John L. Anderson en est le président.
La National Academy of Medicine – Académie nationale de Médecine – (anciennement Institute of Medicine) a été créée en 1970 en vertu de la charte de la National Academy of Sciences pour conseiller la Nation sur les questions médicales et sanitaires. Les membres sont élus par leurs pairs pour leurs remarquables contributions à la médecine et à la santé. Le Dr Victor J. Dzau en est le président.
Les trois académies travaillent conjointement en tant que National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine afin de fournir des analyses et des conseils indépendants et objectifs à la Nation et mener d’autres activités pour résoudre des problèmes complexes et éclairer les décisions de politique publique. Les National Academies encouragent également l’éducation et la recherche, reconnaissent les contributions remarquables à l’enrichissement des connaissances et améliorent la compréhension du public en matière de sciences, d’ingénierie et de médecine.
Pour en savoir plus sur les National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, consultez le site www.nationalacademies.org.
Les rapports d’étude consensuels publiés par les National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine exposent le consensus fondé sur des preuves apportées par un comité d’expertes et experts, autrices et auteurs. Les rapports contiennent généralement des résultats, conclusions des recommandations qui se fondent sur les informations recueillies par le Comité et qui résultent des délibérations du Comité. Chaque rapport a été soumis à un processus rigoureux et indépendant d’examen de confrères et est représentatif de la position des National Academies sur la déclaration de mission.
Les comptes-rendus publiés par les National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine font état des présentations et des discussions soulevées lors d’ateliers, de symposiums ou de tout autre événement organisé par les National Academies. Les déclarations et les opinions contenues dans les comptes-rendus sont celles des participants et ne sont pas nécessairement approuvées par d’autres participants, le comité de planification ou les National Academies.
Pour plus d’informations sur les autres produits et activités des National Academies, veuillez consulter le site www.nationalacademies.org/about/whatwedo.
COMITÉ SUR L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE FEMMES DANS LES SCIENCES, LA TECHNOLOGIE, L’INGÉNIERIE, LES MATHÉMATIQUES ET LA MÉDECINE (STEMM)1
(11 décembre 2019 - 31 mars 2020)
RITA COLWELL, Ph.D. (présidente) [NAS]2, professeure émérite, University of Maryland à College Park et Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health ; ancienne directrice, National Science Foundation ; ancienne présidente, Comité sur les femmes dans les sciences, l’ingénierie et la médecine des National Academies
GILDA A. BARABINO, Ph.D. [NAE], professeure titulaire de la chaire Daniel et Frances Berg, doyenne de la Grove School of Engineering, City College of New York ; membre actuel du Comité sur les femmes dans les sciences, l’ingénierie et la médecine des National Academies
MAY R. BERENBAUM, Ph.D. [NAS], professeure d’entomologie de la chaire Swanlund, University of Illinois à Urbana-Champaign ; rédactrice en chef, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America ; membre actuel du Comité sur les femmes dans les sciences, l’ingénierie et la médecine des National Academies
VIVIAN W. PINN, M.D. [NAM], directeur fondateur (retraité), Office of Research on Women’s Health, National Institutes of Health ; ancien membre du Comité sur les femmes dans les sciences, l’ingénierie et la médecine des National Academies
BILLY WILLIAMS, M.S., vice-président pour l’éthique, la diversité et l’inclusion, Union américaine de géophysique
Comité d’étude
ASHLEY BEAR, directrice de l’étude, responsable du programme, Comité sur les femmes dans les sciences, l’ingénierie et la médecine des National Academies
ALEX HELMAN, responsable de programme, Comité sur les femmes dans les sciences, l’ingénierie et la médecine des National Academies
THOMAS RUDIN, directeur, Comité sur les femmes dans les sciences, l’ingénierie et la médecine des National Academies
ARIELLE BAKER, chargée de programme adjointe, Comité sur les femmes dans les sciences, l’ingénierie et la médecine
MARQUITA WHITING, assistante principale de programme, Comité sur les femmes dans les sciences, l’ingénierie et la médecine
ADRIANA COUREMBIS, responsable financier, Comité sur les femmes dans les sciences, l’ingénierie et la médecine
LAYNE SCHERER, chargé de programme, Commission de l’enseignement supérieur et de la main-d’œuvre
LIDA BENINSON, chargée de programme, Commission de l’enseignement supérieur et de la main-d’œuvre
FRAZIER BENYA, chargé de programme, Commission de l’enseignement supérieur et de la main-d’œuvre
MARIA LUND DAHLBERG, chargée de programme, Commission de l’enseignement supérieur et de la main-d’œuvre
IRENE NGUN, chargée de programme adjointe, Commission de l’enseignement supérieur et de la main-d’œuvre
AUSTEN APPLEGATE, chercheur associé, Commission de l’enseignement supérieur et de la main-d’œuvre
REBECCA MORGAN, MLIS, documentaliste
ANNE MARIE HOUPPERT, MSLS, documentaliste
Consultantes et consultants
JENNIFER SAUNDERS, rédactrice et rapporteuse
MICHELLE RODRIGUES, boursière postdoctorante, Université de l’Illinois
KATHRYN CLANCY, professeure associée d’anthropologie, Université de l’Illinois
EVAVA PIETRI, professeure adjointe, Indiana University–Purdue University Indianapolis
CORINNE MOSS-RACUSIN, professeure associée, Skidmore College
LESLIE ASHBURN-NARDO, professeure associée, Indiana University–Purdue University Indianapolis
JOJANNEKE VAN DER TOORN, professeure, Leiden University
CHRISTINE LINDQUIST, RTI International
TASSELI McCAY, chercheuse en sciences sociales, Division de la recherche appliquée sur la justice, RTI International
1Le Comité sur l’augmentation du nombre de femmes dans les sciences, la technologie, l’ingénierie, les mathématiques et la médecine (STEMM) et les National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM) sont seuls responsables du contenu final du rapport.
2Nomme les membres des National Academies of Sciences (NAS), National Academy of Engineering (NAE) et des National Academy of Medicine (NAM).
COMITÉ CHARGÉ DE COMPRENDRE ET DE LUTTER CONTRE LA SOUS-REPRÉSENTATION DES FEMMES DANS CERTAINES DISCIPLINES DES SCIENCES ET DE L’INGÉNIERIE1
(5 octobre 2018 - 10 décembre 2019)
MAE JEMISON, (présidente) [NAM]2, présidente et fondatrice du Jemison Group, Inc. et directrice de 100 Year Starship
DIANA BILIMORIA, docteure, professeure et présidente de KeyBank, département du comportement organisationnel, Case Western Reserve University
JOHN C. BOOTHROYD, docteur, (NAS), professeur d’immunologie de la chaire Burt et Marion Avery, département de microbiologie et d’immunologie, et vice-président associé pour l’enseignement supérieur et les affaires postdoctorales, Université de Stanford
PHYLLIS L. CARR, M.D., professeur associé de médecine, Harvard Medical School, et médecin au Women’s Health Associates, Massachusetts General Hospital
SAPNA CHERYAN, docteur, professeur, département de psychologie, Université de Washington
JAIME CURTIS-FISK, docteur, scientifique, The Dow Chemical Company
ELENA FUENTES-AFFLICK, MD, MPH (NAM), professeure de pédiatrie et vice-doyenne des affaires académiques, Université de Californie, San Francisco (démissionnaire en novembre 2019)
IRENE FONSECA, docteur, professeur de mathématiques de l’Université Kavčić-Moura, Université Carnegie Mellon
ANN Q. GATES, docteure, professeure et présidente du département d’informatique, Université du Texas à El Paso
KELLY M. MACK, docteure, vice-présidente de l’éducation STEM de premier cycle, directrice exécutive du projet Kaléidoscope, Association of American Colleges and Universities
RONKE OLABISI, docteure, professeure adjointe, chaire de développement de la faculté Samueli, département de génie biomédical, Université de Californie, Irvine
PATRICIA RANKIN, docteur, professeur de physique, département de physique, Université du Colorado, Boulder
KEIVAN G. STASSUN, docteur, professeur de physique et d’astronomie de la chaire Stevenson, professeur d’informatique et directeur du Frist Center for Autism & Innovation à l’Université Vanderbilt
DENISE SEKAQUAPTEWA, docteure, professeure de psychologie de la diversité et de la transformation sociale à l’Université du Michigan
SONYA T. SMITH, docteure, présidente élue de Sigma Xi : The Scientific Research Honor Society, et professeure au département de génie mécanique de l’Université Howard
STEVEN J. SPENCER, docteur, chaire Robert K. et Dale J. Weary, psychologie sociale, Ohio State University Ohio State University
ABIGAIL J. STEWART, docteure, professeure émérite de psychologie et d’études féminines de la chaire Sandra Schwartz Tangri, Université du Michigan-Ann Arbor
Comité d’étude
MARILYN BAKER, directrice de l’étude (octobre 2019-décembre 2019)
ASHLEY BEAR, docteure, directrice de l’étude (octobre 2018-septembre 2019), chargée de programme principale, Comité sur les femmes dans les sciences, l’ingénierie et la médecine
ALEX HELMAN, docteur, chargé de programme, Comité pour les femmes dans les sciences, l’ingénierie et la médecine
THOMAS RUDIN, M.S., directeur, Comité pour les femmes dans les sciences, l’ingénierie et la médecine
ARIELLE BAKER, docteure, agente de programme associée, Comité pour les femmes dans les sciences, l’ingénierie et la médecine
MARQUITA WHITING, assistante de programme principale, Comité pour les femmes dans les sciences, l’ingénierie et la médecine
JOHN VERAS, assistant de programme principal, Commission de l’enseignement supérieur et de la main-d’œuvre
ADRIANA COUREMBIS, agent financier, Comité sur les femmes dans les sciences, l’ingénierie et la médecine
Consultant et consultantes
KATHLEEN COLGAN, docteure, rédactrice
JENNIFER SAUNDERS, docteure, rédactrice et rapporteuse
MICHELLE RODRIGUES, docteure, boursière postdoctorante, Université de l’Illinois
KATHRYN CLANCY, docteure, professeure associée d’anthropologie,
Université de l’Illinois
EVAVA PIETRI, docteure, professeure adjointe, Université d’Indiana-Purdue Indianapolis
CORINNE MOSS-RACUSIN, docteure, professeure associée, Skidmore College
LESLIE ASHBURN-NARDO, docteure, professeure associée, Indiana University-Purdue University Indianapolis
JOJANNEKE VAN DER TOORN, docteure, professeure, Université de Leiden
CHRISTINE LINDQUIST, docteure, RTI International
TASSELI McCAY, M.P.H., chercheuse en sciences sociales, Division de la recherche appliquée sur la justice, RTI International
1Les membres du Comité chargé de comprendre et de lutter contre la sous-représentation des femmes dans certaines disciplines des sciences et de l’ingénierie ont contribué activement au contenu du rapport du 5 octobre 2018 au 10 décembre 2019 et méritent une reconnaissance toute particulière pour leur contribution intellectuelle substantielle. Ils ne sont pas responsables du contenu de ce rapport, y compris des conclusions et des recommandations.
2Désigne l’appartenance à la National Academy of Sciences (NAS), National Academy of Engineering (NAE) ou à la National Academy of Medicine (NAM)
Je n’avais pas conscience que des portes m’étaient fermées jusqu’à ce que je commence à y frapper.
Gertrude B. Elion, lauréate du prix Nobel de physiologie et de médecine en 1988
Préface
Au XXIe siècle, les domaines de la science, de l’ingénierie et de la médecine contribuent de manière significative à soutenir et faire progresser la sécurité, la prospérité et la santé de notre nation. Cependant, les découvertes scientifiques, les innovations en matière d’ingénierie et les progrès médicaux ne tombent pas du ciel ; ils sont le fruit de la passion, de l’ingéniosité et du travail acharné de personnes dévouées. Pour relever les défis d’aujourd’hui et de demain, il est essentiel que tous les membres de la société s’engagent pleinement et se montrent proactifs.
Malheureusement, de nombreux domaines des sciences, de l’ingénierie et de la médecine continuent de faire face à une immense pénurie de talents, et les femmes – qui représentent plus de 50 % de la population – sont largement sous-représentées dans ces domaines. Bien que le nombre de femmes qui poursuivent des études et des carrières dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie, des mathématiques et de la médecine (STEMM) ait augmenté, et que la parité ait même été atteinte dans certains de ces domaines, la représentation des femmes dans les STEMM demeure un défi. Les femmes de couleur sont largement sous-représentées dans toutes les disciplines des STEMM. Les femmes sont notamment sous-représentées en ingénierie, en informatique et en physique, et ce à tous les niveaux. Dans les domaines où le nombre de diplômés et de professionnels en début de carrière est égal, comme en médecine, elles sont sous-représentées aux postes de direction.
Les données relatives à la sous-représentation des femmes dans les STEMM et les témoignages des effets néfastes des préjugés, de la discrimination et du harcèlement dans les domaines scientifiques soulignent le fait qu’il reste beaucoup à faire pour améliorer le recrutement, le maintien et l’avancement des femmes dans les STEMM. Il y a des raisons d’être optimiste et de penser que nous pouvons améliorer la situation. Il est essentiel de prendre en compte l’ensemble des leçons tirées des recherches scientifiques présentées dans ce rapport et que nous prenions note des nombreux exemples de réussite exposés et qui démontrent qu’une approche volontaire et éprouvée dans la mise en œuvre concrète de politiques, programmes et interventions peut générer un impact extrêmement positif dans un laps de temps relativement court.
Au cours de ma carrière, j’ai eu le privilège d’analyser cette problématique sous de nombreux angles différents : en tant que scientifique, en tant que directrice d’une agence fédérale, en tant que directrice d’un institut scientifique, en tant que conseillère auprès d’organisations gouvernementales et à but non lucratif et, désormais, en tant que présidente de cette étude. Je retire de ces expériences la ferme conviction que si toutes les parties prenantes partagent la passion, la volonté et la persévérance nécessaires pour parvenir à un changement positif, nous pouvons relever le défi de créer un monde scientifique, technique et médical plus diversifié, plus équitable et plus inclusif.
Rita Colwell, présidente
Remerciements
Ce rapport est l’aboutissement du travail de deux comités : le Comité pour l’augmentation du nombre de femmes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie, des mathématiques et de la médecine (STEMM) [Rita Colwell, présidente] et le Comité chargé de comprendre et de lutter contre la sous-représentation des femmes dans certaines disciplines des sciences et de l’ingénierie (Mae Jemison, présidente). Le Comité sur la compréhension de la sous-représentation a activement contribué à la rédaction de ce rapport entre le 5 octobre 2018 et le 10 décembre 2019, et le Comité pour l’augmentation du nombre de femmes dans les STEMM du 11 décembre 2019 jusqu’à sa révision, son achèvement et sa publication.
Les membres du Comité chargé de comprendre et de lutter contre la sous-représentation des femmes dans certaines disciplines des sciences et de l’ingénierie ont largement contribué aux conclusions de ce rapport. Ils ne sont toutefois pas responsables du contenu de ce rapport, y compris des conclusions et des recommandations. Le Comité pour l’augmentation du nombre de femmes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie, des mathématiques et de la médecine (STEMM) et les National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (les National Academies) sont seuls responsables du contenu final du rapport.
Remerciements du Comité
Ce comité tient à remercier les membres du Comité chargé de comprendre et de lutter contre la sous-représentation des femmes dans certaines disciplines des sciences et de l’ingénierie pour leur travail diligent et les contributions intellectuelles substantielles qu’ils ont apportées à ce rapport. Ils ont analysé les données sur le statut des femmes dans de multiples disciplines des STEMM, ont documenté les facteurs contribuant à la persistance de la sous-représentation des femmes malgré des décennies d’efforts pour l’atténuer, et ont présenté des exemples de blocages volontaires et involontaires auxquels les femmes sont confrontées à de nombreux niveaux. Ils ont également identifié des programmes d’intervention efficaces, ont donné un aperçu de l’importance du contexte institutionnel dans la mise en œuvre de programmes réussis, et ont proposé des actions pour accroître la participation des femmes et des filles dans les STEMM.
Pour préparer ce rapport, nous avons puisé dans l’ensemble des ressources compilées pour ce projet, notamment une solide base de données existante, les recommandations tirées des rapports précédents des National Academies, trois documents rédigés par des chercheurs indépendants et commandités par les National Academies, ainsi que dans d’importantes recherches préliminaires et des comptes-rendus rédigés par le comité de l’étude. Nous avons également examiné de nouvelles recherches et mené notre propre analyse, en nous appuyant sur les preuves et l’expertise des membres du comité. En outre, le rapport s’appuie de manière significative sur les idées, les interprétations de la recherche et les conclusions des membres du Comité chargé de comprendre la sous-représentation des femmes. Leurs analyses sont largement utilisées dans les discussions sur les données et les conclusions des documents de recherche commandés aux chapitres 2 et 3. De plus, bon nombre de stratégies visant à mettre en œuvre des changements dans le recrutement, le maintien et l’avancement des universitaires au chapitre 4, qui présente 17 stratégies pratiques permettant aux établissements d’enseignement supérieur de mettre en œuvre des changements, constituent des stratégies formulées par ce comité, que nous remercions vivement.
Le Comité tient également à souligner le travail effectué par les consultants qui ont contribué à ce rapport : Jennifer Saunders, Michelle Rodrigues, Kathryn Clancy, Evava Pietre, Corinne Moss-Racusin, Leslie Ashburn-Nardo, Jojanneke Van Der Toorn, Christine Lindquist et Tasseli McCay. Leurs recherches et leurs écrits ont contribué de manière substantielle à l’établissement des preuves présentées dans ce rapport.
Nous tenons également à sincèrement remercier le comité d’étude pour son leadership et ses précieux conseils, ainsi que pour les activités de recherche et de rédaction approfondies qu’il a entreprises afin de soutenir cette étude, dans le cadre de son travail avec les deux comités. Plus précisément, nous tenons à remercier Ashley Bear, Alex Helman et Tom Rudin. Ensuite, nous remercions les réviseurs du rapport. Le présent rapport d’étude consensuel a été révisé sous forme de projet par des personnes choisies pour leurs perspectives diverses et leur expertise technique. L’objectif de cette révision indépendante est de présenter des arguments neutres et critiques qui aideront les National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine à rendre chaque rapport publié aussi solide que possible et à s’assurer qu’il répond aux normes institutionnelles en matière de qualité, d’objectivité, d’intégrité et d’adaptabilité, dont l’étude est responsable. Les commentaires de révision et le projet de manuscrit restent confidentiels afin de protéger l’intégrité du processus de délibération. Nous remercions les personnes suivantes pour leur révision de ce rapport : Molly Carnes, Université du Wisconsin ; Gabriele González, Université d’État de la Louisiane ; Eve Higginbotham, Université de Pennsylvanie ; Stacie Furst Holloway, Université de Cincinnati ; Charles Isbell, Georgia Institute of Technology ; Anne-Marie Nunez, Université d’État de l’Ohio ; Claire Parkinson, NASA Goddard Space Flight Center ; Charles Phelps, Université de Rochester (émérite) ; Julia Phillips, Sandia National Laboratories (retraitée) ; et les membres du comité de rédaction.
National Laboratories (retraitée) ; et Joan Reede, Harvard Medical School.
Bien que les réviseurs cités ci-dessus aient fourni de nombreux commentaires et suggestions constructifs, il ne leur a pas été demandé d’approuver les conclusions ou les recommandations de ce rapport et ils n’ont pas vu la version finale avant sa publication. La révision de ce rapport a été supervisée par Maryellen Giger, de l’Université de Chicago, et Catherine Kling, de l’Université Cornell. Elles ont été chargées de s’assurer qu’un examen indépendant de ce rapport a été effectué conformément aux normes des National Academies et que tous les commentaires de l’examen ont été soigneusement pris en compte. La responsabilité du contenu final incombe entièrement au comité d’auteur et aux National Academies.
Enfin, le comité tient à remercier les sponsors qui ont rendu cette étude possible : les National Institutes of Health, la National Science Foundation et L’Oréal USA.
Table des matières
APERÇU
RÉSUMÉ
1. INTRODUCTION AU PROBLÈME DE L’INÉGALITÉ FEMMES-HOMMES DANS LES DOMAINES DES STEMM AUX ÉTATS-UNIS
Approche de l’étude
2. FACTEURS À L’ORIGINE DE LA SOUS-REPRÉSENTATION DES FEMMES DANS LES DISCIPLINES DES SCIENCES, DE L’INGÉNIERIE ET DE LA MÉDECINE
Les obstacles à l’avancement des femmes
Dynamiques communes aux domaines des STEMM
Intersectionnalité et « double peine »
Différences entre les domaines des STEMM
Conclusion : problèmes systémiques dans la culture des STEMM
Conclusions : chapitre 2
3. INTERVENTIONS PÉDAGOGIQUES POUR AMÉLIORER LE RECRUTEMENT ET LE MAINTIEN
Interventions pédagogiques dans les cours de STEMM
L’importance de s’identifier à des modèles
Créer des relations inclusives grâce au mentorat
Alliés masculins
Conclusions : chapitre 3
4. PRATIQUES EFFICACES POUR LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT, DE MAINTIEN ET D’AVANCEMENT DANS LES STEMM
Reconnaître les limites de la recherche
Méthodes éprouvées pour encourager le recrutement des femmes dans les STEMM
Méthodes éprouvées pour favoriser l’avancement des femmes dans les STEMM
Méthodes éprouvées pour améliorer le maintien et le climat organisationnel
Conclusions : chapitre 4
5. SURMONTER LES OBSTACLES À LA MISE EN ŒUVRE DE CES PRATIQUES
Un leadership engagé et pérenne
Des ressources financières et humaines dédiées
Comprendre le contexte propre à un établissement
Collecte de données pour la responsabilisation et l’intervention ciblée
S’assurer que toutes les femmes bénéficient des initiatives menées en faveur de l’équité et de la diversité, en tenant compte de l’intersectionnalité
Conclusions : chapitre 5
6. RECOMMANDATIONS
I. Favoriser la transparence et la responsabilisation
II. Interventions ciblées et empiriques menées par les établissements d’enseignement supérieur
III. Établir des priorités, reconnaître, récompenser et fournir des ressources
IV. Combler les lacunes en matière de connaissances
RÉFÉRENCES
ANNEXE A
ANNEXE B
Aperçu
Ces dernières années, le nombre de femmes obtenant des diplômes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie, des mathématiques et de la médecine (STEMM) a augmenté par rapport aux hommes. Malgré ces progrès, les femmes – en particulier les femmes de couleur – restent sous-représentées par rapport à leur présence dans la population active et dans la population américaine. Les disparités de représentation varient selon la discipline et le domaine, mais même dans les professions où la parité est atteinte et où les femmes sont surreprésentées, comme c’est le cas dans certaines sous-disciplines de la biologie et de la médecine, les postes à responsabilité sont toujours majoritairement occupés par des hommes.
Ce rapport examine l’état actuel des connaissances sur les facteurs qui entraînent la sous-représentation des femmes dans les STEMM et donne un aperçu des recherches existantes sur les politiques, les pratiques, les programmes et les interventions visant à améliorer le recrutement, le maintien et l’avancement des femmes dans ces domaines. Ce rapport évalue également pourquoi des pratiques prometteuses n’ont pas été mises en œuvre par un plus grand nombre de structures. Il convient de noter que l’objectif de ce rapport n’est pas de « réparer les femmes », mais plutôt de promouvoir un changement systémique dans le milieu des STEMM afin d’atténuer les inégalités structurelles, les préjugés, la discrimination et le harcèlement qui, selon un corpus substantiel de documents, nuisent considérablement à l’éducation et aux carrières des femmes dans les STEMM.
Bien que plusieurs rapports des National Academies se soient penchés sur la sous-représentation des femmes dans les domaines des STEMM (voir l’annexe B pour un aperçu des conclusions et des recommandations des rapports précédents des National Academies), le présent rapport se distingue en mettant l’accent sur les expériences des femmes de couleur et des femmes issues d’autres groupes marginalisés qui sont confrontées à des préjugés et à des obstacles plus importants. En outre, ce rapport met en évidence les obstacles communs et distincts auxquels sont confrontées les femmes dans les disciplines des STEMM – ingénierie, informatique, physique, biologie, médecine, mathématiques et chimie – afin d’identifier pourquoi les modèles nationaux de sous-représentation diffèrent selon la discipline.
Pour s’attaquer à des obstacles spécifiques, le comité a obtenu des preuves de l’efficacité de diverses stratégies et pratiques que les structures peuvent adopter pour améliorer le recrutement, le maintien et l’avancement des femmes principalement blanches dans un large éventail de disciplines des STEMM, et ce, à différents stades de leur parcours éducatif et professionnel. Le comité a conclu que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre comment soutenir de la manière la plus efficace possible la participation des femmes de couleur et des femmes ayant d’autres identités intersectionnelles dans les STEMM et pour mieux comprendre l’impact des pratiques prometteuses sur les femmes qui étudient et travaillent dans un plus grand nombre de contextes institutionnels (par exemple, les établissements au service des minorités, les établissements d’enseignement supérieur publics). Les recherches effectuées à ce jour mettent en évidence un ensemble commun de conditions qui favorisent l’adoption par les établissements de pratiques visant à améliorer le recrutement, le maintien et l’avancement des femmes dans les STEMM. Ces conditions comprennent (1) des instances dirigeantes engagées à tous les niveaux ; (2) des ressources financières et humaines dédiées ; (3) une compréhension approfondie du contexte institutionnel ; (4) la responsabilisation et la collecte de données – en particulier en tant qu’outil pour informer et encourager les progrès ; et (5) l’adoption d’une approche intersectionnelle qui aborde explicitement les défis auxquels sont confrontées les femmes de couleur et d’autres groupes qui font face à de nombreux préjugés et à de multiples formes de discrimination.
Sur la base de l’analyse des preuves existantes, ce rapport propose à un grand nombre de parties prenantes – le Congrès, les agences fédérales, le corps enseignant et les instances dirigeantes de l’enseignement supérieur, ainsi que les sociétés professionnelles – un ensemble de recommandations pratiques sur la façon de mener à un changement systémique dans l’éducation et les carrières des STEMM. Les recommandations sont destinées à fonctionner en synergie pour encourager et informer l’adoption à grande échelle de pratiques prometteuses et empiriques permettant d’améliorer le recrutement, le maintien et l’avancement des femmes dans les STEMM. Plus précisément, les neuf recommandations et les actions de mise en œuvre qui leur sont associées soutiennent un processus par lequel la responsabilité fondée sur les données, des instances dirigeantes engagées et des récompenses tangibles, les ressources et la reconnaissance des efforts en matière d’équité et de diversité alimentent un cycle répété qui comprend quatre étapes : (1) un établissement, une école ou un département recueille, analyse et assure le suivi des données quantitatives et qualitatives afin de diagnostiquer les problèmes spécifiques au recrutement, au maintien et à l’avancement des femmes blanches et des femmes de couleur ; (2) les leaders institutionnels prennent des mesures pour combler les lacunes au niveau du programme, de l’école ou du département en s’appuyant sur les résultats des recherches existantes et sur les pratiques appropriées à adopter ou à adapter pour une approche ciblée et empirique; (3) l’établissement, l’école ou le département répète la collecte de données et le suivi pour déterminer si l’intervention a été efficace ou si une nouvelle approche est nécessaire ; et (4) les instances dirigeantes institutionnalisent officiellement les pratiques efficaces par des changements de politique qui soutiennent les changements de direction, du budget et d’autres facteurs susceptibles de nuire à la durabilité.
Les recherches examinées dans ce rapport constituent une base solide pour une action institutionnelle visant à améliorer le recrutement, le maintien et l’avancement des femmes dans les domaines des STEMM.
Résumé
Les carrières dans les domaines des sciences, de l’ingénierie, de la technologie, des mathématiques et de la médecine (STEMM) offrent la possibilité de faire progresser les connaissances, contribuent à améliorer le bien-être des communautés et la sécurité, la prospérité et la santé des États-Unis. Cependant, de nombreuses femmes ne poursuivent pas ces carrières, n’y restent pas ou n’accèdent pas à des postes à responsabilité. La plupart des preuves indiquent que la sous-représentation des femmes dans les STEMM – y compris aux niveaux de direction – est due à un large éventail de schémas structurels, culturels et institutionnels qui reposent sur des préjugés, de multiples formes de discrimination et sur des inégalités qui ne touchent pas les hommes dotés de compétences et d’une formation identiques à ces femmes.
À ce jour, sept rapports des National Academies publiés au cours des deux dernières décennies ont abordé les causes et les conséquences de la sous-représentation des femmes en sciences, en ingénierie et en médecine. Parmi ces conséquences, citons :
1.une pénurie de main-d’œuvre à l’échelle nationale dans de nombreuses professions scientifiques, d’ingénierie et médicales, en particulier dans les domaines techniques, qui ne peut être comblée à moins que les établissements et les entreprises ne recrutent dans un vivier de talents étendu et diversifié ;
2.des opportunités perdues en matière d’innovation et de gains économiques, d’autant plus que la recherche montre que des équipes plus diversifiées génèrent des solutions plus innovantes, publient des articles à plus fort impact et améliorent les résultats de l’entreprise. En d’autres termes, le manque de diversité dans le domaine scientifique nuit à l’économie ;
3.perte de talents due à la discrimination, aux préjugés inconscients et au harcèlement sexuel, qui empêchent souvent les femmes de faire carrière dans les sciences, l’ingénierie et la médecine.
Dans ce rapport, qui s’appuie sur une analyse des recherches actuelles, le comité apporte à un ensemble de parties prenantes des recommandations concrètes sur la manière de prendre des mesures coordonnées afin de parvenir aux changements nécessaires dans les domaines de l’éducation, de la recherche et de l’emploi dans les filières des sciences, de l’ingénierie et de la médecine. Les recommandations du comité ne visent pas à « réparer les femmes », mais plutôt à changer la culture par des actions systémiques. Pour y parvenir, il est impératif que les hommes et les femmes du Congrès, de la Maison Blanche, des agences de financement fédérales (en particulier les National Institutes of Health et la National Science Foundation), des établissements d’enseignement supérieur et des sociétés professionnelles abordent cette question en urgence et conçoivent une stratégie fondée sur des preuves.
Le présent rapport vise à fournir les deux.
MISSION
Le comité a été chargé par les National Institutes of Health, la National Science Foundation et L’Oréal USA d’accomplir trois missions : (1) effectuer une analyse et une synthèse de la recherche actuelle sur les facteurs à l’origine des disparités entre les sexes en matière de recrutement, de rétention et d’avancement dans toute une série de disciplines scientifiques, techniques et médicales et tout au long du parcours scolaire et professionnel ; (2) un examen de la recherche sur les stratégies et pratiques éprouvées qui, selon la recherche, peuvent améliorer le recrutement, le maintien et l’avancement des femmes dans ces domaines, avec un accent particulier sur l’amélioration de la représentation et de l’inclusion des femmes de couleur ; et (3) une exploration des raisons pour lesquelles les interventions efficaces n’ont pas été étendues ou adoptées par un plus grand nombre de structures.
En bref, le rapport aborde quatre questions :
1.quel est le problème ? (chapitres 1 et 2) ;
2.quelles sont les solutions envisageables ? (chapitres 3 et 4) ;
3.pourquoi n’y a-t-il pas plus de progrès ? (chapitre 5) ;
4.que peut-on faire pour ouvrir les portes aux femmes dans les STEMM ? (Recommandations) (chapitre 6).
Voir le chapitre 1 pour l’énoncé complet de la mission.
CONCLUSIONS
Le comité est parvenu à six grandes conclusions, qui sont étayées par les résultats qui figurent à la fin de chaque chapitre du rapport.
Conclusion 1 : bien que le nombre de femmes obtenant des diplômes dans les domaines des sciences, de l’ingénierie et de la médecine ait augmenté ces dernières années, les femmes – en particulier les femmes de couleur – sont sous-représentées par rapport au nombre de femmes actives et dans la population américaine. Les schémas nationaux de sous-représentation varient selon le stade auquel la femme se trouve dans sa carrière, sa race et son origine ethnique, et la discipline concernée.
Conclusion 2 : les préjugés, la discrimination et le harcèlement sont les principaux facteurs de sous-représentation des femmes dans les domaines des sciences, de l’ingénierie et de la médecine ; ces facteurs concernent d’autant plus les femmes qui ont des identités intersectionnelles (par exemple, les femmes de couleur, les femmes handicapées, les femmes LGBTQIA1.
Conclusion 3 : si certaines structures ont constaté des améliorations dans la représentation des femmes dans les études et les carrières scientifiques, techniques et médicales, les schémas nationaux de sous-représentation sont toujours prédominants dans la plupart des structures, en particulier pour les femmes de couleur.
Conclusion 4 : il existe de nombreuses stratégies et pratiques empiriques efficaces, que les établissements peuvent adopter pour améliorer le recrutement, le maintien et l’avancement des femmes blanches dans un large éventail de disciplines scientifiques, techniques et médicales, et ce, à de multiples stades de leur parcours scolaire et professionnel. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre comment soutenir plus efficacement la participation des femmes de couleur et des femmes appartenant à d’autres groupes identitaires dans les domaines des sciences, de l’ingénierie et de la médecine.
Conclusion 5 : il est primordial d’améliorer le recrutement et le maintien des femmes dans les STEMM tout au long de leur parcours scolaire et de leur formation, en particulier dans les domaines où il est essentiel d’avoir une solide maîtrise des mathématiques tel qu’en informatique et en ingénierie. Les stratégies éducatives qui remettent en question les stéréotypes sur les caractéristiques essentielles d’un bon professionnel des STEMM et sur la nature du travail dans les STEMM peuvent accroître l’intérêt, améliorer les performances et instiller un sentiment d’appartenance à ces domaines chez les femmes blanches, les femmes de couleur et d’autres groupes sous-représentés (par exemple, les étudiants « de première génération » et les hommes de couleur).
Conclusion 6 : tant la recherche que les résultats des groupes de discussion menés par l’institut de recherche indépendant à but non lucratif RTI International pour le compte de cette étude indiquent un ensemble commun de conditions qui soutiennent l’adoption par les établissements de pratiques visant à améliorer le recrutement, le maintien et l’avancement des femmes, notamment :
•des instances dirigeantes engagées à tous les niveaux, en particulier de la part de ceux et celles qui sont en position d’autorité (tels que les décideurs politiques, les présidents et les doyens des établissements d’enseignement supérieur, les professeurs qui gèrent les programmes de formation et les grands laboratoires) qui peuvent mettre en œuvre, allouer des ressources et suivre les progrès des nouvelles politiques et stratégies qui réduisent l’écart entre les sexes ;
•des ressources financières et humaines dédiées – y compris des fonds nouveaux ou réorientés, et des personnes correctement rémunérées occupant des postes à responsabilité ou de direction, et dont le travail vise à ouvrir aux femmes les portes de la réussite ;
•la responsabilisation et la collecte de données – en particulier lorsqu’elles sont utilisées comme outil pour informer et encourager les progrès ;
•l’adoption d’une approche intersectionnelle qui répond explicitement et concrètement aux défis auxquels sont confrontées les femmes de couleur et les autres groupes qui font face à de nombreux préjugés et à de multiples formes de discrimination.
LE RÔLE MAJEUR DES POLITIQUES PUBLIQUES
Le présent rapport s’adresse à des publics multiples dans la mesure où la sous-représentation des femmes dans les STEMM est un problème systémique qui doit être traité par de nombreux acteurs et à de nombreux niveaux. Toutefois, dans ce rapport, le comité a mis l’accent sur le changement de politique. Le Congrès, la Maison Blanche et les agences gouvernementales ont à la fois la capacité et l’obligation d’endosser le rôle majeur de catalyseur en encourageant la création et la mise en œuvre de politiques, programmes et stratégies visant à atténuer les préjugés et les obstacles qui sapent actuellement le recrutement, le maintien et l’avancement des femmes dans les domaines des sciences, de l’ingénierie et de la médecine. Par conséquent, bien qu’une grande partie de la responsabilité du leadership incombe au corps professoral et aux instances dirigeantes des établissements d’enseignement supérieur du pays pour remédier aux inégalités au sein de la communauté universitaire, la communauté politique dispose de puissants leviers pour encourager l’innovation et l’action.
Les recommandations du comité apportent des pistes à envisager aux instances dirigeantes de multiples secteurs sur la manière d’aller de l’avant avec des stratégies et des politiques empiriques volontaires afin d’améliorer le recrutement, le maintien et l’avancement des femmes dans les domaines des sciences, de l’ingénierie et de la médecine, et ainsi améliorer significativement la prospérité, la sécurité et le bien-être à l’échelle nationale.
RECOMMANDATIONS
Les recommandations du comité sont regroupées en quatre grandes catégories, qui visent à encourager et à informer l’adoption à grande échelle de pratiques prometteuses et empiriques pour améliorer le recrutement, le maintien et l’avancement des femmes en sciences, en ingénierie et en médecine :
1.favoriser la transparence et la responsabilisation : les structures doivent formuler et atteindre des objectifs et des critères de référence mesurables, régulièrement contrôlés et rendus publics. De nombreuses études ont démontré que la transparence et la responsabilisation peuvent entraîner un changement de comportement ;
2.adopter des approches empiriques pour lutter contre la sous-représentation des femmes dans les STEMM : le comité recommande une approche ciblée et empirique afin de combler l’écart entre les femmes et les hommes dans les domaines des sciences, de l’ingénierie et de la médecine. Une telle approche consiste, par exemple, à identifier les obstacles propres à chaque discipline et à chaque stade de la carrière, à reconnaître explicitement que les interventions et les stratégies qui fonctionnent généralement pour les femmes blanches peuvent ne pas fonctionner pour les femmes de couleur et, en outre, à utiliser la collecte, l’analyse et le suivi de données désagrégées comme base pour élaborer des interventions spécifiques dans le contexte unique de chaque institution ;
3.récompenser, reconnaître et fournir des ressources pour les effortsaccomplis en matière d’équité, de diversité et d’inclusion : les efforts des établissements en matière d’équité, de diversité et d’inclusion sont souvent entravés par un manque de ressources et par le fait que l’on s’attend à ce que les individus, en particulier les femmes et les hommes de couleur – qui sont les plus touchés par ces questions – endossent un rôle de leader dans la promotion d’un changement positif sans recevoir de compensation pour leur travail, sans disposer de l’autorité nécessaire ou sans promesse de récompense ou de reconnaissance ;
4.combler les lacunes dans les connaissances : bien que la recherche universitaire sur les inégalités entre les sexes dans les domaines de la science, de l’ingénierie et de la médecine ait permis de recueillir de nombreuses informations qui peuvent être exploitées pour atteindre l’égalité femmes-hommes, il existe des lacunes majeures dans les connaissances qui nécessitent une attention particulière.
En réalité, ces quatre grandes catégories ne sont pas distinctes les unes des autres mais sont plutôt des composantes fondamentalement interconnectées d’un système complexe d’acteurs, d’incitations et d’informations. Les moteurs de la transparence et de la responsabilisation produisent de nouvelles informations qui peuvent permettre d’identifier des stratégies d’interventions ciblées et empiriques, tout en incitant à une plus grande allocation des ressources en faveur de l’équité, de la diversité et de l’inclusion. Le comité soutient que l’interconnexion de ces recommandations est à l’origine de leur force. Cela ne veut pas dire que les recommandations individuelles, si elles sont mises en œuvre par les parties prenantes, ne peuvent pas avoir des répercussions tangibles, mais qu’un changement systémique est nécessaire pour parvenir à un changement rapide sur cette question et est adapté à une approche systémique.
Outre les recommandations de haut niveau, le comité propose pour chacune d’entre elles une série de mesures de mise en œuvre destinées à fournir aux parties prenantes des conseils pratiques spécifiques. Dans de nombreux cas, le comité a intentionnellement élaboré ces actions de mise en œuvre afin de pouvoir tirer parti des infrastructures et des activités existantes et de les modifier de manière spécifique pour faciliter l’exécution des recommandations.
I. FAVORISER LA TRANSPARENCE ET LA RESPONSABILISATION
Les pouvoirs législatif et exécutif du gouvernement fédéral peuvent servir de moteurs afin de favoriser la transparence et la responsabilisation dans les domaines des sciences, de l’ingénierie et de la médecine. Au chapitre 5, le comité a constaté que la transparence et la responsabilisation sont des leviers essentiels pour susciter des changements positifs en matière d’équité et de diversité. Par conséquent, le comité recommande plusieurs mesures susceptibles d’accroître la transparence et la responsabilisation du public afin que la nature, l’étendue et l’impact des efforts menés par les organismes fédéraux et les universités garantissent que le recrutement du personnel scientifique, technique et médical respecte des principes d’équité, de diversité et d’inclusion. En plus d’accroître la transparence et la responsabilisation, ces recommandations présentent d’autres avantages. Par exemple, si elles sont mises en œuvre fidèlement, elles peuvent mettre en évidence la mesure dans laquelle chaque agence fédérale fait de l’équité, de la diversité et de l’inclusion une priorité en documentant l’impact qualitatif et quantitatif de leurs efforts.
RECOMMANDATION 1 : les pouvoirs législatif et exécutif du gouvernement américain devraient travailler ensemble pour accroître la transparence et la responsabilisation des agences fédérales en exigeant la collecte, l’analyse et la communication de données sur la nature, l’impact et le degré d’investissement en ce qui concerne les efforts visant à améliorer le recrutement, le maintien et l’avancement des femmes dans les STEMM, en mettant l’accent sur les efforts existants qui adoptent une approche intersectionnelle.
Actions de mise en œuvre
Action 1-A : le directeur de l’Office of Science and Technology Policy de la Maison Blanche, en collaboration avec les coprésidents des National Institutes of Health (NIH) et de la National Science Foundation (NSF) du Subcommittee on Safe and Inclusive Research Environments du Joint Committee on the Research Environment, devrait répertorier, évaluer et comparer chaque année les divers efforts déployés par les agences scientifiques fédérales pour soutenir largement le recrutement, le maintien et l’avancement des femmes dans les domaines des sciences, de l’ingénierie et de la médecine. Le directeur devrait charger le sous-comité de publier un rapport annuel librement accessible, sur le modèle du tableau récapitulatif de la NSF sur les programmes visant à élargir la participation dans sa demande de budget annuel au Congrès, qui documente les programmes existants dans chaque agence, en mettant particulièrement l’accent sur les programmes qui adoptent une approche intersectionnelle, en tenant compte des expériences des femmes de couleur et des femmes qui ont d’autres identités intersectionnelles (par exemple, les femmes handicapées ou LGBTQIA), et l’impact qualitatif et quantitatif de ces programmes, en utilisant les instruments de mesure et les données d’évaluation des programmes, lorsqu’ils sont recueillis.2
Action 1-B : le Congrès devrait commanditer une étude à un organisme indépendant, tel que le Government Accountability Office, afin d’offrir une évaluation et un examen externes des programmes fédéraux existants axés sur le soutien d’une plus grande équité, diversité et inclusion dans les sciences, l’ingénierie et la médecine. Cette étude devrait déboucher sur une publication qui documentera la nature et l’impact sur divers groupes donnés et la priorisation de ces programmes, tels que décrits ci-dessus, dans l’ensemble des organismes fédéraux.
RECOMMANDATION 2 : les organismes fédéraux devraient engager la responsabilité des établissements bénéficiaires de subventions en ce qui concerne l’adoption de pratiques efficaces pour remédier aux inégalités entre les sexes en matière de recrutement, de rétention et d’avancement, et procéder à une collecte régulière de données pour suivre les progrès réalisés.
Actions de mise en œuvre
Action 2-A : les organismes fédéraux de financement devraient effectuer un « audit d’équité » pour les établissements bénéficiaires qui ont reçu un financement important sur une longue période afin de s’assurer que l’établissement œuvre réellement à corriger les inégalités entre les sexes et les races dans le recrutement, le maintien et l’avancement. Les établissements qui ne respectent pas ces principes pourraient être signalés électroniquement par l’agence de financement pour un audit d’équité après une certaine durée de financement. Une évaluation de la représentation des femmes au sein des instances dirigeantes devrait être incluse dans un tel audit. Les procédures d’audit en matière d’équité devraient inclure une déclaration de la part des établissements afin de tenir compte du contexte institutionnel particulier, de la géographie, des limites des ressources et de la mission, et d’engager la responsabilité de l’établissement dans ce contexte. Elles devraient également rendre compte des progrès réalisés au fil du temps en ce qui concerne l’amélioration de la représentation et des expériences vécues par les groupes sous-représentés dans les domaines des sciences, de l’ingénierie et de la médecine, et indiquer les solutions envisagées ou autres actions prévues afin d’améliorer les résultats de la procédure. Cette procédure devrait donner lieu à un rapport public disponible sur le site web de l’organisme.
Action 2-B : les agences fédérales doivent prendre en compte les efforts des structures et des chercheurs indépendants afin d’encourager l’équité, la diversité et l’inclusion dans le cadre du processus de propositions en matière de conformité, d’examen et d’attribution des récompenses en reconnaissance des efforts accomplis. Pour réduire les charges administratives supplémentaires, les agences devraient travailler dans le cadre du respect des conditions existantes concernant les propositions pour atteindre cet objectif. Par exemple, la NSF devrait réviser ses directives à l’attention des bénéficiaires de subventions concernant les déclarations dites à « impact plus large » de la NSF, et les NIH devraient réviser leur directives à l’attention des bénéficiaires de subventions concernant la section « importance » du plan de recherche afin d’inclure une déclaration explicite sur les efforts déployés par les futurs bénéficiaires de subventions et/ ou la structure pour promouvoir une plus grande équité, diversité et inclusion dans les sciences, l’ingénierie et la médecine. Bien que de nombreux bénéficiaires mettent actuellement l’accent sur les efforts déployés en matière d’équité, de diversité et d’inclusion dans ces sections des propositions émises par la NSF et les NIH, historiquement, ces sections des propositions ont servi, avant tout, à documenter l’impact sociétal de la recherche (par exemple, la lutte contre le changement climatique, la guérison du cancer, etc.) Cette dernière fonction de ces sections des propositions est essentielle et ne doit pas être remplacée par la description des efforts déployés en matière d’équité, de diversité et d’inclusion. Au contraire, cette section des propositions doit être élargie afin d’inclure des commentaires sur ces deux composantes essentielles de la recherche financée par le gouvernement fédéral. En outre, ces sections des propositions doivent être inscrites et prises au sérieux dans les recommandations de financement des comités d’examen et les décisions de financement du personnel des agences. Si ces sections des propositions ne sont pas considérées de la même manière par les différents instituts, départements et services de directions, il faudrait s’efforcer d’uniformiser l’importance accordée à ces sections des propositions au sein de l’agence. Par exemple, le National Science Board pourrait procéder à un examen des prix décernés par la NSF dans le passé afin de déterminer comment les services de direction de la NSF ont intégré les principes d’équité, de diversité et d’inclusion parmi les critères évalués dans les propositions soumises à la NSF.
II. INTERVENTIONS CIBLÉES ET EMPIRIQUES MENÉES PAR LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR3
À bien des égards, les recommandations de cette section représentent les mesures les plus directes de ce rapport. Ces recommandations sont fondées sur l’analyse exhaustive des données collectées par le comité sur les stratégies spécifiques et les meilleures pratiques permettant d’améliorer la participation et l’avancement des femmes dans les domaines des sciences, de l’ingénierie et de la médecine.
Les recommandations proposées par le comité dans cette section décrivent également un processus de changement. Ce processus commence par la collecte, l’analyse et le suivi de données quantitatives et qualitatives par une unité administrative (par exemple, un département, une école ou une université) afin de diagnostiquer des problèmes précis en matière de recrutement, de rétention et d’avancement, puis de prendre des mesures pour combler les lacunes en s’appuyant sur les recherches et les pratiques existantes pour adopter des solutions ciblées et empiriques. L’étape suivante du processus consiste à répéter le processus de collecte et de suivi des données pour déterminer si les solutions apportées ont été efficaces ou si une nouvelle approche est nécessaire. La dernière étape du processus consiste à institutionnaliser officiellement les pratiques qui ont fait leur preuve par des changements de politique afin qu’elles puissent supporter les changements de direction, les fluctuations budgétaires et d’autres facteurs de perturbation potentiels qui pourraient compromettre les efforts accomplis à long terme.
Le comité recommande un processus de changement, plutôt qu’un plan d’action unique, car il n’existe aucune approche unique applicable à l’ensemble des contextes institutionnels. La mission, les données démographiques sur les étudiants, les besoins des étudiants et les contraintes en matière de ressources varient d’un établissement à l’autre. Ainsi, une stratégie spécifique peut donner de bons résultats dans un établissement et de mauvais résultats dans un autre. C’est pourquoi le comité recommande aux établissements d’adopter ou d’adapter les stratégies et les pratiques décrites dans le présent rapport et d’itérer au fil du temps pour élaborer une approche qui fonctionnera bien pour leur établissement et les personnes qui s’y trouvent.
RECOMMANDATION 3 : les doyens et les directeurs de départements des établissements d’enseignement supérieur devraient recueillir, examiner et publier chaque année4 des données sur le nombre d’étudiants, de stagiaires, de professeurs et de membres du personnel, ventilées par sexe et par race/ appartenance ethnique, afin de comprendre la nature des problèmes propres à leur structure en matière de recrutement, de rétention et d’avancement des femmes, puis utiliser ces informations pour prendre des mesures (voir les recommandations 5 et 7 pour obtenir des conseils sur les stratégies et pratiques spécifiques que les instances dirigeantes peuvent adopter ou adapter pour résoudre les problèmes de recrutement, de rétention et d’avancement, en les appliquant et en les modifiant le cas échéant, de manière à ce qu’elles soient efficaces dans le contexte particulier de l’établissement).
Actions de mise en œuvre
Action 3-A : les doyens et les directeurs de département des établissements d’enseignement supérieur doivent collecter et suivre annuellement les données démographiques au niveau du département, en s’appuyant sur les données déjà collectées par leur établissement conformément aux données communiquées au Système intégré de données sur l’enseignement supérieur, afin de déterminer s’il existe des schémas de sous-représentation parmi les étudiants, les stagiaires, les résidents, les médecins assistants, le corps enseignant et le personnel, y compris aux postes de direction. Plus précisément, les doyens et les directeurs de département doivent demander les types de données suivants et suivre ces données dans le temps :
a.la composition démographique des étudiants actuellement inscrits et récemment diplômés dans un département ou un collège donné. Ces données doivent être ventilées par sexe et par race/ ethnicité et doivent être suivies dans le temps ;
b.la composition démographique longitudinale du corps enseignant, ventilée par rang, département, sexe et race/ appartenance ethnique ;
c.la composition démographique longitudinale des chercheurs postdoctoraux, des résidents, des médecins assistants et des scientifiques, ventilée par département, sexe et race/ ethnicité.
Ces informations devront être utilisées pour adopter ou adapter des pratiques prometteuses efficaces et empiriques, en tenant compte du contexte particulier de l’établissement (voir la recommandation 5).
RECOMMANDATION 4 : les instances dirigeantes des établissements supérieurs devraient consacrer des ressources à la réalisation de recherches qualitatives sur le climat de l’école ou du département et sur les expériences des groupes sous-représentés, et utiliser ces informations pour élaborer des politiques et des pratiques visant à promouvoir un climat inclusif et à soutenir les groupes sous-représentés inscrits ou employés dans l’établissement.
Actions de mise en œuvre
Action 4-A : les instances dirigeantes des établissements d’enseignement supérieur doivent travailler avec un auditeur extérieur à l’unité concernée pour soutenir une recherche périodique sur le climat afin d’évaluer le climat dans l’établissement ou le département d’une manière méthodologiquement solide, indépendante, objective, impartiale et dénuée de conflits d’intérêts. La recherche sur le climat peut prendre la forme d’enquêtes, de groupes de discussion et/ ou d’entretiens.
Action 4-B : étant donné la représentation extrêmement faible des femmes de couleur dans la plupart des domaines scientifiques, en ingénierie et en médecine, les instances dirigeantes et les auditeurs externes doivent travailler ensemble pour adopter une approche méthodologique permettant de protéger l’anonymat de ces personnes et de saisir avec précision leurs expériences. Dans certains cas, les entretiens peuvent être le moyen le plus approprié pour recueillir ces informations. Il convient de noter que, dans certains contextes, les chercheurs d’une seule structure peuvent ne pas être en mesure de protéger suffisamment l’anonymat des femmes de couleur, qui constituent une extrême minorité dans certains domaines, et qu’il peut donc être préférable de mener ces recherches à travers un système institutionnel. La protection des informations sensibles et personnelles sera également facilitée par le recours à un consultant externe qui pourra détenir les données brutes et ne communiquer que des résultats agrégés à la direction du département.
RECOMMANDATION 5 : en tenant compte du contexte institutionnel, les présidents des établissements d’enseignement supérieur, les doyens, les directeurs de département et les autres dirigeants devraient adopter ou adapter des stratégies et des pratiques réalisables et empiriques (voir les mesures de mise en œuvre 5A-5C) qui visent directement à combler les inégalités entre les sexes en matière de recrutement, de rétention et d’avancement des femmes en sciences, en ingénierie et en médecine au sein de leur établissement, tel qu’observé par l’analyse et le suivi des données quantitatives et qualitatives (voir les recommandations 3 et 4 ci-dessus).
Actions de mise en œuvre
Action 5-A : afin d’améliorer le recrutement et le maintien des femmes dans l’enseignement des STEMM, le corps enseignant et les instances dirigeantes du secteur de l’enseignement, quel que soit le niveau, devraient adopter les approches suivantes :
a.réorganiser les cours de STEMM pour y incorporer des exercices d’apprentissage actif (par exemple, faire travailler les étudiants en groupe utiliser des « clickers ») et un apprentissage intégré en équipe, dirigé par les pairs ;
b.promouvoir un état d’esprit de croissance en communiquant aux étudiants qu’ils peuvent améliorer leurs capacités dans le domaine des STEMM par l’apprentissage ;
c.remettre en question les stéréotypes sur la nature des carrières dans les STEMM en expliquant aux élèves que les scientifiques travaillent souvent en équipe, mènent des recherches visant à aider les autres et ont une vie en dehors du travail ;
d.prendre des mesures pour exposer les étudiantes à un ensemble diversifié de modèles dans les STEMM qui remettent en question le stéréotype sociétal persistant selon lequel les professionnels des STEMM sont des hommes blancs, hétérosexuels et cisgenres. Par exemple, le corps professoral et les instances dirigeantes devraient donner des devoirs qui obligent les étudiants à se renseigner sur le travail des femmes qui ont apporté une contribution importante au domaine ; s’assurer que le corps professoral du département est diversifié, de sorte que les étudiants suivent des cours et effectuent des recherches avec des personnes appartenant à différents groupes démographiques ; et investir dans du matériel pédagogique (par exemple, des manuels et d’autres supports d’enseignement) qui met en évidence la diversité des personnes qui ont contribué aux sciences, à l’ingénierie et à la médecine ;
e.veiller à ce que la composition des classes et des groupes soit équilibrée, et prendre des mesures pour promouvoir des interactions équitables en classe.
Action 5-B5 : Pour résoudre les problèmes de recrutement des femmes dans les programmes universitaires et les carrières en sciences, en ingénierie et en médecine, les responsables des admissions, les responsables des ressources humaines et les comités de recrutement devraient :
a.travailler en permanence pour identifier les candidates prometteuses issues de groupes sous-représentés et élargir les réseaux d’où proviennent les candidates ;
b.rédiger les offres d’emploi et les descriptions de programmes de manière à attirer un large éventail de candidates et utiliser de multiples médias et moyens permettant de faire connaître ces opportunités à grande échelle ;
c.remettre en questions les exigences et les critères en fonction desquels les candidates seront jugées afin d’identifier et d’éliminer ou de réduire l’importance accordée à ceux qui sont particulièrement liés à des préjugés et qui peuvent également se révéler être de mauvais indicateurs de réussite (par exemple, certaines notes obtenues à des tests standardisés) ;
d.décider du poids relatif et de la priorité des différents critères d’admission ou d’emploi avant d’interroger les candidates ;
e.tenir les responsables des décisions d’admission et d’embauche pour responsables des résultats à chaque étape du processus de candidature et de sélection ;
f.sensibiliser les recruteurs pour qu’ils tiennent compte des responsabilités liées à la garde des enfants et aux congés parentaux auxquelles les femmes sont souvent confrontées, notamment lorsqu’ils examinent les « lacunes » d’un curriculum vitae ;
g.dans la mesure du possible, utiliser des entretiens structurés dans les décisions d’admission et d’embauche ;
h.sensibiliser les recruteurs et les responsables des admissions aux préjugés et aux stratégies pour les contrer ;
i.augmenter le montant des bourses et les salaires des étudiants de deuxième cycle, des postdocs, des professeurs non-titulaires et des autres membres du personnel afin de garantir que tous les stagiaires et les employés reçoivent un salaire décent.
Action 5-C6 : Pour résoudre les problèmes le maintien des femmes dans les programmes universitaires et dans les carrières des sciences, de l’ingénierie et de la médecine, les instances dirigeantes de l’enseignement supérieur devraient :
a.s’assurer que l’accès aux ressources est juste et équitable pour tous les employés et les étudiants ;
b.prendre des mesures pour communiquer amplement et clairement sur les ressources institutionnelles qui sont à la disposition des étudiants et des employés et être transparents sur la répartition de ces ressources ;
c.réviser les politiques et les ressources afin de refléter les divers besoins de vie personnelle des employés et des étudiants à différents stades de leurs études et de leur carrière, et faire connaître ces politiques et ces ressources afin que tous en soient informés et puissent y accéder facilement ;
d.créer des programmes et des opportunités dans le milieu éducatif qui encouragent un environnement inclusif et respectueux, exempt de harcèlement sexuel et non-sexiste ;
e.définir et diffuser largement des normes comportementales, y compris des sanctions en cas de comportement irrespectueux, d’incivilité et de harcèlement. Ces normes devraient inclure un certain nombre de mesures disciplinaires en fonction de la gravité et de la fréquence des actes commis afin de sanctionner les individus qui ont violé ces normes ;
f.créer des politiques qui soutiennent les employés pendant les périodes où les exigences de la vie familiale et personnelle sont les plus fortes – en particulier lorsqu’il s’agit d’élever de jeunes enfants et de s’occuper de parents âgés. Par exemple, les politiques en matière d’arrêt de travail et de modification de la charge de service, qui devraient être accessibles au plus grand nombre, devraient représenter un véritable temps d’arrêt du travail et ne devraient pas pénaliser ceux qui en bénéficient ;
g.instaurer des politiques et des pratiques qui tiennent compte de la nécessité pour les actifs de trouver un équilibre entre leurs rôles professionnels et familiaux (non seulement en ce qui concerne l’attention portée aux enfants et à la famille, mais aussi les responsabilités liées à l’école et aux activités extrascolaires des enfants) ;
h.limiter les réunions et les fonctions du département à des heures de travail précises qui sont conformes aux attentes d’un lieu de travail favorable à la famille.
Action 5-D : afin d’être des mentors efficaces et de nouer des relations solides dans le cadre d’un programme de mentorat, le corps enseignant et le personnel doivent reconnaître que les identités influencent le développement sur le plan académique et professionnel, et sont donc pertinentes pour un mentorat efficace. Pour ce faire :
a.les instances dirigeantes des établissements d’enseignement supérieur devraient soutenir intentionnellement les initiatives en matière de mentorat qui reconnaissent, répondent à, valorisent et développent le pouvoir de la diversité. Les instances dirigeantes devraient créer intentionnellement des cultures d’excellence inclusive pour améliorer la qualité et la pertinence dans les STEMM ;
b.les mentors devraient apprendre et utiliser des approches inclusives du mentorat telles que l’écoute active, le travail vers la sensibilité culturelle, dépasser les préjugés liés à la couleur de peau, prendre en compte intentionnellement la façon dont les dynamiques culturelles peuvent influencer négativement les relations entre les mentors et les mentorés, et la réflexion sur la façon dont leurs biais et leurs préjugés peuvent nuire aux élèves et aux relations entre les mentors et les mentorés, spécifiquement pour le mentorat des groupes sous-représentés ;
c.les élèves devraient réfléchir et reconnaître l’influence de leurs identités sur leur trajectoire académique et professionnelle et devraient rechercher des mentors volontaires tout en tenant compte des expériences individuelles vécues.
Action 5-E : les instances dirigeantes des établissements, ainsi que les professeurs et le personnel devraient soutenir les politiques, les procédures