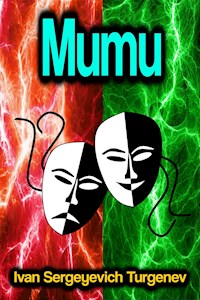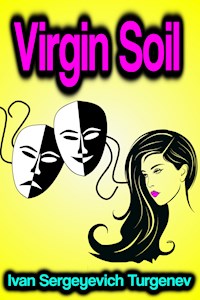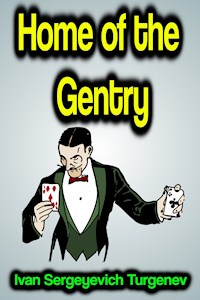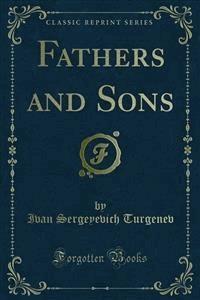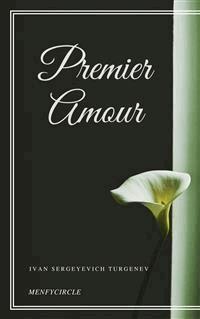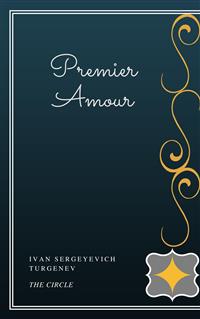
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Henri Gallas
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Réunis un soir, des amis se racontent leur premier amour.« J'avais alors seize ans. Cela se passait au cours de l'été 1883. J'étais chez mes parents, à Moscou… » Dans la maison voisine, une princesse, jeune fille à la Tourgueniev, délicieuse, pure et volontaire, s'amuse de ses soupirants jusqu'au jour où elle-même succombe à l'amour.Ce récit au charme cruel est une histoire vraie. L'adolescence de Vladimir fut celle de Tourgueniev. Il n'aima vraiment toute sa vie qu'une seule femme, sans en être aimé. Echos de sa jeunesse au milieu des serfs et des paysans russes, de ses peines amoureuses, ces trois nouvelles sont des chefs-d'oeuvre de vérité et de poésie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Premier Amour
Ivan Sergeyevich Turgenev
Ivan Sergeyevich Turgenev (November 9 [O.S. October 28] 1818 – September 3 [O.S. August 22] 1883) was a major Russian novelist and playwright. His novel Fathers and Sons is regarded as a major work of 19th-century fiction.
Chapitre1
Les invités avaient pris congé depuis longtemps. L’horloge venait de sonner la demie de minuit. Seuls, notre amphitryon, Serge Nicolaiévitch et Vladimir Pétrovitch restaient encore au salon.
Notre ami sonna et fit apporter les reliefs du repas.
« Nous sommes bien d’accord, messieurs, fit-il en s’enfonçant dans son fauteuil et en allumant un cigare, chacun de nous a promis de raconter l’histoire de son premier amour. À vous le dé, Serge Nicolaiévitch. »
L’interpellé, un petit homme blond au visage bouffi, regarda l’hôte, puis leva les yeux au plafond.
« Je n’ai pas eu de premier amour, déclara-t-il enfin. J’ai commencé directement par le second.
— Comment cela ?
— Tout simplement. Je devais avoir dix-huit ans environ quand je m’avisai pour la première fois de faire un brin de cour à une jeune fille, ma foi fort mignonne, mais je me suis comporté comme si la chose ne m’était pas nouvelle ; exactement comme j’ai fait plus tard avec les autres. Pour être franc, mon premier — et mon dernier — amour remonte à l’époque où j’avais six ans. L’objet de ma flamme était la bonne qui s’occupait de moi. Cela remonte loin, comme vous le voyez, et le détail de nos relations s’est effacé de ma mémoire. D’ailleurs, même si je m’en souvenais, qui donc cela pourrait-il intéresser ?
— Qu’allons-nous faire alors ? se lamenta notre hôte… Mon premier amour n’a rien de très passionnant, non plus. Je n’ai jamais aimé avant de rencontrer Anna Ivanovna, ma femme. Tout s’est passé le plus naturellement du monde : nos pères nous ont fiancés, nous ne tardâmes pas à éprouver une inclination mutuelle et nous nous sommes mariés vite. Toute mon histoire tient en deux mots. À vrai dire, messieurs, en mettant la question sur le tapis, c’est sur vous que j’ai compté, vous autres, jeunes célibataires… À moins que Vladimir Pétrovitch ne nous raconte quelque chose d’amusant…
— Le fait est que mon premier amour n’a pas été un amour banal », répondit Vladimir Pétrovitch, après une courte hésitation.
C’était un homme d’une quarantaine d’années, aux cheveux noirs, légèrement mêlés d’argent.
« Ah ! Ah ! Tant mieux !… Allez-y ! On vous écoute !
— Eh bien, voilà… Ou plutôt non, je ne vous raconterai rien, car je suis un piètre conteur et mes récits sont généralement secs et courts ou longs et faux… Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, je vais consigner tous mes souvenirs dans un cahier et vous les lire ensuite. »
Les autres ne voulurent rien savoir, pour commencer, mais Vladimir Pétrovitch finit par les convaincre. Quinze jours plus tard, ils se réunissaient de nouveau et promesse était tenue.
Voici ce qu’il avait noté dans son cahier :
[modifier] I
J’avais alors seize ans. Cela se passait au cours de l’été 1833.
J’étais chez mes parents, à Moscou. Ils avaient loué une villa près de la porte Kalougski, en face du jardin Neskoutchny. Je me préparais à l’université, mais travaillais peu et sans me presser.
Point d’entraves à ma liberté : j’avais le droit de faire tout ce que bon me semblait, surtout depuis que je m’étais séparé de mon dernier précepteur, un Français qui n’avait jamais pu se faire à l’idée d’être tombé en Russie comme une bombe[1] et passait ses journées étendu sur son lit avec une expression exaspérée. Mon père me traitait avec une tendre indifférence, ma mère ne faisait presque pas attention à moi, bien que je fusse son unique enfant : elle était absorbée par des soucis d’une autre sorte. Mon père, jeune et beau garçon, avait fait un mariage de raison. Ma mère, de dix ans plus vieille que lui, avait eu une existence fort triste : toujours inquiète, jalouse, taciturne, elle n’osait pas se trahir en présence de son mari qu’elle craignait beaucoup. Et lui, affectait une sévérité froide et distante… Jamais je n’ai rencontré d’homme plus posé, plus calme et plus autoritaire que lui. Je me souviendrai toujours des premières semaines que j’ai passées à la villa. Il faisait un temps superbe. Nous nous étions installés le 9 mai, jour de la Saint Nicolas. J’allais me promener dans notre parc, au Neskoutchny, ou de l’autre côté de la porte de Ralougsky ; j’emportais un cours quelconque — celui de Kaïdanov, par exemple — mais ne l’ouvrais que rarement, passant la plus claire partie de mon temps à déclamer des vers dont je savais un grand nombre par cœur. Mon sang s’agitait, mon cœur se lamentait avec une gaieté douce, j’attendais quelque chose, effrayé de je ne sais quoi, toujours intrigué et prêt à tout. Mon imagination se jouait et tourbillonnait autour des mêmes idées fixes, comme les martinets, à l’aube, autour du clocher. Je devenais rêveur, mélancolique ; parfois même, je versais des larmes. Mais à travers tout cela, perçait, comme l’herbe au printemps, une vie jeune et bouillante. J’avais un cheval. Je le sellais moi-même et m’en allais très loin, tout seul, au galop. Tantôt je croyais être un chevalier entrant dans la lice — et le vent sifflait si joyeusement à mes oreilles ! — tantôt je levais mon visage au ciel, et mon âme large ouverte se pénétrait de sa lumière éclatante et de son azur. Pas une image de femme, pas un fantôme d’amour ne s’était encore présenté nettement à mon esprit ; mais dans tout ce que je pensais, dans tout ce que je sentais, il se cachait un pressentiment à moitié conscient et plein de réticences, la prescience de quelque chose d’inédit, d’infiniment doux et de féminin… Et cette attente s’emparait de tout mon être : je la respirais, elle coulait dans mes veines, dans chaque goutte de mon sang… Elle devait se combler bientôt. Notre villa comprenait un bâtiment central, en bois, avec une colonnade flanquée de deux ailes basses ; l’aile gauche abritait une minuscule manufacture de papiers peints… Je m’y rendais souvent. Une dizaine de gamins maigrichons, les cheveux hirsutes, le visage déjà marqué par l’alcool, vêtus de cottes graisseuses, sautaient sur des leviers de bois qui commandaient les blocs de presses carrées. De cette manière, le poids de leur corps débile imprimait les arabesques multicolores du papier peint. L’aile droite, inoccupée, était à louer. Un beau jour, environ trois semaines après notre arrivée, les volets des fenêtres s’y ouvrirent bruyamment, j’aperçus des visages de femmes — nous avions des voisins. Je me rappelle que le soir même, pendant le dîner, ma mère demanda au majordome qui étaient les nouveaux arrivants. En entendant le nom de la princesse Zassekine, elle répéta d’abord, avec vénération : « Ah ! une princesse », puis elle ajouta : « Pour sûr, quelque pauvresse. » « Ces dames sont arrivées avec trois fiacres, observa le domestique, en servant respectueusement le plat. Elles n’ont pas d’équipage, et quant à leur mobilier, il vaut deux fois rien. — Oui, mais j’aime tout de même mieux cela », répliqua ma mère. Mon père la regarda froidement et elle se tut. Effectivement, la princesse Zassekine ne pouvait pas être une personne aisée : le pavillon qu’elle avait loué était si vétuste, petit et bas, que même des gens de peu de fortune auraient refusé d’y loger. Pour ma part, je ne fis aucune attention à ces propos. D’autant plus que le titre de princesse ne pouvait pas me produire la moindre impression, car je venais précisément de lire Les Brigands, de Schiller.
Chapitre2
J’avais contracté l’habitude d’errer chaque soir à travers les allées de notre parc, un fusil sous le bras, guettant les corbeaux. De tout temps, j’ai haï profondément ces bêtes voraces, prudentes et malignes. Ce soir-là, descendu au jardin, comme de coutume, je venais de parcourir vainement toutes les allées : les corbeaux m’avaient reconnu et leurs croassements stridents ne me parvenaient plus que de très loin. Guidé par le hasard, je m’approchai de la palissade basse séparant notre domaine de l’étroite bande jardinée qui s’étendait à droite de l’aile et en dépendait.
Je marchais, tête baissée, lorsque je crus entendre un bruit de voix ; je jetai un coup d’œil par-dessus la palissade, et m’arrêtai stupéfait… Un spectacle étrange s’offrait à mes regards.
À quelques pas devant moi, sur une pelouse bordée de framboisiers verts, se tenait une jeune fille, grande et élancée, vêtue d’une robe rose à raies et coiffée d’un petit fichu blanc ; quatre jeunes gens faisaient cercle autour d’elle, et elle les frappait au front, à tour de rôle, avec une de ces fleurs grises dont le nom m’échappe, mais que les enfants connaissent bien : elles forment de petits sachets qui éclatent avec bruit quand on leur fait heurter quelque chose de dur. Les victimes offraient leur front avec un tel empressement, et il y avait tant de charme, de tendresse impérative et moqueuse, de grâce et d’élégance dans les mouvements de la jeune fille (elle m’apparaissait de biais), que je faillis pousser un cri de surprise et de ravissement… J’aurais donné tout au monde pour que ces doigts adorables me frappassent aussi.
Mon fusil glissa dans l’herbe ; j’avais tout oublié et dévorais des yeux cette taille svelte, ce petit cou, ces jolies mains, ces cheveux blonds légèrement ébouriffés sous le fichu blanc, cet œil intelligent à moitié clos, ces cils et cette joue veloutée…
« Dites donc, jeune homme, croyez-vous qu’il soit permis de dévisager de la sorte des demoiselles que vous ne connaissez pas ? » fit soudain une voix, tout contre moi.
Je tressaillis et restai interdit… Un jeune homme aux cheveux noirs coupés très courts me toisait d’un air ironique, de l’autre côté de la palissade. Au même instant, la jeune fille se tourna également de mon côté… J’aperçus de grands yeux gris, sur un visage mobile qu’agita tout à coup un léger tremblement, et le rire, d’abord contenu, fusa, sonore, découvrant ses dents blanches et arquant curieusement les sourcils de la jeune personne… Je rougis piteusement, ramassai mon fusil et m’enfuis à toutes jambes, poursuivi par les éclats de rire. Arrivé dans ma chambre, je me jetai sur le lit et me cachai le visage dans les mains. Mon cœur battait comme un fou ; je me sentais confus et joyeux, en proie à un trouble comme je n’en avais jamais encore éprouvé.
Après m’être reposé, je me peignai, brossai mes vêtements et descendis prendre le thé. L’image de la jeune fille flottait devant moi ; mon cœur s’était assagi, mais se serrait délicieusement.
« Qu’as-tu donc ? me demanda brusquement mon père. Tu as tué un corbeau ? »
J’eus envie de tout lui raconter, mais je me retins et me contentai de sourire à part moi. Au moment de me coucher, je fis trois pirouettes sur un pied — sans savoir pourquoi — et me pommadai les cheveux. Je dormis comme une souche. Peu avant le petit jour, je me réveillai un instant, soulevai la tête, regardai autour de moi, plein de félicité — et me rendormis.
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!