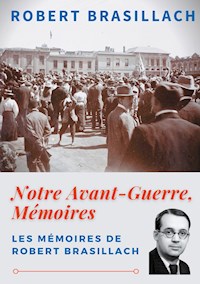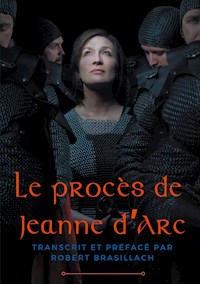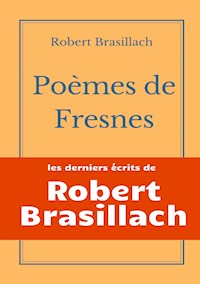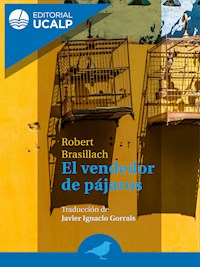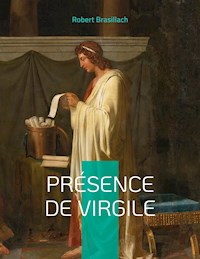
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : "Présence de Virgile" est une oeuvre littéraire fascinante, écrite par Robert Brasillach alors qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de vingt ans. Ce livre explore la figure emblématique de Virgile, le poète romain, et son influence persistante à travers les siècles. Brasillach, avec une maîtrise étonnante du langage, nous invite à redécouvrir Virgile non seulement comme un auteur de l'Antiquité mais comme un esprit vivant dont les oeuvres continuent de résonner dans le monde moderne. Le jeune auteur s'engage dans une réflexion profonde sur l'héritage littéraire et la manière dont les grands écrivains du passé façonnent notre compréhension actuelle de la littérature et de la culture. À travers une prose élégante et réfléchie, Brasillach parvient à capturer l'essence intemporelle de Virgile, tout en offrant une analyse perspicace de son impact sur les générations futures. Ce livre est une invitation à contempler la durabilité de l'art et de la pensée, et à reconnaître la présence continue des grands esprits littéraires dans notre monde contemporain. "Présence de Virgile" n'est pas simplement une étude académique, mais un hommage vibrant à l'une des figures les plus influentes de la littérature occidentale. L'AUTEUR : Robert Brasillach, né en 1909, est une figure notable de la littérature française du XXe siècle. Connu pour son talent précoce, Brasillach a marqué les esprits par son premier livre, "Présence de Virgile", écrit avant ses vingt ans. Il a étudié à l'École Normale Supérieure, où il a développé une passion pour la littérature classique et les auteurs de l'Antiquité. Brasillach s'est distingué par sa capacité à combiner une érudition profonde avec une plume élégante. Son oeuvre littéraire est souvent marquée par une réflexion sur l'héritage culturel et la place des auteurs classiques dans le monde moderne. Malheureusement, sa carrière a été entachée par ses engagements politiques controversés pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont conduit à son arrestation et à son exécution en 1945. Malgré cela, son travail littéraire continue d'être étudié pour sa contribution au débat sur la littérature et l'héritage culturel. Brasillach reste une figure complexe, dont les écrits offrent un aperçu fascinant des tensions entre art, politique et mémoire culturelle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TABLE DES MATIERES
PREMIÈRE PARTIEJeunesse de Virgile
Enfances
IL Études
Guerre et Paix
Le port du bonheur
DEUXIÈME PARTIELittérature
La fin du domaine
Débuts
Jeux alternés
Pastorales
Le Voyage de l'amitié
Les travaux et les jours
VIL Une pourpre s'apprête...
TROISIÈME PARTIEAppareillages
Mort d'un ami
La terre et les morts
Départs
Sagesses
Ô mort, vieux capitaine...
Table des matières
Première partie
Enfances
Études
Guerre et Paix
Le port du bonheur
Deuxième partie
La fin du domaine
Débuts
Jeux alternés
Pastorales
Le Voyage de l’amitié
Les travaux et les jours
Une pourpre s’apprête
.
Troisième partie
Mort d’un ami
La terre et les morts
Départs
Sagesses
Ô mort, vieux capitaine
.
I ENFANCES
Il restait peu de souvenirs de sa jeunesse : certaines images seulement, déformées comme des légendes, et puis de grands trous qui ne l’inquiétaient pas.
Il était né, un quinze octobre, dans un petit village de la plaine du Pô, non loin de Mantoue. Ses Parents y possédaient un bien... Mais ces souvenirs-là sont des choses qu’on ne peut pas raconter. Le charme des souvenirs d’enfance est sans doute dans cette faculté d’étirer, d’étendre en tous sens, espace et temps, une journée de soleil, une aventure. Plus qu’une autre, cette partie de notre vie est formée non pas de moments et de gestes successifs, mais de halos et de clartés mêlés. Aussi est-ce une chose décevante et un peu stupéfiante, pour celui qui croit que la vie est fragmentée et racontable, que de considérer cette période. On croyait bien, pourtant, que dix ans, douze ans, représentaient des faits, peu nombreux, mais nets, car on a bonne mémoire. Et pourtant, ce n’est qu’une atmosphère incroyable, formée par alluvions, où se sont déposés les récits familiaux, un rêve étrange et déchiré, un paysage inconnu avec des odeurs résineuses et des buissons plats, les vrais et maigres souvenirs, et les souvenirs beaucoup plus beaux dont nous ne nous souvenons pas.
C’est pourquoi, quand nous disons « notre enfance » , « mon enfance » , nous pouvons, du premier coup de pensée, sans chercher à analyser, savoir ce que c’est, mais ne cherchons pas à préciser, ne cherchons pas à le dire aux autres. Bien sûr, si nous disions tout uniment « ma vie » , « notre vie » , les autres non plus ne sauraient pas ce que c’est, mais nous pourrions leur faire croire qu’ils savent, car il y a des choses à dire. Il n’y a pas de choses à dire sur notre enfance.
Pour lui, comme pour d’autres, l’enfance était donc cette succession indicible de colorations où il n’y avait presque rien de précis. Il revoyait sans peine le fleuve vert de mer naître du lac de Garde, et venir, large et sinueux, baigner le domaine paternel. C’était une plaine, quelques hauteurs où se couchait le soleil d’été, et le bord uni de la rivière avec ses marécages et ses roseaux. Car il connaissait tout le pays, et Mantoue la verte, au bord de ses eaux, où il accompagnait parfois son père, lorsqu’il portait à la ville ses fromages durs et son miel. Le bien familial existait toujours, serré dans ses ceintures d’eaux, entre le Mincio et un ruisseau qui s’y jetait. Il n’était pas très vaste, mais gras et ordonné. Il venait de son grand-père maternel, un petit agent voyer fier d’une race de bonne bourgeoisie, qu’il avait connu un peu. Tous ces visages familiaux avaient beau être peu nets, il les aimait et les trouvait heureux. Son père n’était qu’un ouvrier potier qui, devenu fermier du grand-père maternel, finit par en épouser la fille. C’était un homme industrieux, économe, et plein de vertus paysannes. Il venait de Crémone. Maintenant, il habitait tou-jours cette petite ferme baignée de rivières, aveugle et attendant sa fin. Et plus il y songeait, plus son fils pensait qu’il en avait hérité de caractères, avec cet amour du sol, cette gêne un peu rustaude et, parfois, le goût des plaisirs primitifs.
Car il sentait fortement tout ce qui le liait à la terre et à ses ancêtres. Le peu qu’il en savait, déformé par des traditions familiales indécises, lui faisait infiniment respecter les efforts de petits paysans mantouans, de soldats, de marchands, et des chaînes l’unissaient à des races inconnues, âpres au gain, ou bien à ces races trop enclines au rêve qu’il aimait, se sachant des ascendances celtiques aussi bien que toscanes.
Il ignorait tout de ses premiers jours, comme nous tous, sinon ces récits puérils qu’on lui contait : sa mère avait fait un songe la nuit de l’accouchement, et puis, quand il était né, il n’avait pas pleuré du tout, mais il s’était mis à sourire. Et puis encore... Mais ce qu’il voulait seulement savoir et qui lui plaisait, c’est qu’il était né en plein air, dans un fossé, tout contre la terre, un matin d’automne que sa mère, revenant de Mantoue, gagnait la campagne avec son mari. Il était né comme les bêtes des champs. Selon la coutume des paysans de la région, on planta à sa naissance une bouture de peuplier, et il pouvait encore la voir. Car on ne manquait pas de lui dire que c’était cet arbre si grand, beaucoup plus grand que tous les autres, et pourtant, il a été planté bien après.
Il avait été élevé à la campagne, parmi les pacages et les vergers, jus-qu’à douze ans. Il avait vécu de la vie de tous les petits garçons de fermiers des environs, partageant leurs très anciens repas de châtaignes bouillies et de fromages, et chantant dans leurs rondes :
Le meilleur sera roi, tra la la !
Mais il était déjà de santé médiocre, dans ce climat trop humide. Quand il était tout petit, sa mère le berçait en lui chantant des chansons anciennes :
Le bébé qui ne rit pas à sa maman
Ne dînera pas avec le dieu
Ne se mariera pas avec la déesse.
Ou bien, elle lui racontait de vieilles histoires, et il s’habitua ainsi à croire à demi aux fées et aux magiciens capricieux qui transforment les plantes. Cette terre gorgée et fraîche, les canards et les cygnes sauvages sur les mares et les ruisseaux, la douceur mouillée des courtes nuits d’été, les ruches qu’élevait son père dans les endroits frais et pleins de fieurs, tout cela l’avait entouré de songes merveilleux.
Sa mère l’avait élevé avec une affection alors assez rare. C’était une femme encore jeune, dévorée d’amour pour ses enfants. Il n’avait qu’à se souvenir, l’autre année, lorsque son petit frère était mort, des plaintes terribles de sa mère, se lamentant à voix haute, à la mode italienne. C’est d’elle, sans doute, qu’il tenait le meilleur de lui-même, une forme de piété très douce, la croyance aux forces de la terre, l’amour du pardon et de la pitié, l’amitié pour les bêtes. Les besognes familières, l’intimité avec les plantes, les chiens, les troupeaux, la parenté si visible et si continue pour des yeux de petit paysan entre la bête et l’homme, il ne devait pas oublier ces leçons. De sa mère sans doute, il tenait aussi cette délicatesse qui devait surprendre ses amis futurs, écoliers de Crémone, étudiants de Milan, et qui le fit surnommer « la fille ». Car il était un peu gauche, mais curieux de la vie des garçons et des bêtes, et se penchant avec prédilection sur chaque chose.
C’est ainsi que son amour du pays s’était formé. Car il ne devait pas souvent, en somme, après douze ans, habiter continuement la campagne. C’est pourquoi il fallait bien que ce fût à cet âge qu’il eût appris un certain nombre de choses, et spécialement à se sentir un paysan. Un peu plus précisément, lorsqu’il y pensait avec quelque attention, il retrouvait tous les renseignements lourds et passionnés qu’il tenait de son père, de ses camarades, des valets de ferme. C’était dans des conversations qu’il avait entendu les recettes vieilles et rusées pour arracher à la terre le plus d’or possible. Il savait sous quelle étoile il fallait ouvrir le sol et marier la vigne grimpante à l’ormeau, la manière de multiplier le bétail. Avant d’enfoncer le fer dans une glèbe inconnue, il savait qu’il faut étudier l’influence des vents, le climat, les procédés scientifiques, et encore plus les traditions locales. Car on ne séparait jamais le sol de ses démons. Il y avait encore dans ses souvenirs, reposés comme dans l’hiver poussiéreux, certains outils de son père, le corps de charrue en bois dur, des rouleaux ferrés, des traîneaux, des herses, des râteaux géants et puis les osiers, les claies à sécher le fromage, celles de roseau et celles d’arbousier, le van presque sacré. À la mode antique, il avait vu couper et puis durcir au feu le joug de tilleul et le manche de hêtre. Lorsqu’avec le rouleau, on aplanissait l’aire, il y mêlait la craie et l’argile pour empêcher l’herbe de pousser. Quand la charrue allait, il suivait, découvrant les bêtes, le ver rouge, la fourmi. D’autres encore : le mulot, la taupe aveugle et fine à toucher, le scarabée.
Mais c’étaient les abeilles qu’il aimait. Dès l’enfance, comme son père en faisait l’élevage, il savait qu’il fallait chercher, pour établir des ruches, de claires fontaines, des étangs bordés de mousse, avec un arbre. Il jetait alors de grosses pierres dans l’eau, et les abeilles venaient s’y reposer. L’odeur du thym, du fenouil, de le lavande grise et bleue, se mêlait pour lui désormais à ce bourdonnement pressé, qui est comme le bruissement même de l’été. Il y avait là des saules glauques, les crocus rougissants et les jacinthes rouillées. Les ruches de son père étaient en écorce, ou en osier, enduites de terre grasse à la base, et couvertes de feuilles. Et toute la prairie sentait bon.
C’est ainsi que la terre, autant que ses ancêtres inconnus, que ce père et que cette mere presque aussi ignorés, avaient contribué à le former. A voir se suivre les saisons inégales, monter du Mincio les brouillards gris et minces, ou ces vapeurs électriques qui rendent les bêtes folles, l’été, il avait commencé sa vie et l’avait pour jamais dessinée. Ce climat mouillé, qui lui faisait mal, il l’en aimait davantage, peut-être, avec ses longs crépuscules, les mottes humides où le pied enfonce, les grands troupeaux, et cette légèreté de l’air, par les beaux jours. C’est là qu’il avait passé dans le jeu, les premières années de sa vie.
Il revoyait, un jour de ses douze ans, cette petite fille qui était venue avec sa mère cueillir dans leur verger des pommes. Il courait devant elle et sautait pour atteindre aux branches tremblantes ; il la trouvait jolie et se croyait amoureux d’elle. Que ne pouvait-il y mordre encore, à ces pommes acides et serrées, et à ces joues si fraiches de la brume du matin !
II ÉTUDES
C’était le dernier souvenir de son enfance. À douze ans, il avait quitté ces voluptueux et sages paysages, et il avait fallu aller à Crémone, travailler, apprendre, avec sa dure tête de petit paysan qui veut savoir, et sa santé débile. Vers quinze ans, on l’avait émancipé, fait bien rare, car la coutume était d’attendre plus tard, et il avait quitté les amulettes enfantines que sa mère avait suspendues à son cou dans une bulle de cuir.
Trois ans de Crémone, un an de Milan, tout cela était bien vague. Il avait appris le grec, l’histoire, s’était occupé de poésie, avait lu énormément. Pour d’autres, il se préparait à faire son droit. Ses parents le voyaient avocat, et célèbre. Il faisait semblant de croire à sa vocation.
Il avait lu des philosophes, réfléchi un peu... Ces écoles provinciales, soucieuses d’études désintéressées, lui plaisaient. Les garçons actifs qu’il rencontra à Rome demandaient des leçons pratiques pour se conduire dans leur vie et se hâtaient d’assurer leur carrière d’homme politique, de banquier ou d’avocat. Le plus célèbre essayiste du temps avait longuement et vainement protesté contre cette trahison de l’esprit. Rien n’y faisait, et seuls, les maîtres patients des écoles du Nord continuaient à penser que la philosophie et la science sont autre chose qu’une technique.
Il avait appris à connaître les plus anciens poètes de son pays et ceux qu’un bienfaisant élargissement de la littérature introduisait grâce au snobisme. Il rêvait l’alliance des forces étrangères et orientales au génie latin, pour une nouvelle notion de l’humanité.
Et puis, un beau matin de ses dix-sept ans, il était arrivé à Rome, il y avait maintenant trois années, trois années si pleines et si lourdes qu’il n’en connaîtrait jamais sans doute la profondeur interdite.
Après un long voyage, coupé de haltes dans de médiocres auberges, il avait découvert avec émotion une ville énorme et stupéfiante. Il croyait d’abord, dans sa simplicité, que Rome ressemblerait à Mantoue ou à Crémone, comme une chienne à son chiot. Mais dès l’approche, sur des larges routes, une vie onduleuse faisait naître les bruits, les voitures, le cri, et puis, un à un, surgit un tombeau, une colonne, un temple. Et lorsqu’il eut pénétré dans les faubourgs, il fut assailli par une foule violente et bigarrée, des marchands éclatants, des appels obscènes : c’étaient des vendeurs d’allumettes soufrées échangeant leur marchandise contre de la verroterie brisée ; des trafiquants de soupes, de légumes cuits, d’arlequins bizarres, criant leurs produits en plein air ; des montreurs de serpents ; des prestidigitateurs ; l’homme « le plus fort du monde » qui portait sept à huit personnes sur ses bras. Un désordre, un encombrement de voitures affolant, tout cela rayé de soleil et d’ombre, avec des taches rouges sur les marchands de viande qui transportent des poumons sanglants ou des tripes, des taches bleues sur les mules du charbonnier qui crie, le visage noir et blanc partagé en deux par l’ombre raide de son fouet.
Cette ville qu’il avait crue pareille à tant d’autres, c’était quelque chose de si nombreux et de si massif (une bruissante cité, riche de marbres, de larges espaces, avec les palais des collines, les souvenirs anciens à chaque pas, les cités ouvrières qui se dressaient et ces anciennes rues étroites et fraîches, ces maisons de bois, reléguées à l’écart, détruites, envahies par un modernisme puissant et brutal – tout un ensemble, un mélange de formes et d’odeurs extravagant, dans les années troublées que vivait le siècle) que c’était un monstre vivant auquel il ne pouvait comparer aucune ville.
Il se plongea avec passion dans le mouvement. La ville lui offrait ses rues, les odeurs des quartiers populaires, le plaisir à bon marché, les promenades. Il sut bientôt l’heure des intrigues au Champ-de-Mars, sous les portiques : il allait, lorsqu’il était seul, y regarder les jeunes femmes suivies de vieilles nourrices ou suivantes, chaperons autant que maquerelles. Et lorsqu’il en avait assez de l’artificiel d’une vie charmante, il descendait aux quartiers ouvriers ou commerçants. Là, dans les cavernes à bas prix, au flanc des rues dévalantes, le peuple de Rome se nourrit pour dix sous : des fèves au vinaigre, de la polenta de farine, des têtes de mouton bouillies, des saucisses à l’ail et à la ciboule. C’est là que, sur des bancs, on boit un vin cuit, on mange des gâteaux, on joue aux dés. Une fille du quartier se met quelquefois à chanter.
Les tondeurs en plein vent, les chanteurs de rue, les marchands de gâteaux et de boudins à la porte des bains publics, cette foule intense et brutale, assaillie de passions, les ivrognes endormis dans les ruisseaux, tout cela, aussi bien que la voiture à la mode, l’agent électoral et ses manœuvres, l’agitation du Sénat à la veille d’une grande séance, imposait un amour sans bornes de la vie et de la lumière du jour.
Comme tous ces plaisirs l’intéressaient bien plus que ses prétendues études de droit ! Il les avait pourtant terminées, pour faire plaisir à ses parents, et aussi pour voir. Il gardait le souvenir de l’unique cause qu’il eût plaidée. Décidément, ce n’était pas fait pour lui. Il avait fait l’impression d’un imbécile, car devant un public nombreux et indifférent, Il ne trouvait plus ses mots, se troublait. Son client devait avoir été condamné, n’est-ce pas ? Mais quelle importance cela avait-il ?
Pourtant, il ne se contentait pas du plaisir. Débarrassé du droit, il avait voulu apprendre encore davantage, s’était passionné pour les mathématiques et aussi pour la médecine. Il se savait prétuberculeux et désirait se soigner en connaissance de cause. Mais surtout, il se lança avec passion dans les études philosophiques et l’éloquence. C’était de son âge.
Il suivait les cours d’un Grec assez connu : Epidios, amateur de belles phrases, de prose ornée, de métaphores, qui avait retenu de l’Orient le goût du style en fleurs et des caresses. D’autres maîtres de ce genre, Tarquito, Selio, Varrone, avaient cette séduction bruyante et vaine qui l’enthousiasmait pour l’instant. Malgré les attaques fréquentes contre l’école orientaliste et précieuse, il se donnait le luxe de faire partie d’une espèce d’avant-garde, par goût juvénile autant que par jactance.
L’avant-garde – et il ne s’agit ici que de l’avant-garde entre les mains du snobisme – possède en effet le charme de l’absurde et du nouveau. Non seulement elle cherche des voies ignorées, et nous donne le plaisir de voir des arts inconnus se faire des lois, des mots jamais unis se marier pour notre agrément, des recherches verbales ou psychologiques aboutir ; mais encore, lorsqu’elle n’est pas entre les mains de très grands génies, elle pousse jusqu’à l’extravagance sa nouveauté. Et par là, elle est peut-être davantage elle-même : car ce n’est qu’en allant aux confins de l’absurde et de la folie que nous sortons décidément des chemins battus. Le grand génie qui consacrera les découvertes de l’avant-garde, les humanisera, les intégrera à un idéal universel que les hommes pourront entendre. Mais ainsi il s’interdira telle région de l’âme un peu excentrique comme telle alliance de mots un peu trop dépourvue de signification humaine ; il agrandira la possibilité de compréhension des autres hommes, il ne nous mettra pas à part d’eux. Et même, lorsque l’on a déjà d’autres idées, que l’on se rend compte de la vanité presque ridicule de certaines originalités purement extérieures, on retomberait avec un certain regret au rang des autres hommes. C’est alors, mon Dieu, qu’on trouve du charme aux épithètes saugrenues, aux emphases, aux métaphores incohérentes. On a beau ne s’en servir qu’en souriant, elles sont, elles aussi, un moyen d’évasion.
Et pour d’autres, beaucoup plus rares, elles sont encore autre chose. Lorsque nous lisons une œuvre passée, que nous contemplons une œuvre d’art ou un meuble, outre leur charme éternel et profond s’il s’agit de choses belles, il s’ajoute pour certains de nous, le charme qu’aurait tout de même une œuvre médiocre, un tableau médiocre, un meuble sans art. C’est le charme de l’époque. Ce charme est très difficile à saisir sur les belles œuvres que produit l’époque ou nous vivons. Il se Ht plus facilement sur les œuvres d’un intérêt secondaire, et principalement sur les ouvrages outranciers et délicieux qui sont ceux de l’avant-garde. En eux, nous découvrons la part incorruptible et irremplaçable du présent, ce qui fera dire dans trente ans d’ici : « Mon Dieu, comme c’est donc démodé, comme c’est donc... » (Et ici la date de l’œuvre). C’est ainsi qu’en même temps qu’un moyen d’évasion hors du banal, l’avant-garde est aussi le goût un peu pervers du démodé de notre époque.
Mais elle ne pouvait suffire à satisfaire les exigences du jeune homme. Il allait à la philosophie avec un amour inné de l’universel, un besoin immense d’explications. Trop jeune pour s’arrêter, il ne savait lequel croire, et cependant des contradicteurs et des ennemis, il formait sans doute peu à peu déjà ce qui serait la règle même de sa vie. Les dures doctrines matérialistes le rejetaient vers l’étude de la science, mathématiques ou médecine, et lui imposaient de limiter l’homme à son corps. Il apprenait d’elles dans tout l’éclat de leur jeune séduction, à ordonner la vie autour d’un centre, à déduire les choses. A l’explication du monde, la découverte de l’atome, les vieux systèmes des premiers penseurs grecs renouvelés par la philosophie du jour, s’ajoutaient pour le tenter un désespoir, une amertume virile et dure. Ceux-là même qui proclamaient la loi de l’univers nécessaire, promulguaient une morale raide et épurée, et il les aimait de vouloir faire consister la sagesse en une soumission à la nécessité. Oui, mais alors d’autres arrivaient, qui parlaient de l’écoulement éternel des choses et affirmaient qu’on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve. Platon apportait sa doctrine fluide et compliquée, respectant la complexité de la vie et donnant au monde une solution poétique, – et il songeait indéfiniment sur ces mythes presque divins, les prisonniers amoureux des ombres, ou Err le Pamphylien qui vit le pays des morts. Quand pourrait-il unir ces charmes dissémblabiés et sévères ?
Il lisait aussi les poètes et se croyait une vocation. Dans le cercle d’amis qui l’avaient suivi à Milan comme à Rome, quelques-unes de ses épigrammes contre le professeur d’escrime, ou bien telle de ses autres compositions burlesques, ou poétiques, avaient un succès d’ironie et d’estime. Il imitait le poème sur le canot de Catulle dans une parodie un peu scolaire, mais cocasse. Et puis, aussi, il travaillait à des poèmes de plus longue haleine, sans en rien dire.
Il s’amusait beaucoup. Malgré sa faible santé (il souffrait souvent de l’estomac et de la gorge et était sujet à des névralgies et à des crachements de sang), c’était un grand garçon assez fort, le teint coloré, l’air paysan. Il avait les cheveux courts, le front découvert aux tempes, les orbites profondes, avec des yeux enfoncés, les pommettes saillantes, le menton accusé, la bouche charnue ; cela formait une figure maigre et grave.
Il aimait le plaisir avec une sorte de candeur, étant naturellement sensuel, et courait les filles et les garçons, comme l’y autorisaient les mœurs de son époque. Il n’y voyait aucun mal, les maîtres qu’il lisait admettant cet éclectisme, et il suivait son désir sans aller chercher plus loin.
Mais il aimait les jeunes filles. Dans ses rêves, elles venaient, se tenant par le col ou par la main, diverses. Il y avait la petite fille de ses douze ans, dans le verger matinal. Ou bien telle autre, fraîche, avec des joues brunies par le soleil des champs, qui fuyait derrière les saules et se retournait pour être vue. Celle-là, et d’autres, avec leur cadre naturel de feuilles, le foisonnement des bois enchevêtrés, les rayures vertes et noires des profondeurs de la forêt. Il les aimait toutes, de cette façon timide et sensuelle : celle qui fuyait derrière les saules penchés de la rivière, tout son cœur bondissant s’en rappelait la grâce ; mais s’il était assez fin pour savoir qu’elle voulait être vue, il n’avait pas assez de courage ou d’irrespect pour la poursuivre et pour la prendre.
Il y en avait bien d’autres qu’il aimait et qu’il rêvait avec toute sa force inemployée, tout ce qui le poussait vers les choses neuves et vierges, et ce goût qu’il avait pour les élégances et l’harmonie que crée une femme autour d’elle. C’étaient celles qui étaient si fières, si lointaines, avec leur long corps flexible, leur regard impérieux, belles filles royales et méprisantes, qu’il leur donnait tout de suite l’armure de vieilles batailles, le cheval caparaçonné et un cœur ennemi de l’homme. Etaient-elles réelles, seulement, avec leurs vieux noms célèbres qu’on pouvait lire sous une statue ou sous un tableau ? Mais, dans ses rêves, il savait leur parler et elles étaient à lui. Elles étaient pareillement à lui, celles qui souffraient délaissées comme Ariane, qui méditaient le crime, les filles de son pays, qui croyaient aux sorciers, aux herbes maléfiques bouillies sous la lune rousse, aux imprécations et aux envoûtements.
Toutes ces jeunes filles, et aussi les confidentes, les sœurs d’enfants trop jolies et trop ardentes, celles qui préparent les amours des autres et ne disent rien d’elles-mêmes, toutes ces jeunes filles, il les aimait, presque pareilles, avec leur attrait éphémère, leur corps intact, leur amour de l’amour, cette peau fraîche et dorée et cet équilibre merveilleux.
Avec tous ses rêves, tous ses désirs, c’était un timide, un maladroit, un sérieux garçon. Il rougissait avec une facilité charmante, et hors ses amis et les filles qu’il appelait à son plaisir, il était désespéré lorsqu’il lui fallait voir quelqu’un. Il aimait le silence, l’étude, la mélancolie, autant que le mouvement, le plaisir, l’allégresse. Il sortait de sa solitude pour une brusque explosion de vie, une promenade avec les copains, une nuit de rires. Il contemplait le monde avec peu de joie et ne savait pas grand-chose de la politique. Il était sensuel et réservé, d’ailleurs exigeant, irritable. Mal vêtu, mal chaussé, au milieu d’amis élégants, il savait à peine se raser et fréquentait peu les coiffeurs.
C’est ainsi que vers l’âge de vingt ans, il pouvait rappeler ces souvenirs, alors que ses amis seuls le connaissaient et que personne d’autre ne savait le nom de Virgile.
III GUERRE ET PAIX
C’était en pleine crise politique et guerre civile. Il aurait fallu être singulièrement habile à se séparer de l’univers et à vivre pour soi pour ne pas s’apercevoir bon gré mal gré, que l’on risquait de se faire assassiner, le soir, dans les rues mal famées et que s’intéresser à la littérature et à la philosophie pouvait devenir une distraction éphémère.
Le 18 janvier 52, peu de temps après l’arrivée de Virgile à Rome, Clodius avait été assassiné par les spadassins de Milon. La foule lui avait fait des funérailles horribles et magnifiques et avait failli brûler la ville. La nuit encore, parfois, des feux sinistres éclataient dans les bas quartiers. Des gens rouges et harassés entouraient le Sénat en hurlant. Et cela menaçait d’être pire.
Pourtant les années avaient été relativement calmes. Le Sénat affolé avait donné des pouvoirs dictatoriaux à Pompée qui s’efforça de maintenir l’ordre. Aussi, les jeunes gens comme Virgile purent-ils s’amuser à leurs petits jeux intellectuels avec assez de tranquillité.
Mais tous les esprits un peu pénétrants pouvaient prévoir que les luttes étaient imminentes. Pompée tenait Rome, César était en Gaule, cela allait à peu près. Mais César rentrerait un jour. On savait fort bien qu’il ne s’était allié à Pompée que par nécessité politique. D’ailleurs l’homme d’Etat qui bornait leur ambition était mort, tué dans une aventureuse expédition en Syrie, ce qui les laissait face à face. Pompée avait perdu sa femme Julie, fille de César : un autre lien se rompait.
On ne s’étonna donc pas outre mesure de voir Pompée prendre une série de décisions qui atteignaient César par le biais. Dès l’an 50, la crise éclata : allait-on rappeler César ? Celui-ci fit savoir qu’il se soumettrait aux lois de la République et qu’il abandonnerait son commandement, à condition que Pompée abandonnât en même temps le sien. Pompée refusa, réunit des troupes à Naples, et se prépara à défendre l’Etat et son pouvoir.
Le 18 janvier 49, César, qui bouillait d’impatience à Ravenne, franchit le Rubicon, limite de son gouvernement militaire, et marcha sur Rome. Les forces de Pompée étaient en Espagne. Pompée et le Sénat, abandonnant la capitale par raison d’État, se réfugièrent à l’abri des coups, en Grèce, laissant à d’autres le mandat de défendre Rome. Déjà ! En deux mois, César avait occupé l’Italie entière, couru en Espagne où il avait battu les lieutenants de Pompée à Lérida, pris Marseille révoltée. Matée, Rome ne bougea pas.
Virgile n’avait pas été enrôlé. Il avait pourtant laissé ses cours de philosophie et ses poètes pour les années de grandes vacances que ses pareils ont parfois aimées. Mais, s’il avait suivi avec joie les exploits de César, si la gloire du conquérant avait pour lui l’attrait qu’elle avait sur les jeunes gens, il détestait cette guerre. En paysan, il souffrait de savoir les champs en friche, de voir des bandes parcourir les campagnes, avec leur faux retournée changée en pique. Le monde lui semblait maudit et frappé de folie furieuse.