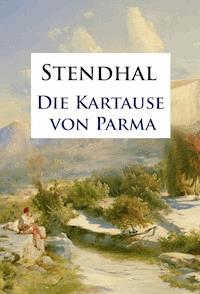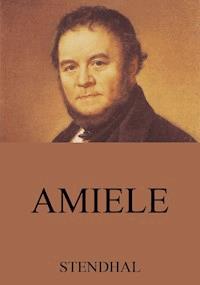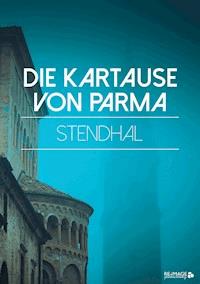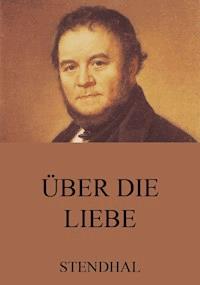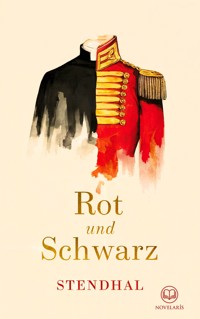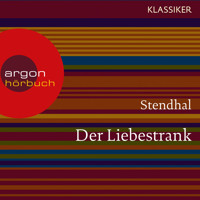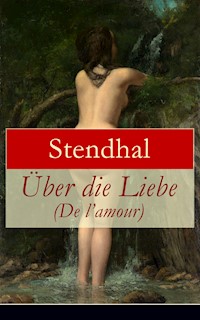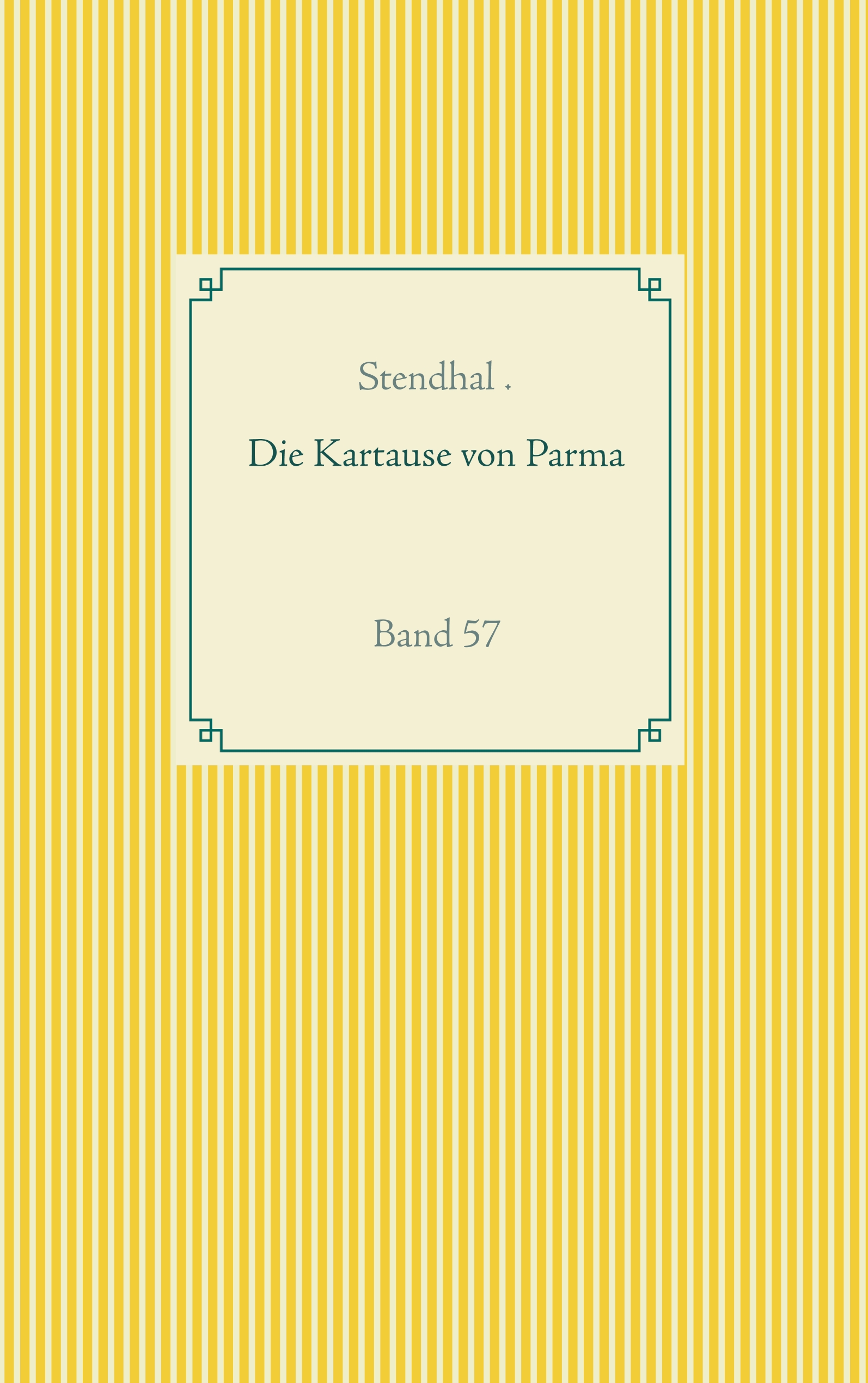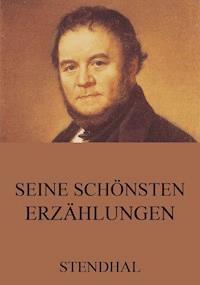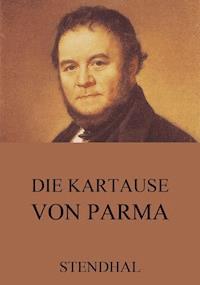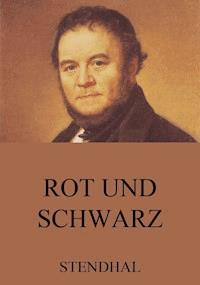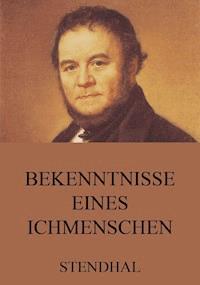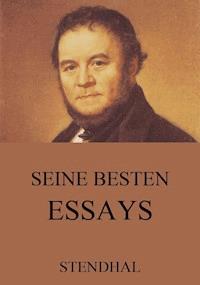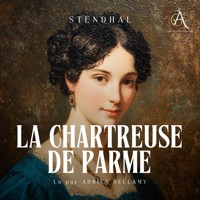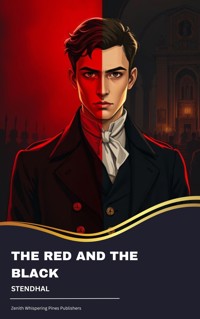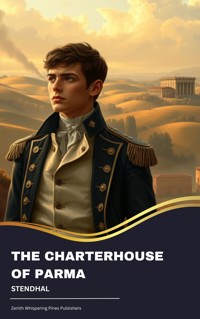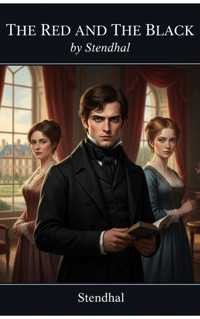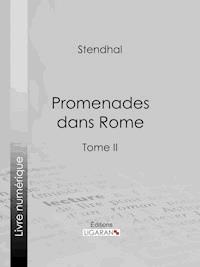
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Promenades dans Rome, un chef-d'œuvre littéraire de l'écrivain français Stendhal, nous transporte dans les rues pittoresques et les monuments majestueux de la Ville Éternelle. Publié en 1829, ce livre est bien plus qu'un simple guide touristique, il est une véritable invitation à la découverte de Rome à travers les yeux passionnés de son auteur.Stendhal, connu pour son style d'écriture vivant et captivant, nous emmène dans une promenade envoûtante à travers les ruelles étroites, les places animées et les églises somptueuses de la capitale italienne. À travers ses descriptions minutieuses et ses observations perspicaces, il nous fait revivre l'atmosphère vibrante de la Rome du XIXe siècle.
Au fil des pages, Stendhal nous dévoile les trésors cachés de la ville, des sites emblématiques tels que le Colisée et le Panthéon, aux lieux moins connus mais tout aussi fascinants. Il nous fait également part de ses rencontres avec les habitants de Rome, nous offrant ainsi un aperçu unique de la vie quotidienne et de la culture romaine de l'époque.
Mais Promenades dans Rome est bien plus qu'un simple récit de voyage. Stendhal y exprime également ses réflexions sur l'art, la beauté et l'histoire, nous invitant à porter un regard neuf sur les monuments et les œuvres d'art qui jalonnent la ville. Son amour pour Rome transparaît à chaque page, et sa passion contagieuse nous pousse à explorer nous-mêmes les merveilles de cette cité éternelle.
Avec Promenades dans Rome, Stendhal nous offre un voyage littéraire inoubliable, mêlant histoire, art et émotions. Ce livre est un véritable trésor pour les amoureux de la littérature et de l'histoire, ainsi que pour tous ceux qui rêvent de découvrir ou de redécouvrir la beauté intemporelle de Rome.
Extrait : "ROME, 29 mai 1829.—Voici une suite d'intrigues assez peu intéressantes, il est vrai, que les hasards d'une procédure secrète viennent de faire découvrir Flavia à M. le cardinal N***, légat à ***. Flavia Orsini gouvernait avec prudence et fermeté le couvent noble de Catanzara, situé dans la Marche. Elle s'aperçut qu'une de ses religieuses, l'altière Lucrèce Frangimani, avait une intrigue avec un jeune homme de Forli qu'elle introduisit la nuit dans le couvent…"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 648
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ROME, 29 mai 1828. – Voici une suite d’intrigues assez peu intéressantes, il est vrai, que les hasards d’une procédure secrète viennent de faire découvrir à M. le cardinal N ***, légat à ***.
Flavia Orsini gouvernait avec prudence et fermeté le couvent noble de Catanzara, situé dans la Marche. Elle s’aperçut qu’une de ses religieuses, Faîtière Lucrèce Frangimani, avait une intrigue avec un jeune homme de Forli quelle introduisait la nuit dans le couvent.
Lucrèce Frangimani appartenait à l’une des premières familles des états de l’Église, et l’abbesse se vit obligée à beaucoup de ménagements.
Clara Visconti, nièce de l’abbesse et religieuse depuis peu de mois, était l’amie intime de Lucrèce. On regardait Clara comme la plus belle personne du couvent. C’était un modèle presque parfait de cette beauté lombarde, que Léonard de Vinci a immortalisée dans ses têtes d’Hérodiade.
Sa tante l’engagea à représenter à son amie que l’intrigue qu’elle entretenait était connue et que son honneur l’obligeait à y mettre un terme. – Vous n’êtes encore qu’une enfant timide, lui répondit Lucrèce ; vous n’avez jamais aimé : si votre heure arrive une fois, vous sentirez qu’un seul regard de mon amant est fait pour avoir plus d’empire sur moi que les ordres de madame l’abbesse et les châtiments les plus terribles qu’elle peut m’infliger. Et ces châtiments, je les redoute peu ; je suis une Frangimani !
L’abbesse, voyant que tous les moyens de douceur échouaient, en vint aux réprimandes sévères ; Lucrèce y répondit en avouant sa faute, mais avec hauteur. Son illustre naissance devait, suivant elle, la placer bien au-dessus des règles communes. « Mes excellents parents, ajouta-t-elle avec un sourire amer, m’ont fait faire des vœux terribles dans un âge où je ne pouvais comprendre ce à quoi je m’engageais ; ils jouissent de mon bien ; il me semble que leur tendresse doit aller jusqu’à ne pas laisser opprimer une fille de leur nom, ceci ne leur coûtera pas d’argent. »
Peu de temps après cette scène assez violente, l’abbesse eut la certitude que le jeune homme de Forli avait passé trente-six heures caché dans le jardin du couvent. Elle menaça Lucrèce de la dénoncer à l’évêque et au légat, ce qui eût amené une procédure et un déshonneur public. Lucrèce répondit fièrement que ce n’était pas ainsi qu’on en agissait avec une fille de sa naissance, et que, dans tous les cas, si l’affaire devait être portée à Rome, l’abbesse eût à se souvenir que la famille Frangimani y avait un protecteur naturel dans la personne de monseigneur *** (c’est l’un des grands personnages de la cour du pape.) L’abbesse, indignée de tant d’assurance, comprit cependant toute la valeur de ce dernier mot ; elle renonça à supprimer, par les voies de droit, l’intrigue qui déshonorait son couvent.
Flavia Orsini, d’une fort grande naissance elle-même, avait beaucoup d’influence dans le pays ; elle sut que l’amant de Lucrèce, jeune homme fort imprudent, était vivement soupçonné de carbonarisme. Nourri de la lecture du sombre Alfieri, indigné de la servitude où languissait l’Italie, ce jeune homme désirait passionnément faire un voyage en Amérique, afin de voir, disait-il, la seule république qui marche bien. Le manque d’argent était l’unique obstacle à son voyage ; il dépendait d’un oncle avare. Bientôt cet oncle, obéissant à la voix de son confesseur, engage son neveu à quitter le pays, et lui donne les moyens de voyager. L’amant de Lucrèce n’osa la revoir ; il traversa la montagne qui sépare Forli de la Toscane, et l’on sut qu’il avait pris passage à Livourne sur un vaisseau américain.
Ce départ fut un coup mortel pour Lucrèce Frangimani. C’était alors une fille de vingt-sept à vingt-huit ans, d’une rare beauté, mais d’une physionomie fort changeante. Dans ses moments sérieux, ses traits imposants et ses grands yeux noirs et perçants annonçaient peut-être un peu trop l’empire qu’elle était accoutumée à exercer sur tout ce qui l’environnait ; dans d’autres instants, pétillante d’esprit et de vivacité, elle devançait toujours la pensée de qui lui parlait. Du jour qu’elle eut perdu son amant, elle devint pâle et taciturne. Quelque temps après, elle se lia avec plusieurs religieuses qui faisaient profession de haïr l’abbesse. Celle-ci s’en aperçut, mais n’y fit aucune attention. Bientôt Lucrèce prêta son génie à la haine jusque-là inactive et impuissante de ses nouvelles amies.
L’abbesse avait toute confiance dans la sœur converse attachée à son service ; Martina était une fille simple, habituellement triste. Sous prétexte de santé, mais dans le fait par des motifs plus sérieux, la sœur Martina préparait seule les mets fort simples qui formaient la nourriture de l’abbesse. Lucrèce dit à ses nouvelles amies : « Il faut à tout prix nous lier avec Martina, et d’abord découvrir si elle n’a aucune intrigue au dehors. » Après plusieurs mois de patiente observation, on sut que Martina aimait un veturino du bourg voisin de Catanzara, et mourait de peur d’être dénoncée à la vertueuse abbesse. Le veturino Silva était toujours par voies et par chemins ; mais, à chaque voyage qu’il faisait à Catanzara, il ne manquait pas de trouver un prétexte pour venir voir Martina. Lucrèce et plusieurs de ses nouvelles amies avaient hérité de quelques parures en diamants ; elles les firent vendre à Florence. Ensuite, le frère de la femme de chambre de l’une de ces dames feignit d’avoir des affaires hors du pays, voyagea dans la voiture de l’amant de Martina, devint son ami, et un jour lui dit négligemment qu’une sœur converse du couvent, nommée Martina, venait d’hériter en secret du trésor d’une religieuse morte depuis peu, et qu’elle avait soignée avec beaucoup de zèle.
Le veturino venait justement d’être presque ruiné par une confiscation et une prison de trois mois qu’il avait subie à Vérone. Un de ses voyageurs, après avoir rempli sa voiture de contrebande, s’était évadé au moment où les douaniers autrichiens de la ligne du Pô saisissaient les marchandises prohibées. Après ce malheur, Silva revenait à Catanzara avec des chevaux de louage, les siens avaient été vendus ; il ne manqua pas de demander de l’argent à Martina qui, dans le fait, était pauvre, et fut réduite au désespoir par les reproches de son amant et ses menaces de l’abandonner. Cette fille tomba malade ; Lucrèce Frangimani eut la bonté d’aller la voir souvent.
Un soir elle lui dit : « Notre abbesse a un caractère trop irascible, elle devrait prendre de l’opium pour se calmer, elle nous tourmenterait moins par ses réprimandes journalières. » Quelque temps après Lucrèce revint sur cette idée : « Moi-même, dit-elle, quand je me sens disposée à trop d’impatience, j’ai recours à l’opium. Depuis mon malheur, j’en prends souvent. » Enhardie par cette allusion à un évènement bien connu dans le couvent, Martina confia en pleurant, à la puissante sœur Frangimani, qu’elle avait le malheur d’aimer un homme du bourg voisin, et que cet amant était sur le point de la quitter parce qu’il la croyait riche, et lui demandait des secours qu’elle ne pouvait lui offrir.
Lucrèce portait ce jour-là, sous sa guimpe, une petite croix ornée de diamants ; elle la détacha et força Martina à l’accepter. Peu de temps après elle revint avec adresse sur l’idée de donner de l’opium à l’abbesse pour calmer ses emportements journaliers. Quelque prudence que Lucrèce mit dans cette proposition, la fatale idée de poison s’offrit à Martina dans toute son horreur. « Qu’appelez-vous poison ? dit Lucrèce indignée. Tous les trois ou quatre jours vous mettrez quelques gouttes d’opium dans ses aliments, et je prendrai moi-même devant vous, dans mon café, la même quantité de gouttes d’opium sortant de la même fiole. » Martina était simple et confiante ; elle adorait son amant ; elle avait affaire à une personne passionnée, d’une adresse et d’un esprit infinis. Son amant avait reçu avec reconnaissance la petite croix de diamants et l’aimait plus que jamais. Elle donna à l’abbesse ce qu’on appelait de l’opium, et fut presque tout à fait rassurée en voyant Lucrèce laisser tomber dans son café quelques gouttes de la même liqueur.
Une autre séduction contribua surtout à décider Martina. Les religieuses du chapitre noble de Catanzara ont le privilège, au bout de cinq ans de religion, d’exercer tour à tour, et pendant vingt-quatre heures chacune, les fonctions de portière du couvent. Lucrèce dit à Martina que, la première fois qu’elle ou une de ses amies aurait la garde de la clôture, on oublierait de mettre la barre derrière la petite porte près de la cuisine, par laquelle les hommes de peine apportaient les provisions au couvent. Martina comprit qu’elle pourrait cette nuit-là recevoir son amant.
Près d’une année s’était écoulée depuis que l’abbesse avait eu la fatale idée de gêner les amours de Lucrèce Frangimani. Pendant cet intervalle, un jeune Sicilien, accusé de carbonarisme dans son pays, était venu se réfugier en quelque sorte sous la protection du confesseur du couvent, qui était son oncle. Rodéric Landriani vivait fort retiré dans une petite maison du bourg de Catanzara ; son oncle lui avait recommandé de ne pas faire parler de lui. Rodéric n’avait pour cela aucune violence à se faire. D’un caractère généreux et romanesque, mais fort pieux, les persécutions qu’il souffrait depuis la révolution de 1821 avaient redoublé la mélancolie qui lui était naturelle. Son oncle lui avait conseillé de passer chaque jour plusieurs heures dans l’église du couvent ; « Vous pourrez y porter, lui dit-il, des livres d’histoire que je vous prêterai. » Aux yeux de Rodéric une lecture mondaine en un tel lieu eût été une profanation ; il y lisait des livres de piété. Les sœurs converses, qui avaient le soin de l’église, remarquèrent ce beau jeune homme auquel rien ne pouvait donner de distraction ; sa beauté mâle et son air militaire faisaient un étrange contraste, aux yeux des bonnes sœurs, avec la réserve extrême de ses manières.
L’abbesse apprit cette conduite exemplaire ; elle invita à dîner à son parloir particulier, le neveu d’un personnage aussi important que le confesseur du couvent. Landriani eut ainsi quelques rares occasions de parler à Clara Visconti. Par ordre du directeur de sa conscience Clara passait des heures entières en contemplation derrière le grand rideau qui sépare du reste de l’église la grille du chœur des religieuses. Une fois que Rodéric lui fut connu, elle remarqua qu’il fréquentait assidûment l’église ; il lisait avec attention ; et, quand l’angelus sonnait, il quittait son livre pour se mettre à genoux et faire la prière.
Landriani qui, en Sicile, avait vécu dans le monde, se trouvant à Catanzara sans autre société que celle d’un oncle d’un caractère sombre et despotique, prit peu à peu l’habitude de venir voir l’abbesse tous les deux jours. Il trouvait Clara auprès de sa tante ; elle répondait en peu de mots à ce qu’il disait et d’un air fort triste et presque sauvage. Rodéric qui n’avait aucun projet se sentit moins malheureux ; mais bientôt le jour qu’il passait sans voir Clara lui sembla d’une longueur insupportable. Comme il en disait quelque chose à la jeune religieuse sans dessein et presque sans s’en apercevoir, elle lui répondit que son devoir l’appelait presque tous les jours au chœur des religieuses, d’où elle le voyait fort bien lisant dans la nef. À la suite de cette confidence, il arrivait que quelquefois Clara appuyait sa tête contre le rideau et la grille de façon à marquer l’endroit où elle était.
Un jour que Rodéric regardait attentivement la grille qui le séparait de Clara ; elle eut la faiblesse d’écarter un peu le rideau. Ils étaient assez près pour se parler facilement ; mais il a été prouvé, dans la procédure, que jamais à cette époque ils ne s’étaient adressé la parole dans l’église. Après quelques semaines de bonheur et d’illusions Rodéric devint fort malheureux ; il ne put se dissimuler qu’il aimait : mais Clara était religieuse, elle avait fait des vœux au ciel, à quel crime horrible ne le conduisait pas cet amour !
Rodéric, qui disait tout à Clara, lui fit part de ses remords et de son malheur ; ce fut la première fois qu’il lui parla d’amour. Elle le reçut fort mal, mais cette étrange manière de déclarer sa passion ne le rendit que plus intéressant aux yeux de la jeune Romaine. Tel est l’amour dans ces âmes passionnées ; les plus grands défauts, les crimes, les désavantages les plus extrêmes, loin d’éteindre l’amour, ne font que l’augmenter. « J’aimerais mon amant quand il serait voleur ! » me disait madame L ***, par qui j’ai su l’histoire que je raconte.
Tout ceci se passait pendant l’année que Lucrèce employa à nouer sa noire intrigue avec Martina. On était dans les grandes chaleurs de la fin d’août ; il y avait déjà plusieurs mois qu’il n’existait plus d’autre bonheur pour Clara que celui de voir Rodéric de deux jours l’un au parloir, et l’autre jour dans l’église. Religieuse exemplaire et nièce favorite de l’abbesse, elle jouissait d’une grande liberté ; souvent, ne pouvant dormir la nuit, elle descendait au jardin.
Le 29 août, vers les deux heures du matin, ainsi qu’il a été prouvé dans le procès, elle quittait le jardin à pas lents et rentrait dans sa cellule. Comme elle passait devant la petite porte destinée aux gens de service, elle s’aperçut que la barre transversale, qui ordinairement passait dans deux anneaux de fer scellés dans le mur et dans un autre anneau fixé dans la porte et fermait celle-ci, n’avait pas été placée ; elle continuait son chemin sans songer à rien, lorsqu’une petite clarté sombre qui passait entre les deux battants lui montra que la porte n’était pas même fermée à clef. Elle la poussa un peu, et vit le pavé de la rue.
Cette vue jeta le trouble dans son âme. L’idée la plus extravagante s’empara d’elle ; tout-à-coup elle détache son voile, dont elle se fait une sorte de turban ; elle arrange sa guimpe comme une cravate, la grande robe flottante de soie noire de son ordre devient une sorte de manteau d’homme. Ainsi vêtue, elle ouvre la porte, la repousse, et la voilà dans les rues de Catanzara, allant faire une visite à Rodéric Landriani.
Elle connaissait sa maison, qu’elle regardait souvent du haut de la terrasse qui forme le comble du couvent. Elle frappe en tremblant, elle entend la voix de Rodéric qui réveille son domestique. Celui-ci monte au premier étage pour voir qui frappe, il redescend, ouvre ; le vent de la porte éteint la lampe qu’il venait d’allumer, il bat le briquet ; pendant ce temps, Rodéric s’écrie de la chambre voisine : Qui est-ce ? que me veut-on ? – C’est un avertissement qui intéresse votre sûreté, répond Clara, en grossissant sa voix.
Enfin la lampe est rallumée, et le domestique conduit à son maître le jeune homme qui lui apportait cet avis. Clara trouva Rodéric habillé et armé ; mais voyant un très jeune homme tout tremblant et qui avait l’air d’un séminariste, Rodéric déposa le tromblon qu’il avait à la main. La lampe éclairait mal et le jeune homme était si ému qu’il ne pouvait parler. Rodéric prit la lampe, l’approcha de la figure de Clara, et tout-à-coup la reconnaissant, il poussa son domestique dans l’autre pièce, et dit à Clara : « Grand Dieu ! que venez-vous faire ici ? Le feu a-t-il pris au couvent ? »
Ce mot ôta tout son courage à la pauvre religieuse, elle commença à voir toute l’étendue de sa folie. Le froid accueil de l’homme qu’elle adorait sans le lui avoir jamais dit, la fait tomber presque évanouie sur une chaise ; Rodéric répète sa question, elle porte la main sur son cœur, se lève comme pour sortir, et les forces lui manquant de nouveau, elle tombe tout à fait sans connaissance.
Peu à peu elle revient à elle, Rodéric lui parle, et enfin par le silence prolongé de Clara, il comprend l’étrange démarche de son amie. « Clara qu’as-tu fait ? » lui dit-il. Il la serrait dans ses bras ; tout-à-coup il la replace sur une chaise, s’éloigne un peu, et lui dit avec fermeté :
« Tu es l’épouse du Seigneur, tu ne peux m’appartenir, le crime serait horrible pour toi et pour moi ; repens-toi de ton péché. Demain matin, je quitterai Catanzara pour jamais. »
Ce mot affreux la fit fondre en larmes. Landriani passa dans la pièce voisine, il reparaît bientôt couvert d’un grand manteau. – « Comment êtes-vous sortie ? – Par la porte près de la cuisine, que j’ai trouvée ouverte par hasard, bien par hasard. – Je comptais vous mener à mon oncle,… il suffit » ; dit Rodéric, en lui présentant le bras, et sans ajouter un mot, il la reconduit au couvent. Ils trouvèrent la petite porte dans l’état où Clara l’avait laissée, environ trois quarts d’heure auparavant. Ils entrèrent doucement, mais Clara ne pouvait plus se soutenir ; Rodéric lui dit avec tendresse : « Où est ta chambre ? – Par ici, » répondit-elle d’une voix mourante ; elle avait indiqué le dortoir du premier étage.
En montant l’escalier, Clara craignant d’être méprisée de son amant et sentant qu’elle lui parlait pour la dernière fois, tomba tout à fait évanouie sur les marches. Une lampe allumée devant une madone lointaine, éclairait faiblement cette scène. Landriani comprit que son devoir lui ordonnait d’abandonner Clara, qui désormais était dans son couvent, mais il n’en eut pas le courage. Bientôt des sanglots convulsifs sont sur le point d’étouffer Clara. « Le bruit de ses pleurs peut attirer l’attention de quelque religieuse, se dit Rodéric, et ma présence ici la déshonore. » Mais il ne peut se résoudre à la quitter en cet état ; elle était incapable de se soutenir et de marcher, ses sanglots l’étouffaient ; Rodéric la prend dans ses bras. Il redescend vers la porte par laquelle il venait d’entrer et qu’il savait devoir être près du jardin. En effet, après avoir fait quelques pas dans le corridor, près de la porte, toujours portant Clara, il aperçoit le jardin et ne s’arrête que dans la partie le plus éloignée des bâtiments, tout à fait au fond. Là il dépose son amie sur un banc de pierre caché dans un bosquet de platanes taillés fort bas.
Mais il avait serré trop longtemps dans ses bras une jeune fille qu’il adorait ; arrivé sous les platanes, il n’eut plus le courage de la quitter, et enfin l’amour fit oublier la religion. Quand l’aube du jour parut, Clara se sépara de lui, après lui avoir fait jurer mille fois que jamais il ne quitterait Catanzara. Elle vint seule ouvrir la porte qu’elle trouva non fermée, et veilla de loin sur la sortie de son amant.
Le jour suivant, il la vit au parloir ; il passa la nuit caché dans la rue près de la petite porte, mais vainement Clara essaya de l’ouvrir ; toutes les nuits suivantes, elle la trouva fermée à clef et avec la barre. La sixième nuit après celle qui avait décidé de son sort, Clara cachée dans les environs de la porte vit distinctement Martina qui arrivait sans bruit. Un instant après, la porte s’ouvrit et un homme entra, mais la porte fut soigneusement refermée ; Clara et son amant attendirent jusqu’à la sortie de cet homme, qui eut lieu à la petite pointe du jour. Ils n’avaient de consolation que celle de s’écrire. Dans la lettre du lendemain, Rodéric dit à son amie que l’homme plus heureux que lui était le veturino Silva, mais qu’il la suppliait de ne faire aucune confidence à Martina. Bien éloigné maintenant de ses scrupules religieux, Landriani proposait à Clara de pénétrer dans le couvent par le mur du jardin, elle frémit du péril auquel il voulait s’exposer : ce mur bâti dans le Moyen Âge pour défendre les nonnes contre les débarquements des Sarrasins, a quarante pieds de haut dans la partie la moins élevée. Il s’agissait d’avoir une échelle de cordes ; Landriani, craignant de compromettre son amie en achetant des cordes dans les environs, part pour Florence ; quatre jours après il était dans les bras de Clara. Mais par une coïncidence étrange, cette même nuit la malheureuse abbesse Flavia Orsini rendait le dernier soupir ; elle dit en mourant au père confesseur : « Je meurs par le poison pour avoir essayé d’empêcher les intrigues de mes religieuses avec des hommes du dehors. Peut-être cette nuit même la clôture a-t-elle été violée. »
Frappé de cette confidence, à peine l’abbesse est-elle morte, que le confesseur fait exécuter la règle dans toute son exactitude. Toutes les cloches du couvent annoncent l’évènement qui vient d’avoir lieu. Les paysans du bourg se lèvent à la hâte et se réunissent devant la porte du couvent, Rodéric s’était échappé aux premiers coups de cloche.
Mais on voit sortir le veturino Silva qui est arrêté. On savait que cet homme avait vendu une croix de diamants, il avoua qu’il la tenait de Martina qui dit à son tour que Lucrèce avait eu la générosité de lui en faire cadeau. Accusée d’avoir commis un sacrilège en ouvrant la porte du couvent, Martina crut se sauver en compromettant le neveu du père confesseur ; elle dit que la sœur Visconti ouvrait cette porte à son amant Rodéric Landriani. Le confesseur, assisté de trois prêtres que l’archevêque de R *** lui avait envoyés, interrogea Clara ; il déclara, en sortant du couvent, que le lendemain elle serait confrontée à Martina. Il paraît que, la nuit suivante, Rodéric pénétra jusqu’à la cellule qui servait de prison à son amie et lui parla à travers la porte. Le lendemain matin Lucrèce Frangimani, qui jusqu’ici n’était nullement compromise mais qui redoutait la confrontation de Martina avec Clara, fit probablement jeter du poison dans le chocolat qu’on leur porta à toutes les deux. Vers les sept heures, quand les délégués de l’archevêque arrivèrent pour continuer la procédure, on leur apprit que Clara Visconti et la sœur converse Martina n’existaient plus. Rodéric se conduisit d’une manière héroïque, mais personne ne fut puni, et l’affaire a été étouffée. Malheur à qui en parlerait !
30 mai 1828. – Ce matin, le ciel chargé de nuages nous permettait de courir les rues de Rome sans être exposés à un soleil brûlant et dangereux. Nos compagnes de voyage ont voulu revoir le Forum, sans projet, ni science, et uniquement en suivant l’impulsion du moment.
Nous avons débuté par descendre dans le trou profond du milieu duquel s’élève la colonne de Phocas. Nous avons remarqué les fragments de colonnes renversés que l’on a laissées couchées sur l’ancien pavé du Forum à quinze ou dix-huit pieds de profondeur, car en ce lieu telle est l’épaisseur de la couche de terre. Que de colonnes et peut-être de statues n’eût pas trouvées le Russe généreux qui voulait déterrer le Forum ! Au lieu de se piquer contre les courtisans de Léon XII qui le forcèrent à quitter Rome, il aurait dû les acheter. Aujourd’hui quelle différence pour sa mémoire ! À l’aide d’un peu d’adresse et de deux cent mille francs, le nom de Demidoff aurait pénétré en Amérique et dans l’Inde, à la suite des noms de Napoléon, de Rossini et de lord Byron.
Je crois que c’est à cause de l’air de propreté de la jolie ruine appelée le Forum Palladium, que dès le premier jour elle a séduit nos compagnes de voyage. Ce Forum, commencé par Domitien, achevé et dédié par Nerva, était une grande salle carrée ; le long des murs de chaque côté étaient placées seize colonnes cannelées d’ordre corinthien : à en juger par les deux qui nous restent, elles avaient neuf pieds et demi de circonférence et vingt-neuf pieds de haut. L’entablement quelles soutenaient présentait des ornements d’un beau travail ; les petites figures sculptées en bas-relief sur la frise sont admirables.
Tout ce forum est recouvert de douze ou quinze pieds de terre. Sur les fonds de sa liste civile pour 1814, l’empereur Napoléon avait ordonné qu’on exécutât ici un travail analogue à celui de la basilique de Trajan.
On voit, au-dessus du sol, la partie supérieure du mur de l’angle oriental du Forum Palladium, les extrémités de deux colonnes corinthiennes cannelées, l’entablement, la frise, et au-dessus la figure de Pallas debout : tout cela est on ne peut pas plus joli. Les extrémités de la grande salle que j’ai appelée carrée, étaient formées par des murs légèrement circulaires. Tous ces détails sont niés par d’autres antiquaires qui donnent d’autres explications.
Ces trois magnifiques colonnes de marbre blanc que vous apercevez à gauche, en allant vers le mont Quirinal, appartenaient au Forum Transitorium, ou à un temple de Pallas ou à un temple de Nerva. Le lieu où nous sommes était, peut-être, le plus fréquenté de l’ancienne Rome. Tout y était magnifique et monumental.
C’était le chemin naturel par lequel la partie basse de Rome, située du côté de Velabro, la rue Suburra, placée entre le Colisée et Saint-Jean-de-Latran et l’une des plus populeuses, et enfin le Forum, communiquaient avec la partie élevée de la ville, située sur les monts Qairinal, Viminal et Esquilin (Il faudrait que le lecteur voulût bien vérifier ceci sur une carte). La hauteur qui était couronnée par les thermes de Titus, était un obstacle à ce que les habitants de la rue Suburra se rendissent au mont Esquilin en suivant la ligne la plus droite.
Le forum dédié par Nerva prit le nom de transitorium à cause de la position que nous venons d’indiquer, ou bien ce nom lui vint de l’arc de Pantani, qui fut une porte de Rome au temps de Numa. C’est dans ce lieu qu’Alexandre Sévère fit étouffer avec de la fumée de paille brûlée, un de ses courtisans, nommé Turinus, qui vendait aux particuliers les grâces qu’il promettait d’obtenir de l’empereur ; que le vendeur de fumée soit puni par la fumée dit Sévère.
Ce forum était appuyé à un grand mur qui nous semble l’une des choses les plus étonnantes de Rome ; il est construit de blocs de pépérin assemblés sans mortier avec des crampons d’un bois fort dur. Je n’ai rien trouvé de satisfaisant sur ce mur ; mais je ne puis affirmer au lecteur avoir compulsé la masse énorme des trois ou quatre cents bouquins, la plupart in-folio, relatifs aux monuments de Rome. Ce qu’il y a de pis, c’est que, faute de logique dans la tête des auteurs, ils sont écrits d’un style entortillé et obscur.
La construction de ce mur, l’impression de grandeur sévère qu’il laisse dans l’âme du spectateur, et sa direction qui ne s’accorde point avec les bâtiments situés au couchant, font supposer qu’il est antérieur de plusieurs siècles à Nerva.
Le temple que Trajan fit élever en l’honneur de Nerva passait pour l’un des plus beaux édifices de l’ancienne Rome. Par sa grandeur, il se rapprochait de nos églises modernes, toute l’antiquité a loué son architecture comme excellente, enfin Trajan y avait fait réunir les ornements les plus riches.
D’un aussi grand monument il ne paraît aujourd’hui au-dessus du sol que trois magnifiques colonnes de marbre blanc, qui ont cinquante-un pieds de hauteur et seize et demi de circonférence. Elles sont cannelées et d’ordre corinthien. Il reste un fragment du mur de la Cella (ou sanctuaire), qui, avec les trois colonnes et un pilastre, supporte l’architrave. Pendant le Moyen Âge on a bâti sur cet architrave un clocher carré en briques, fort élevé et fort pesant, qui finira par faire écrouler ce qui nous reste du temple de Nerva. C’est contre ce clocher que sont dirigés les vœux de tous les antiquaires de Rome. Je ne doute pas qu’il n’ait donné des idées libérales à plusieurs de ces messieurs. Tous désirent qu’il soit démoli, mais il appartient à l’église de l’Annonciation. Quand aurons-nous un pape assez philosophe pour permettre qu’un édifice consacré au culte soit démoli, et cela pour augmenter le plaisir profane des dilettanti ?
L’architrave et le plafond du portique pour lequel nous tremblons, présentent les plus beaux ornements. Palladio a donné un plan de ce temple de Nerva. On peut en conclure que la façade était tournée vers la Voie Sacrée et le forum. Ce temple était environné de colonnes d’une grande hauteur et d’une beauté parfaite. Le portique, formant la façade, était composé de deux rangs de huit colonnes chacun. Les deux parties latérales du portique, le long des grands côtés du monument, avaient neuf colonnes, en comptant celles de l’angle.
Nous arrivons au grand péché de Paul V Borghèse. Par les ordres de ce pape, qui a fini Saint-Pierre, on enleva ce qui restait du temple de Pallas élevé par l’empereur Nerva. Cette ruine magnifique se composait de sept grandes colonnes cannelées de marbre blanc, et d’ordre corinthien. Elles soutenaient un riche entablement et un fronton. Hier soir, chez madame de D ***, nous avons vu plusieurs gravures représentant ce monument tel qu’il était avant Paul V. Ce pape le fit démolir parce qu’il avait besoin des marbres pour sa fontaine Pauline sur le mont Janicule. L’utilité du livre que vous lisez, si tant est qu’il en ait, est peut-être d’empêcher à l’avenir de tels attentats. Avant la fin de la promenade d’aujourd’hui, vous verrez ce que l’on a osé faire en 1823.
Ce n’est que par un appel à l’opinion de l’Europe que l’on peut mettre un frein à la sottise opiniâtre et hardie de certains hommes que je devrais nommer, et qui feraient démolir le Colisée pour arriver au chapeau un an plus tôt.
Il y a quelques jours qu’un Anglais est arrivé à Rome avec ses chevaux qui l’ont porté d’Angleterre ici. Il n’a pas voulu de cicérone, et, malgré les efforts de la sentinelle, il est entré à cheval dans le Colisée. Il y a vu une centaine de maçons et de galériens qui travaillent toujours à consolider quelque pan de mur ébranlé par les pluies. L’Anglais les a regardés faire, puis nous a dit le soir :
« Par Dieu ! le Colisée est ce que j’ai vu de mieux à Rome. Cet édifice me plaît ; il sera magnifique quand il sera fini. »
Il a cru que ces cent hommes bâtissaient le Colisée.
Avant de retourner vers le Forum, nous sommes entrés dans la tour de’ Conti, élevée au commencement du treizième siècle, par Innocent III, de la maison Conti, sur les ruines du temple de la Terre, si célébré par les auteurs anciens.
Ce petit arc de triomphe si joli fut élevé en l’honneur de Titus, fils de l’empereur Vespasien ; on voulut immortaliser la conquête de Jérusalem ; il n’a qu’une arcade. Après l’arc de triomphe de Drusus près la porte Saint-Sébastien, celui-ci est le plus ancien de ceux que l’on voit à Rome ; il fut le plus élégant jusqu’à l’époque fatale où il a été refait par M. Valadier.
Cet homme est architecte et romain de naissance malgré son nom français. Au lieu de soutenir l’arc de Titus, qui menaçait ruine, par des armatures de fer, ou par un arc-boutant en briques, tout à fait distinct du monument lui-même, ce malheureux l’a refait. Il a osé tailler des blocs du travertin d’après la forme des pierres antiques, et les substituer à celles-ci qui ont été emportées je ne sais où. Il ne nous reste donc qu’une copie de l’arc de Titus.
Il est vrai que cette copie est placée au lieu même où était l’arc ancien, et les bas-reliefs qui ornent l’intérieur de la porte ont été conservés. Cette infamie a été commise sous le règne du bon Pie VII ; mais ce prince, déjà fort vieux, crut qu’il ne s’agissait que d’une restauration ordinaire, et le cardinal Consalvi ne put résister au parti rétrograde qui protégeait, dit-on, M. Valadier.
Heureusement, le monument que nous pleurons était semblable en tout aux arcs de triomphe élevés en l’honneur de Trajan à Ancone et à Bénévent.
Les bas-reliefs de l’arc de Titus sont d’un travail excellent et qui ne rappelle point le fini de la miniature comme ceux de l’arc du Carrousel. L’un de ces bas-reliefs représente Titus dans son char triomphal, attelé de quatre chevaux ; il est au milieu de ses licteurs, suivi de son armée, et protégé par le génie du sénat. Derrière l’empereur on aperçoit une victoire qui de la main droite pose une couronne sur sa tête et de la gauche tient un rameau de palmier allusif à la Judée. Le bas-relief qui est placé vis-à-vis est plus caractéristique ; on y voit les dépouilles du temple de Jérusalem portées en triomphe : le candélabre d’or à sept branches, la caisse qui contenait les livres sacrés, la table d’or, etc. Les petites figures de la frise complétaient l’explication du monument. On distingue encore la statue couchée du Jourdain, fleuve de la Judée, portée par deux hommes.
Cet arc était orné sur ses deux façades de quatre colonnes composites cannelées, qui soutenaient, une corniche extrêmement riche. Quelques dilettanti regardent les victoires en bas-reliefs que l’on voit ici, comme les plus belles qui existent à Rome. On suppose que cet arc a été élevé à Titus par Trajan qui, avec sa modestie ordinaire, ne s’est pas nommé dans l’inscription que l’on voit sur l’attique, du côté du Colisée ; je la transcris à cause de sa brièveté et de sa noble simplicité :
S.P.Q.R.
DIVO TITO DIVI VESPASIANI F.
VESPASIANO AVGVSTO.
La qualité de divus donnée à Titus annonce que ce monument lui a été élevé après sa mort. On voit au milieu de la voûte de la porte la figure de ce grand homme revêtu de la toge, il est assis sur une aigle.
Ce monument charmant n’a que vingt-cinq pieds et demi de haut, vingt-un de large et quatorze pieds d’épaisseur. Les surfaces extérieures étaient de marbre pentélique, la pierre de Tivoli ou travertin, avait été employée pour certaines parties de l’intérieur. Vous savez que la Voie Sacrée passait sous cet arc.
Après avoir fait quelques pas vers le Colisée, nous avons vu sur la droite l’arc de Constantin. La masse de ce monument est imposante et belle : il a trois arcades comme celui du Carrousel, avec lequel nous lui avons trouvé beaucoup de rapports ; il est orné sur chaque façade de quatre colonnes cannelées de jaune antique et d’ordre corinthien qui portent des statues.
Il est évident que Constantin a eu la bassesse de faire arranger en son honneur cet arc de triomphe qui avait été élevé à Trajan. On explique ainsi la beauté du plan général, qui fait disparate avec la pauvre exécution de plusieurs détails. Le caractère romain brisé et avili par le règne d’une suite de monstres trahissait son abaissement par la décadence des arts. Ce monument fut élevé vers l’an 326 ; l’inscription annonce qu’on a voulu célébrer la victoire remportée par Constantin sur Maxence.
Lorenzino de Médicis, celui-là même qui tua le duc Alexandre sans avoir eu l’esprit de convoquer un gouvernement qui pût réorganiser la liberté, crut s’immortaliser en faisant enlever de nuit les têtes des huit statues de barbares prisonniers de guerre qui sont placés au-dessus des colonnes de l’arc de Constantin. Les têtes que nous avons vues aujourd’hui sont donc modernes ; un nommé Bracci les fit sous Clément XII, d’après des modèles antiques dit-on.
Tous les bas-reliefs de l’attique et les huit médaillons placés de chaque côté au-dessus des portes latérales, sont d’une rare beauté. Ces bas-reliefs représentent des guerres, des chasses et autres actions de Trajan. Les autres sculptures de cet arc de triomphe annoncent la barbarie qui s’emparait de Rome en l’an 326 de notre ère.
L’intérêt historique ou de curiosité nous a portés à examiner ces mauvais bas-reliefs, moins menteurs que des livres. On y voit Constantin qui prend Vérone, sa victoire sur Maxence, son triomphe ; on le voit parler aux Romains réunis dans le Forum, du haut de la tribune aux harangues. Deux médaillons qui représentent le char du soleil et celui de la lune sont plus soignés.
M. Raphaël Sterni nous a fait reconnaître qu’il faut attribuer au siècle de Trajan les deux grands bas-reliefs que l’on voit sous l’arcade principale ; seulement ils ont été gâtés par les sculpteurs employés par Constantin et qui voulurent adapter à leur héros des bas-reliefs relatifs aux actions de Trajan et qui semblent la continuation de ceux de l’attique.
Lorsque ce monument était à demi enterré, ces sculptures furent gâtées par les passants. Ce n’est qu’en 1804, sous Pie VII, que cet arc a été dégagé, ainsi que celui de Septime Sévère ; ils se trouvent placés maintenant comme au centre d’une petite cour en contrebas, laquelle est environnée d’un mur de soutènement de huit ou dix pieds de haut.
M. Demidoff avait le projet d’étendre jusqu’ici sa grande opération relative à l’enlèvement des terres qui couvrent le Forum. Il voulait déterrer tout ce qui se trouve entre l’arc de Titus, le temple de Vénus et de Rome, la basilique de Constantin d’une part, et de l’autre le Colisée et l’arc de Constantin.
Sept des colonnes d’ordre corinthien qui ornent ce monument, sont de jaune antique ; la huitième est d’un marbre tirant sur le blanc. Sept des statues des rois barbares prisonniers de guerre, sont en marbre violet et appartenaient à l’arc de Trajan. La huitième qui est en marbre blanc est un ouvrage moderne de l’époque de Clément XII, qui restaura cet arc de triomphe. On nous a fait voir une petite chambre dans l’attique.
Nous sommes allés lire la vie de Trajan à l’ombre d’un petit bois d’acacias planté par les Français à quelques pas d’ici. Elle nous a tellement intéressés que nous sommes revenus à l’arc de triomphe pour examiner en détail les bas-reliefs qui rappellent les actions de ce grand homme.
Le premier à gauche du spectateur qui vient du Colisée, représente l’entrée de Trajan dans Rome ; le second est relatif à la voie Appienne restaurée par lui ; le troisième à une distribution de vivres faite au peuple ; le quatrième à Parthomasiris roi d’Arménie détrôné par Trajan.
Le bas-relief carré placé vers les jardins Farnèse, nous montre, ainsi que celui qui est vers le Cælius, la victoire que Trajan remporta sur Décébale, roi des Daces. Les autres bas-reliefs carrés, représentent la découverte d’une conspiration tentée par le roi Décébale ; Trajan qui donne un nouveau roi aux Parthes ; cet empereur qui fait une allocution à ses soldats ; et enfin le sacrifice solennel qu’on appelait Suovetaurilia.
Les huit bas-reliefs ronds placés de chaque côté sur les petites arcades, représentent des chasses et des sacrifices offerts par Trajan à Mars, Sylvain, Diane et Apollon. Il paraît que cet arc avait des ornements en porphyre et en bronze. On suppose qu’il était couronné par un char triomphal en bronze, attelé de quatre chevaux et dans lequel Constantin était placé. Le charmant arc de triomphe du Carrousel peut donner une idée de tout ceci.
Quels que soient les outrages que les ouvriers employés par Constantin aient fait subir à ce monument, qui d’abord fut destiné à un grand homme, il nous semble qu’il doit toujours servir de modèle. Il est singulier qu’une chose aussi inutile fasse autant de plaisir ; le genre de l’arc de triomphe est une conquête de l’architecture.
1er. juin 1828. – L’empereur Adrien avait une véritable passion pour l’architecture, c’est ce que montrent bien les vestiges de la fameuse villa Adriana sur la route de Tivoli. Il y avait fait bâtir des copies en miniature de tous les édifices célèbres, vus par lui dans ses voyages. On reconnut de son temps qu’il n’y avait plus de place dans le mausolée d’Auguste pour la cendre des empereurs. Adrien saisit cette occasion de se bâtir un tombeau ; le souvenir de ce qu’il avait vu en Égypte, eut sans doute beaucoup de part à cette résolution. Il choisit la partie des immenses jardins de Domitia, qui était la plus voisine du Tibre, et cet édifice fut la merveille de son siècle.
Sur une base carrée, dont chaque côté avait deux-cent-cinquante-trois pieds de long, s’élevait la grande masse ronde du mausolée, dont vous ne voyez plus maintenant que ce qu’il a été impossible de détruire. Les revêtements de marbre, les corniches admirables, les ornements de tous les genres ont été brisés. On sait seulement que les vestiges de la base carrée ont existé jusqu’au huitième siècle.
L’immense tour ronde que nous voyons aujourd’hui, était comme le noyau de l’édifice. Elle se trouvait environnée d’un corridor et d’un autre mur qui faisait façade : tout cela a disparu. Au-dessus de cette partie ronde s’élevaient, suivant l’usage, d’immenses gradins, et l’édifice était couronné par un temple magnifique, aussi de forme ronde. Vingt-quatre colonnes de marbre violet formaient un portique autour de ce temple ; enfin, au point le plus élevé de la coupole, était placée la pomme de pin colossale qui a donné son nom à l’un des jardins du Vatican, et que nous y avons vue. C’est dans ce tombeau de bronze que furent déposées les cendres d’un des hommes les plus spirituels qui aient jamais occupé un trône. Il fut passionné comme un artiste, et quelquefois cruel. Si Talma avait été empereur, n’eut-il pas envoyé à la mort l’abbé Geoffroy ? Adrien avait longtemps habité l’Égypte et trop pour sa gloire. Le malheur qu’il y éprouva, lui nuit plus aujourd’hui que ses cruautés. Il pensa avec raison qu’un tombeau, tel que celui dont nous examinons les restes informes, était plus élégant qu’une pyramide ; mais les pyramides durent encore, et toutes les causes se sont réunies pour réduire le plus beau tombeau qui ait peut-être jamais existé, à ce qu’on appelle aujourd’hui le fort Saint-Ange ou la Mole Adriana.
Au centre de quelques bastions fort bas, s’élève une masse ronde de cinq cent soixante-seize pieds de tour, surmontée de bâtiments assez irréguliers, et terminée par une statue de bronze de dix pieds de proportion.
Quand Aurélien renferma le Champ-de-Mars dans l’enceinte de Rome, il se servit du mausolée d’Adrien, pour former ce qu’on appellerait aujourd’hui une tête de pont sur la rive droite du Tibre. Il y ouvrit une porte appelée Cornelia, qui n’a été fermée que sous Paul III.
Procope nous a laissé la description du tombeau d’Adrien, tel qu’il l’avait vu. De son temps, la partie supérieure était déjà privée de ses colonnes ; la nouvelle religion les avait transportées à la basilique de Saint-Paul hors des murs, mais Procope vit encore le revêtissement de marbre et les ornements sculptés qui décoraient le reste du tombeau.
En 537, les Goths assaillirent à l’improviste la porte Cornelia ; les troupes de Bélisaire renfermées dans le fort voisin mirent en pièces les ornements de marbre pour les lancer sur les assaillants. Après cette grande dévastation, le tombeau d’Adrien porta plusieurs noms, et entre autres celui de l’immortel Crescentius, qui voulut rendre la liberté à son pays. Comme le marquis de Posa de Schiller, comme le jeune Brutus, Crescentius n’appartenait pas à son siècle ; c’était un homme d’un autre âge. Notre révolution s’est chargée de fournir un nom à cette espèce d’hommes généreux et malhabiles à conduire les affaires, c’était un Girondin. Pour agir sur les hommes, il faut leur ressembler davantage ; il faut être plus coquin. Peut-être faut-il être au moins aussi coquin que Napoléon.
Crescentius, assiégé par l’empereur Othon, se confia à la capitulation qui lui fut offerte par ce prince ; il sortit de sa forteresse, et fut immédiatement conduit au supplice. Après que la mémoire de ce grand homme eut péri, sa forteresse fut appelée la maison de Théodoric.
Au douzième siècle on la trouve désignée par le nom de château Saint-Ange, probablement à cause d’une petite église située dans la partie la plus élevée, et qui était dédiée à saint Michel. On voit dans l’histoire que les chefs de faction, qui tour à tour s’emparaient du pouvoir, se regardaient comme bien établis dans Rome, lorsqu’ils étaient maîtres de ce fort ; souvent il fut occupé par les papes.
En 1493, la foudre mit le feu à une certaine quantité de poudre qu’on y gardait. Alexandre VI répara le dommage et augmenta les fortifications, ce dont bien lui prit ; car, lors de l’entrée de Charles VIII, si le fort Saint-Ange n’avait pas été considéré comme difficile à enlever, ce pape scandaleux eût été déposé, ou plus simplement mis à mort. Trente ans plus tard le fort Saint Ange rendit le même service à Clément VII. Paul III l’embellit ; enfin, le cavalier Bernin, que nous retrouvons partout, mit les fortifications extérieures dans l’état où on les voit aujourd’hui. Nous avons remarqué, il y a peu de jours, à Civita-Vecchia, que même au milieu des choses utiles de l’architecture militaire les Italiens savent conserver une beauté et un style que l’on ne retrouve jamais dans les ouvrages de Vauban, probablement fort supérieurs sous d’autres rapports.
Le geôlier du fort Saint-Ange nous a fait remarquer plusieurs petits passages dans l’épaisseur du mur de cette immense tour ronde. Les anciens y avaient placé des tombeaux, ou bien ils servaient de communications entre les divers étages. C’est ici qu’Innocent XI a pris l’urne de porphyre où il repose à Saint-Jean-de-Latran. Par les ordres de Paul III, on orna de peintures et de stucs le portique qui est situé du côté de la campagne. Ce pape, voulant justifier le nom donné à cette forteresse, fit placer au sommet de l’édifice une statue de marbre représentant un ange tenant à la main une épée nue. Cet ouvrage de Raphaël de Monteluppo a été remplacé, du temps de Benoît XIV, par une statue de bronze, qui fournit cette belle réponse à un officier français assiégé dans ce fort à une époque de nos guerres d’Italie : Je me rendrai quand l’ange remettra son épée dans le fourreau.
Cette statue est du flamand Wanschefeld. On trouve dans le salon, des peintures de Pierin del Vaga ; et lorsque certaines chambres ne sont pas occupées par des prisonniers d’état, le geôlier fait voir quelques petites fresques de Jules Romain. La présence d’un prisonnier d’importance n’a pas permis qu’on nous les montrât.
C’est un archevêque égyptien qui a, dit-on, mystifié la cour de Rome, et à son tour a été pipé par le gouvernement napolitain ; l’archevêque avait pris pour confident un jésuite.
C’est du haut du château Saint-Ange que, dans les soirées des 28 et 29 juin, fêtes de saint Pierre et de saint Paul, protecteurs de Rome, on tire un des plus beaux feux d’artifice que j’aie jamais vus. Le bouquet est composé de quatre mille cinq cents fusées. L’idée de ce feu est due à Michel-Ange.
Je me garderais d’en jurer. On frémit quand on songe à ce qu’il faut de recherches pour arriver à la vérité sur le détail le plus futile.
Les jours de fête on hisse à des mâts placés sur les fortifications, le long du Tibre, de grands pavillons aux couleurs brillantes, le vent les agite mollement ; rien n’est plus joli. Nous avons retrouvé cet usage à Venise, sur la place Saint-Marc, et dans tout le pays vénitien.
On nous a dit que le fameux Barbone, chef de brigands, était dans le château ; mais jamais le geôlier n’a voulu répondre à nos questions sur les carbonari qui s’y trouvent renfermés. À la fièvre près qui peut les atteindre en été, ils ne sont pas mal ; presque tous sont tombés dans une excessive dévotion. La vue qu’ils ont du haut de leur prison est magnifique, et faite pour changer en douce mélancolie la tristesse la plus colérique. On plane sur la ville des tombeaux ; cette vue enseigne à mourir.
TASSO.
Quoi de plus ridicule qu’un homme qui se présenterait avec vingt mille francs dans sa poche pour acheter le Louvre ? Voilà les conspirateurs.
Quand nous faisions des questions sur les carbonari, le geôlier, qui voulait gagner la mancia, nous parlait des galériens qui sont sous sa garde. Ceux que le ministre de la police (Monsignor Governatore di Roma) veut favoriser, sont employés à balayer les rues. Ces malheureux, avec leurs chaînes bruyantes et pesantes, forment un spectacle hideux qui nous attriste tous les matins, quand nous traversons le Corso. Nous nous sommes trouvés au château Saint-Ange comme ils rentraient. Le geôlier nous a fait remarquer le mari de la célèbre Maria Grazzi, dont les traits se trouvent répétés dans la plupart des tableaux faits à Rome de notre temps, et notamment dans les admirables ouvrages de Schnetz. Cette femme ne songe qu’à obtenir la liberté de son mari, qui réellement est en prison par un malentendu. Dans son simple bon sens elle ne peut comprendre qu’il soit regardé comme coupable. Il était alla machia, il lut une amnistie à la porte d’une église, il se rend chez lui pour faire sa soumission ; le délai fixé par l’amnistie était expiré depuis quelques heures, et on le met dans les fers comme s’il eût été pris les armes à la main.
Le geôlier nous a montré le corridor qui communique du palais du Vatican au château Saint-Ange ; il a plus de quatre cent vingt mètres de long, et fut élevé par Alexandre VI sur l’ancien mur de la cité Léonine. Pie IV fit faire dans ce mur, lorsqu’il étendit cette partie de la ville, les grands arcs que l’on y voit aujourd’hui. Enfin, par ordre d’Urbain VIII, ce corridor fut isolé des maisons voisines.
Le plaisir de sentir un petit, venticello bien frais, qui régnait à cette hauteur, nous avait arrêtés sous le portique situé dans la partie la plus élevée du fort Saint-Ange, Paul nous a surpris agréablement en faisant servir des glaces. Frédéric nous a lu le récit du Sac de Rome ; nos yeux dominaient une partie du champ de bataille.
Le 5 mai 1527, le connétable de Bourbon parut dans les prés devant Rome, le long de la muraille qui s’étend entre le Vatican et le mont Janicule ; il fit sommer la ville par un trompette. Clément VII, dont la conduite dans ce grand évènement ne fut qu’un mélange ridicule d’extrême timidité et de vanité puérile, renvoya ce trompette avec arrogance. Il fit ordonner au comte Rangone, qui accourait pour défendre Rome avec cinq mille fantassins et un petit corps d’artillerie, de changer de direction et d’aller joindre la grande armée qui venait de Toscane. Comme le connétable se présentait devant les murs de la partie de la ville où est Saint-Pierre, quelques hommes sages eurent l’idée de couper les ponts afin de se défendre derrière le Tibre, si le Borgo était forcé. Clément VII ne voulut pas le permettre, et leur prudence passa pour lâcheté et fut en butte aux railleries de sa cour. Il donna ordre aux gardes des portes d’empêcher que rien ne sortit de Rome. La route de Naples était encore libre, ainsi que celles de Frascati, de Tivoli, etc. Par Frascati, on pouvait facilement gagner des forêts inaccessibles.
Le pape voulut que l’on déchargeât de grandes barques sur lesquelles on avait placé beaucoup d’effets précieux.
L’armée qui menaçait les murs était forte de quarante mille hommes. Beaucoup de soldats étaient des Allemands luthériens, et avaient en exécration Rome et sa religion. Le connétable lui-même, qui portait les armes contre son pays, sentait qu’il était profondément méprisé ; une victoire éclatante pouvait seule le relever à ses propres yeux et aux yeux des autres.
Le 6 mai au matin, il conduisit ses troupes à l’assaut contre la partie du mur de Rome située au couchant de la ville, entre le Janicule et le Vatican. À peine l’attaque commencée, il crut voir que ses fantassins allemands se portaient mollement au combat ; il saisit une échelle et l’appuya lui-même contre le mur. Il avait monté trois échelons lorsqu’il fut atteint d’une balle de mousquet qui lui traversa le côté et la cuisse droite ; il sentit aussitôt que le coup était mortel et ordonna à ceux qui l’entouraient de couvrir son corps d’un manteau, afin que ses soldats ne fussent pas découragés ; il expira au pied du mur pendant que l’assaut continuait.
La mort du connétable fut bientôt connue des soldats, ils étaient furieux ; mais on leur résistait vaillamment ; les Suisses de la garde du pape défendaient le mur d’enceinte avec une bravoure héroïque. Une batterie placée dans Rome, sur le haut de la colline, prenait de flanc les assiégeants et leur tuait beaucoup de monde. Malheureusement, au moment où le soleil se levait, il survint un épais brouillard qui empêcha les artilleurs de bien diriger leurs pièces ; les Espagnols profitèrent de cet instant pour entrer dans la ville, au moyen de quelques petites maisons attenant au mur. Au même moment, les Allemands y pénétraient aussi d’un autre côté, les assaillants avaient perdu alors un millier d’hommes.
En entrant dans la ville par deux endroits, les soldats du connétable de Bourbon se trouvèrent avoir coupé une partie de ce qu’on appellerait aujourd’hui la garde nationale de Rome. Ces jeunes gens qui avaient marché sous les ordres de leurs capo-rioni (chefs de quartier), furent tous massacrés sans pitié, encore que la plupart eussent jeté leurs armes et demandassent la vie à genoux.
Benvenuto Cellini qui se trouvait ce jour-là au château Saint-Ange, et probablement dans le lieu où nous sommes, a laissé un récit curieux de cette journée et de celles qui la suivirent. Mais il est un peu gascon et je ne le crois guère. Pendant que l’on se battait, Clément VII était en prières devant l’autel de sa chapelle au Vatican, détail singulier chez un homme qui avait commencé sa carrière par être militaire. Lorsque les cris des mourants lui annoncèrent la prise de la ville, il s’enfuit du Vatican au château Saint-Ange par le long corridor dont nous avons parlé et qui s’élève au-dessus des plus hautes maisons. L’historien Paul Jove, qui suivait Clément VII, relevait sa longue robe pour qu’il pût marcher plus vite, et lorsque le pape fut arrivé au pont qui le laissait à découvert pour un instant, Paul Jove le couvrit de son manteau et de son chapeau violet de peur qu’il ne fût reconnu à son rochet blanc et ajusté par quelque soldat bon tireur.
Pendant cette longue fuite le long du corridor, Clément VII apercevait au-dessous de lui, par les petites fenêtres, ses sujets poursuivis par les soldats vainqueurs qui déjà se répandaient dans les rues. Ils ne faisaient aucun quartier à personne et tuaient à coups de pique tout ce qu’ils pouvaient atteindre.
Après avoir gagné le château Saint-Ange, le pape aurait eu le temps de s’enfuir par le pont voisin qui était sous la protection de l’artillerie du fort ; il aurait pu entrer dans la ville, la traverser rapidement, et sous l’escorte de ses chevau-légers gagner la campagne et quelque lieu de sûreté ; mais la peur et la vanité en faisaient un imbécile. On calcule que dans cette première journée, sept ou huit mille Romains furent massacrés.
Le Borgo et le quartier du Vatican furent immédiatement saccagés ; les soldats tuaient et violaient ; ils n’épargnèrent ni les couvents, ni le palais du pape, ni l’église de Saint-Pierre elle-même. Ils eurent à livrer un petit combat pour s’emparer du quartier de Trastevere. Les habitants, si féroces encore aujourd’hui, ne soutinrent point leur réputation, en défendant leurs maisons. Les soldats de l’empereur parcoururent rapidement la rue de la Longara ; enfin, Louis de Gonzague à la tête de l’infanterie italienne entra le premier dans Rome proprement dite par le Ponte-Sisto.
La singulière circonstance militaire que nous avons vue à Paris en 1814, se présenta à Rome en 1527. Le jour même où l’armée du connétable emportait Rome, le comte Rangone, qui avait eu le bon sens de ne pas obéir à l’ordre ridicule que Clément VII lui avait envoyé, était parvenu jusqu’au Ponte-Salario avec ses chevau-légers et huit cents arquebusiers. Si les ponts avaient été coupés et que la ville eût tenu quelques heures, elle était sauvée par ce brave militaire. Une grande armée marchait au secours de Rome, mais elle n’était partie de Florence que trois jours auparavant, et d’ailleurs le général commandant en chef était un ennemi personnel du pape.
Le fanatisme de la nouvelle réforme que professaient presque tous les soldats allemands, fut la véritable cause des horreurs commises au sac de Rome, tant il est vrai que cette passion inconnue des anciens, est la pire de toutes. Jamais rien de plus atroce n’a eu lieu en pareille circonstance. Plusieurs femmes et filles se jetèrent par les fenêtres pour éviter le déshonneur, dit l’historien contemporain Jacques Buonaparte, d’autres furent tuées par leurs pères ou leurs mères, et ces corps palpitants et ensanglantés n’étaient point à l’abri de la brutalité des soldats. Ils pénétraient dans les églises, se couvraient des ornements pontificaux, et dans cet état allaient prendre des religieuses qu’ils exposaient nues aux regards de leurs camarades. Les tableaux d’église furent mis en pièces et brûlés, les reliques et les hosties consacrées répandues dans la boue, les prêtres étaient battus de verges et livrés aux huées de la soldatesque.
Ces horreurs durèrent sept mois, les soldats régnaient dans Rome et se moquaient de leurs généraux.
Les soldats espagnols se distinguèrent par leur avidité et leur cruauté. On observa qu’après le premier jour, il arriva rarement qu’un Allemand tuât un Romain ; ils permettaient à leurs prisonniers de se racheter à très bon compte. Les Espagnols, au contraire, brûlaient les pieds aux leurs et les obligeaient par des tourments prolongés à découvrir leurs richesses, ou à épuiser la bourse des amis qu’ils pouvaient avoir hors de Rome. Les palais des cardinaux furent pillés avec d’autant plus de soin, que beaucoup de marchands, à l’approche de l’armée de l’empereur, avaient déposé leurs effets dans les palais des cardinaux partisans de ce prince ; mais il n’y eut de grâce pour personne.
La marquise de Mantoue racheta son palais au prix de cinquante mille ducats ; tandis que son fils, qui avait un commandement dans l’armée impériale, reçut dix mille ducats pour sa part du pillage. Le cardinal de Sienne, après s’être racheté des Espagnols, fut fait prisonnier par les Allemands, complètement dépouillé, battu, et forcé de racheter de nouveau sa personne au prix de cinq mille ducats. Les prélats allemands ou espagnols ne furent nullement épargnés par leurs compatriotes.
Le cardinal Pompée Colonna entra dans Rome deux jours après la prise de cette ville, il venait jouir de l’humiliation de son ennemi Clément VII. Une foule de paysans de ses fiefs arrivèrent avec lui : peu de temps auparavant ils avaient été barbarement pillés par ordre du pape, ils s’en vengèrent en pillant à leur tour les maisons romaines. Ils y trouvèrent encore les gros meubles.
Mais Pompée Colonna fut touché d’une profonde pitié, quand il vit l’état dans lequel il avait contribué à précipiter sa patrie. Il ouvrit son palais à tous ceux qui voulurent s’y réfugier ; il racheta de ses deniers, sans distinction de faction amie ou ennemie, les cardinaux que les soldats tenaient captifs ; il conserva la vie à une foule de misérables qui, ayant tout perdu dès le premier jour, seraient morts de faim sans lui.
Ces scènes d’horreur ont été décrites en détail par Sandoval, évêque de Pampelune, qui, de peur de déplaire à Charles-Quint, se contente d’appeler le sac de Rome une œuvre non sainte (obra no santa). Charles-Quint âgé seulement de vingt-sept ans, mais qui comprenait qu’on ne peut combattre Rome qu’avec ses propres armes, lorsqu’il apprit les horreurs qui, faute de contre-ordre de sa part, durèrent sept mois, fit une belle procession pour demander à Dieu la délivrance du pape, qui dépendait uniquement de lui Charles-Quint. Ce trait d’habileté doit troubler le sommeil de certains prélats modernes.
L’évêque Sandoval rapporte qu’un soldat espagnol avait volé dans le Sanctus sanctorum de Saint-Jean-de-Latran une cassette remplie de reliques, parmi lesquelles se trouvait une petite partie du corps de Jésus-Christ, détachée par le grand-prêtre dans la première enfance du Sauveur. Lors de la retraite de l’armée impériale, le soldat abandonna cette cassette dans un village des environs de Rome. En 1551, c’est-à-dire trente ans après, un prêtre la retrouva et se hâta de la porter à Madeleine Strozzi. Aidée de Lucrèce Orsini, sa belle-sœur, et en présence de sa fille Clarice, âgée de sept ans, Madeleine Stozzi ouvrit la cassette. Ces dames trouvèrent d’abord un morceau de chair encore toute fraîche de saint Valentin, une partie de la mâchoire avec une dent de sainte Marthe, sœur de sainte Marie-Madeleine.
La princesse Strozzi prit ensuite un petit paquet sur lequel on ne lisait autre chose que le nom de Jésus. Aussitôt elle sentit ses mains s’engourdir, et force lui fut de le laisser échapper. Ce miracle ouvrit les yeux de Lucrèce Orsini, qui s’écria que le paquet contenait sans doute une partie du corps de Jésus. À peine eut-elle prononcé ce nom, que la cassette exhala une odeur suave, mais tellement forte que Flaminio Anguillara, mari de Madeleine Strozzi, qui se trouvait dans un appartement voisin, demanda d’où provenait le parfum qui arrivait jusqu’à lui.
On essaya en vain, à plusieurs reprises, d’ouvrir le paquet. Enfin le prêtre qui avait trouvé la cassette, eut l’idée que les mains pures de la jeune Clarice, âgée de sept ans seulement, auraient plus de succès. La sainte relique fut en effet découverte et placée ensuite dans l’église paroissiale de Calcata, diocèse de Civita-Castellana.
Une dissertation, réimprimée à Rome avec approbation en 1797, donne sur cette relique des détails que je n’oserais répéter. L’approbation d’un livre qui traite un sujet si délicat prouve que l’auteur ne s’écarte en rien des opinions regardées comme orthodoxes par la cour de Rome. L’auteur discute le mot de saint Athanase, qui soutient que le Verbe divin cum omni integritate resurrexit. Jean Damascène avait dit, en parlant du Verbe : Quod semel assumpsit, nunquàm dimisit. Ici paraît la théorie des quantités infiniment petites d’Euler que l’on peut considérer comme nulles.
La première fois que nous passerons près de Calcata, nous irons voir cette relique unique au monde.
4 juin. – Hier, comme je visitais seul le palais de Monte-Cavallo, admirablement restauré, d’après les ordres de M. Martial Daru (intendant de la couronne à Rome sous Napoléon), j’ai été joint par M. l’abbé Colonna, auquel j’ai apporté une lettre de Naples. Il m’a parlé in confidenza, preuve d’estime dont je ne me vante que parce qu’il est en un lieu où il se moque fort de la police. (Nous avons passé trois heures sous les ombrages charmants du jardin de Monte-Cavallo ; la femme du portier nous a fait d’excellent café).