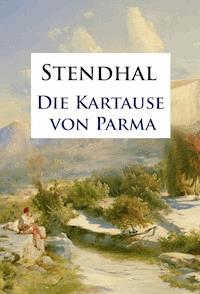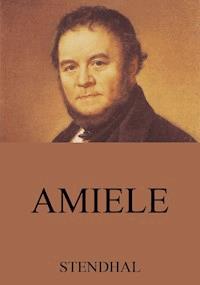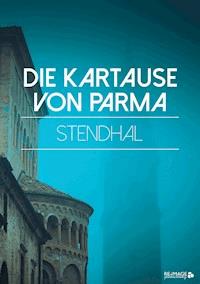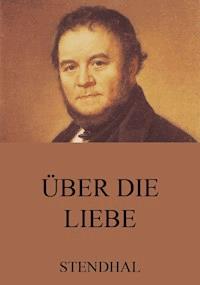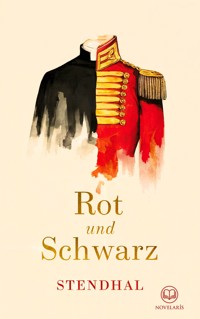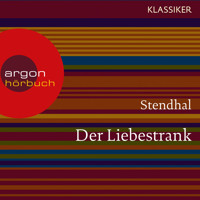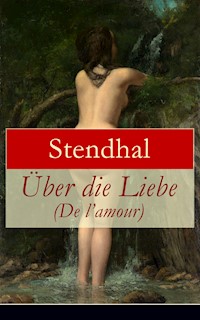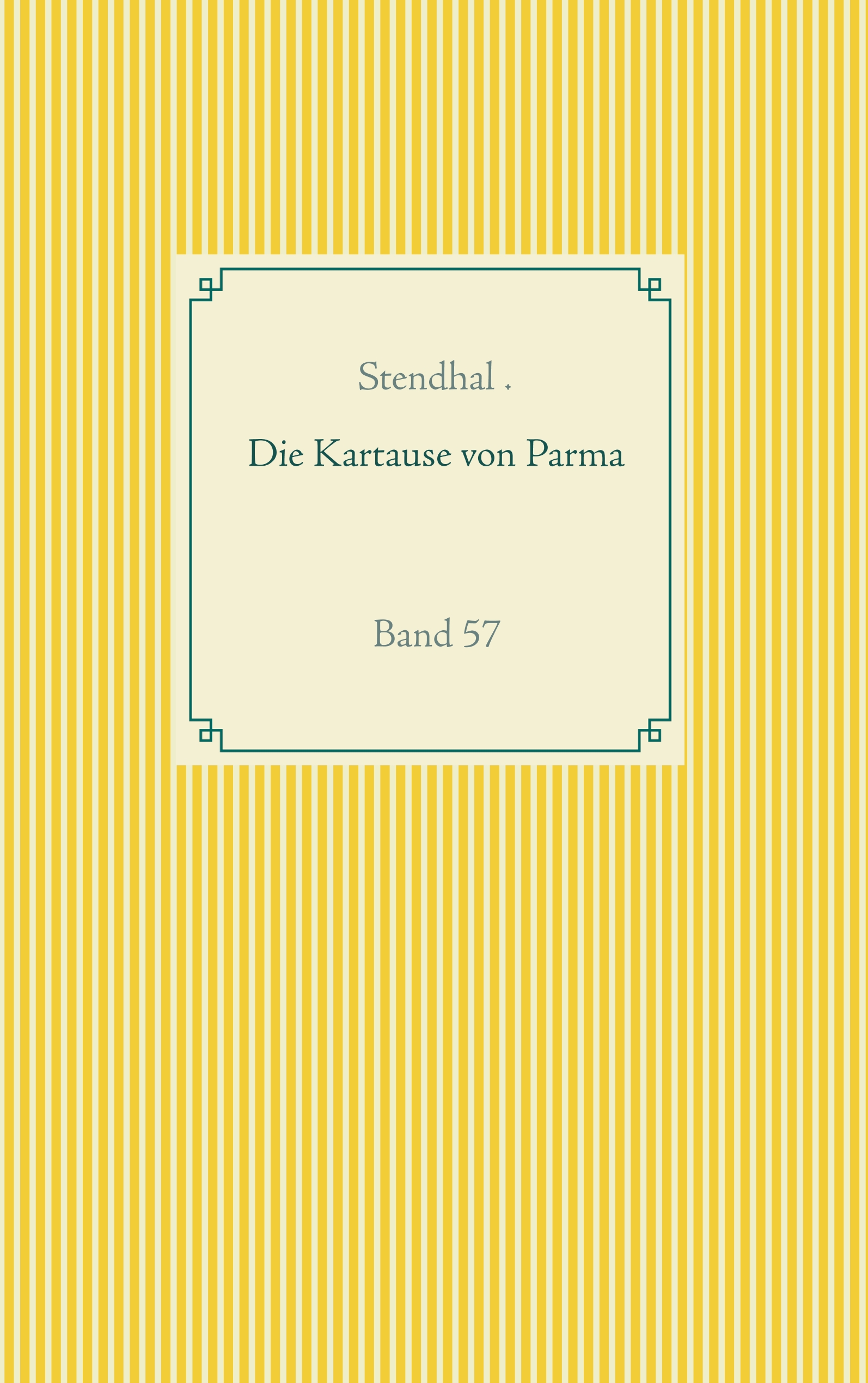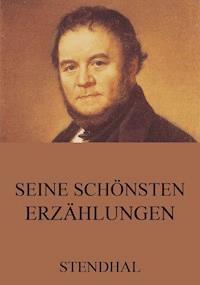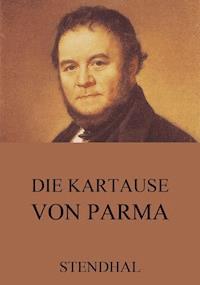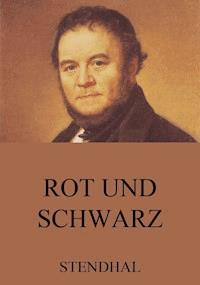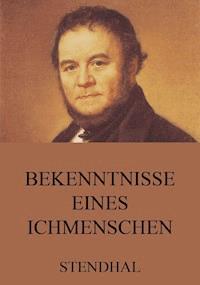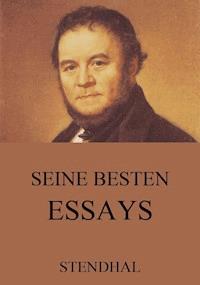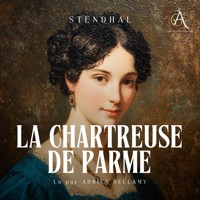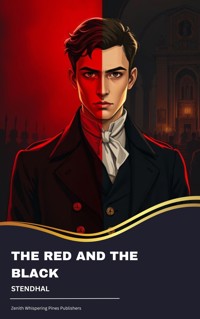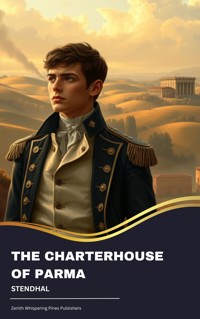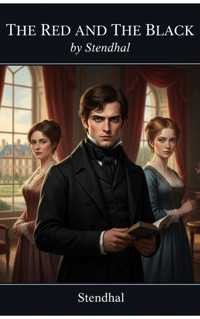Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: A verba futuroruM
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Stendhal, dans ce livre de voyages, nous entraîne dans la ville de Rome pour laquelle il a une véritable passion. Au fil des pages, il nous présente et nous explique les structures des bâtiments, les réalisations des peintures de maîtres, les différentes sculptures et l'histoire de la ville.
C'est un véritable guide qui autorisera chacun à démontrer sa connaissance des lieux.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Stendhal, de son vrai nom
Henri Beyle (1783-1842), est un écrivain français majeur du XIXe siècle. Marqué par une jeunesse difficile, il découvre en Italie un idéal de bonheur qu’il nomme « beylisme ». Il devient romancier à 44 ans avec "Armance", puis accède à la notoriété avec "Le Rouge et le Noir" et "La Chartreuse de Parme". Observateur lucide des passions humaines, il laisse une œuvre marquée par la quête de vérité et l’analyse psychologique.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Promenades dans Rome
Stendhal
PRÉFACE
En arrivant à Rome, ne vous laissez empoisonner par aucun avis ; n’achetez aucun livre, l’époque de la curiosité et de la science ne remplacera que trop tôt celle des émotions ;
logez-vous via Gregoriana, ou, du moins, au troisième étage de quelque maison de la place de Venise, au bout du Corso ; fuyez la vue et encore plus le contact des curieux. Si, en courant les monuments pendant vos matinées, vous avez le courage d’arriver jusqu’à l’ennui par manque de société, fussiez-vous l’être le plus éteint par la petite vanité de salon, vous finirez par sentir les arts.
Au moment de l’entrée dans Rome, montez en calèche, et, suivant que vous vous sentirez disposé à sentir le beau inculte et terrible, ou le beau joli et arrangé, faites-vous conduire au Colysée ou à Saint-Pierre.
LE COLYSÉE
ROME, 16 août 1827.
Le Colysée offre trois ou quatre points de vue tout à fait différents. Le plus beau peut-être est celui qui se présente au curieux lorsqu’il est dans l’arène où combattaient les gladiateurs, et qu’il voit ces ruines immenses s’élever tout autour de lui. Ce qui m’en touche le plus, c’est ce ciel d’un bleu si pur que l’on aperçoit à travers les fenêtres du haut de l’édifice vers le nord.
Il faut être seul dans le Colysée ; souvent vous serez gêné par les murmures pieux des dévots qui, par troupes de quinze ou vingt, font les stations du Calvaire, ou par un capucin qui, depuis Benoit XIV, qui restaura cet édifice, vient prêcher ici le vendredi. Tous les jours, excepté au moment de la sieste ou le dimanche, vous rencontrez des maçons servis par des galériens ; car il faut toujours réparer quelque coin de ruines qui s’écroule. Mais cette vue singulière finit par ne pas nuire à la rêverie.
On monte dans les couloirs des étages supérieurs par des escaliers assez bien réparés. Mais, si l’on n’a pas de guide (et à Rome tout cicerone tue le plaisir), on est exposé à passer sur des voûtes bien amincies par les pluies et qui peuvent s’écrouler. Parvenu au plus haut étage des ruines, toujours du côté du nord, on aperçoit vis-à-vis de soi, derrière de grands arbres et presque à la même hauteur, San-Pietro in Vincoli, église célèbre par le tombeau de Jules II et le Moïse de Michel-Ange.
Au midi, le regard passe par-dessus les ruines de l’amphithéâtre, qui, de ce côté, sont beaucoup plus basses, et va s’arrêter au loin dans la plaine, sur cette sublime basilique de Saint-Paul, incendiée dans la nuit du 15 au 16 juillet 1823. Elle est à demi cachée par de longues files de cyprès. Cette église fut bâtie au lieu même où l’on enterra, après son martyre, l’homme dont la parole a créé ce fleuve immense qui, sous le nom de religion chrétienne, vient encore aujourd’hui se mêler à toutes nos affections. La qualité de saint, qui, une fois, fut le comble de l’honneur, nuit aujourd’hui à saint Paul. Cet homme a eu sur le monde une bien autre influence que César ou Napoléon. Comme eux, pour avoir le plaisir de commander, il s’exposait à une mort probable. Mais le danger qu’il courait n’était pas beau comme celui des soldats.
Du haut des ruines du Colysée, on vit à la fois avec Vespasien qui le bâtit, avec saint Paul, avec Michel Ange. Vespasien. triomphant des Juifs, a passé sur la voie Sacrée, près de cet arc de triomphe, élevé à son fils Titus, et que, de nos jours encore, le Juif évite dans sa course. Ici, plus près, est l’arc de Constantin : mais il fut construit par des architectes déjà barbares ; la décadence commençait pour Rome et pour l’Occident.
Je le sens trop, de telles sensations peuvent s’indiquer, mais ne se communiquent point. Ailleurs ces souvenirs pourraient être communs ; pour le voyageur placé sur ces ruines, ils sont immenses et pleins d’émotion.
Ces pans de murs, noircis par le temps, font sur l’âme l’effet de la musique de Cimarosa, qui se charge de rendre sublimes et touchantes les paroles vulgaires d’un libretto. L’homme le plus fait pour les arts, J.-J. Rousseau, par exemple, lisant à Paris la description la plus sincère du Colysée, ne pourrait s’empêcher de trouver l’auteur ridicule a cause de son exagération ; et, pourtant, celui-ci n’aurait été occupé qu’à se rapetisser et à avoir peur de son lecteur.
Je ne parle pas du vulgaire, né pour admirer le pathos de Corinne, les gens un peu délicats ont ce malheur bien grand au dix-neuvième siècle : quand ils aperçoivent de l’exagération, leur âme n’est plus disposée qu’à inventer de l’ironie.
Pour donner une idée quelconque des restes de cet édifice immense, plus beau peut-être, aujourd’hui qu’il tombe en ruines, qu'il ne le fut jamais dans toute sa splendeur (alors ce n’était qu’un théâtre, aujourd’hui c’est le plus beau vestige du peuple romain). il faudrait connaître les circonstances de la vie du lecteur. Cette description du Colysée ne peut se tenter que de vive voix, quand on se trouve, après minuit, chez une femme aimable, en bonne compagnie, et qu’elle et les femmes qui l’entourent veulent bien écouter avec une bienveillance marquée. D’abord le conteur se commande une attention pénible, ensuite il ose être ému ; les images se présentent en foule, et les spectateurs entrevoient, par les yeux de l’âme, ce dernier reste encore vivant du plus grand peuple du monde. On peut faire aux Romains la même objection qu’à Napoléon. Ils furent criminels quelquefois, mais jamais l’homme n’a été plus grand.
Quelle duperie de parler de ce qu’on aime ! Que peut-on gagner ? le plaisir d’être ému soi-même un instant par le reflet de l’émotion des autres. Mais un sot, piqué de vous voir parler tout seul, peut inventer un mot plaisant qui vient salir vos souvenirs. De là peut-être cette pudeur de la vraie passion que les âmes communes oublient d’imiter quand elles jouent la passion.
Il faudrait que le lecteur qui n’est pas à Rome eût la bonté de jeter les yeux sur une lithographie du Colysée (celle de M. Lesueur). ou du moins sur l’image qui est dans l’Encyclopédie.
L’on verra un théâtre ovale, d’une hauteur énorme, encore tout entier à l’extérieur du côté du nord, mais ruiné vers le midi : il contenait cent sept mille spectateurs.
La façade extérieure décrit une ellipse immense ; elle est décorée de quatre ordres d’architecture : les deux étages supérieurs sont formés de demi-colonnes et de pilastres corinthiens ; l’ordre du rez-de-chaussée est dorique, et celui du second étage ionique. Les trois premiers ordres se dessinent par des colonnes à demi engagées dans le mur, comme au nouveau théâtre de la rue Vencadour.
Le monde n’a rien vu d’aussi magnifique que ce monument : sa hauteur totale est de cinquante-sept pieds, et sa circonférence extérieure de mille six cent quarante et un. L’arène où combattaient les gladiateurs a deux cent quatre-vingt-cinq pieds de long sur cent quatre-vingt-deux de large. Lors de la dédicace du Colysée par Titus, le peuple romain eut le plaisir de voir mourir cinq mille lions, tigres et autres bêtes féroces, et près de trois mille gladiateurs. Les jeux durèrent cent jours.
L’empereur Vespasien commença ce théâtre à son retour de Judée ; il y employa douze mille Juifs, prisonniers de guerre ; mais il ne put le finir ; cette gloire était réservée à Titus, son fils, qui en fit la dédicace l’an 80 après Jésus-Christ (1).
Quatre cent quarante-six ans plus tard, c’est-à-dire l’an 526 de notre ère, les Barbares de Totila en ruinèrent diverses parties, afin de s’emparer des crampons de bronze qui liaient les pierres. Tous les blocs du Colysée sont percés de grands trous. J’avouerai que je trouve inexplicables plusieurs travaux exécutés par les Barbares, et que l’on dit avoir eu pour objet d’aller fouiller dans les masses énormes qui forment le Colysée. Après Totila, cet édifice devint comme une carrière publique, où, pendant dix siècles, les riches Romains faisaient prendre des pierres pour bâtir leurs maisons, qui, au moyen âge, étaient des forteresses. Encore en 1623, les Barberini, neveux d’Urbain VIII, en tirèrent tous les matériaux de leur immense palais. De là le proverbe :
Quod non fecerunt barbari fecere Barberini.
17 août 1827.
Une fois, vers la fin du moyen âge (1377). Rome a été réduite à une population de trente mille habitants ; M. le cardinal Spina disait douze mille ; maintenant elle en a cent quarante mille. Si les papes ne fussent pas revenus d'Avignon, si la Rome des prêtres n’eût pas été bâtie aux dépens de la Rome antique, nous aurions beaucoup plus de monuments des Romains ; mais la religion chrétienne n’eût pas fait une alliance aussi intime avec le beau ; nous ne verrions aujourd’hui ni Saint-Pierre, ni tant d’églises magnifiques répandues dans toute la terre : Saint-Paul de Londres, Sainte Geneviève, etc. Nous-mêmes, fils de chrétiens , nous serions moins sensibles au beau. A six ans peut-être vous avez entendu parler avec admiration de Saint-Pierre de Rome.
Les papes devinrent amoureux de l'architecture, cet art éternel qui se marie si bien à la religion de la terreur ; mais, grâce aux monuments romains, ils ne s’en tinrent pas au gothique. Ce fut une infidélité à l’enfer. Les papes, dans leur jeunesse, avant de monter sur le trône, admiraient les restes de l’antiquité. Bramante inventa l’architecture chrétienne : Nicolas V, Jules II, Léon X, furent des hommes dignes d’être émus par les ruines du Colysée et par la coupole de Saint-Pierre.
Lorsqu’il travaillait à cette église, Michel-Ange, déjà trés vieux, fut trouvé, un jour d’hiver, après la chute d’une grande quantité de neige, errant au milieu des ruines du Colysée. Il
venait monter son âme au ton qu’il fallait pour pouvoir sentir les beautés et les défauts de son propre dessin de la coupole de Saint-Pierre. Tel est l’empire de la beauté sublime ; un théâtre donne des idées pour une église.
Dès que d’autres curieux arrivent au Colysée, le plaisir du voyageur s’éclipse presque en entier. Au lieu de se perdre dans des rêveries sublimes et attachantes, malgré lui il observe les ridicules des nouveaux venus, et il lui semble toujours qu’ils en ont beaucoup. La vie est ravalée à ce qu ‘elle est dans un salon : on êcoute malgré soi les pauvretés qu’ils disent. Si j’avais le pouvoir, je serais tyran, je ferais fermer le Colysée durant mes séjours à Rome.
18 août 1827.
L’opinion commune est que Vespasien fit construire le Colysée dans l’endroit où étaient auparavant les étangs et les jardins le Néron ; c’était à peu près le centre de la Rome de César et de Cicéron. La statue colossale de Néron, en marbre de cent dix pieds, fut placée près de ce théâtre ; de là le nom de Colosseo, D’autres prétendent que cette dénomination vient de l’étendue surprenante et de la hauteur colossale de cet édifice.
Comme nous, les Romains avaient l'usage de célébrer par une fête l’ouverture d’une maison nouvelle ; un drame, représenté avec une pompe extraordinaire, faisait la dédicace d'un théâtre ; celle d’une naumachie était célébrée par un combat de barques ; des courses de chars, et surtout des combats de gladiateurs, marquaient l’ouverture dun cirque ; des chasses de bêtes féroces faisaient la dédicace d’un amphithéâtre. Titus, comme nous l’avons vu, fit paraître, le jour de l’ouverture du Colysée, un nombre énorme d’animaux féroces qui tous furent tués (2). Quel doux plaisir pour des Romains ! Si nous ne sentons plus ce plaisir, c’est à la religion de Jésus Christ qu’il en faut rendre grâce.
Le Colysée est bâti presque en entier de blocs de travertin, assez vilaine pierre remplie de trous comme le tuf, et d’un blanc tirant sur le jaune. On la fait venir de Tivoli. L’aspect de tous les monuments de Rome serait bien plus agréable au premier coup d’œil si les architectes avaient eu à leur disposition la belle pierre de taille employée à Lyon ou à Édimbourg, ou bien le marbre dont on a fait le cirque de Pola (Dalmatie).
On voit des numéros antiques au-dessus des arcs d’ordre dorique rlu Colysée : chacune de ces arcades servait de porte. De nombreux escaliers conduisaient aux portiques supérieurs et aux gradins. Ainsi, en peu d’instants, cent mille spectateurs pouvaient entrer au Colysée et en sortir.
On dit que Titus fit construire une galerie qui partait de son palais sur le mont Esquilin, et lui permettait de venir au Colysée sans paraître dans les rues de Rome. Elle devait aboutir entre les deux arcs marqués des numéros 38 et 39. Là on remarque un arc qui n’est pas numéroté. (Voir Fontana, Neralco et Marangonius.)
L’architecte qui a bâti le Colysée a osé être simple. Il s’est donné garde de le surcharger de petits ornements jolis et mesquins, tels que ceux qui gâtent l’intérieur de la cour du Louvre. Le goût public à Rome n’était point vicié par l’habitude des fêtes et des des cérémonies d’une cour comme celle de Louis XIV. (Voir les Mémoires de Dangeau.) Un roi devant agir sur la vanité est obligé d’inventer des distinctions et de les changer souvent. Voir les fracs de Marly, inventés par Louis XIV. (SAINT-SIMON.).
Les empereurs de Rome avaient eu l’idée simple de réunir en leur personne toutes les magistratures inventées par la république à mesure des besoins des temps. Ils étaient consuls, tribuns, etc. - Ici tout est simplicité et solidité ; c’est pour cela que les joints des immenses blocs de travertin qu’on aperçoit de toutes parts prennent un caractère étonnant de grandiose. Le spectateur doit cette sensation, qui s’accroît encore par le souvenir, à l’absence de tout petit ornement ; l’attention est laissée à la masse d’un si magnifique édifice. La place où l’on donnait les jeux et les spectacles s’appelait arène (arena), à cause du sable qui était répandu sur le sol, les jours où les jeux devaient avoir lieu. On prétend que cette arène était anciennement olus basse de dix pieds qu’elle ne l'est aujourd’hui. Elle était entourée d’un mur assez élevé pour empêcher les lions et les tigres de s’élancer sur les spectateurs. C’est ce qu’on voit encore dans les théâtres en bois, destinés, en Espagne, aux combats de taureaux. Ce mur était percé d’ouvertures fermées par des grilles de fer. C’est par là qu’entraient les gladiateurs et les bêtes féroces, et que l'on emportait les cadavres.
La place d’honneur, parmi les Romains, était au-dessus du mur qui entourait l’arène, et s’appelait podium ; de là on pouvait jouir de la physionomie des gladiateurs mourants, et distinguer les moindres détails du combat. Là se trouvaient es sièges réservés aux vestales, à l'empereur et à sa famille, aux sênateurs et aux principaux magistrats.
Derrière le podium commençaient les gradins destinés au peuple ; ces gradins étaient divisés en trois ordres appelés meniana, La première division renfermait douze gradins, et la seconde quinze ; ils étaient en marbre. Les gradins de la troisième division étaient, à ce qu’on croit, construits en bois. Il y eut un incendie, et cette partie du théâtre fut restaurée par Héliogabale et Alexandre. La totalité des gradins pouvait contenir quatre-vingt-sept mille spectateurs, et on estime que vingt mille se plaçaient debout dans les portiques de la partie supérieure, bâtis en bois.
On distingue, au-dessus des fenêtres de l’étage le plus élevé, des trous dans lesquels on suppose que s’enchâssaient les poutres du velarium. Elles supportaient des poulies et des cordes, à l’aide desquelles on manœuvrait une suite d’immenses bandes de toile qui couvraient l’amphithéâtre et devaient garantir les spectateurs de l’ardeur du soleil. Quant à la pluie, je ne conçois pas trop comment ces tentes pouvaient mettre à l’abri de ces pluies battantes que l’on éprouve à Rome.
Il faut chercher dans l’Orient, parmi les ruines de Palmyre, de Balbec ou de Pétra, des édifices comparables à celui-ci pour la grandeur ; mais ces temples étonnent sans plaire. Plus vastes que le Colysée, ils ne produiront jamais sur nous la même lmpression. Ils sont construits d’après d’autres règles de beauté, auxquelles nous ne sommes point accoutumés. Les civilisations qui ont créé cette beauté ont disparu.
Ces grands temples élevés et creusés dans l’Inde ou en Égypte ne rappe!lent que les souvenirs ignobles du despotisme ; ils n’étaient pas destinés à plaire à des âmes généreuses.
Dix mille esclaves ou cent mille esclaves ont péri de fatigue, tandis qu’on les occupait à ces travaux êtonnants.
A mesure que nous connaîtrons mieux l’histoire ancienne, que de rois ne trouverons-nous pas plus puissants qu’Agamemnon, que de guerriers aussi braves qu’Achille ! mais ces noms nouveaux seront pour nous sans émotions. On lit les curieux Mémoires de Bober, empereur d’Orient vers 1340. Après y avoir songé un instant, on pense à autre chose.
Le Colysée est sublime pour nous, parce que c’est un vestige vivant de ces Romains dont l’histoire a occupé toute notre enfance. L’âme trouve des rapports entre la grandeur de leurs entreprises et celle de cet édifice. Quel lieu sur la terre vit une fois une aussi grande multitude et de telles pompes ? L’empereur du monde (et cet homme était Titus !) y était reçu par les cris de joie de cent mille spectateurs ; et maintenant quel silence !
Lorsque les empereurs essayèrent de lutter avec la nouvelle religion prêchée par saint Paul, qui annonçait aux esclaves et aux pauvres l’égalité devant Dieu, ils envoyèrent au Colysée beaucoup de chrétiens souffrir le martyre. Cet édifice fut donc en grande vénération dans le moyen âge ; c’est pour cela qu’il n’a pas été tout à fait détruit. Benoît XIV, voulant ôter tout prétexte aux grands seigneurs qui, depuis des siècles, y envoyaient prendre des pierres comme dans une carrière, fit ériger autour de l’arène quatorze petits oratoires, chacun desquels contient une fresque exprimant un trait de la Passion du Sauveur. Vers la partie orientale, dans un coin des ruines, on a établi une chapelle où l’on dit la messe ; à côté, une porte fermée à clef indique l’entrée de l’escalier de bois par lequel on monte aux étages supérieurs.
En sortant du Colysée par la porte orientale, vers Saint-Jean-de-Latran, on trouve un petit corps de garde de quatre hommes, et l’immense arcboutant de briques, élevé par Pie VII, pour soutenir cette partie de la façade extérieure prête à s’écrouler.
Je parlerai dans la suite, quand le lecteur aura du goüt pour ces sortes de choses, des conjectures proposées par les savants à propos des constructions trouvées au-dessous du niveau actuel de l’arène du Colysèe, lors des fouilles exécutées par les ordres de Napoléon (1810 à 1814).
J’invite d’avance le lecteur à ne croire en ce genre que ce qui lui semblera prouvé, cela importe à ses plaisirs ; on ne se fait pas l’idée de la présomption des ciceroni romains.
ROME, 18 août 1827.
Que de matinées heureuses j’ai passées au Colysée, perdu dans quelque coin de ces ruines immenses ! Des étages supérieurs on voit en bas, dans l’arène, les galériens du pape travailler en chantant. Le bruit de leurs chaînes se mêle au chant des oiseaux, tranquilles habitants du Colysée. Ils s’envolent par centaines quand on approche des broussailles qui couvrent les sièges les plus élevés où se plaçait jadis le peuple roi. Ce gazouillement paisible des oiseaux, qui retentit faiblement dans ce vaste édifice, et de temps à autre, le profond silence qui lui succède, aident sans doute l’imagination à s’envoler dans les temps anciens. On arrive aux plus vives jouissances que la mémoire puisse procurer.
Cette rêverie, que je vante au lecteur, et qui peut-être lui semblera ridicule.
C’est le sombre plaisir d’un cœur mélancoiique.
LA FONTAINE.
A vrai dire, voilà le seul grand plaisir que l’on trouve à Rome. Il est impossible pour la première jeuesse, si folle d’espérances. Si, plus heureux que les écoliers de la fin du dernier siècle, le lecteur n’a pas appris le latin péniblement durant la première enfance, son âme sera peut-être moins préoccupée des Romains et de ce qu’ils ont fait sur la Terre. Pour nous, qui avons traduit pendant des années des morceaux de Tite-Live et de Florus, leur souvenir précède toute expérience. Florus et Tite-Live nous ont raconté des batailles célèbres, et à huit ans quelle idée ne se fait-on pas d’une bataille ! C'est alors que l’imagination est fantastique, et les images qu’elle trace, immenses. Aucune froide expêrience ne vient en rogner les contours.
Depuis les imaginations de la première enfance, je n’ai trouvé de sensation analogue, par son immensité et sa ténacité, qui triomphe de tous les autres souvenirs, que dans les poèmes de lord Byron. Comme je le lui disais un jour à Venise, en citant le Giaour, il me répondit : « C’est pour cela que vous y voyez des lignes de points. Dès que l’expérience des temps raisonnables de la vie peut attaquer une de mes images, je l’abandonne, je ne veux pas que le lecteur trouve chez moi les mêmes sensations qu’à la Bourse. Mais vous, Français, êtres légers, vous devez à cette disposition, mère de vos défauts et de vos vertus, de retrouver quelquefois le bonheur facile de l’enfance. En Angleterre, la hideuse nécessité du travail apparaît de toutes parts. Dès son entrée dans la vie, le jeune homme, au lieu de lire les poètes ou d’écouter la musique de Mozart, entend la voix de la triste expérience qui lui crie : Travaille dix-huit heures par jour, ou après demain tu expireras de faim dans la rue ! Il faut donc que les images du
Giaour puissent braver l’expérience et le souvenir des réalités de la vie. Pendant qu’il lit, le lecteur habite un autre univers ; c’est le bonheur des peupIes malheureux... Mais vous, Français, gais comme des enfants, je m’étonne que vous soyez sensibles à ce genre de mérite. Trouvez-vous réellement beau autre chose que ce qui est à la mode ? Mes vers sont à la mode parmi vous, et vous les trouverez ridicules dans vingt ans. J’aurai le sort de l’abbé Delille. »
Je ne prétends nullement que ce soient là les paroles expresses du grand poète qui me parlait, pendant que sa gondole le conduisait de la Piazzetta au Lido.
La phrase qu’on vient de lire est la dernière précaution que je prendrai contre la petite critique de mauvaise foi.
Je me souviens que j’eus la hardiesse de lui faire de la morale :
« Quand on est si aimable que vous, comment peut-on acheter l’amour ? »
Cette rêverie de Rome, qui nous semble si douce et nous fait oublier tous les intérêts de la vie active, nous la trouvons également au Colysée ou à Saint-Pierre, suivant que nos âmes sont disposées. Pour moi, quand j’y suis plongé, il est des jours où l’on m’annoncerait que je suis roi de la terre, que je ne daignerais pas me lever pour aller jouir du trône ; je renverrais à un autre moment.
SAINT-PIERRE
ROME, 24 novembre 1827.