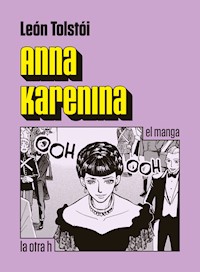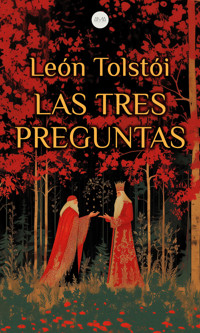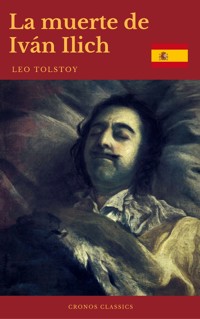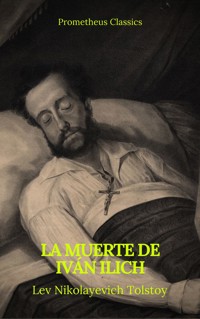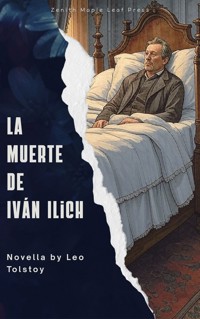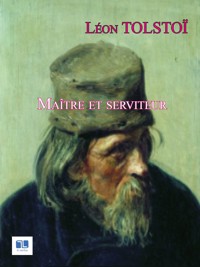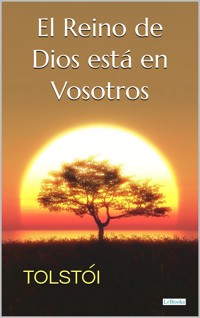6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Dans "Qu'est-ce que l'art?", Léon Tolstoï explore les fondements et les implications de l'art dans la société. Ce texte, rédigé à la fin du XIXe siècle, interroge la nature de l'art et son rôle dans l'évolution culturelle et morale de l'humanité. Tolstoï critique l'art élitiste et inaccessible, prônant un art qui soit compréhensible et bénéfique pour tous. Il considère que l'art doit transmettre des émotions authentiques et contribuer au progrès éthique de l'humanité. L'auteur s'oppose fermement à l'art pour l'art, qu'il juge déconnecté des véritables besoins humains. Dans son analyse, Tolstoï examine également les critères de jugement de l'art, remettant en question les standards esthétiques établis. Il propose une vision où l'art est un moyen puissant de communication et de cohésion sociale, capable de transcender les barrières culturelles et linguistiques. Ce livre demeure une réflexion profonde sur la fonction de l'art et son potentiel à transformer la société. Frédéric Gimello-Mesplomb et Théodore de Wyzewa apportent leur éclairage sur cette oeuvre, enrichissant le débat sur la réception artistique. Léon Tolstoï, né le 9 septembre 1828 à Iasnaïa Poliana, en Russie, est l'un des écrivains les plus influents de la littérature mondiale. Issu d'une famille noble, il connaît une enfance marquée par la perte de ses parents. Tolstoï s'engage dans l'armée avant de se consacrer entièrement à l'écriture. Ses oeuvres majeures, telles que "Guerre et Paix" et "Anna Karénine", sont célébrées pour leur profondeur psychologique et leur exploration des dilemmes moraux. Tolstoï est également connu pour ses essais philosophiques et ses réflexions sur la religion, la morale et la société. Sa quête de vérité et de justice sociale l'amène à critiquer les institutions et à prôner un retour à une vie simple et spirituelle. Vers la fin de sa vie, Tolstoï adopte des positions pacifistes et anarchistes, influençant de nombreux penseurs et activistes. Frédéric Gimello-Mesplomb et Théodore de Wyzewa, spécialistes de la réception artistique, ont contribué à la diffusion et à l'analyse de ses idées, enrichissant la compréhension de son oeuvre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
à Linda Idjeraoui-Ravez
L’art est un mensonge qui nous fait entrevoir la vérité.
— Pablo Picasso
Table des matières
Introduction de Frédéric Gimello-Mesplomb (2021)
Avant-propos de Théodore de Wyzewa (1898)
Introduction de Léon Tolstoï (1898)
LE PROBLÈME DE L’ART
LA BEAUTÉ
DISTINCTION DE l’ART ET DE LA BEAUTÉ
LE RÔLE PROPRE DE L’ART
L’ART VÉRITABLE
LE FAUX ART
L’ART DE L’ÉLITE
LES CONSÉQUENCES DE LA PERVERSION DE l’ART :
LES CONSÉQUENCES DE LA PERVERSION DE L’ART : LA RECHERCHE
LES CONSÉQUENCES DE LA PERVERSION DE l’ART : LA CONTREFAÇON
L’ART PROFESSIONNEL, LA CRITIQUE, L’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
L’OEUVRE DE WAGNER, MODÈLE PARFAIT DE LA CONTREFAÇON DE
DIFFICULTÉ DE DISTINGUER L’ART VÉRITABLE DE SA CONTREFAÇON
LA CONTAGION ARTISTIQUE, CRITÉRIUM DE L’ART VÉRITABLE
LE BON ET LE MAUVAIS ART
LES SUITES DU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE L’ART
POSSIBILITÉ D’UNE RÉNOVATION ARTISTIQUE
CE QUE DEVRA ÊTRE l’ART DE L’AVENIR
Conclusion
Introduction de Frédéric Gimello-Mesplomb (2021)
Au soir de sa vie, on doit à Léon Tolstoï (1828 – 1910) quelques textes courts et relativement peu connus mais qui nous renseignent sur la fascination tardive du célèbre auteur et moraliste russe pour l’ontologie du rapport à l’art et à la foi. Ce thème taraudait l’auteur de Guerre et Paix et d’Anna Karénine au point qu’il coucha sur le papier le fruit de ses réflexions. En 1906 paraissent dans son ouvrage La Foi universelle deux chapitres distincts intitulés « Qu’est-ce que la religion ? » (pp. 155-254 de l’édition originale de 1906) et « Qu’est-ce que l’Évangile ? » (pp. 49-139). Mais ceux-ci ont été précédés, en 1898, d’un essai du même acabit sobrement intitulé Qu’est-ce que l’art ? que nous livrons aujourd’hui dans une nouvelle édition augmentée de deux préfaces dont celle de Teodor de Wyzewa, l’éditeur de sa première édition française.
Alors que la réflexion de Tolstoï sur l’appréciation artistique telle que les intellectuels tentent de d’analyser (et de la définir) à la fin du XIXe siècle tombera progressivement dans l’oubli dans les décennies qui suivront, elle emporte pourtant l’adhésion des cercles et salons parisiens dès l’année de sa parution française et une réédition est même effectuée en urgence ce qui – fait notable – porte à deux les éditions et traductions distinctes pour la seule année 1898. Elles sont assurées, l’une par Teodor de Wyzewa pour le compte des éditions Perrin, et l’autre par Ilia Halpérine-Kaminski (Ollendorff).
Nous retrouvons dans cet opuscule devenu rare les mêmes traits caractéristiques qui fleuriront plus tard, dans La Foi universelle, à savoir une critique des impostures doctrinales et du pouvoir des institutions cléricales, mais aussi la critique socialiste et morale (courante fin XIXe chez les intellectuels européens) de ce que l’on nommera plus tard le syndrome de « l’art pour l’art ». Nous y reviendrons.
Enfin, et de manière encore plus surprenante, Qu’est-ce que l’art ? nous propose un point de vue argumenté sur le consumérisme artistique des classes bourgeoises. Cet intérêt pour l’analyse de l’appréciation artistique n’est pas totalement nouveau en cette fin du XIXe siècle. N’oublions pas que de l’autre côté de l’Atlantique, au même moment, l’américain Veblen est en train de mettre le point final à sa célèbre Théorie de la classe de loisir qui paraîtra l’année suivante, en 1899, et dans laquelle Veblen analyse le capitalisme non pas sous le prisme de la production, comme a pu le faire Marx, mais sous celui de la consommation, s’arrêtant sur les classes supérieures, cible de nos deux auteurs et, plus tard, de leurs célèbres continuateurs Edmond Goblot (La barrière et le niveau, 1925) et Pierre Bourdieu (La distinction, 1976).
Contrairement à d’autres études contemporaines de la parution de cet ouvrage, Tolstoï a cherché à circonscrire le sens de l’art dans le monde social (et dans les classes sociales) et non à en étudier simplement ou mécaniquement ses seuls « effets » sur les individus. Aussi, ses réflexions sur le « beau » en art sont, à cet égard, d’ordre précurseur.
Faire la généalogie intellectuelle de cette entreprise de déconstruction de l’appréciation artistique dans le cadre de l’étude des pratiques culturelles et, singulièrement, de la fréquentation muséale, s’avère d’un intérêt crucial pour qui s’intéresse un tant soit peu à la sociologie historique des pratiques culturelles. En effet, les similarités entre les positions défendues par Veblen et celles - dans un autre registre - de Tolstoï, méritent de s’y arrêter. Tandis que Tolstoï éreinte le pouvoir des penseurs (et censeurs) doctrinaux, Veblen analyse quant à lui les moeurs de la classe dominante, qu’il nomme « classe de loisir », pour qualifier une classe à l’abri du besoin matériel et intellectuel. C’est l’angle du loisir que Veblen privilégie, ouvrant en cela la porte à la sociologie des loisirs américano-canadienne des cinquante années suivantes. Or, pour Tolstoï, nuance de taille, le musée n’est en rien un lieu de loisir. On rentre dans un musée comme l’on rentre en communion avec les oeuvres, dans le silence d’une cathédrale. L’art « vrai » est le moyen suprême d’atteindre la jouissance esthétique. Or, tant chez Tolstoï que chez son contemporain Veblen, on observe que les classes dominantes sont pourtant mues par une constante recherche de distinction, à travers des actes socialement valorisés, parmi lesquels nous retrouvons l’appréciation esthétique (se doter d’un point de vue sur l’art) et la fréquentation artistique (se rendre sur le lieu où se trouve l’art). Nourrie de convictions sur la valeur des objets artistiques, la classe de loisir cherche à montrer aux autres qu’elle est en capacité d’utiliser son temps libre pour le travail « non-essentiel » qu’est celui de la fréquentation des lieux d’art.
La mouvance des recherches sur le consumérisme artistique connaîtra son apogée dans la décennie suivante avec la publication de nombreux travaux dits de « sociologie industrielle » consacrés à la consommation culturelle des ouvriers (citons, entr’autres, la thèse de doctorat qu’Emilie Kiep-Altenloh (1888-1985) soutiendra en 1913 sous la direction d’Alfred Weber - le frère de Max -, sur la sociologie des publics du cinéma dans la banlieue ouvrière de Mannheim).
En dépit d’une écriture qui peut paraître un peu datée, Qu’est-ce que l’art? pose finalement des questions de phénoménologie de la réception encore très actuelles. Ses questions sur les mystères de l’appréciation artistique ne sont, certes, pas très éloignées de celles que Tolstoï posera plus tard sur la foi (ici évoquée de manière allégorique par la « beauté ») qui transcende chaque individu passant la porte d’un musée comme l’on passe le porche d’une église. L’art doit il être « beau » ? Comment comprendre l’art sans croire en la beauté ? Comment formuler une théorie de l’art sans produite une énième théorie de la beauté ? Autant de questions auxquelles les écrivains contemporains de Tolstoï se risqueront aussi. Au moment où le livre de Tolstoï sort, le mouvement de « L’Art pour l’art » est un slogan qui connaît une certaine actualité en énonçant que la valeur intrinsèque de l’art est (et doit être) dépourvue de toute fonction didactique, morale ou utile. Les oeuvres autotéliques, entreprises sans autre but qu’elles-mêmes, anticipent ce que sera plus tard le surréalisme et le dadaïsme. Tolstoï, à travers cet ouvrage, nous montre que l’écrivain russe milite clairement pour la fonction « utilitariste » de l’art, rejoignant en cela une George Sand pour qui « l’art pour l’art est un vain mot. L’art pour le beau et le bon, voilà la religion que je cherche…» (George Sand, Correspondance 1812-1876).
Enfin, il n’est pas inintéressant de s’arrêter au cours de cette courte présentation sur la figure du traducteur de cet ouvrage, le critique français d’origine polonaise Teodor de Wyzewa (1862-1917), l’un des principaux promoteurs du mouvement symboliste en France. De 1885 à 1888, de Wyzewa écrit régulièrement dans la Revue Wagnérienne de Édouard Dujardin plusieurs textes qui donnent à lire un point de vue très voisin de celui de Tolstoï sur les publics guindés des grandes salles européennes d’opéra et de spectacles lyriques. Auteur d’une bibliographie abondante sur les grands peintres et compositeurs, et traducteur réputé de l’allemand, de l’anglais, du russe, et du polonais, Teodor de Wyzewa sera l’un des critiques musicaux et littéraires les plus cités, mais aussi les plus sévères, de la Revue des deux Mondes, puis du Figaro.
Dans Qu’est-ce que l’art, Tolstoï cherche à promouvoir un christianisme social, condamnant les institutions intellectuelles et artistiques modernes. L’art n’échappe pas aux tirs croisés de Tolstoï et Wyzewa lorsqu’il est employé par ces institutions à des fins de domination. Que l’on ne s’y trompe pas, c’est l’art bourgeois, l’art dominant qui est si sévèrement critiqué ici, l’art comme moyen et outil d’asservissement des classes inférieures, l’art instrumentalisé par le monde bourgeois. Tolstoï défend l’idée que l’acte qui consiste à poser un jugement sur une oeuvre d’art s’appuie avant tout sur le plaisir que cette dernière procure à celui qui l’admire, notamment en raison de sa « beauté ». Le jugement esthétique découle, par conséquent, d’un plaisir éprouvé devant des oeuvres d’art communément admises comme « belles». Or, nul besoin d’appartenir à la classe dominante pour en faire l’expérience. Cette expérience du beau est ouverte à tous. Le principal reproche que fait donc Tolstoï à la bourgeoisie, c’est avant tout d’avoir perdu les valeurs du christianisme véritable, fait d’humilité et de partage, en « confisquant » le bénéfice de l’expérience esthétique à son seul compte et pour son seul plaisir. Cette appropriation, pour ne pas dire cette confiscation du patrimoine artistique pose question pour Tolstoï. Et c’est cette question qu’il développe en idée originale, martelée dans les trois derniers chapitres de cet ouvrage. En effet, si une forme d’art est rendue inaccessible au plus grand nombre, elle devient immédiatement dénuée d’universalité et donc de légitimité. Comment alors définir un « bon art », un art qui n’aurait pas comme seule finalité la promotion de la beauté mais des valeurs universelles telle que la communion entre individus? Tolstoï le voit dans l’art de demain, celui qui « aura pour objet de manifester la plus haute conscience religieuse des générations futures » et sera un moyen de transmission des sentiments parmi les hommes.
Avec Qu’est-ce que l’art ?, Tolstoï ouvre finalement une voie assez radicale pour redéfinir le concept d’art, voie à laquelle une frange non négligeable des intellectuels français n’est alors pas insensible dans cette toute fin du xixe siècle où les tenants de « l’art pour l’art » occupent, aux cotés des auteurs de manifestes futuristes, l’avant-scène du débat intellectuel.
On l’aura compris, ce livre oublié de Léon Tolstoï ne mérite pas d’être relégué au rang de ces oeuvres mineures d’ intellectuels se penchant avec complaisance le champ artistique. Présenté à raison par Michel Meyer dans sa rééditions aux PUF comme un « texte précurseur de l’esthétique moderne », il a pour principale vertu de reposer la question, d’une actualité toujours brûlante, de la fonction utilitaire de l’art et de ses intermédiations.
Frédéric Gimello-Mesplomb
Avignon Université, mai 2021
Avant-propos de Théodore de Wyzewa (1898)
L’étude qu’on va lire a été publiée, en russe, dans les deux dernières livraisons d’une revue de Moscou, les Questions de Philosophie et de Psychologie. C’est pour l’écrire que, nous dit-on, le comte Tolstoï a interrompu un roman qu’il avait commencé, et dont sans doute il avait rêvé de faire un modèle de « l’art chrétien », tel que, suivant lui, il doit être désormais. Aura-t-il jugé que, pour nous donner le goût de cet art, une définition théorique valait mieux que tous les modèles ? ou bien un art aussi nouveau, aussi différent de nos « contrefaçons » d’à présent, lui aura-t-il paru plus facile à définir qu’à produire ? Il se trompe en tout cas s’il croit, comme on nous l’a dit encore, que sa peine à finir le roman ébauché provient surtout de son grand âge, et de l’affaiblissement de ses facultés créatrices; car son étude sur l’art nous prouve assez que jamais sa pensée n’a été plus lucide, son imagination plus fraîche, son éloquence à la fois plus hardie et plus vive. De tous les livres qu’il a écrits depuis dix ans, celui-ci est certainement le plus artistique. Une même idée s’y poursuit du début à la fin, avec un ordre, une rigueur, une précision admirables ; et ce sont, à tous les chapitres, des développements imprévus, des comparaisons, des exemples, des souvenirs et des anecdotes, tout un appareil d’artifices ingénieusement combinés pour saisir et pour retenir la curiosité du lecteur. À soixante-dix ans, pour ses débuts dans le genre de la philosophie de l’art, le comte Tolstoï nous offre le meilleur livre que nous ayons dans ce genre ; et, en vérité, ce n’est pas beaucoup dire ; mais tout le monde assurément s’accordera à le dire.
Tout au plus pourra-t-on s’étonner que, après avoir si clairement démontré l’absurdité des innombrables tentatives faites, jusqu’ici, pour analyser l’art et la beauté, il ait eu le courage de refaire, lui-même, une tentative pareille, et de vouloir expliquer, une fois de plus, des choses qui avaient tant de chances d’être inexplicables. Strictement déduite de sa définition de l’art, la doctrine qu’il nous expose est un monument de construction logique : à cela près qu’elle est simple, variée, vivante, et agréable à lire, je ne vois aucune raison pour ne pas l’admirer à l’égal de l’immortel jeu de patience métaphysique de Baruch Spinoza. Mais la définition d’où elle découle, cette conception de l’art comme « le moyen de transmission des sentiments parmi les hommes », n’at-il pas craint qu’à son tour elle ne parût ou incomplète, ou excessive, ou trop matérielle, ou trop « mystique », de même que ces définitions antérieures dont personne mieux que lui ne nous a montré le néant ? Le spectacle de l’immense champ de ruines qu’est l’esthétique, passée et présente, ne lui a-t-il pas inspiré un doute touchant la possibilité de rien bâtir de solide sur un terrain aussi mouvant, aussi réfractaire aux efforts de notre logique ? Ne s’est-il pas dit que puisque Baumgarten, Kant, Fichte, Hegel, Schopenhauer, et Schiller, et Goethe, et Darwin, et Renan, et Wagner avaient échoué à découvrir même l’ombre d’une définition raisonnable de l’art, leur échec provenait peut-être, non de leur inintelligence, mais, au contraire, de ce que l’art et la beauté sont choses où l’intelligence ne peut rien faire que déraisonner ? Ne s’est-il pas dit que l’art, ayant pour seul objet de transmettre des sentiments, pouvait n’être accessible qu’aux seuls sentiments ? et qu’à vouloir discuter les rapports de l’art avec la beauté on risquait d’entrechoquer dans les nuages deux formules vaines, tandis qu’il y avait sur la terre tant d’oeuvres d’art, bonnes et belles, qui ne demandaient qu’à être goûtées en silence ? Non, évidemment, il ne s’est rien dit de tout cela, puisque le voici qui nous apporte un nouveau système d’esthétique : mais comment ne pas s’étonner de son courage ? et comment ne pas trembler pour l’avenir de son système ?
Dieu me garde, après cela, de paraître vouloir faire un reproche au comte Tolstoï ! C’est dans l’intérêt même de sa thèse que je regrette qu’il l’ait présentée sous cette forme systématique, dans l’intérêt de tant de réflexions ingénieuses et profondes qui remplissent son livre, et qui peut-être auraient eu plus d’effet s’il ne les avait réduites à être les corollaires d’une définition émise à priori. Jamais plus haute voix n’a protesté avec plus de force contre le honteux abaissement de l’art contemporain. La perte définitive de tout idéal, l’appauvrissement de la matière artistique, la recherche de l’obscurité et de la bizarrerie, l’alliance, tous les jours plus étroite, du mauvais goût et de l’immoralité, et la substitution croissante, à l’art sincère et touchant, de mille contrefaçons, hélas ! pas même habiles : tout cela n’est pas affaire de raisonnement logique, mais d’observation immédiate et constante ; et jamais tout cela n’a été observé avec plus de justesse, ni étalé à nos yeux d’une touche plus ferme, que dans ce livre où l’auteur de La Guerre et la Paix et de la Mort d’Ivan Iliitch a résumé l’expérience, non seulement, comme il le dit, des quinze dernières années, mais d’une longue vie toute employée au service de l’art. Pourquoi donc faut-il que, pour nous entendre avec lui sur tout cela, nous soyons forcés d’admettre, du même coup, que l’art consiste « à faire passer les conceptions religieuses du domaine de la raison dans celui du sentiment », qu’il est essentiellement distinct de la beauté, et que toute oeuvre d’art doit émouvoir tous les hommes de la même façon ?
Et, à ce propos, il y a encore une objection que je ne puis m’empêcher de soumettre, bien respectueusement, au comte Tolstoï, comme aussi aux lecteurs français de son livre. Il nous dit lui-même que, pour universel que doive être l’art véritable, « le meilleur discours, prononcé en chinois, restera incompréhensible à qui ne sait pas le chinois ». Et il reconnaît ailleurs que la valeur artistique d’une oeuvre d’art ne consiste ni dans son fond, ni dans sa forme, mais dans une harmonie parfaite de la forme et du fond. Or, cela étant, j’ai la conviction que, si même je savais le chinois, la véritable valeur artistique d’un discours chinois me resterait incompréhensible. J’en comprendrais le fond, ou plutôt je croirais le comprendre ; mais ce fond ne pourrait être vraiment compris que dans son harmonie avec sa forme ; et cette harmonie m’échapperait toujours, parce que, n’étant pas chinois, ne sachant penser et sentir qu’en français, je serais hors d’état de comprendre la forme des phrases chinoises. Ceux-là seuls peuvent juger de la convenance mutuelle du fond et de la forme, dans une oeuvre de littérature, ceux-là seuls peuvent en apprécier la « valeur artistique », qui sont accoutumés non seulement à comprendre la langue où elle a été écrite, mais encore à penser, à sentir dans cette langue. Et je veux bien admettre que l’idéal de l’art soit d’être universelcomme nous l’affirme le comte Tolstoï : mais pour la littérature, en particulier, aussi longtemps que le volapük n’aura pas remplacé les langues des diverses nations, l’idéal d’une littérature universelle ne sera jamais qu’une généreuse chimère.
Ayons donc pleine confiance dans le jugement du comte Tolstoï sur les poèmes de Pouchkine, son compatriote ! Croyons-le, encore, quand il nous parle d’écrivains allemands, anglais, et scandinaves : il a les mêmes droits que nous à se tromper sur eux. Mais ne nous trompons pas avec lui sur des oeuvres françaises dont le vrai sens, forcément, lui échappe, comme il échappera toujours à quiconque n’a pas, dès l’enfance, l’habitude de penser et de sentir en français ! Je ne connais rien de plus ridicule que l’admiration des jeunes esthètes anglais ou allemands pour tel poète français, Verlaine, par exemple, ou Villiers de l’Isle-Adam. Ces poètes ne peuvent être compris qu’en France, et ceux qui les admirent à l’étranger les admirent sans pouvoir les comprendre. Mais il ne résulte pas de là, comme le croit le comte Tolstoï, qu’ils soient absolument incompréhensibles. Ils ne le sont que pour lui, comme pour nous Lermontof et Pouchkine. Ce sont des artistes : la valeur artistique de leurs oeuvres résulte de l’harmonie de la forme et du fond : et si lettré que soit un lecteur russe, si parfaite que soit sa connaissance de la langue française, la forme de cette langue lui échappe toujours.
Aussi ai-je pris la liberté de supprimer, dans la traduction de ce livre, un passage où sont cités comme étant « absolument incompréhensibles » deux poèmes en prose français, le Galant Tireur de Baudelaire, et le Phénomène Futur, de M. Mallarmé. Voici d’ailleurs ces deux poèmes en prose : on verra s’ils méritent le reproche que leur fait le comte Tolstoï.
LE GALANT TIREUR
Comme la voiture traversait le bois, il la fit arrêter dans le voisinage d’un tir, disant qu’il lui serait agréable de tirer quelques balles, pour tuer le Temps.
Tuer ce monstre-là, n’est-ce pas l’occupation la plus ordinaire et la plus légitime de chacun ? — Et il offrit galamment la main à sa chère, délicieuse, et exécrable femme, à cette mystérieuse femme à qui il doit tant de plaisir, tant de douleur, et peut-être aussi une grande partie de son génie.
Plusieurs balles frappèrent loin du but proposé ; l’une d’elles s’enfonça même dans le plafond, et comme la charmante créature riait follement, se moquant de la maladresse de son époux, celui-ci se tourna brusquement vers elle, et lui dit : « Observez cette poupée, là bas, à droite, qui porte le nez en l’air et qui a la mine si hautaine. Eh ! bien, cher ange, je me figure que c’est vous ! » Et il ferma les yeux et il lâcha la détente. La poupée fut nettement décapitée.
Alors, s’inclinant vers sa chère, sa délicieuse, son exécrable femme, son inévitable et impitoyable Muse, et lui baisant respectueusement la main, il ajouta :
« Ah ! mon cher ange, combien je vous remercie de mon adresse ! »
LE PHÉNOMÈNE FUTUR.
Un ciel pâle, sur le monde qui finit de décrépitude, va peut-être partir avec les nuages : les lambeaux de la pourpre usée des couchants déteignent dans une rivière, dormant à l’horizon submergé de rayons et d’eau. Les arbres s’ennuient et, sous leur feuillage blanchi (de la poussière du temps plutôt que celle des chemins), monte la maison en toile du Montreur de Choses Passées. Maint réverbère attend le crépuscule et ravive les visages d’une malheureuse foule, vaincue par la maladie immortelle et le péché des siècles, d’hommes près de leurs chétives complices, enceintes des fruits misérables avec lesquels périra la terre. Dans le silence inquiet de tous les yeux suppliant là-bas le soleil qui, sous l’eau, s’enfonce avec le désespoir d’un cri, voici le simple boniment : « Nulle enseigne ne vous régale du spectacle intérieur, car il n’est pas maintenant un peintre capable d’en donner une ombre triste. J’apporte, vivante (et préservée à travers les ans par la science souveraine), une Femme d’autrefois. Quelque folie, originelle et naïve, une extase d’or, — je ne sais quoi ! — par elle nommée sa chevelure se ploie avec la grâce des étoffes autour d’un visage qu’éclaire la nudité sanglante de ses lèvres. À la place du vêtement vain, elle a un corps ; et les yeux, — semblables aux pierres rares ! — ne voilent pas ce regard qui sort de sa chair heureuse : des seins levés comme s’ils étaient pleins d’un lait éternel, la pointe vers le ciel, les jambes lisses qui gardent le sel de la mer première. » Se rappelant leurs pauvres épouses, chauves, morbides et pleines d’horreur, les maris se pressent : elles aussi, par curiosité, mélancoliques, veulent voir.
Quand tous auront contemplé la noble créature, vestige de quelque époque déjà maudite, les uns indifférents , car ils n’auront pas eu la force de comprendre ; mais d’autres, navrés et la paupière humide de larmes résignées, se regarderont ; tandis que les poètes de ces temps, sentant se rallumer leurs yeux éteints, s’achemineront vers leur lampe, le cerveau ivre un instant d’une gloire confuse, hantés du Rythme, et dans l’oubli d’exister à une époque qui survit à la beauté.
Que les sentiments exprimés par ces deux poèmes soient mauvais, au sens où l’estime le comte Tolstoï, qu’ils ne soient ni chrétiens, ni universels, nous pouvons l’admettre, encore que les sentiments qu’exprime le Phénomène Futur ne soient pas sensiblement éloignés d’être tolstoïens, en dépit de l’apparence contraire, et que jamais un poète n’ait flétri en plus nobles images l’action dégradante, abrutissante, anti-artistique de notre soi-disant civilisation. Mais certes ce ne sont point là des oeuvres « absolument incompréhensibles ». Et si le comte Tolstoï avait été français, au lieu d’être russe, ce n’est point ces deux oeuvres qu’il aurait choisies comme exemples, pour nous prouver la justesse de ses observations sur le désarroi, la bassesse, et la fausseté de l’art contemporain. De meilleurs exemples, hélas ! ne lui auraient pas manqué.
Sa critique de l’art de Richard Wagner repose, elle aussi, sur une erreur de fait, également excusable, mais qui vaut également d’être rectifiée. Ce n’est que dans l’imagination des commentateurs wagnériens que Wagner a voulu « subordonner la musique à la poésie », ou même « faire marcher de pair la poésie et la musique ». Les observations que lui adresse, à ce sujet, le comte Tolstoï, lui-même n’a jamais cessé de les adresser à ceux qui, sous prétexte de donner à la musique une portée dramatique, l’abaissaient au rôle dégradant d’un trémolo de mélodrame. Ce qu’il rêvait de substituer à l’opéra, ce n’était pas la tragédie accompagnée de musique, mais un drame musical, un drame où tous les autres arts auraient précisément été « subordonnés » à la musique, pour permettre à celle-ci d’exprimer ce qu’elle seule est capable d’exprimer, les sentiments les plus profonds, les plus généraux, les plus humains de l’âme humaine. Loin d’estimer que la poésie, dans les opéras, tenait trop peu de place, il estimait, au contraire, qu’elle en tenait trop ; ce n’est pas à la poésie, mais à la musique, qu’il projetait de donner plus de développement ; et le drame musical tel qu’il le concevait ne procédait pas des oeuvres de Gluck, de Méhul et de Spontini, mais bien de Don Juan et des Noces de Figaro.
Son seul tort est de n’avoir pas su présenter sa doctrine sous une forme claire et précise, qui eût coupé court aux malentendus : tort déplorable, puisqu’il nous a valu toute la musique qu’on nous a infligée depuis vingt-cinq ans. Mais qu’on lise l’admirable résumé que vient de nous offrir de cette doctrine M. Chamberlain ; et l’on sera étonné de voir combien elle est simple et forte, et combien elle a d’analogie avec la nouvelle doctrine du comte Tolstoï. Pour Wagner aussi, il n’y a d’art véritable que l’art universel ; pour lui aussi notre art d’à présent est un art dégénéré ; et lui aussi assigne pour unique objet au bon art d’éveiller et d’entretenir, dans le coeur des hommes, les plus hauts sentiments de la conscience religieuse. Si le comte Tolstoï, au lien d’entendre massacrer à Moscou deux actes de Siegfried, avait pu entendre jouer Parsifal au théâtre de Bayreuth, peut-être se serait-il trouvé forcé de citer Wagner dans sa liste des quelques hommes qui ont tenté un art « chrétien supérieur ».
Et qu’après cela Wagner ait échoué dans sa tentative, que ses oeuvres ne soient encore que de géniales « contrefaçons de l’art », libre au comte Tolstoï de le penser, et de nous le dire. Wagner lui-même, j’imagine, n’a pas toujours été éloigné de le croire ; et c’est encore un trait de ressemblance entre ces deux grands hommes, puisqu’on va voir avec quelle admirable et touchante modestie l’auteur de Qu’est-ce que l’art ? proclame mauvaises, et indignes du nom d’art, les oeuvres immortelles qu’il nous a données.
T. W.
25 avril 1898.
Introduction de Léon Tolstoï (1898)
Ouvrez un journal quelconque : vous ne manquerez pas d’y trouver une ou deux colonnes consacrées au théâtre et la musique. Vous y trouverez aussi, au moins deux fois sur trois, le compte-rendu de quelque exposition artistique, la description d’un tableau, d’une statue, et aussi l’analyse de romans, de contes, de poèmes nouveaux.